SSLR Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
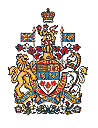
38e LÉGISLATURE, 1re SESSION
Sous-comité de l'examen des lois sur le racolage du Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile
TÉMOIGNAGES
TABLE DES MATIÈRES
Le lundi 18 avril 2005
| » | 1740 |
 |
Le président (M. John Maloney (Welland, Lib.)) |
 |
Mme Rose Dufour (chercheuse associée, Collectif de recherche sur l'itinérance, la pauvreté et l'exclusion sociale, Université du Québec à Montréal) |
| » | 1745 |
| » | 1750 |
| » | 1755 |
 |
Le président |
 |
M. Art Hanger (Calgary-Nord-Est, PCC) |
| ¼ | 1800 |
 |
Mme Rose Dufour |
 |
M. Art Hanger |
 |
Mme Rose Dufour |
 |
M. Art Hanger |
 |
Mme Rose Dufour |
| ¼ | 1805 |
 |
M. Art Hanger |
 |
Mme Rose Dufour |
 |
M. Art Hanger |
 |
Mme Rose Dufour |
 |
M. Art Hanger |
 |
Mme Rose Dufour |
 |
M. Art Hanger |
 |
Mme Rose Dufour |
 |
M. Art Hanger |
 |
Mme Rose Dufour |
 |
Le président |
 |
M. Réal Ménard (Hochelaga, BQ) |
 |
Mme Rose Dufour |
| ¼ | 1810 |
 |
M. Réal Ménard |
 |
Mme Rose Dufour |
 |
M. Réal Ménard |
 |
Mme Rose Dufour |
| ¼ | 1815 |
 |
M. Réal Ménard |
 |
Mme Rose Dufour |
 |
M. Réal Ménard |
 |
Le président |
 |
M. Réal Ménard |
 |
Mme Libby Davies (Vancouver-Est, NPD) |
 |
Mme Rose Dufour |
| ¼ | 1820 |
 |
Mme Libby Davies |
 |
Mme Rose Dufour |
 |
Mme Libby Davies |
 |
Mme Rose Dufour |
 |
Le président |
 |
L'hon. Hedy Fry (Vancouver-Centre, Lib.) |
| ¼ | 1825 |
 |
Mme Rose Dufour |
 |
L'hon. Hedy Fry |
 |
Mme Rose Dufour |
 |
Hon. Hedy Fry |
 |
Mme Rose Dufour |
| ¼ | 1830 |
 |
Le président |
 |
Mme Paule Brunelle (Trois-Rivières, BQ) |
| ¼ | 1835 |
 |
Mme Rose Dufour |
 |
Mme Paule Brunelle |
 |
Mme Rose Dufour |
| ¼ | 1840 |
 |
Le président |
 |
Mme Rose Dufour |
 |
M. Art Hanger |
 |
Le président |
 |
M. Art Hanger |
 |
Mme Rose Dufour |
 |
Le président |
 |
M. Art Hanger |
 |
Mme Rose Dufour |
 |
Mme Paule Brunelle |
 |
Mme Rose Dufour |
 |
Le président |
 |
M. Art Hanger |
| ¼ | 1845 |
 |
Mme Rose Dufour |
 |
M. Art Hanger |
 |
Mme Libby Davies |
 |
Le président |
 |
M. Art Hanger |
 |
Le président |
 |
Le président |
 |
M. Laurie Arron (directeur, Services d'assistance judiciaire, Égale Canada) |
| ¼ | 1850 |
 |
M. Stephen Lock (membre, Conseil d'administration, Égale Canada) |
| ¼ | 1855 |
 |
Le président |
 |
M. Laurie Arron |
| ½ | 1900 |
 |
Le président |
 |
M. Laurie Arron |
 |
Le président |
 |
L'hon. Hedy Fry |
 |
M. Laurie Arron |
 |
L'hon. Hedy Fry |
| ½ | 1905 |
 |
M. Laurie Arron |
 |
L'hon. Hedy Fry |
 |
M. Stephen Lock |
| ½ | 1910 |
 |
L'hon. Hedy Fry |
 |
Le président |
 |
Mme Libby Davies |
 |
M. Laurie Arron |
 |
Mme Libby Davies |
| ½ | 1915 |
 |
M. Laurie Arron |
 |
Mme Libby Davies |
 |
M. Laurie Arron |
 |
Mme Libby Davies |
 |
Le président |
 |
Mme Libby Davies |
 |
M. Laurie Arron |
 |
Le président |
 |
Mme Paule Brunelle |
 |
M. Stephen Lock |
 |
Mme Paule Brunelle |
 |
M. Laurie Arron |
| ½ | 1920 |
 |
Mme Paule Brunelle |
 |
M. Laurie Arron |
 |
Le président |
 |
M. Art Hanger |
 |
Mme Libby Davies |
 |
M. Art Hanger |
 |
M. Laurie Arron |
| ½ | 1925 |
 |
M. Art Hanger |
 |
M. Laurie Arron |
 |
M. Art Hanger |
 |
M. Laurie Arron |
 |
M. Art Hanger |
 |
M. Laurie Arron |
 |
M. Art Hanger |
 |
M. Laurie Arron |
 |
M. Art Hanger |
 |
M. Laurie Arron |
 |
M. Art Hanger |
 |
M. Laurie Arron |
 |
Le président |
| ½ | 1930 |
 |
L'hon. Hedy Fry |
 |
M. Laurie Arron |
 |
Le président |
 |
Mme Libby Davies |
 |
M. Stephen Lock |
 |
M. Laurie Arron |
| ½ | 1935 |
 |
Le président |
 |
Mme Paule Brunelle |
 |
M. Laurie Arron |
 |
Mme Paule Brunelle |
 |
M. Laurie Arron |
 |
Le président |
 |
M. Art Hanger |
 |
M. Laurie Arron |
| ½ | 1940 |
 |
M. Art Hanger |
 |
M. Laurie Arron |
 |
M. Art Hanger |
 |
Le président |
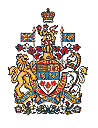
CANADA
Sous-comité de l'examen des lois sur le racolage du Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile |
|
l |
|
l |
|
TÉMOIGNAGES
Le lundi 18 avril 2005
[Enregistrement électronique]
* * *
»  (1740)
(1740)
[Traduction]

Le président (M. John Maloney (Welland, Lib.)): Je déclare la séance ouverte. C'est la 25e séance du Sous-comité de l'examen des lois sur le racolage du Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile.
Notre premier témoin ce soir est Mme Dufour, de l'Université du Québec à Montréal. Bonsoir, madame Dufour.
Voici comment nous procédons. Vous pouvez faire un exposé d'une dizaine de minutes, après quoi les députés vous poseront des questions; dans un premier temps, ils auront sept minutes chacun, après quoi nous ferons des tours d'environ trois minutes.
Je vous invite à commencer quand vous serez prête, madame Dufour.
[Français]


Mme Rose Dufour (chercheuse associée, Collectif de recherche sur l'itinérance, la pauvreté et l'exclusion sociale, Université du Québec à Montréal): Bonjour, monsieur le président, madame, messieurs.
Ma position s'appuie sur une recherche que j'effectue sur le terrain depuis quatre ans. Le rapport de recherche que j'ai apporté compte 646 pages. Je vais le déposer en même temps que je déposerai un mémoire.
Il m'est difficile de faire en 10 minutes une présentation des résultats de cette recherche. Par ailleurs, je crois que la position que j'exposerai nécessite absolument l'explication de quelques-uns de ces résultats.
Je voudrais d'abord dire que je travaille avec les femmes prostituées depuis quatre ans. Je les aide à faire le point dans leur vie. Ce faisant, j'ai récolté des données qui m'ont permis de mettre à jour les processus qui conduisent les femmes à se prostituer. J'ai approfondi 20 histoires de vie. J'ai atteint ce qu'on appelle le point de saturation en ce qui concerne la prostitution de rue et je suis arrivée à la conclusion que l'abus sexuel est la clé des systèmes de production de la prostitution. Par la suite, après une année et demie de travail avec ces femmes, j'ai décidé de faire une enquête auprès des clients de prostituées. J'ai fait la première recherche en Amérique sur les clients de prostituées, avec 64 clients. J'ai pu, par cette recherche, définir une typologie des clients et mettre à jour les systèmes de représentation de la prostituée et de la prostitution. Je vais essayer de vous en parler aussi. Après avoir documenté ces deux acteurs principaux du système prostitutionnel, j'ai fait l'histoire de vie de deux proxénètes pour essayer de comprendre comment d'autres le deviennent.
Il y a donc trois questions fondamentales. Premièrement, comment les femmes en viennent-elles à se prostituer? Les limites budgétaires de la recherche ne m'ont pas permis de travailler avec des hommes prostitués. Deuxièmement, pourquoi des hommes rencontrent-ils des prostituées? Troisièmement, comment d'autres deviennent-ils proxénètes?
Les réponses à ces trois questions permettent de définir le point zéro de la prostitution, ce point étant le point de départ des systèmes de production de la prostitution.
Comment les femmes en viennent-elles à se prostituer? Ma recherche a démontré que 17 fois sur 20, c'est-à-dire dans 85 p. 100 des cas, les filles avaient été abusées à répétition dans leur propre famille ou dans leur voisinage immédiat. J'ai pu mettre à jour également un mécanisme qui fait que la petite fille qui est abusée, puisqu'elle ne définit pas les conditions de l'abus sexuel, n'est pas en mesure de dire non à son abuseur, qui est généralement quelqu'un qu'elle aime, qui a conquis sa confiance et à qui elle veut plaire. Elle ne se donne pas dans cette relation: elle met son corps en disponibilité. Voilà exactement le type de relation qu'il y a entre la prostituée et le client. Elle ne se donne pas, parce que se donner demande un partage d'intimité, ce que l'enfant ne fait pas et ce que la femme prostituée ne fait pas. Elle rend son corps disponible seulement.
Dans la relation prostitutionnelle, la femme prostituée reproduit ce même mécanisme de mise en disponibilité de son corps. Elle a appris à se mettre au service sexuel de l'autre plutôt qu'au service de ses propres besoins. Être prostituée, c'est avoir un corps public, c'est ne plus avoir de corps privé. La prostituée, dans cette sorte de représentation, devient en quelque sorte la plus abusée des abusés.
J'ai également pu mettre à jour comment la toile de fond de la prostitution était une condition liée à la pauvreté de ces personnes. Dans cet approfondissement des conditions de l'abus sexuel, j'ai également pu mettre à jour que dans certains cas, aucune avenue autre que la prostitution ne s'ouvre à la personne abusée, parce qu'elle intériorise une identité de prostituée, en raison des mots qui lui sont dits pendant les abus sexuels répétitifs, en raison du monnayage fait des activités qu'on lui demande, etc.
Dans un autre groupe, il y en a quatre qui ne pouvaient que devenir prostituées, sept autres pour qui l'abus sexuel est la cause principale de la prostitution et six autres pour qui l'abus sexuel est relié à la prostitution sans en être la cause principale.
C'est très complexe, et je ne peux pas vous l'expliquer en deux mots, mais je peux dire que le degré de parenté, l'intensité des relations, le type de rapport établi par l'abuseur avec l'abusée créent un type de relation particulier.
» 
 (1745)
(1745)
Comme la femme prostituée est une personne abusée, je recommande à ce comité de ne plus la considérer comme une criminelle, mais de lui venir en aide parce qu'elle a été abusée sexuellement. Ce sont des femmes qui, dans la plupart des cas, présentent des symptômes du syndrome de stress post-traumatique.
Je n'ai pas le temps d'argumenter maintenant, mais je le ferai en répondant à vos questions. Je vous dirai comment la pratique de la prostitution amène une désensibilisation progressive du corps, une perte du désir sexuel et un anéantissement total de la sexualité de ces femmes. D'autres conséquences sont évidentes, mais je n'aurai pas le temps d'en parler ici.
En ce qui concerne l'enquête sur les clients, le rapport de recherche présente cinq chapitres qui approfondissent certaines questions. Qui sont ces hommes? Pourquoi vont-ils voir les prostituées et à quelle fréquence? Qu'est-ce qu'ils font avec elles? Quels sont leurs discours sur les femmes prostituées, etc.?
Je ne vous parlerai que de la typologie des clients. Le premier acétate présente la typologie des clients selon leurs motivations. La première catégorie est celle du timide. Il y a 23 p. 100 des clients qui sont des hommes célibataires qui ne sont pas capables d'entrer en relation avec les femmes parce qu'ils sont trop timides.
Contrairement au préjugé populaire, la raison pour laquelle les hommes vont voir des prostituées n'est pas qu'ils sont insatisfaits dans leur vie sexuelle maritale, conjugale ou de couple, puisque seulement 15,6 p. 100 des hommes utilisent cet argument.
Une autre catégorie est celle du vieux garçon. Il s'agit d'un homme volontairement célibataire ou qui subit le célibat. Sa caractéristique est de ne pas vouloir s'engager.
L'insatiable, pour sa part, est un homme marié qui se dit comblé dans sa relation maritale mais qui désire avoir toutes les femmes.
Le cachottier représente 7,8 p.100 des cas. C'est un client qui a des demandes particulières à adresser à la femme prostituée, demandes qu'ils n'adresserait pas à sa femme ou à sa conjointe.
Il reste 4,6 p. 100 des clients qui n'entrent dans aucune de ces catégories.
Un deuxième acétate montre, non pas en termes de pourcentage mais en termes de motivations, c'est-à-dire les raisons qui font que les hommes vont voir des prostituées, que dans les trois premières catégories, celles du timide, de l'insatisfait et du vieux garçon, il y a le galant, qui aime les femmes et qui veut rencontrer des femmes. Le consommateur, quant à lui, n'est qu'à la recherche de sexe. Il ne veut pas rencontrer une femme, il cherche un sexe.
» 
 (1750)
(1750)
Ainsi, 51,5 p. 100 des hommes sont dans un rapport d'homme à femme, alors que les hommes de la deuxième catégorie, c'est-à-dire le vieux garçon consommateur, l'insatiable et le cachottier, donc près de 40 p. 100 des cas, se trouvent dans un rapport d'homme à objet sexuel, et non à sujet.
Ce sont des observations intéressantes car elles nous communiquent un certain pronostic de la situation. Lorsque le vieux garçon consommateur, le cachottier et l'insatiable sont misogynes, c'est-à-dire qu'ils détestent les femmes et qu'ils sont violents, ils se trouvent déjà dans un rapport d'homme à femme objet. On voit le danger.
Dans les deux premiers cas, c'est différent. Si le timide, par exemple, rencontrait une femme avec laquelle il pourrait s'engager, il cesserait de consommer de la prostitution. De la même façon, si l'insatisfait pouvait trouver le moyen de régler son problème, il cesserait aussi de consommer de la prostitution. Cependant, les hommes des autres catégories, le vieux garçon, l'insatiable et le cachottier, qui représentent près de 56 p. 100 des hommes, ne veulent pas s'engager. Dans leur cas, la prostitution apparaît en quelque sorte irréversible.
Quand on analyse les façons dont les clients perçoivent la prostitution et la prostituée, il est impressionnant de constater que la majorité de ces hommes ne voient pas, dans la femme qu'ils sollicitent et qu'ils paient, une prostituée.
Pour les hommes interrogés, il y a trois types de prostituées. La prostituée pure et dure, comme ils disent, est la prostituée de rue qui a commencé à faire de la prostitution jeune et qui n'est pas capable d'en sortir. La prostituée nécessiteuse est celle qui est pauvre, qui a très peu de clients et qui a peu de demandes de leur part, c'est-à-dire que les exigences de ses clients sont moindres. Entre les deux, il y a ce qu'ils appellent la prostituée soft, celle qui le fait pour le plaisir. Elle ne le fait pas pour des raisons d'argent, pensent-ils.
Les hommes croient, dans tous les cas, que les femmes prostituées aiment le sexe et qu'elles se prostituent pour cette raison, ce qui est totalement faux. Je n'ai rencontré aucune femme, depuis quatre ans, qui se prostituait pour des désirs sexuels.
Les hommes ont le sentiment d'apporter quelque chose à ces femmes sur le plan sexuel, ce qui est faux. Je crois qu'ils doivent maintenant apprendre qu'ils ne leur apportent rien sur ce plan. Les hommes sont ignorants des parcours de vie de ces femmes, de leurs tragédies, des raisons qui les ont menées à se prostituer. Ils sont également ignorants des conséquences de la prostitution sur ces femmes. Par ailleurs, j'ai noté qu'ils étaient extrêmement sensibles lorsque je leur expliquais les parcours de vie des femmes avec lesquelles je travaillais. Ils étaient silencieux et touchés par ces questions.
En conséquence, ma position par rapport au client est qu'il faut le criminaliser et lui venir en aide. Les personnes prostituées sont l'ombre de ces hommes, l'ombre dans ce qu'ils sont de plus odieux. Le client produit la prostitution lorsqu'il sollicite des personnes mineures et lorsqu'il consomme de la prostitution offerte par des mineures. Dans la prostitution adulte, le client possède le désir et l'argent. La prostituée a la beauté et la capacité de le faire jouir. Il est en position de domination, parce qu'elle a besoin de cet argent. Dans la prostitution adulte, le client entretient la prostitution en la consommant et il la produit lorsqu'il la sollicite. Sans client, il n'y a pas de prostitution.
Sur le plan familial, nous avons tort de considérer que la prostitution ne concerne que l'homme qui l'utilise. À partir de certaines expériences que j'ai connues avec des familles où le père consomme de la prostitution, je crois que nous devons, au contraire, constater que cette consommation a des conséquences sur l'ensemble de la famille, et pas seulement sur le plan financier. En effet, la consommation de la prostitution par un père de famille sous-entend une représentation de la femme qui a des conséquences sur sa propre famille.
» 
 (1755)
(1755)
Sur le plan juridique, je considère que la prise de position sur la responsabilité des clients producteurs de prostitution est devenue essentielle, non seulement en appliquant des sentences qui sont significatives plutôt que symboliques, mais également en appliquant des sentences qui tiennent compte des gestes et des comportements des clients dans leur relation avec une prostituée.
Dans une relation avec une prostituée, tout n'est pas acceptable. Dans le rapport de recherche, vous pourrez lire que les femmes prostituées indiquent aux clients des limites à ne pas dépasser. Par exemple, la sodomie ne fait pas partie des activités courantes de la prostitution. Il arrive que les clients transgressent la règle, non seulement sur la sodomie, mais également sur l'utilisation des excréments. Généralement, la sentence ne concerne que le fait que, par exemple, les prostituées sont mineures et est appliquée en conséquence. On ne tient jamais compte des comportements des clients.
Par ailleurs, je tiens à souligner le fait que dans une relation avec une prostituée, deux misères se rencontrent: la misère de la femme prostituée et la misère du client. Le client y laisse sa dignité ainsi que son argent, et dans la majorité des cas, comme vous pourrez le lire dans le rapport, les hommes ne sont pas satisfaits de ce qu'ils trouvent dans cette relation.
Le travail d'éducation à faire du côté des clients est énorme. J'ai trouvé que le fossé entre les femmes et les hommes était immense. Les femmes, contrairement à leurs clients, savent parfaitement à qui elles ont affaire.
Du côté des proxénètes, je n'ai fait que deux histoires de vie. L'enquête ne visait qu'à évaluer la faisabilité de la recherche. J'ai fait une histoire de vie d'une femme propriétaire d'un salon de massage et d'un homme propriétaire d'une agence d'escorte. Je voulais simplement vérifier s'ils vivaient déjà une très grande proximité de la prostitution dans leur famille, et c'est ce que j'ai démontré. Sans pouvoir élaborer, j'y reviendrai si vous le souhaitez.
Ma position sur les proxénètes est qu'il faut criminaliser toute forme de proxénétisme, incluant le proxénétisme caché et hypocrite des annonces classées des journaux. J'ai pu constater que le pivot du système fonctionnel de la prostitution est dans nos journaux, dans les annonces classées. Les filles s'y annoncent, les clients y trouvent les numéros de téléphone qu'ils cherchent et les proxénètes y annoncent les services qu'ils veulent offrir.
Voilà mon résumé. Je m'excuse du temps que j'ai pris. Je vais déposer un document écrit.
[Traduction]


Le président: Merci beaucoup.
Monsieur Hanger, vous avez sept minutes.


M. Art Hanger (Calgary-Nord-Est, PCC): Merci, monsieur le président.
Je vous remercie pour votre présentation. Je pense que vous avez soulevé des questions très intéressantes, notamment bien sûr vos recherches sur le client.
Vous avez interviewé 64 clients. Bien sûr, vous avez aussi interviewé deux proxénètes, comme vous l'avez signalé, qu'on appelle des souteneurs. Mais au sujet des clients, d'après votre graphique, le tableau 19, je conclus de cette recherche que vous avez effectuée en partant de la matière première, pour ainsi dire, c'est-à-dire les personnes elles-mêmes, que les clients dangereux se trouvent tout au bas de l'échelle. Je suppose qu'ils se trouvent dans la catégorie des « insatiables » et dans la catégorie des « cachotiers ». Ai-je raison?
¼ 
 (1800)
(1800)
[Français]


Mme Rose Dufour: Oui, je crois que vous avez raison. On peut soupçonner, chez le vieux garçon consommateur, la présence de personnes ayant un rapport à la prostituée qui est différent. Par définition, ces clients ne sont pas nécessairement dangereux, mais il peut se trouver qu'ils le soient, parce que les exigences sont plus importantes.
[Traduction]


M. Art Hanger: Oui.
Maintenant, au cours de vos entrevues avec l'une ou l'autre de ces personnes qui utilisent les femmes de cette manière, est-ce que l'un ou l'autre d'entre eux a admis avoir tendance à être violent avec les femmes?
[Français]


Mme Rose Dufour: Oui, nous avons parlé de la violence physique et de la violence verbale. Généralement, les hommes disaient demander l'autorisation aux femmes lorsqu'ils voulaient qu'il y ait usage d'un langage violent ou de traitements violents. Ces catégories dans le cadre desquelles j'ai discuté avec les hommes regroupaient des individus qui voulaient être dominés. C'était le cas, par exemple, du cachottier.
Pour ce qui est de certaines autres catégories, le discours que tiennent les femmes prostituées au sujet de leurs clients est évidemment différent. Elles disent, bien sûr, que des clients leur demandent l'autorisation d'utiliser un langage violent et qu'elles ont alors la liberté d'accepter ou de refuser.
Il reste que généralement, un client très violent ne demande pas d'autorisation. Au cours de la dernière année, dans l'organisme où je travaille, six femmes sont mortes à la suite de traitements violents infligés par des clients. L'une des femmes qui a participé à cette action-recherche a disparu à la fin de l'été dernier. Je n'arrive pas à la retrouver.
[Traduction]


M. Art Hanger: Vous ne faites vraiment aucune distinction ici entre ce qui peut arriver dans la rue et ce qui peut arriver dans un service d'escorte ou un salon de massage ou même une maison de débauche—qualificatif qui pourrait être appliqué à tous les autres endroits, à l'exception des prostituées de rues.
[Français]


Mme Rose Dufour: Je vous remercie d'avoir posé cette question, qui est d'une extrême importance. J'ai mis l'accent sur la prostitution de rue parce que c'est la plus dangereuse: les filles sont plus vulnérables, beaucoup plus pauvres, grandes consommatrices de drogue et extrêmement seules. À Québec, contrairement à Montréal, les femmes prostituées ont moins souvent des souteneurs. J'ai donc accordé beaucoup plus d'attention aux femmes de la rue qu'aux escortes.
Cependant, lorsque j'analyse leur parcours professionnel, si je peux m'exprimer ainsi, je constate généralement qu'elles ont d'abord été danseuses nues, employées dans des agences d'escorte ou masseuses, pour finalement se retrouver dans la rue. Dans certains cas, elles ont commencé à se prostituer à l'adolescence. En effet, l'âge où elles commencent à le faire se situe en général autour de 13, 14 ou 15 ans. Cela s'applique à environ 46 p. 100 des cas, si mes souvenirs sont exacts.
Je dois dire cependant que quatre des vingt femmes ont commencé plus tard, soit à 35, 37, 40 et 46 ans. Il va sans dire que pour ces femmes, le processus d'entrée n'a pas été le même. En général, les femmes ont été abusées sexuellement lorsqu'elles étaient jeunes. Or, ce sont ici d'autres facteurs reliés à la vie familiale qui ont fait en sorte qu'elles se retrouvent dans la rue. Dans certains cas, ces femmes sont sollicitées par des clients; dans d'autres, elles décident d'offrir leurs services sur le trottoir.
¼ 
 (1805)
(1805)
[Traduction]


M. Art Hanger: Vous avez eu l'occasion d'avoir des entretiens avec deux groupes de gens—probablement trois, en fait—et il semble que vous travaillez dans une organisation dont les objectifs sont d'aider les jeunes femmes tombées dans la prostitution à s'en sortir. Je suppose donc qu'au départ, votre attitude est que cela ne doit pas être légitimé, et vous faites du travail de prévention parmi les jeunes gens pour les sensibiliser à la réalité de la prostitution.
[Français]


Mme Rose Dufour: Je ne suis pas certaine d'avoir bien compris. Je n'ai pas eu d'interprétation.
[Traduction]


M. Art Hanger: Je peux répéter la question.
Vous travaillez avec une organisation dont les objectifs sont d'aider les jeunes qui sont tombés dans la prostitution à s'en sortir.
[Français]


Mme Rose Dufour: Non, pas du tout. Le Projet Intervention Prostitution Québec a pour mission d'accompagner les personnes qui vivent quotidiennement dans l'univers de la prostitution et de leur venir en aide. Nous n'avons absolument pas pour objectif de les faire sortir de la prostitution. Nous les épaulons si elles décident d'en sortir.
[Traduction]


M. Art Hanger: Je voudrais apporter une précision, monsieur le président.
J'ai ici ce document qui a été remis avec votre nom dessus, le Projet...
[Français]


Mme Rose Dufour: Projet Intervention Prostitution Québec.
[Traduction]


M. Art Hanger: ... Intervention Prostitution Québec. C'est leur mandat. Vous n'êtes donc pas d'accord avec ce mandat?
[Français]


Mme Rose Dufour: Non, son mandat n'est pas de faire sortir les personnes de la prostitution. Je ne sais pas ce que vous avez entre les mains, je ne l'ai pas. La mission de Projet Intervention Prostitution Québec est de venir en aide aux personnes qui se prostituent, et non pas de les faire sortir de la prostitution.
[Traduction]


M. Art Hanger: Le projet inscrit ici est le Projet Intervention Prostitution Québec. On dit ici que le projet a été créé en 1984 dans la ville de Québec afin de proposer du soutien et une approche globale aux jeunes ayant des problèmes liés à la prostitution. Il vise deux principaux objectifs : premièrement, aider les jeunes tombés dans la prostitution à s'en sortir et deuxièmement, faire un travail de prévention auprès des jeunes en les sensibilisant aux réalités de la prostitution. C'est ce qu'on lit dans ce document. Vous n'êtes pas d'accord avec cela?
[Français]


Mme Rose Dufour: Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Je ne sais pas qui a déposé ce document. L'objectif de l'organisme n'est pas de les faire sortir de la prostitution mais de les aider.
[Traduction]


Le président: Merci, monsieur Hanger.
Monsieur Ménard, vous avez la parole.
[Français]


M. Réal Ménard (Hochelaga, BQ): D'abord, je suis très content d'avoir fait votre connaissance puisque la publication de votre livre au Québec — je ne sais pas quelle est la situation au Canada anglais — a beaucoup fait parler. Votre contribution me semble majeure. Je n'ai pas encore lu votre livre. Cela fera partie de mes études d'été, et j'espère évidemment que cela me permettra d'avoir une connaissance de ce sujet aussi approfondie que la vôtre.
Cependant, je suis un peu étonné parce que j'avais lu les travaux du professeur Shaver, de l'Université Concordia, et ceux de Colette Parent, qui avaient d'ailleurs été subventionnés par la Commission de réforme du droit du Canada. Évidemment, 20 travailleuses du sexe, c'est beaucoup parce que c'est une clientèle clandestine, qui ne se prête pas facilement à ce type d'investigation.
Est-ce scientifiquement concluant? Peut-être pourriez-vous nous donner votre point de vue à ce sujet. C'est certainement beaucoup, dans la mesure où c'est une clientèle difficile à joindre.
Ce qui m'étonne de votre témoignage, c'est que vous semblez exclure la possibilité que des femmes s'engagent dans le travail du sexe de façon délibérée, dans une perspective de réalisation de soi et de propos librement consentis. Au cours de différents témoignages antérieurs, des porte-parole de travailleuses du sexe nous ont exposé ce point de vue. Personnellement, je connais des escortes masculines qui font ce travail de manière très volontaire.
Ne pensez-vous pas que votre évaluation a peut-être occulté un phénomène qui peut exister, même s'il n'est pas dans votre échantillon?


Mme Rose Dufour: Depuis quatre ans, je travaille quotidiennement au Projet Intervention Prostitution Québec avec des femmes prostituées. Je suis également allée au Centre de détention de Québec. Depuis quatre ans, je rencontre des femmes prostituées.
Je reconnais qu'il y a une différence entre la prostituée de rue et l'escorte. L'escorte tient un rôle de séductrice, et le client est également dans un rapport de séduction. Quoi qu'il en soit, depuis quatre ans, j'ai rencontré des danseuses nues, des escortes, des prostituées de la rue, et aucune d'entre elles ne voulait que la prostitution soit reconnue comme un métier comme les autres. Ce n'est pas un métier, parce qu'utiliser son sexe comme objet de travail, c'est faire de soi un objet.
¼ 
 (1810)
(1810)


M. Réal Ménard: D'après moi, il y a une nuance que vous ne faites peut-être pas.
Je suis député de l'est de Montréal. Il y a au moins 100 ou 150 travailleuses du sexe connues des organismes d'application de la loi. Je suis député juste à côté du village gai, où on trouve le phénomène des escortes.
Il est vrai que ce n'est pas un travail comme les autres. On ne trouvera pas beaucoup de littérature qui dise cela. Cependant, lorsque des clients vont vers les escortes, il n'y a pas toujours un acte sexuel qui en résulte. Je connais au moins une vingtaine de clients qui viennent combler des besoins relationnels. J'étais d'accord sur la typologie que vous avez faite. Ce n'est pas parce qu'on a recours à une travailleuse du sexe qu'il s'ensuit nécessairement un acte sexuel. Certaines personnes le font pour combler des carences affectives. Des escortes, autant des hommes que des femmes, m'ont raconté que des gens allaient les voir seulement pour se faire serrer dans leurs bras ou parce qu'ils avaient le goût d'un dialogue. Il y a des gens qui paient seulement pour pouvoir dialoguer.
Je ne sais pas si on doit conclure que le fait d'être une travailleuse ou un travailleur du sexe n'amène une personne qu'à répondre à un besoin sexuel. Je pense qu'il y a des carences affectives. Des gens qui sont profondément seuls dans la vie ont recours à ces services. Pouvez-vous envisager cette hypothèse?


Mme Rose Dufour: Non, je ne peux pas envisager cette hypothèse, parce qu'aucune des femmes qui se prostituent ne peut reconnaître cette vision. Je peux vous amener ici plusieurs femmes pour qu'elles témoignent, car c'est à elles de dire quel est leur point de vue. Moi, je ne peux parler que de l'expérience que j'ai connue depuis quatre ans.
Du côté des clients, ce que vous dites est vrai. La typologie des clients montre qu'il y a des clients, par exemple le timide, qui vont payer simplement parce qu'ils veulent être touchés par une femme ou sentir son odeur. Mais devons-nous pour cette raison, en tant que société, accepter que des femmes deviennent des marchandises pour répondre à une telle vision? Voyons! Les hommes eux-mêmes, lorsqu'ils discutent de cela, reconnaissent qu'ils ont une vision économique de la femme et de la sexualité.
C'est difficile à résumer en quelques mots, mais dans une autre partie de la recherche, on voit que les hommes ont une vision économique du mariage et de la relation de couple. Les femmes n'ont pas la même perception d'une relation.


M. Réal Ménard: Me permettez-vous une dernière question?


Mme Rose Dufour: Je suis là pour cela.
¼ 
 (1815)
(1815)


M. Réal Ménard: Soyez sûre que je vais lire votre livre.
En tant que législateurs, nous devrons faire des recommandations. D'après ce que j'ai cru comprendre de vos remarques préliminaires, vous seriez plus encline à faire la promotion du modèle suédois, qui est de criminaliser les clients mais de ne pas criminaliser les femmes prostituées. Ai-je bien compris vos recommandations? Si on avait à s'inspirer d'un modèle, seriez-vous plus près du modèle suédois?


Mme Rose Dufour: Oui, définitivement, à cause des conséquences de la prostitution sur le corps des femmes.
Par exemple, je connais une fille qui est agente d'escorte depuis maintenant 12 ou 15 ans. Elle n'est pas capable d'en sortir. Elle voudrait bien pouvoir en sortir. Elle est désespérée, car elle est maintenant dans une relation de couple avec un homme et elle voudrait s'engager de façon définitive.
Que veulent ces femmes? Elles veulent avoir une relation de couple avec un homme qui va les protéger et les aimer pour ce qu'elles sont. C'est absolument impressionnant de voir, dans le rapport de recherche, à quel point les hommes clients ignorent le parcours de ces femmes, ne les connaissent ni comme femmes, ni comme prostituées. Ils ne les connaissent que par le sexe. Elles sont pourtant bien autre chose.
Quel que soit le type de prostitution, toutes les femmes vont aboutir à la conséquence absolument désastreuse qu'est la désensibilisation totale du corps. Même les agentes d'escorte et les hôtesses m'ont décrit dans quelle détresse absolument épouvantable elles se trouvent. En effet, elles ne ressentent plus rien. Leur sexualité complète est anéantie.


M. Réal Ménard: Ai-je le temps de poser une dernière question?


Le président: Non.


M. Réal Ménard: Excusez-moi, je dois partir, mais au plaisir.
Merci.
[Traduction]


Mme Libby Davies (Vancouver-Est, NPD): Merci beaucoup, madame Dufour, d'être venue.
Je voulais vous dire que quand nous étions à Montréal pour entendre des témoins, votre livre a été mentionné et, en fait, il a fait l'objet d'un débat très animé. Certaines personnes trouvaient que votre livre était très bon, tandis que d'autres, notamment des travailleuses du sexe, contestaient ardemment votre livre, mais c'était une discussion intéressante.
C'est un sujet très complexe. Je me considère moi-même comme une ardente féministe et je ne souhaite donc assurément pas que des femmes soient exploitées ou traitées comme des objets, mais je trouve intéressant de voir où l'on trace la ligne de démarcation entre ce qui est légal et illégal. Par exemple, les femmes sont transformées en objets ou utilisent leur corps quand elles travaillent comme mannequins, ou même comme danseuses érotiques ou effeuilleuses. Il y a parfois des femmes qui se marient pour l'argent. Je ne sais pas si l'on peut alors dire qu'elles sont d'une certaine manière transformées en objets.
Sur un plan plus philosophique, je me demande où vous tracez la ligne. On dirait que l'argument se situe davantage sur le plan moral parce que des activités sexuelles sont en cause. C'est ma première question.
Ma deuxième question, ce à quoi je m'intéresse vraiment en fait, c'est de savoir comment vous voyez la différence entre la prostitution de rue et la prostitution ailleurs que dans la rue. Nous avons entendu le témoignage de beaucoup de femmes, notamment à Montréal. La plupart d'entre elles travaillaient comme escortes, mais pas toutes, et beaucoup d'entre elles ont fait valoir qu'elles faisaient ce métier par choix. Pas toutes, mais certaines d'entre elles ont dit cela, et vous venez de parler du secteur des services d'escorte par opposition à la prostitution de rue. Je m'interroge : Pourquoi faites-vous une différence entre les deux? Est-ce une question de classe sociale ou de pauvreté? Si vous ramenez la question davantage sur le plan moral ou si vous invoquez l'argument de la réification, alors quelle est la différence?
[Français]


Mme Rose Dufour: Je voudrais dire d'abord qu'au début de ma recherche, je ne voyais pas les danseuses érotiques comme des prostituées. Ce sont les premières danseuses que j'ai interviewées qui m'ont expliqué que la danse érotique devant un auditoire d'hommes était de la prostitution: il s'agissait d'utiliser son corps pour se faire payer.
Depuis que la danse érotique se pratique dans des isoloirs, la situation s'est complètement transformée: elle est maintenant désastreuse. Auparavant, les filles dansaient sur la scène et il y avait une distance entre elles et le client. Elles étaient payées pour danser. Aujourd'hui, ce sont elles qui doivent payer pour aller danser. Elles doivent accepter d'aller dans un isoloir avec les clients, sans quoi elles ne gagnent pas d'argent. Que se passe-t-il dans l'isoloir? Des fellations, entre autres. Il n'y a pas que des attouchements, il y a aussi des relations sexuelles. Les danseuses me disent que même sans ces attouchements ou ces relations sexuelles, on parle de prostitution puisqu'il s'agit ici d'utiliser ou d'exposer son corps en échange d'argent. Regarder, c'est toucher.
Dans le cadre de la recherche que j'ai réalisée auprès des filles, j'ai pu constater que certains pères étaient incestueux de par le regard intrusif qu'ils portaient sur leurs filles. J'ai pu démontrer — je pense ici au cas de Marion — que les dommages causés par l'abus sexuel d'un père incestueux étaient absolument dramatiques. Dans ce cas pourtant, il n'avait jamais pénétré sa fille. Il la touchait, la léchait et portait sur elle un regard intrusif. Je vous invite à lire cette histoire, qui est absolument pathétique. L'abus sexuel n'est donc pas simplement une relation sexuelle.
Se marier pour de l'argent, dites-vous? Certains hommes ont abordé cette question au cours des entrevues. Cela existe sans doute. Il y a aussi des hommes qui marient des femmes qui ont de l'argent. Dans le cadre de son mariage, la femme mariée ne se compare en aucune façon à une prostituée, parce qu'elle fonde une famille, donne naissance à des enfants, les éduque, en fait des citoyens, et ainsi de suite.
Comment pouvons-nous définir la prostitution? C'est un échange de sexe pour de l'argent, sans égard aux désirs et aux besoins de la personne qui se prostitue. Cette dernière n'est pas là pour combler ses désirs personnels. Au contraire, elle s'en détourne pour se mettre au service de l'autre. C'est ce que l'abus sexuel lui a appris à faire.
¼ 
 (1820)
(1820)
[Traduction]


Mme Libby Davies: Cela veut-il dire que les femmes mariées qui fournissent des services sexuels et qui ne satisfont peut-être pas leurs propres besoins ou qui ont des relations sexuelles sans vraiment le vouloir sont également des prostituées?
[Français]


Mme Rose Dufour: Pardonnez-moi, j'étais distraite. Voulez-vous répéter votre question?
[Traduction]


Mme Libby Davies: Vous dites qu'il y a prostitution lorsque la prostituée elle-même ne satisfait pas ses besoins, lorsqu'elle le fait contre sa volonté. Cela arrive à des femmes mariées. Sont-elles des prostituées?
Je ne comprends vraiment pas où se situent les limites de votre définition. De la manière dont vous définissez cela, c'est très étendu. Dites-vous que nous ne devrions pas autoriser la danse érotique?
[Français]


Mme Rose Dufour: Pour moi, la différence fondamentale réside dans le fait que la femme prostituée rend son corps disponible. Dans la relation amoureuse, il y a échange et partage d'intimité. Le fait que certaines personnes ne puissent vivre cela à l'intérieur de leur mariage ne change pas pour autant cette définition.
Dans la relation prostitutionnelle, il y a un échange de sexe pour de l'argent, sans égard aux besoins et aux désirs de la personne qui se prostitue et sans engagement émotif et relationnel de la part du client. À ma connaissance, dans la relation de couple, il y a un engagement émotif et relationnel de la part des partenaires. Ce n'est pas le cas dans la relation marchande et prostitutionnelle.
Je dirai encore une fois que les conséquences de l'exercice de la prostitution sur ces femmes sont absolument dramatiques. Ce n'est pas moi qui ai inventé ces conséquences: ce sont les femmes elles-mêmes qui en dressent la liste et les décrivent.
[Traduction]


Le président: Merci, madame Davies.
Docteure Fry.


L'hon. Hedy Fry (Vancouver-Centre, Lib.): Merci beaucoup, madame Dufour.
Je voulais revenir sur les préoccupations de Mme Davies en allant un peu plus loin.
D'abord et avant tout, nous avons entendu au cours de notre tournée tellement de femmes dire qu'elles aimeraient pouvoir choisir être des travailleuses du sexe. Certaines d'entre elles nous ont dit qu'elles ont aussi une relation amoureuse avec quelqu'un d'autre. Elles vivent avec cette personne, elles rentrent à la maison pour retrouver cette personne, elles ont un conjoint. Elles font cela parce qu'elles croient offrir un service. Certaines d'entre elles croient que ce service peut être valable, par exemple pour la personne timide qui a besoin d'être prise en charge ou la personne handicapée qui ne peut pas trouver de partenaire. Beaucoup d'entre elles finissent par être convaincues qu'elles fournissent un service. Elles fournissent ce service avec un certain détachement, peut-être de la même manière que certaines personnes arrivent à un certain détachement vis-à-vis leurs clients. Les médecins s'efforcent de se détacher à certains égards du patient auquel ils offrent un service, surtout si le patient en question est mourant. Pour pouvoir offrir un bon service, il faut s'assurer de faire ce qu'il faut pour le patient. Il faut éviter de développer un attachement affectif trop prononcé avec le patient, ce qui risquerait de fausser le jugement. Il y a donc des gens qui s'efforcent d'atteindre ce détachement. Nous avons entendu des femmes nous expliquer cela.
Vous dites n'avoir jamais rencontré de femmes qui sont dans ce cas. Nous, nous en avons rencontré. La question que Mme Davies pose et que je voulais poser moi aussi est celle-ci : On dirait parfois qu'il y en a parmi nous qui croient pouvoir transformer en victimes des gens qui disent ne pas être des victimes. Ces femmes-là disent : « Nous ne choisissons pas d'être des victimes. Nous voulons faire des choix. Si c'est un choix que je fais, pourquoi viendriez-vous me dire que je suis une victime? Pourquoi me diriez-vous ce que je devrais ou ne devrais pas faire, ou quels sentiments je devrais ou ne devrais pas ressentir? » Nous avons entendu cet argument.
J'ai aussi une deuxième question. Vous avez évoqué le modèle suédois, dont vous avez dit du bien. Mais nous aboutissons à ce dilemme, cette hypocrisie, en ce sens que vous dites qu'une femme ne peut pas être criminalisée parce qu'elle vend des services sexuels, mais vous criminalisez l'homme qui les achète. Vous avez créé une situation dans laquelle la femme ne peut pas faire son travail, parce qu'elle se livre quand même à un acte criminel lorsqu'elle a des rapports sexuels avec un homme qui commet, lui, un acte criminel. Nous avons lu des rapports sur des femmes en Suède qui disent qu'elles ne pouvaient pas aller trouver la police pour demander de l'aide lorsqu'elles avaient affaire à un client violent, parce qu'elles ne pouvaient pas dire qu'elles se livraient à cette activité qui, à bien des égards, est mal vue. Enfin, vous ne pouvez pas dire que la moitié d'une personne est une criminelle tandis que l'autre moitié ne l'est pas. Ce n'est absolument pas logique. Beaucoup d'entre elles s'inquiétaient à l'idée qu'on puisse leur enlever leurs enfants. En fait, elles n'avaient aucun recours, aucune protection quand elles en avaient besoin pour se protéger contre un client violent. Elles ne trouvaient donc pas que le modèle suédois était valable.
Ce sont les deux questions que je veux vous poser, car il semble y avoir d'autres arguments que les vôtres de la part des femmes qui travaillent dans le commerce du sexe.
¼ 
 (1825)
(1825)
[Français]


Mme Rose Dufour: Il y a quatre ans, je tenais le même discours que vous parce que j'avais les mêmes préjugés que vous, parce que je n'avais pas l'expérience sur le terrain, parce que les filles elles-mêmes m'expliquaient les avantages qu'elles trouvaient à se prostituer. Il m'aura fallu quatre années de travail intense seulement pour définir le phénomène. Il m'aura fallu quatre années pour comprendre quelles étaient les conséquences de la prostitution, mais surtout, quel était ce mécanisme fondamental qui faisait que, dans la relation de prostitution, ces filles reproduisaient la situation d'abus sexuel, de façon inconsciente bien sûr. Lorsqu'on approfondit ces discours avec elles, elles ne disent plus qu'elles veulent demeurer prostituées. Je n'en connais aucune qui le veuille.
Bien sûr, je sais ce que vous dites, j'entends aussi ces discours.
[Traduction]


L'hon. Hedy Fry: Ce que vous dites, en fait, c'est que ces femmes-là ne savent pas ce qu'elles veulent, qu'elles ne savent pas ce qu'elles ressentent et que vous, vous le savez, que nous le savons mieux qu'elles.
[Français]


Mme Rose Dufour: Non, je ne dis pas cela.
[Traduction]


Hon. Hedy Fry: Je suis médecin et je peux vous dire que je dois accepter ce que mon patient me dit quand il décrit sa réalité. Ce n'est pas à moi de décider que je sais mieux que ma patiente ce qu'elle devrait faire et comment elle devrait se sentir. Si des femmes viennent me dire à répétition qu'elles choisissent de faire cela pour telle ou telle raison, qui suis-je pour leur dire de ne pas le faire? « Je suis d'avis que vous ne devriez pas avoir ce sentiment. Je sais que vous avez tort, que vous n'êtes pas en prise avec vos sentiments profonds ». Cela m'apparaît un peu paternaliste. Dans ce système, vous dites aux gens que vous savez mieux qu'eux ce qu'ils font, comment ils se sentent et ce qu'ils veulent dans la vie.
[Français]


Mme Rose Dufour: Il y a le discours que les filles tiennent et il y a les résultats d'une analyse scientifique fondés sur des critères scientifiques. La science est censée nous permettre d'aller au-delà des préjugés et des apparences. Bien sûr, toute cette recherche est fondée sur la parole de ces femmes. Il n'y en a que 20, ce qui n'est pas un échantillon statistique. Pour la recherche de type qualitatif, nous utilisons comme critère un principe de saturation des données, ce qui revient à dire qu'à un certain point, nous n'obtenons plus de données nouvelles. Je peux vous affirmer que dans le cas de ces 20 femmes, les données que j'ai obtenues concernant la prostitution de rue ont atteint le point de saturation. N'ayant pas les fonds requis pour le faire, je n'ai pas réalisé une recherche exhaustive auprès des femmes qui travaillent comme danseuses érotiques ou dans des agences d'escorte. Pour ce qui est de celles avec qui j'ai travaillé, j'arrive à cette conclusion et je considère que c'est la position que je dois prendre.
Je suis parfaitement consciente que mes recommandations peuvent paraître surprenantes, mais je crois que c'est la voie à prendre. J'ai fait plusieurs conférences depuis la parution de l'ouvrage, et jusqu'à maintenant, j'ai été très touchée par l'attitude des hommes. Je trouve qu'ils font preuve d'une très grande sensibilité à l'égard des conclusions de la recherche, particulièrement en ce qui concerne leur vision de la prostituée et de la prostitution telle que je la décris.
Lors des entrevues, les hommes disaient vouloir que la prostitution soit reconnue comme un métier au même titre que les autres et que c'était la raison pour laquelle ils participaient à la recherche. Je demandais alors à ceux qui étaient pères de famille s'ils seraient d'accord pour que leur fille ou leur fils devienne prostitué. Aucun ne l'était. Je me demande si vous seriez d'accord pour que votre fille se prostitue. Si elle est prostituable, toutes les femmes le sont.
Sans doute avez-vous entendu parler du courriel que j'ai reçu et que je pourrais vous faire parvenir. Il s'agit d'une situation qui a eu lieu en Hollande, où la prostitution est reconnue comme un métier. Une femme qui était au chômage s'est vu offrir un poste dans une agence d'escorte. Elle a voulu refuser, disant que cela ne lui convenait pas, mais on lui a répondu que c'était un métier comme un autre et que si elle refusait ce travail, elle perdrait son allocation d'assurance-chômage.
Pour conclure, je dirai qu'à mon avis, le défi du XXIe siècle sera celui de la dignité humaine. Des débats comme celui que nous tenons sur le statut de la prostitution ainsi que d'autres portant sur la vente d'organes, le clonage des humains et le droit à l'euthanasie en tant que façon de mourir dans la dignité, sont des sujets brûlants, capitaux sur le plan de la dignité humaine.
Cet après-midi, en me promenant sur le boulevard de la Confédération, j'ai vu une énorme sculpture sur laquelle il était écrit que tous les humains sont nés égaux sur le plan de la dignité et des droits. Les 20 femmes avec qui j'ai travaillé ne sont pas nées dans des conditions leur permettant de développer leur dignité. Je ne crois pas que se prostituer soit digne.
Je ne suis pas certaine d'avoir pleinement rendu justice au contenu de ce mémoire en en parlant de vive voix aujourd'hui. Je vous demande donc de le lire.
Merci.
¼ 
 (1830)
(1830)
[Traduction]


Le président: Madame Brunelle, avez-vous des questions?
[Français]


Mme Paule Brunelle (Trois-Rivières, BQ): Madame Dufour, je trouve très intéressant que vous nous parliez de l'abus sexuel comme de la clé, d'un pattern, d'un monnayage. Vous nous dites que la prostituée qui a un corps public n'a plus de corps privé. C'est la première fois que j'entends ce type de discours. Cela vous amène à dire qu'on doit décriminaliser la femme prostituée parce qu'elle est une victime. Or, dans ce cas, je me demande si on peut sortir de la prostitution, puisqu'on va se retrouver avec un syndrome de stress post-traumatique. J'aimerais que vous m'en parliez un peu plus. Que pouvons-nous faire, en tant que législateurs?
C'est difficile de généraliser. Vous définissez un type de femme, une sorte de prostitution. Il y a toutes sortes d'autres choses. Il faudrait certainement qu'il y ait des mesures de soutien. Nous avons à changer la loi. C'est difficile pour moi de faire la part des choses dans tout cela.
Expliquez-moi un peu plus le syndrome de stress post-traumatique dont ces femmes sont victimes.
¼ 
 (1835)
(1835)


Mme Rose Dufour: Je vais utiliser l'exemple de quatre filles à qui on n'a accordé de valeur que sur le plan sexuel, qui ont été victimes d'abus. Pour certaines, l'abus sexuel a commencé à l'âge de quatre ans. Je pense à l'histoire de Jo-Annie, qui commence à être victime d'abus à huit ans et dont la mère est elle-même prostituée.
Tout à l'heure, je vous ai dit que, 17 fois sur 20, elles ont été victimes d'abus sexuels à répétition pendant des années, parfois par plusieurs personnes différentes à l'intérieur de la famille ou dans le proche environnement. Cependant, j'ai oublié de vous dire que 20 fois sur 20, le rapport mère-fille est un rapport déficitaire, problématique. Dans certaines familles, il y a un système structurel producteur de prostitution, lorsque le père est abuseur, que la fille est abandonnée par la mère et que la mère nie l'abus sexuel ou l'inceste par le père ou par les frères. Il y a véritablement une structure. Dans certains cas, comme les quatre premiers, des mots injurieux sont utilisés lors de l'abus. L'enfant est payée par de l'argent, des bonbons, des vêtements, etc. Dans ces cas, elle intériorise une identité de prostituée. Elle n'a donc pas d'alternative possible. Elle ne peut que devenir prostituée.
Dans d'autres cas, il n'y a pas cette intériorisation d'une identité de prostituée, ce que j'ai vu chez six filles, qui ont une sorte de marge de manoeuvre. Elles sont moins marquées. Elles ont comme une possibilité de ne pas se prostituer. Cependant, dans ces cas-là, j'ai pu constater que la proximité à la prostitution était très grande, qu'elles baignaient dans un milieu proche de la prostitution et qu'elles étaient très pauvres. En effet, la prostitution est un phénomène directement lié à la pauvreté des femmes. La toile de fond de la prostitution est toujours le besoin d'argent.
J'ai également vu, dans 12 cas sur 20, que la personne qui fait passer la fille à la prostitution est une amie. Ce sont des femmes extrêmement seules. Lorsque je parle de pauvreté, je ne parle pas seulement de pauvreté économique, mais aussi de pauvreté affective. Ce sont des femmes qui souffrent de carences sur le plan affectif. C'est une pauvreté relationnelle et une pauvreté sociale. Ce sont des femmes extrêmement seules, des femmes qui ont vécu dans des familles d'accueil. La famille d'accueil ne permet pas l'insertion de la personne, parce qu'elle ne lui construit pas de liens ou de réseaux sociaux.
Sur le plan social, j'ai vu à quel point la fin des programmes sociaux lorsqu'elles atteignaient l'âge de 18 ans avait un effet dramatique. Lorsque je parle de la fin des programmes sociaux, je ne parle pas du bien-être social qui, lui, est assuré, mais plutôt de l'encadrement, de l'émulation, de l'aide, du soutien qui sont généralement apportés. Ces filles vont se retrouver, à 18 ans, seules dans la rue, sans encadrement. Elles sont donc tout de suite happées par le système de la prostitution. Dans certains quartiers où la prostitution est très répandue, lorsque la femme est très pauvre, la tentation est grande, car elle a construit une familiarité avec la prostitution, qui est proche et quotidienne.


Mme Paule Brunelle: Certains groupes qui tentaient de réinsérer ces femmes dans la société, entre autres à Vancouver, nous ont dit que cela pouvait prendre de cinq à dix ans. C'est peut-être pour cela que cette femme que vous nous décrivez a besoin de se reconstruire.


Mme Rose Dufour: Le travail de reconstruction est gigantesque. Depuis la sortie de ce rapport de recherche, je suis préoccupée par une seule chose. Comment peut-on appuyer ces femmes? Quels sont les processus qui permettent à ces femmes de sortir de la prostitution?
Je me suis rendue disponible pour les accompagner dans ce cheminement et pour essayer de comprendre comment elles font. Je n'ai aucun budget de recherche. Je le fais en raison de mon engagement personnel, parce que je suis intéressée et préoccupée.
Les femmes disent qu'il est beaucoup plus difficile d'en sortir que d'y entrer. Selon la littérature, pour une année de prostitution, il faut sept années de réhabilitation. Il est certain que sur le plan financier, le rapport à l'argent est très particulier. D'ailleurs, ces femmes ne s'enrichissent pas. Il y a un mythe selon lequel les prostituées font beaucoup d'argent, mais c'est comme de l'argent de Monopoly. C'est un argent souillé, qu'elles dilapident très rapidement.
Bien sûr, il y a des cas d'exception. J'ai moi-même connu certaines femmes qui ont utilisé leur argent pour s'en sortir, mais c'était toujours dans des conditions très particulières. Le processus de sortie était déjà enclenché pour une raison ou pour une autre. Normalement, elles ne capitalisent pas.
Également, la consommation de drogue et d'alcool est inhérente à la pratique de la prostitution. Elles consomment avant pour se donner le courage d'y aller, pendant pour être capables de le faire et après pour oublier. Ces femmes se lavent d'une façon compulsive après. Elles n'arrivent pas à laver cette souillure.
¼ 
 (1840)
(1840)
[Traduction]


Le président: Merci, madame Brunelle.
Madame Dufour, votre temps est écoulé. Nous vous sommes très reconnaissants d'être venue témoigner ici ce soir. Vous nous avez certainement présenté un point de vue peut-être un peu différent de ce que nous avons entendu ailleurs, et c'est ce dont nous avons besoin, d'un éventail équilibré d'opinions. Merci.
[Français]


Mme Rose Dufour: Merci.
[Traduction]


M. Art Hanger: Je n'ai pas tout à fait compris la position de Mme Dufour sur une ou deux questions dont nous avons discuté ici. Premièrement, considère-t-elle que les lois sur le racolage créent une menace?


Le président: Je vous demanderais d'être très bref, monsieur Hanger.


M. Art Hanger: Oui.
Croyez-vous que les lois sur la sollicitation créent un danger pour les prostitués de la rue? Puisque le comité a dépassé cette étape et qu'il a étudié toute la question des bordels, est-ce que les lois interdisant les bordels, l'usage des fruits de la prostitution et les autres lois semblables devraient être invalidées?
[Français]


Mme Rose Dufour: Je n'ai pas la traduction.
[Traduction]


Le président: Veuillez répéter la question, monsieur Hanger.


M. Art Hanger: Il s'agit d'un éclaircissement. On a dit que les lois sur la sollicitation ont forcé les prostituées à faire du racolage dans des endroits dangereux et que ces lois devraient donc être invalidées, qu'on devrait aussi annuler les lois sur les bordels et qu'on devrait aussi faire disparaître les lois sur l'usage des fruits de la prostitution. Qu'en pensez-vous?
[Français]


Mme Rose Dufour: Je veux éviter de commettre une erreur en parlant du contenu de la loi, parce que je ne l'ai pas sous la main. Je voudrais dire que ma position est que le fait de solliciter quelqu'un pour la prostitution, que ce soit par le proxénète ou par le client, doit être criminalisé.


Mme Paule Brunelle: Mais la femme n'est pas une criminelle.


Mme Rose Dufour: Je dois suivre la logique du processus que j'ai mis à jour, à savoir que dans la relation prostitutionnelle, la femme reproduit le mécanisme de l'abus sexuel en se rendant disponible seulement physiquement, puisqu'elle se dissocie sur le plan mental. Je ne la considère pas comme une victime, mais je crois qu'on doit lui venir en aide.
Dans le mémoire, j'explique cela beaucoup mieux.
[Traduction]


Le président: Nous avons la deuxième partie de la question concernant les bordels.


M. Art Hanger: Un petit éclaircissement sur la loi au sujet des bordels; on prétend qu'on devrait annuler la Loi sur la sollicitation et que la prostitution pourrait alors se faire derrière des portes closes dans un environnement plus sécuritaire. Non seulement y a-t-il des gens qui prétendent cela, mais la communauté homosexuelle prétend aussi qu'on devrait annuler les lois sur les maisons closes.
¼ 
 (1845)
(1845)
[Français]


Mme Rose Dufour: Je ne suis pas capable de répondre, parce que je n'ai pas suffisamment saisi la nuance de la question. Je ne suis pas d'accord sur l'idée des zones de tolérance, si c'est ce que vous avancez.
[Traduction]


M. Art Hanger: Non, ce n'est pas vraiment si vous êtes d'accord ou non avec les zones de tolérance, mais plutôt...


Mme Libby Davies: Rappel au Règlement! Je sais qu'au moins deux membres du comité doivent partir à 19 h 30, ce qui mettra fin à notre réunion, et nous empiétons maintenant de 15 minutes sur le temps réservé à nos prochains témoins. Si nous voulons poursuivre le débat, peut-être que nos recherchistes pourront faire le suivi par écrit s'il faut encore des éclaircissements. Nous allons manquer de temps.


Le président: Nous avons aussi commencé en retard. Nous n'avons pas encore dépassé l'heure.
Monsieur Hanger, je crois qu'il nous faudra entendre nos prochains témoins.


M. Art Hanger: Ça va.


Le président: Peut-être pourriez-vous vous entretenir avec le témoin pendant la courte pause qui suit.
Merci, madame Dufour. Très bien, merci.
Une petite pause de 30 secondes, maintenant, pour permettre à nos prochains témoins de prendre place.
¼ 
 (1845)
(1845)
¼ 
 (1847)
(1847)


Le président: Au vu de ce qu'a dit Mme Davies et le fait qu'elle et la Dre Fry, me semble-t-il, doivent partir, nous pourrions peut-être leur faire la fleur de leur laisser poser les premières questions. Nous ferons le tour de table en sens inverse de tout à l'heure, si ça va. Pas de problème? Très bien.
Nos prochains témoins nous viennent d'Égale. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Laurie Arron et Stephen Lock. Merci beaucoup.
Monsieur Arron, je crois que vous allez passer le premier pour ensuite céder la place à M. Lock. Nous consacrons environ dix minutes aux présentations et nous passons ensuite aux questions et réponses pour des périodes d'environ sept minutes par intervenant et, si nous en avons le temps, il y aura ensuite un deuxième tour de trois minutes.
Allez-y, monsieur.


M. Laurie Arron (directeur, Services d'assistance judiciaire, Égale Canada): Merci.
Honorables députés, je m'appelle Laurie Arron et je suis le directeur des services d'assistance judiciaire d'Égale Canada. Il s'agit d'un groupe national canadien qui préconise l'égalité et la justice envers les lesbiennes, les gais, les bisexuels, les transgenres et leurs familles.
Nous sommes heureux de pouvoir intervenir sur les importantes questions traitées par le sous-comité. Notre intervention portera sur les dispositions du Code criminel traitant de l'indécence, dont on se sert pour cibler les saunas destinés aux lesbiennes, gais, bisexuels et transgenres, que nous appellerons en abrégé LGBT.
Je suis accompagnée aujourd'hui par Stephen Lock, un membre du conseil d'administration d'Égale qui habite à Calgary et qui connaît bien la question de l'application du Code criminel à la communauté gaie. Notre exposé comprendra les points suivants : tout d'abord, le rapport entre les dispositions sur la sollicitation et les lois qui criminalisent les rapports sexuels consensuels entre adultes en privé; deuxièmement, la nature et l'historique des saunas pour gais et l'application du Code criminel à ces établissements; troisièmement, un aperçu des lois qui criminalisent les rapports sexuels consensuels entre adultes en privé; quatrièmement, la criminalisation des rapports sexuels consensuels entre adultes en privé dans le contexte de la Charte et cinquièmement, les recommandations d'Égale.
Premièrement, le rapport entre les dispositions sur la sollicitation et les lois qui criminalisent les rapports sexuels consensuels entre adultes en privé. Les lois canadiennes sur la sollicitation sont inextricablement liées à la réglementation générale de la moralité sexuelle. Égale estime que le sous-comité devrait étudier ce contexte social et juridique plus large pour faire des recommandations grâce auxquelles le Canada s'éloignera d'une moralité sexuelle imposée pour devenir une société plus respectueuse de l'autonomie de la personne et consciente du fait qu'une activité sexuelle saine va bien au-delà de ce que permet actuellement le Code criminel.
Depuis longtemps, on se sert des lois et des politiques qui réglementent le comportement sexuel contre les lesbiennes, les gais, les bisexuels et les transgenres, ce qui nous a causé un tort considérable. Ceci est largement dû au fait que la sexualité des LGBT est considérée comme immorale. Le débat actuel sur le mariage entre personnes de même sexe montre bien que de nombreux Canadiens considèrent toujours la sexualité des LGBT comme immorale. Il est également évident que la Charte exige que nos lois ne soient pas fondées sur cette forme de jugement négatif à l'égard des LGBT.
Le fait que les lesbiennes, les gais et les bisexuels soient victimes de harcèlement, de discrimination et de violence à cause de leur attrait sexuel les oblige à y regarder à deux fois avant de révéler leurs tendances et leurs activités. Nous sommes aux prises avec une homophobie sociétale que nous avons internalisée. Finalement, si nous en venons à bout, nous reconnaissons que notre sexualité n'est pas intrinsèquement immorale ou mauvaise; c'est au contraire un élément sain et heureux de notre personnalité. C'est cette perspective qui éclaire le présent exposé d'Égale.
Égale a élaboré cinq lignes directrices en fonction desquelles nous évaluons la réglementation de l'activité sexuelle; elle figure à la page 3 de notre mémoire. Nous les soumettons au sous-comité en tant que critères utilisables pour évaluer les options législatives.
Premièrement, de façon générale, toute interdiction d'activités sexuelles doit se justifier par des motifs précis et convaincants.
Deuxièmement, l'égalité : lorsque les lois et politiques qui régissent le comportement sexuel sont justifiées, elles doivent être écrites et s'appliquer également à tout le monde.
Troisièmement, les normes sociales : les activités sexuelles ne devraient pas être interdites simplement parce qu'elles heurtent les normes sociales de certains ou sont considérées immorales par d'autres.
Quatrièmement, le principe du préjudice : lorsqu'on peut s'attendre raisonnablement à la protection de la vie privée, les activités sexuelles entre adultes consentants qui ne causent pas de préjudice à autrui ne devraient pas être interdites.
Cinquièmement, l'agression sexuelle : Égale reconnaît et affirme la nécessité d'accorder une protection contre le préjudice causé par les agressions sexuelles, en particulier les agressions sexuelles contre les enfants et les adolescents. Ce faisant, le gouvernement devrait éduquer et responsabiliser les adolescents, afin qu'ils puissent faire des choix sexuels sains.
La deuxième partie de notre exposé traite de la nature et de l'historique des saunas et des conséquences du Code criminel. L'expérience et l'expertise d'Égale à propos des dispositions sur les maisons de débauche concernent essentiellement les descentes de police dans les saunas gais, dont M. Lock parlera tout à l'heure. Les saunas gais sont utilisés à des fins sexuelles spécifiques. Dans un sauna, il est possible de se livrer à des activités sexuelles sans prétendre à quelle qu'autre fin. Il n'y a pas de jeu de séduction ni d'attente de quoi que ce soit d'autre. Il y a une compréhension mutuelle entre participants, ainsi qu'un consentement libre et éclairé.
Bien que cet exposé porte essentiellement sur les conséquences du Code criminel pour les saunas gais, Égale souhaite aussi préciser que nous sommes favorables à une décriminalisation de toute activité sexuelle consensuelle entre adultes en privé lorsqu'elle ne cause aucun préjudice, indépendamment de l'identité et de l'orientation sexuelles des participants.
Mon collègue Stephen Lock va maintenant présenter un bref aperçu de la nature et de l'historique des saunas gais et de leur relation difficile avec la police.
¼ 
 (1850)
(1850)


M. Stephen Lock (membre, Conseil d'administration, Égale Canada): Je vous remercie de nous accorder votre attention. J'aimerais vous donner un bref aperçu de l'environnement physique d'un sauna gai ordinaire, puis vous parlez des conséquences des accusations en vertu des dispositions sur les maisons de débauche pour ceux qui en sont victimes.
Ceux qui ne fréquentent pas ces établissements, qu'ils soient eux-mêmes gais ou lesbiennes ou hétérosexuels, supposent généralement que dès qu'on entre dans un tel établissement, on assiste immédiatement à des activités sexuelles. Ce n'est nullement le cas. Tous ces établissements exercent un contrôle à l'entrée, autant à des fins de protection contre le harcèlement ou la violence à l'égard des clients qu'afin de faire payer l'utilisation des locaux, des casiers, la distribution des serviettes , etc. Il y a généralement au moins une porte à franchir pour y pénétrer, et il y en a souvent plusieurs. Une fois l'entrée franchie, on trouve souvent un salon, un foyer ou un bar situé immédiatement à l'entrée, les salles et les casiers étant situés plus loin. L'aménagement même d'un établissement de sauna en fait un endroit parfaitement contrôlé et donc, à notre avis, privé.
On insistera jamais trop sur les conséquences d'une accusation en vertu des dispositions sur les maisons de débauche. Le simple fait d'être présent lors d'une descente de police peut entraîner des accusations criminelles. Il n'y a pas à prouver que la personne participait à des activités illégales ou indécentes pour l'accusé. La simple présence suffit pour porter une accusation.
Le tort causé par cette accusation est incalculable. Lors de la descente de police contre l'établissement Goliath de Calgary en décembre 2002, l'un des treize accusés était simplement entré dans l'établissement en se rendant à son travail afin de restituer une cassette vidéo qu'il avait emprunté à un ami qui travaillait au bar. Il était resté au bar pour discuter avec lui avant de se rendre à son travail.
L'un des autres accusés, Terry Haldane, qui a refusé d'opter pour la déjudiciarisation et qui avait l'intention, avant que son accusation ne soit suspendue 23 mois plus tard, d'invoquer la Charte pour contester ces dispositions, a été victime de stress, d'angoisse, de crises de panique et de dépression. Il a dû être hospitalisé à deux reprises pour des crises d'angoisse, alors qu'il avait fait une crise cardiaque un an avant la descente de police. Les avocats d'Haldane lui ont conseillé de renoncer à ses fonctions au sein d'un comité de santé et sécurité communautaire de quartier auquel siégeaient également des membres de la brigade mondaine, afin de ne pas nuire à sa cause.
L'un des hommes initialement accusé d'être tenancier d'une maison de débauche, et qui travaillait à temps partiel à l'entrée pour financer ses études, a craint de voir compromise sa carrière de travailleur social auprès de jeunes à risque. Les accusations portées contre lui ont été abandonnées par la suite, mais seulement plusieurs mois plus tard.
Le directeur de l'établissement a dû renoncer à ses activités à cause de problèmes de santé résultant de cette épreuve, et il souffre toujours de crises de panique. Le propriétaire craint une nouvelle descente de police; il est très endetté actuellement il a subi un manque à gagner de près de 250 000 $ et il dot se faire soigner par un thérapeute.
Sur les 13 hommes accusés, 12 ont opté pour la déjudiciarisation afin de préserver leur vie privée, leur carrière, leur famille et leur image dans la collectivité où ils vivent. La plupart de ces hommes n'avaient pas révélé leur orientation sexuelle. Plusieurs d'entre eux étaient des hétérosexuels mariés et pères de famille, plusieurs d'entre eux étaient membres d'une minorité visible. Même s'il est caractéristique de la population qui fréquente les sauna gais, une partie importante de la clientèle de ces établissements ne s'affiche pas comme gais. Son seul rapport avec la communauté homosexuelle masculine consiste à fréquenter un sauna gai.
Comme aucun sauna gai n'avait fait l'objet d'une descente de police au cours des 23 années qui ont précédé la descente au Goliath, on considérait que ces établissements bénéficiaient à tout le moins d'une approbation tacite et qu'on pouvait donc les fréquenter en toute sécurité. Le fait que cette sécurité ait été violée a créé un stress énorme parmi les victimes des descentes de police ainsi que dans l'ensemble de la communauté gaie. Les saunas fonctionnent depuis des années en tant qu'entreprises légitimes qui payent des impôts, obtiennent des permis municipaux en bonne et due forme, contribuent à la vie de la collectivité, se conforment à la législation du travail en vigueur et offrent un service important et indispensable à la communauté homosexuelle.
La communauté gaie, lesbienne, bisexuelle et trans-genre s'est toujours méfiée de la police et à Calgary, le service de police et plusieurs membres de la communauté GLBT se sont appliqués à faire disparaître cette méfiance. La descente contre le club Goliath a causé un tort profond et sans doute irréparable aux relations entre la communauté GLBT de Calgary et le Service de police de la ville.
¼ 
 (1855)
(1855)
Comme l'a dit M. Arron, le fait que les lesbiennes, les gais et les homosexuels sortent maintenant de la clandestinité porte bon nombre d'entre nous à revoir nos attitudes, notre sexualité et notre façon de la concevoir, et cela de façon fort profonde. Dans la collectivité, cela conduit souvent à mieux comprendre que notre sexualité est une composante tout à fait saine de notre identité.
Ce qui se passe dans l'intimité des saunas pour les gais ne porte préjudice à personne, et toute activité sexuelle qui s'y déroule ne devrait donc pas tomber sous le coup du code pénal puisque rien ne prouve que ce genre d'activité soit nuisible.
Je vous remercie.


Le président: Merci beaucoup, monsieur Lock.
Allez-vous poursuivre, monsieur Arron?


M. Laurie Arron: Si vous voulez bien, oui.
½ 
 (1900)
(1900)


Le président: D'accord, mais alors très rapidement parce que les dix minutes sont déjà écoulées.


M. Laurie Arron: C'est vrai? Très bien. Je vais donc essayer d'être bref.
Il existe dans le Code criminel deux dispositions qui intéressent les saunas fréquentés par les LGBT. La première de ces dispositions est celle qui concerne les maisons de débauche. La seconde disposition qui permet de s'en prendre aux saunas est l'alinéa 173(1)a) qui punit l'acte indécent commis dans un endroit public. En l'occurrence, le problème est ici que la définition de ces endroits publics englobe également certains lieux qui sont totalement à l'abri des regards, les saunas par exemple, comme l'a dit M. Lock. C'est la raison pour laquelle la Charte pose ici problème étant donné l'étendue excessive de cette disposition. Par ailleurs, le Code criminel ne définit nulle part ce qu'est un acte indécent, de sorte que les tribunaux ont beaucoup de latitude pour en juger.
La troisième disposition qui pose problème est l'article 159 qui punit de façon particulièrement rigoureuse le coït anal qui n'est permis par la loi que dans certains cas très limités, mais en excluant les saunas. L'article 159 a été jugé inconstitutionnel par la Cour d'appel de l'Ontario en 1995 et par la Cour d'appel du Québec en 1998. Or, le Parlement n'a pas encore abrogé cette disposition. Il n'y a aucune raison pour que le Code criminel s'en prenne ainsi à ce genre d'acte sexuel, d'autant plus qu'en le mettant ainsi en exergue, il stigmatise les gais et les bisexuels de sexe masculin.
La façon dont la législation canadienne réglemente les activités sexuelles entre adultes consentants a évolué avec le temps. À l'origine, nos lois reposaient essentiellement sur des canons moraux mais, au fil du temps, les tribunaux ont délaissé la norme de la communauté pour pencher plutôt vers la notion de préjudice. Toutefois, dans la réalité des choses, les juges préfèrent souvent leurs propres opinions conservatrices du préjudice lorsqu'ils sont appelés à déterminer si un acte est bien indécent. Cet état de choses conduit à un second problème découlant de la Charte, en l'occurrence le problème du flou que présente la loi et le fait que la population est incapable de déterminer avec tant soit peu de raison qu'elle est la ligne de démarcation que trace la loi entre un acte sexuel autorisé et un acte sexuel à caractère criminel.
Étant donné que les corps policiers continuent à s'en prendre à la communauté homosexuelle sous couvert des dispositions légales concernant les maisons de débauche, il ne faudra sans doute guère attendre longtemps pour voir ces dispositions contestées en vertu de la Constitution. Cette contestation reposera sur une allégation d'infraction aux articles 7 et 15 de la Charte. Les lois qui punissent l'indécence seront donc contestées puisqu'elles sont contraires à l'article 7 de la Charte en ce sens qu'elles entravent la liberté individuelle au mépris des principes de la justice fondamentale. Lorsque quelqu'un est passible d'emprisonnement pour une raison injuste, la notion de liberté est automatiquement en cause. En l'occurrence, on soutiendrait que l'autonomie de l'individu n'est pas respectée que la loi est arbitraire, qu'elle est vague et qu'elle est aussi d'une application trop large. Le mouvement Egale soutient que les dispositions qui interdisent les actions indécentes commises en privé ou dans une maison de débauche sont viciées pour toutes ces raisons et que les dispositions qui interdisent le coït anal le sont de la même façon, si ce n'est qu'en l'occurrence, la loi ne saurait être qualifiée de vague.
Je pense ainsi avoir expliqué pourquoi ces dispositions ne respectent pas l'autonomie individuelle, pourquoi elles sont vagues et excessivement générales. Elles sont également arbitraires parce qu'elles pénalisent des actes qui ne portent préjudice à personne.
Un principe qu'on cite souvent dans le cas de l'article 7 de la Charte est celui qui veut, de façon plus générale, que l'État doive respecter les choix individuels et éviter dans toute la mesure du possible de subordonner ces choix à une conception plutôt qu'une autre de ce qu'est une vie saine. Ce que dit ainsi la Cour suprême signifie que la Charte empêche l'individu de se voir imposer les valeurs d'autrui sans raisons valables, ce qui est le cas en l'occurrence.
S'agissant des relations sexuelles librement consenties entre adultes et qui se déroulent en privé dans les saunas et d'autres établissements fréquentés par les LGBT à l'abri des regards, il n'y a absolument rien qui puisse prouver que ces relations puissent représenter un préjudice pour la société.
Je ne vais pas exposer en détail le problème que présente l'article 15, si ce n'est pour vous dire qu'étant donné le stigmate qui est déjà associé à l'homosexualité, les normes de la communauté sont intrinsèquement biaisées au détriment des lesbiennes, des gais et des personnes bisexuelles. Porter un jugement sur un comportement sexuel en fonction d'une norme de ce genre entraînera inévitablement un traitement préjudiciable.
Je vais passer à nos recommandations.
À notre avis, le Parlement devrait prendre l'initiative de revoir et d'abroger, ou encore de remanier les lois concernant les actes indécents et abroger également la disposition qui pénalise le coït anal. Il ne faut pas, car ce n'est pas nécessaire, que le Parlement attende que ces lois injustes soient contestées devant les tribunaux, il faut au contraire qu'il prenne immédiatement sur lui de remédier à la situation et de lever l'opprobre dont font l'objet ces établissements sinon parfaitement licites. Selon nous, le Parlement devrait boucler la boucle de l'évolution et, au lieu d'imposer à l'individu la morale d'autrui, adopter plutôt une attitude qui respecte l'autonomie individuelle et qui ne pénalise un acte sexuel entre adultes que si cela est justifié de façon péremptoire et véritablement probante.
Nous vous remercions de nous avoir permis de vous faire cet exposé et nous répondrons maintenant volontiers à vos questions.


Le président: Merci, monsieur Arron.
Madame Fry, vous avez sept minutes, pour des questions et les réponses.


L'hon. Hedy Fry: Merci beaucoup.
Que proposeriez-vous par rapport à la définition actuelle d'un endroit public? Comment pourrait-on changer la définition pour qu'elle n'englobe plus les saunas publics et les activités privées consensuelles qui y ont lieu? Avez-vous des définitions à nous proposer pour le terme « endroit public »?


M. Laurie Arron: Nous n'avons pas formulé d'autres libellés à vous proposer. Nous serions ravis de le faire, mais vous disposez sans doute de plus d'avocats que nous. Cependant, l'aspect important c'est que le problème ne se pose pas par rapport au fait que le public y a accès de droit. La question est de savoir si ces activités se font loin du regard du public et si la population peut voir ce qui s'y passe, sans le vouloir. Donc je proposerais que l'on supprime le libellé qui prévoit que le public a accès de droit et je définirais « endroit public » comme un lieu où le public peut voir ce qui s'y passe.


L'hon. Hedy Fry: Cela me rappelle ce couple d'en face qui regardait dans la chambre à coucher d'un autre couple avec des jumelles et qui parce qu'il n'aimait pas ce qu'il voyait, avait accusé ce couple d'actes indécents. Évidemment, le tribunal a rejeté la plainte et déclaré que même si c'est à la vue du public, il faut reconnaître qu'il s'agit aussi d'un établissement privé.
L'autre question que je veux vous poser porte sur la loi concernant les maisons de débauche. Comme vous le savez bien, cette loi s'applique lorsqu'il y a plus de deux personnes qui font commerce de sexe. Estimez-vous qu'un sauna gai vend des actes sexuels? Pensez-vous que dans tous les cas, qu'il faille considérer un sauna gai...? J'aimerais savoir pourquoi la police y fait des descentes, qu'il s'agisse d'un club ou d'un endroit où les gens vont boire un café, se retrouver, etc. et se livrer ou non à des actes sexuels. Je n'ai pas l'impression que c'est comme une maison de débauche où l'on sait qu'on y va pour acheter les faveurs de quelqu'un, pour s'adonner à un acte sexuel.
C'est une des choses que je voulais vous demander. Pensez-vous que la Loi sur les maisons de débauche devrait être complètement abrogée afin qu'il y ait en fait un endroit où l'on puisse aller pour avoir des relations sexuelles en toute sécurité sachant, et je ne sais pas si vous avez entendu le dernier exposé quant aux risques que courent les prostituées de la rue? Que penseriez-vous que l'on déclare qu'une maison de débauche est un endroit où l'on peut se livrer à ce genre d'actes de façon moins dangereuse?
½ 
 (1905)
(1905)


M. Laurie Arron: Tout d'abord, je dois dire que Egale n'a pas de position sur la prostitution ou le commerce sexuel. Nous ne pourrions le faire avant de consulter ceux qui sont touchés, notamment les travailleurs du sexe, les propriétaires de clubs, les clients. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et coûte cher et nous ne sommes qu'une petite organisation si bien que nous n'avons pas eu la possibilité d'examiner cela. Toutefois, les lignes directrices adoptées par Egale, les cinq lignes directrices dont je parlais, pourraient aider dans ce sens. Nous n'avons tout simplement pas pu examiner les faits et les conséquences.
Je dirais, toutefois, que pour ce qui est de la disposition touchant l'indécence dans la définition d'une maison de débauche ordinaire, il n'est pas du tout nécessaire que l'argent change de mains. En fait, dans les saunas gais, il n'y a habituellement pas de transactions monétaires. Ce n'est pas cela. Ce qui est important, c'est que c'est un endroit où vont les gens pour non pas gagner de l'argent ou en payer mais pour avoir une relation consensuelle.
Cet élément-là devrait donc être abrogé parce qu'il y a d'autres dispositions qui portent sur l'indécence publique, l'indécence qui est réellement publique, pas derrière des portes closes. Nous estimons que les relations sexuelles derrière des portes closes ne devraient pas être criminalisées sans raison spécifique ou impérieuse , ce qui d'après nous, n'est pas le cas des saunas gais.
Je crois qu'il appartient au comité de décider s'il existe des circonstances dans lesquelles il y a une raison spécifique ou impérative de criminaliser ces relations, s'il y a une preuve évidente de préjudice et, si le comité en arrive à cette conclusion, qu'il recommande que les dispositions touchant les maisons de débauche soient mieux adaptées à ces situations.


L'hon. Hedy Fry: J'ai donc une dernière question.
Nous avons entendu beaucoup de choses de beaucoup de témoins. Nous avons parlé à beaucoup de gens d'un bout à l'autre du pays. On ne nous a pas beaucoup parlé de la prostitution chez les hommes, ou des hommes qui vendent des services sexuels aux hommes. Typiquement, on ne parle que de femmes qui vendent des services sexuels, ou de femmes qui sont des victimes. Je pense qu'on aimerait entendre parler un peu plus des hommes.
Pensez-vous pouvoir nous en parler maintenant? Quel est le facteur de causalité, quelles sont les raisons? Pour les hommes qui vendent des services sexuels dans la rue, ou plutôt les garçons—je pense que nous sommes tous d'accord qu'il s'agit d'enfants et de jeunes—est-ce que les facteurs de causalité sont les mêmes? Est-ce qu'ils le font pour les mêmes raisons? Est-ce pour des raisons de survie, de toxicomanie? Est-ce que ce sont toutes les mêmes raisons, ou est-ce qu'il y a différentes causalités pour les hommes, par opposition aux femmes?


M. Stephen Lock: Encore une fois, Égale n'a pas eu l'occasion de se pencher là-dessus, faute de ressources. Nous sommes un petit organisme, et nous avons déjà assez de pain sur la planche dans les communautés gaies, lesbiennes, bisexuelles et trans-identifiées.
Cela dit, à la lumière de certains des projets auxquels j'ai participé à Calgary, il semble bel et bien y avoir une différence sur le plan de la causalité entre les hommes qui se prostituent et les femmes. La dynamique semble quelque peu différente. Je ne suis pas tout à fait au courant des aspects de la causalité. Il y a eu très peu de recherches sur la prostitution chez les hommes en Amérique du Nord en général, et seulement une à ma connaissance au Canada, faite par M. McIntyre à Calgary. Ce livre-là est censé paraître à l'automne, je crois.
½ 
 (1910)
(1910)


L'hon. Hedy Fry: Merci.


Le président: Libby Davies, s'il vous plaît.


Mme Libby Davies: Merci beaucoup d'être venu.
Très rapidement à ce sujet, après les audiences que nous avons eues partout au Canada, je dirais qu'un des groupes qui est probablement les plus marginalisé et le plus sujet à la discrimination, quelles qu'en soient les causes, sont les transgendéristes. Nous avons entendu certaines histoires tout à fait alarmantes concernant ce groupe.
J'en resterai là car j'aimerais revenir aux cinq points sur lesquels vous vous êtes penché. C'est très utile pour nous parce que nous voulons en effet parler de principes. Il y avait tellement à dire qu'il est nécessaire de faire ressortir les principes dont nous débattons ici et je dirais que vous en avez fait ressortir quelques-uns.
Je conviens que la question des normes sociales est extrêmement problématique. On parle souvent de ces normes. Alors quelles sont ces normes? Ce sont les normes de quelle société et qui servent à quelle fin? Alors, je suis bien d'accord, l'idée qu'il y ait une telle norme, que simplement parce que certaines personnes sont choquées par le comportement d'autres, il faut une norme et que cet acte devient illégal...
Par contre, le principe de préjudice me semble réellement important et il est intéressant de constater, à la simple lecture de votre mémoire, que si l'on applique la norme sociale, ce principe en faisait partie dans le procès de 1993. Je me demande alors s'il nous faut définir ce que nous entendons par « préjudice ». Cela peut également être interprété assez largement.
À la fin de votre mémoire, vous parlez de ce que vous aimeriez voir aboli dans les divers articles. Vous dites : « Les activités sexuelles ne devraient être interdites que s'il y a risque de préjudice », ce sur quoi je serais en général d'accord. Il faut savoir ce qui est consensuel et ce qui ne l'est pas, quels préjudices peuvent exister ou non. Mais nous faut-il effectivement définir cela davantage?
Je n'étais pas au courant de cette affaire mais il est évident qu'ils ont invoqué le principe du préjudice pour établir le lien avec une norme sociale. Je me demande si vous y avez réfléchi et si vous pensez que nous devrions en fait définir davantage cela.


M. Laurie Arron: Bien que les tribunaux aient beaucoup parlé de préjudice, nous constatons souvent que c'est surtout le point de vue personnel des juges et ce qui leur semble le bon sens. Ils décident des faits sans preuve réelle et je crois que c'est là qu'est le problème.
Vous avez peut-être entendu parler des affaires Labaye et Kouri au Québec. Il y a eu des descentes similaires dans deux clubs de Montréal. Il s'agissait dans les deux cas de clubs hétérosexuels. La Cour d'appel du Québec, dans ces deux cas distincts, a rendu une décision l'été dernier exactement le même jour. Pour les deux affaires, il y avait des groupes de trois juges et deux de ces trois juges étaient les mêmes mais ils ont rendu des décisions diamétralement opposées. Le juge qui n'était pas le même a pris une décision différente dans les deux cas.
Si on examine donc les motifs, on constate que les différences factuelles ne sont pas en fait ce qui importe. C'est seulement qu'il s'agit de juges différents qui ont des points de vue différents de ce qui est préjudiciable et de ce qui ne l'est pas.
Je dirai que ce qui est important c'est de ne pas essayer de dire : Voici ce que le Parlement juge préjudiciable et voici ce qu'il juge non préjudiciable. Il serait préférable d'imposer des normes de preuve. Ainsi, on ne pourrait pas simplement présenter un argument qui semble sensé à un juge et qui relève souvent plutôt de la moralité. Les actes pourraient être considérés comme préjudiciables seulement si c'est prouvé.


Mme Libby Davies: D'accord. Je ne suis même pas sûre de ce que signifie « normes de preuve ». Cela peut être très difficile.
Ce qui se produit en vertu de la Loi sur les maisons de débauche, dans les saunas gais, n'est pas une question d'échange d'argent, c'est parce que cela inclut « et actes indécents », c'est ça?
½ 
 (1915)
(1915)


M. Laurie Arron: Oui.


Mme Libby Davies: Pour revenir ainsi à ce que disait Mme Fry, ce n'est pas l'argent qui compte, c'est l'« indécence ». Si nous voulons aller plus loin, si nous parlons d'une norme de preuve, je crois qu'il faudrait expliquer davantage ce que vous entendez.


M. Laurie Arron: Par exemple, dans les affaires Labaye et Kouri, on a identifié entre autres le risque de maladies transmissibles sexuellement. Qui dit activité sexuelle dit risque de maladies transmises sexuellement. Il me semble très arbitraire de conclure qu'on ne doit pas se soucier de ce risque si l'activité sexuelle a lieu dans certaines situations mais pas dans d'autres et que le risque de maladies transmises sexuellement devrait exclure les activités sexuelles dans certaines circonstances mais pas dans d'autres. Selon un des juges, les actes dont on s'est plaint étaient indécents en raison de ce risque. On a dit que l'existence d'un effet nuisible prouve que l'acte est indécent. À notre avis, cela ne suffit pas.


Mme Libby Davies: Est-ce qu'il me reste assez de temps pour poser une dernière courte question?


Le président: Oui, très brièvement.


Mme Libby Davies: Considérons le revers de la médaille, si on dit qu'un acte devrait être interdit seulement s'il existe un risque de préjudice, allons-nous recourir à d'autres lois pour le définir? Par exemple, si quelqu'un est violenté ou maltraité, s'il y a des activités apparentées à l'esclavage—certains témoins nous en ont parlé— êtes-vous d'avis à Egale, qu'il existe d'autres dispositions qui s'appliqueraient parfaitement, si on abrogeait ces dispositions-ci, aux mauvais traitements et aux autres formes de préjudice qui existent?


M. Laurie Arron: Nous n'avons pas repéré de préjudices dans les saunas gais ou ailleurs qui donnent lieu à des accusations d'actes indécents ou d'outrage à la pudeur. Si nous avons inclus le principe de préjudice, c'est parce que nous n'avons pas l'expertise nécessaire pour affirmer qu'il n'existe aucune situation de préjudice véritable. Nous recommandons donc l'abrogation des dispositions sur l'indécence dans les lois concernant les maisons de débauche et celle sur des actes indécents, à moins que le comité puisse définir un préjudice précis et grave associé à ces activités.


Le président: Merci, madame Davies.
Madame Brunelle.
[Français]


Mme Paule Brunelle: Bonjour, messieurs.
Bien sûr, on parle des dispositions sur l'indécence. Mais s'il y a une chose difficile à définir, c'est bien l'indécence. Pour certains, c'est une chose; pour d'autres, c'en est une autre. Pour nous, en tout cas, il est difficile de voir où en est rendue la société canadienne.
En ce qui concerne les bains publics et les saunas, pourrait-on connaître l'ampleur du phénomène? Y en a-t-il dans toutes les grandes villes?
[Traduction]


M. Stephen Lock: Dans la plupart des grandes zones urbaines au Canada et aux États-Unis il y a au moins un bain turc ou sauna gai, quelquefois plus. Il y en a deux à Ottawa.
[Français]


Mme Paule Brunelle: Ah, bon!
On dit que ces établissements sont légaux. Dans ce cas, pourquoi la police a-t-elle fait de telles descentes? Selon vous, est-ce de l'abus de pouvoir de la part de la police, ou bien est-ce parce qu'il y a de la prostitution cachée dans ces bains publics et ces saunas?
[Traduction]


M. Laurie Arron: La police y a fait une descente et a porté des accusations en vertu de ces dispositions parce que ces dispositions existent. Comme Stephen l'a dit, il n'y a pas eu de descente pendant bien des années. C'est une de ces lois qui existent toujours et dont on ne devrait pas vraiment se servir, certainement pas dans ce contexte. Quand même, si quelqu'un porte plainte ou si un agent de police quelconque décide de lui-même qu'il y a violation de l'article 210 du Code criminel, c'est suffisant pour justifier la descente. Voilà le problème.
À notre avis, il n'y a aucune raison valable, et il ne faut surtout pas invoquer le bien de la société, pour accuser qui que ce soit dans ces établissements.
½ 
 (1920)
(1920)
[Français]


Mme Paule Brunelle: Vous avez parlé de la cause du club d'échangistes de Montréal qui va être jugée par la Cour suprême. On voit de plus en plus de sexe sur nos écrans à toute heure du jour et même très tôt le soir. Il y en a de plus en plus sur Internet.
Malgré cela, avez-vous l'impression que notre société est devenue plus homophobe et moralisatrice?
[Traduction]


M. Laurie Arron: Non. Je crois que la société prend un virage dans l'autre direction. Dans les cas Kouri et Labaye—la Cour suprême entendra ces causes bientôt—il ne s'agit pas d'homophobie parce que, dans ces cas-là, il s'agit d'actes hétérosexuels qui ont eu lieu derrière des portes closes.
L'important ici c'est de savoir qu'il s'agit de lois qui, à notre avis, sont en contravention de l'article 7 de la Charte et, en ce qui concerne les gais, l'article 15 de la même Charte. Je crois que votre comité doit non seulement tenir compte de ce que veulent les Canadiens mais aussi du fait que le Parlement doit faire de son mieux pour s'assurer que ces lois sont compatibles avec la Charte.


Le président: Monsieur Hanger, sept minutes, y compris questions et réponses.


M. Art Hanger: Merci, monsieur le président.
Pendant que vous faisiez votre exposé, je pensais mettre cela sur la table avec tout ce qui s'y trouve déjà lorsqu'il s'agit de prostitution et de choses du genre. Après avoir tout secoué dans le même cornet et jeté les dés sur la table, il n'y a rien là, c'est-à-dire que toute loi traitant d'agression sexuelle ou de quelque aspect de la sexualité que ce soit serait abrogée si nous devions donner une réponse positive à toutes ces demandes et recommandations qui nous sont faites par ceux qui présentent leur cas devant nous. Vous ne faites pas exception.
Vous voulez que soit abrogée la Loi sur les maisons de débauche. Je peux vous donner toutes sortes de raisons pour ne pas le faire, mais c'est dans votre exposé : vous voulez que cela disparaisse. Plus précisément, vous voulez voir disparaître l'article 159 traitant de coït anal ainsi que la mention d'actes indécents. Comme vous l'avez souligné vous-même, la question demeure entière : Fait-on cela pour le bien de la collectivité? Je parle de la collectivité au sens large. Je ne comprends pas comment cela peut se faire pour le bien de la société en général. La société canadienne ne sera pas meilleure pour avoir abrogé ces lois. Vous y trouverez peut-être votre profit, mais il nous faut voir les choses dans un contexte beaucoup plus large que le vôtre.
Je me demande ce qui restera de nos lois si le comité agit comme le veulent tous les témoins. Je me demande parfois si tous les exposés que nous avons entendus depuis... Combien de réunions avons-nous tenues jusqu'ici?


Mme Libby Davies: Vingt-cinq.


M. Art Hanger: Vingt-cinq. On dirait que les dés sont pipés en faveur de l'abrogation de toutes ces lois, non? Oui, toutes celles qui ont affaire à la moralité. À vrai dire, c'est comme cela que ça s'appelait dans le Code criminel.
Mettez-moi au parfum, messieurs. Que restera-t-il de nos lois si nous abrogeons toutes les lois que vous nous proposez?


M. Laurie Arron: Nous ne proposons pas que le Parlement abroge tous les articles du Code pénal traitant d'activités sexuelles. On ne devrait tout simplement pas criminaliser les activités qui ont lieu derrière des portes closes et entre adultes consentants.
Dans nos recommandations, nous soulignons toutefois que s'il existe des raisons précises et convaincantes pour les garder ou les modifier plutôt que de les abroger, alors il vous faut le faire. S'il y a des raisons précises et convaincantes, c'est à vous de les trouver; quant à nous, nous n'en avons trouvé aucune.
Les lois dont nous recommandons l'abrogation sont très précises. Il n'y est pas question de comportement non consensuel. Il n'y est pas question d'agression sexuelle. Il n'y est pas question d'actes sexuels en public. Il n'y a rien concernant les enfants. Je crois que les lois dont nous recommandons l'abrogation ou la modification sont très précises.
Pour ce qui est de l'article 159, deux cours d'appels provinciales, celles de l'Ontario et du Québec, ont déjà annulé cet article. Pour ce qui est de cet article, je crois qu'il est important pour le bien de la société que l'on voie que le Parlement respecte bien la Charte. Je crois qu'il incombe au Parlement d'abroger cet article.
Comme je l'ai dit, il n'y a aucune raison qui permette de pointer du doigt une activité sexuelle donnée. Cette activité sexuelle précise ne nuit pas au grand public alors pourquoi la particulariser lorsqu'il y a toute une série de dispositions qui traitent de toutes les activités sexuelles, y compris celle-là? Pourquoi la particulariser et lui réserver un traitement particulièrement sévère et astreignant?
½ 
 (1925)
(1925)


M. Art Hanger: Je crois que le dernier mot revient au grand public et non pas aux tribunaux. Je sais que notre population a tendance à toujours s'en remettre à la Charte. À mon avis, la Charte camoufle une multitude de péchés. Les politiciens s'en sont servis exactement pour cela.
Cela me pose un problème, personnellement. Je veux bien écouter ce qu'ont à dire les tribunaux—nous devrions et devons le faire, à titre de députés—mais en bout du compte, le public doit avoir le dernier mot. Enfin, qui a vraiment le dernier mot?


M. Laurie Arron: À mon avis, il est important que le Parlement respecte la loi. Je crois que si le Parlement veut garder l'article 159 dans le Code criminel, il devra modifier ce dernier en y introduisant un article dérogatoire.


M. Art Hanger: L'article dérogatoire pour l'article 159 à propos du coït anal?


M. Laurie Arron: Exactement, puisque l'article a déjà été abrogé. Je crois que les autres dispositions seront abrogées aussi, mais ce n'est pas encore le cas.


M. Art Hanger: Peut-être. Je crois que notre pays a besoin d'un bon débat sur toutes ces questions.
Une voix: C'est ce qu'on fait maintenant.
M. Art Hanger: Je ne suis pas de cet avis. Je crois que nous sommes soumis à la pression de certains groupes d'intérêt qui tiennent à avancer leur cause, mais il n'y a pas eu de bons débats publics encore et je crois qu'il nous en faut un.
Vous avez parlé d'une ligne de démarcation en droit. Dites-m'en un peu plus—l'avis du grand public...


M. Laurie Arron: Il y a cette idée que les lois doivent être rédigées de façon à ce que le grand public comprenne clairement quand est-ce qu'un comportement franchit la ligne de démarcation en droit et se transforme en comportement criminel. Parce qu'il n'y a pas de définition d'acte indécent et parce que les juges imposent souvent leur propre moralité ou leur propre perception, il est très difficile de savoir quand cette ligne est franchie. Il y a un principe directeur qui régit la rédaction de nos lois : elles doivent être rédigées de façon à ne pas être indûment vagues.


M. Art Hanger: Acte indécent : le gars debout au coin de la rue en train de se masturber pendant qu'une famille passe devant lui en automobile dans la rue avec des enfants à bord—est-ce un acte indécent?


M. Laurie Arron: C'est prévu à l'article 173. Je pourrais vous en citer le libellé exact, mais je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Vous y trouverez des articles traitant d'outrage public à la pudeur. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici. Votre exemple sert donc à illustrer qu'il y a d'autres dispositions dans le Code criminel qui traitent de ce genre de choses.


M. Art Hanger: C'est un acte indécent.


M. Laurie Arron: Pardon?


M. Art Hanger: C'est un acte indécent. Lorsque j'étais policier, j'ai déjà porté ce genre d'accusation.


M. Laurie Arron: Mais il y a une différence entre un acte indécent, comme vous dites, qui se passe en privé et un qui se passe en public. Quand cela se passe en public, c'est bien facile d'en constater les conséquences nuisibles, comme vous l'avez dit.
On ne dit pas qu'on devrait pouvoir faire tout ce qu'on veut au vu et au su du grand public. Nous disons que derrière des portes closes, des adultes consentants devraient pouvoir poser tout geste sexuel qu'ils veulent à moins que vous ne puissiez nous prouver clairement et de façon convaincante que cela porte préjudice à quelqu'un.


Le président: Merci, monsieur Hanger.
Nous aurons maintenant des tours de trois minutes.
Madame Fry.
½ 
 (1930)
(1930)


L'hon. Hedy Fry: Ce que vous dites me semble assez clair. Comme le dit Libby, ces cinq principes méritent qu'on s'y attarde et le concept du préjudice en est un qu'il nous faut aborder de façon très claire parce qu'un préjudice pourrait facilement... Même si cela se passe en privé, un préjudice constitue quand même une violence. Il y a préjudice si l'on exploite une personne en l'enfermant dans un endroit privé pour faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire. L'esclavage dont parlait Libby, exploiter les gens parce qu'ils sont accrochés à la drogue, les gens qui se prostituent pour survivre—voilà toutes sortes de choses qui constituent un préjudice.
La question des MTS est excellente, parce qu'une MTS est préjudiciable, mais si une des raisons pour lesquelles nous acceptons les descentes de police dans les saunas gais, c'est la présence de MTS, alors je crois qu'il y a beaucoup d'adolescents qui se promènent dans la rue qu'on devrait arrêter sur-le-champ parce que beaucoup d'adolescents ne s'inquiètent pas d'attraper une MTS pendant leurs relations sexuelles et quant à la contraception...
Alors vous avez absolument raison, à mon avis. Ce sont là de bonnes politiques et de bons principes à étudier. Je n'ai pas vraiment de questions à poser; je m'en tiendrai à dire que les principes sont importants pour le comité lorsqu'il s'agit de définir ce qui constitue un préjudice et où la ligne de démarcation en droit doit être tirée.


M. Laurie Arron: Pour ce qui est des MTS, si c'est là le préjudice qu'on identifie, la loi devrait cibler ce préjudice précisément; et ne pas dire simplement qu'un préjudice peut exister dans une centaine d'endroits et ensuite en choisir un ou deux pour les criminaliser.
Dans les saunas gais, on distribue habituellement de la documentation sur les pratiques sexuelles sans risque ainsi que des condoms. En général, il s'agit d'un environnement sexuel sécuritaire. Alors ciblez le préjudice le plus précisément possible. Que la définition ne soit pas trop large, ni trop vague ou arbitraire.


Le président: Merci, madame Fry.
Madame Davies.


Mme Libby Davies: Tout d'abord, je crois que nous avons eu un échange incroyable. Nous avons entendu des témoins extrêmement intéressants dans les deux camps et on a vraiment remis en question une bonne partie des traditions et de la moralité qui ont donné lieu à ces lois.
Cependant, M. Hanger nous dit qu'il nous faut agir en fonction de ce que nous dicte le grand public. J'aimerais vous entendre à ce propos parce qu'on a beau parler du grand public et de la société en général, mais de quoi s'agit-il au juste? Est-ce 32 millions de gens? Il faut revenir à cette idée de normes sociales de tolérance et c'est très subjectif.
D'après ce que vous dites, il faut voir la chose à la lumière des droits et des choix des gens pour s'assurer qu'on ne crée aucun préjudice. Pour vous, la voix du grand public, c'est quoi?


M. Stephen Lock: Dans l'affaire des tenanciers du Goliath, un étudiant de l'Université de Calgary a effectué une étude dans le cadre de son mémoire de doctorat en anthropologie culturelle. Il a interrogé les résidents du quartier périphérique du centre-ville de Calgary en leur posant une série de questions dans le cadre d'un sondage aléatoire conduit selon les règles de l'art, afin de déterminer ce qu'ils pensaient de toute une série d'activités commerciales et sociales dans leur quartier. Il leur a notamment demandé ce qu'ils pensaient de toute une série de commerces de détail, de bars, de bars pour homosexuels et du sauna fréquenté par les gais.
Je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais un nombre important de répondants lui ont dit que la présence de prostituées et de vendeurs de drogue dans les rues de leur quartier les inquiétaient beaucoup plus, tout comme d'ailleurs les actions des corps policiers, que la présence d'un sauna dont ils ignoraient même l'existence.


M. Laurie Arron: Si vous me permettez de compléter cette réponse, songez à 1969, au moment où l'homosexualité avait été dépénalisée. À l'époque, on pourrait penser que la majorité des Canadiens était contre l'homosexualité. Or, elle a été dépénalisée et, à l'époque aussi, Pierre Trudeau avait déclaré que l'État n'avait pas sa place dans les chambres à coucher de la nation. Je pense que le principe qui sous-tend notre témoignage aujourd'hui, c'est que ce qui se fait en privé n'est l'affaire de personne d'autre, sauf bien sûr s'il y a préjudice.
Et même si vous pensez que c'est bien l'affaire d'autrui, aller jusqu'à pénaliser un comportement—il y a d'autres sanctions qui ne sont pas pénales—qui ne fait de tort à personne, pour la saule raison qu'il y a a des gens qui n'apprécient pas que cela puisse se faire, même s'ils ne pas directement touchés, est quelque chose d'abusif.
½ 
 (1935)
(1935)


Le président: Madame Brunelle.
[Français]


Mme Paule Brunelle: Lors de notre tournée canadienne, j'ai été très frappée par la façon dont la mentalité et le seuil de tolérance des gens variaient en fonction des régions. Le portrait était très différent selon que nous nous trouvions à Montréal, Toronto, Halifax ou Vancouver.
Avez-vous relevé des différences selon les régions en ce qui concerne l'application de l'article 210, qui porte sur les maisons de débauche?
[Traduction]


M. Laurie Arron: Nous n'en avons constaté aucune. Je pense que les données sont précises jusqu'à un certain point seulement. Il y a eu plusieurs descentes à Toronto et à Montréal—probablement les éléments de la société qui sont le plus tolérants. Il y en a également eu à Calgary. Je ne pense donc pas qu'on puise faire ce genre d'adéquation. Nous pourrions dire que pour l'essentiel, cela fait intervenir des facteurs non systémiques.
[Français]


Mme Paule Brunelle: Vous nous dites que les descentes ont lieu à la suite de dénonciations venant de la population où lorsqu'on est en présence de policiers un peu plus zélés que d'autres. On peut penser que la situation risque de varier selon la tolérance de la population. Il peut alors nous être d'autant plus difficile de modifier des articles de la loi et d'obtenir un résultat uniforme. Mes propos allaient dans ce sens.
[Traduction]


M. Laurie Arron: Ici encore, il faudrait selon nous écarter toute cette notion de normes sociales pour retenir le préjudice. Je ne pense donc pas que l'application d'une norme nationale puisse poser quelque problème que ce soit à cet égard.


Le président: La parole est maintenant à M. Hanger pour trois minutes.


M. Art Hanger: À la page 11 de votre mémoire, vous dites ceci :
| Étant donné l'ostracisme contre l'homosexualité, les normes sociales ont fondamentalement un parti pris contre les personnes lesbiennes, gaies et bisexuelles. Juger le comportement sexuel à l'aune de ces normes entraînera inévitablement un traitement discriminatoire. |
Je pense que vous décrivez à juste titre les points de vue de la collectivité, mais de là à dire que ces points de vue sont un parti pris, j'imagine que c'est une façon de présenter les choses, mais je pense que dans l'ensemble, la population a bien des préoccupations. Il est certain qu'il va y avoir des partis pris, mais il y a peut-être d'autres préoccupations que le fait que les gens n'aiment peut-être pas les comportements homosexuels. À votre avis, quelles pourraient être ces autres préoccupations?


M. Laurie Arron: Je pense que les gens ont toutes sortes de points de vue moraux. Ainsi, il y en a pour qui toute activité sexuelle hors mariage est un acte immoral. Je ne pense pas que cela veuille dire que si la majorité des Canadiens pensent ainsi, il faille que le Code criminel interdise toute activité sexuelle hors mariage. Ce que je veux dire par là, c'est que nous savons d'expérience que les lois ne s'appliquent pas de la même façon. S'il s'agissait d'une relation sexuelle entre un homme et une femme, la police n'y retrouverait rien à redire, par contre si c'est un acte sexuel entre deux hommes, elle procédera à leur arrestation. C'est donc un des éléments.
½  (1940)
(1940)


M. Art Hanger: Excusez-moi, je vous prie.
Je comprends ce que vous dites, mais j'aimerais savoir si vous avez quelque chose pour étayer vos propos. Vous dites que la police ne fera rien si un couple hétérosexuel commet certains actes, mais que ce ne sera pas le cas si c'est un couple homosexuel. Est-ce cela un constat dont vous avez pu vérifier la véracité absolue ou que vous avez—sur la base de quelques anecdotes? Avez-vous quelque chose de probant pour pouvoir l'affirmer?


M. Laurie Arron: Nous l'avons effectivement constaté, quoique moins souvent dans le cas des lois qui interdisent les maisons de débauche, étant donné que, dans ce dernier cas, les données sont tellement maigres.


M. Art Hanger: D'accord, je vous remercie.

Le président: C'est tout.
Monsieur Arron, monsieur Lock, merci beaucoup d'être venus témoigner devant le comité ce soir. C'est un point de vue que nous n'avions pas encore entendu. Nous vous remercions de votre aide. Merci.
Pour la gouverne du comité, le récepteur d'interprétation de Mme Dufour a causé certaines difficultés logistiques à celle-ci. En effet, son récepteur était bloqué sur le canal anglais alors que la langue maternelle de Mme Dufour est le français. Voilà donc qui explique en partie pourquoi elle a eu du mal à vous comprendre, monsieur Hanger. Nous vous présentons nos excuses et ferons en sorte que cela ne se reproduise plus lorsque nous entendons des témoins. Mais comme je le disais, même dans les meilleures circonstances, c'est quelque chose qui n'est pas facile à apprendre.
Voilà donc qui conclut notre soirée. Merci à tous.