JUST Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
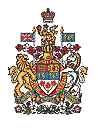
37e LÉGISLATURE, 1re SESSION
Comité permanent de la justice et des droits de la personne
TÉMOIGNAGES
TABLE DES MATIÈRES
Le mardi 16 avril 2002
| ¿ | 0935 |
 |
Le président (M. Andy Scott (Fredericton, Lib.)) |
 |
Me Julie Delaney (avocate, Barreau du Québec) |
| ¿ | 0940 |
 |
Me Giuseppe Battista (avocat, Barreau du Québec) |
 |
Le président |
 |
M. Tony Cerenzia (président, Société canadienne de schizophrénie) |
| ¿ | 0945 |
| ¿ | 0950 |
 |
Le président |
 |
Mme Lindsay Lyster (directrice de politique, British Columbia Civil Liberties Association) |
| ¿ | 0955 |
| À | 1000 |
| À | 1005 |
 |
Le président |
 |
M. Chuck Cadman (Surrey-Nord, Alliance canadienne) |
 |
Mme Lindsay Lyster |
 |
M. Chuck Cadman |
 |
Le président |
 |
M. Tony Cerenzia |
 |
Le président |
 |
Me Giuseppe Battista |
| À | 1010 |
 |
Le président |
 |
M. Robert Lanctôt (Châteauguay, BQ) |
| À | 1015 |
 |
Le président |
 |
Mme Lindsay Lyster |
 |
M. Tony Cerenzia |
 |
Le président |
 |
M. Peter MacKay (Pictou--Antigonish--Guysborough, PC) |
| À | 1020 |
 |
Mme Lindsay Lyster |
| À | 1025 |
 |
M. Peter MacKay |
 |
Mme Lindsay Lyster |
 |
M. Peter MacKay |
 |
Mme Lindsay Lyster |
 |
Le président |
 |
M. Tony Cerenzia |
 |
Le président |
 |
M. John McKay (Scarborough-Est, Lib.) |
| À | 1030 |
 |
M. Tony Cerenzia |
 |
M. John McKay |
 |
M. Tony Cerenzia |
| À | 1035 |
 |
Mme Lindsay Lyster |
 |
M. John McKay |
 |
Mme Lindsay Lyster |
 |
M. John McKay |
 |
Mme Lindsay Lyster |
 |
M. John McKay |
 |
Mme Lindsay Lyster |
 |
Le président |
 |
M. Chuck Cadman |
 |
M. Tony Cerenzia |
| À | 1040 |
 |
M. Chuck Cadman |
 |
M. Tony Cerenzia |
 |
M. Chuck Cadman |
 |
M. Tony Cerenzia |
 |
M. Chuck Cadman |
 |
M. Tony Cerenzia |
 |
Le vice-président (M. John McKay) |
 |
M. Macklin |
 |
Me Giuseppe Battista |
| À | 1045 |
 |
Le président |
 |
Mme Lindsay Lyster |
 |
Le président |
 |
M. Tony Cerenzia |
 |
Le président |
 |
M. Robert Lanctôt |
| À | 1050 |
 |
Le président |
 |
Me Giuseppe Battista |
 |
M. Robert Lanctôt |
 |
Me Giuseppe Battista |
| À | 1055 |
 |
Le président |
 |
M. Ivan Grose (Oshawa, Lib.) |
 |
Le président |
 |
M. Peter MacKay |
| Á | 1100 |
 |
Le président |
 |
Mme Lindsay Lyster |
 |
Le président |
 |
M. Tony Cerenzia |
 |
Le président |
 |
Me Giuseppe Battista |
 |
Le président |
 |
Le président |
 |
Maître Robert Cattrell (procureur général adjoint de Simcoe, Ministère du Procureur général de l'Ontario) |
 |
Le président |
 |
| Á | 1110 |
| Á | 1115 |
 |
Le président |
 |
Maître Curt Flanagan (procureur de la Couronne pour Leeds et Grenville, ministère du Procureur général de l'Ontario) |
| Á | 1120 |
| Á | 1125 |
 |
Le président |
 |
Me Robert Cattrell |
| Á | 1130 |
 |
Le président |
 |
M. Jean-Yves Pronovost (administrateur, Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec) |
| Á | 1135 |
| Á | 1140 |
 |
Le président |
 |
M. Chuck Cadman |
| Á | 1145 |
 |
Me Malcolm Jeffcock |
 |
Le président |
 |
Me Robert Cattrell |
 |
M. Chuck Cadman |
 |
Me Robert Cattrell |
 |
Le président |
 |
M. Paul Morin (coordonnateur du Collectif de défense des droits de la Montérégie, Association des groupes d'intervention en défense de droits en santé mentale du Québec) |
| Á | 1150 |
 |
Le président |
 |
M. Robert Lanctôt |
 |
M. Paul Morin |
 |
M. Robert Lanctôt |
| Á | 1155 |
 |
Le président |
 |
Me Curt Flanagan |
 |
Le président |
 |
M. Paul Morin |
 |
Le président |
 |
M. Peter MacKay |
| Â | 1200 |
 |
Me Malcom Jeffcock |
 |
M. Peter MacKay |
 |
Me Malcom Jeffcock |
| Â | 1205 |
 |
M. Peter MacKay |
 |
Me Malcom Jeffcock |
 |
Le président |
 |
M. Paul Harold Macklin |
 |
Me Curt Flanagan |
| Â | 1210 |
 |
Le président |
 |
Me Robert Cattrell |
 |
Le président |
 |
M. Chuck Cadman |
 |
Me Curt Flanagan |
 |
M. Chuck Cadman |
 |
Le président |
 |
Me Malcom Jeffcock |
 |
M. Chuck Cadman |
 |
Me Malcom Jeffcock |
| Â | 1215 |
 |
Le président |
 |
M. John McKay |
 |
Me Malcom Jeffcock |
 |
Me Curt Flanagan |
 |
Le président |
 |
M. Paul Morin |
| Â | 1220 |
 |
Le président |
 |
M. Robert Lanctôt |
 |
M. Paul Morin |
 |
Le président |
 |
M. Peter MacKay |
| Â | 1225 |
 |
Le président |
 |
Me Robert Cattrell |
| Â | 1230 |
 |
Le président |
 |
M. Paul Morin |
 |
Le président |
 |
M. Paul Morin |
| Â | 1235 |
 |
Le président |
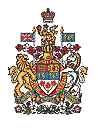
CANADA
Comité permanent de la justice et des droits de la personne |
|
l |
|
l |
|
TÉMOIGNAGES
Le mardi 16 avril 2002
[Enregistrement électronique]
¿  (0935)
(0935)
[Traduction]

Le président (M. Andy Scott (Fredericton, Lib.)): Bienvenue.
Je déclare ouverte cette 76e séance du Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Conformément à l'ordre de renvoi de la Chambre du 26 février 2002, nous poursuivons notre examen prévu par la loi des dispositions du Code criminel sur les troubles mentaux.
Ce matin, notre premier groupe de témoins est composé de représentants du Barreau du Québec, Me Giussepe Battista et Me Julie Delaney; de la Société canadienne de schizophrénie, le président, Tony Cerenzia; et de la British Columbia Civil Liberties Association, Lindsay Lyster, directrice des politiques.
Nous avons eu le bonheur d'accueillir de nombreux témoins de la Colombie-Britannique ces derniers temps, et j'ai bien hâte d'entendre tous vos témoignages. J'espère qu'on a vous expliqué que chaque organisation dispose de 10 minutes pour faire une allocution. Puis il y aura une période de questions pendant laquelle vous pourrez nous donner plus de détails.
Vous êtes-vous entendus sur celui ou celle qui commencera? Sinon, nous commencerons par le Barreau du Québec.
[Français]


Me Julie Delaney (avocate, Barreau du Québec): Monsieur le président, messieurs les députés, bonjour. Je m'appelle Julie Delaney. Je suis avocate au Service de recherche et de législation du Barreau du Québec. Je suis accompagnée de Me Giuseppe Battista. Nous tenons à vous remercier, car c'est avec plaisir que nous sommes devant vous ce matin. La présentation de notre intervention sera brève.
D'entrée de jeu, lorsque le comité de travail en droit criminel du Barreau du Québec s'est demandé si l'article 16 du Code criminel amenait des problèmes réels, la réponse a été négative. De plus, en l'absence de problématique soulevée par les critères établissant l'aptitude d'un accusé à subir son procès, nous ne voyons pas la nécessité de proposer une modification à ces critères. Le document de consultation fait état de la possibilité de définir l'automatisme dans le Code criminel. Le Barreau réitère sa position en faveur du statu quo. Pourquoi modifier un texte de loi qui, en pratique, ne cause pas de problèmes réels? Ensuite, le Barreau ne voit pas la nécessité d'octroyer aux tribunaux le pouvoir d'imposer des ordonnances de surveillance dans les cas d'automatisme sans aliénation mentale.
Dans la même veine, le Barreau ne juge pas opportun d'octroyer de plus amples pouvoirs aux commissions d'examen afin qu'elles puissent libérer totalement un accusé inapte. Par ailleurs, nous sommes favorables à ce que les commissions d'examen aient le pouvoir d'ordonner une évaluation avant la tenue d'une audition d'examen. Cela étant dit, le Barreau se permet de suggérer qu'un médecin indépendant puisse effectuer des évaluations afin, d'une part, d'éviter que la seule source d'information concernant le patient soit le médecin traitant et, d'autre part, de préserver la relation de confiance entre le médecin traitant et son patient. Ainsi, la possibilité pour la commission d'examen d'ordonner à sa discrétion une évaluation par un autre psychiatre rendrait le processus davantage respectueux des droits du patient.
En terminant, au sujet des plafonds de détention, le Barreau déplore le fait que certains réclament l'installation d'un minimum et d'un maximum. En effet, il y a un risque que la commission se complaise dans ce régime et qu'elle préfère laisser écouler le temps et ne procéder à aucune libération avant l'écoulement du délai. Donc, nous préconisons une approche orientée sur le patient et un traitement adapté à chacun.
¿ 
 (0940)
(0940)


Me Giuseppe Battista (avocat, Barreau du Québec): Je voudrais ajouter quelque chose, si vous me le permettez.
Au Barreau, nous sommes d'avis que la révision statutaire qui provoque la tenue de ces audiences est évidemment utile. Mais, à notre avis, il y aurait lieu de procéder à des études approfondies afin de déterminer le nombre de fois où ce moyen est soulevé lors de procès criminels et accueilli avec succès par les jurys. Il faudrait aussi procéder à un suivi à long terme de l'implication des décisions qui sont rendues par les tribunaux ou par les commissions d'examen en ces matières. Je m'explique.
Il peut y avoir une perception populaire, des mythes, au sujet des personnes qui sont reconnues non responsables criminellement. Soit que le moyen de défense est trop facilement évoqué, soit que les personnes qui sont reconnues non responsables ont en fait une responsabilité plus lourde. Ces verdicts-là ou ces décisions-là posent des dangers pour la société. À notre avis, il n'y a pas de problèmes ou de difficultés.
Lorsque le comité permanent en droit criminel du Barreau du Québec, qui est chargé d'étudier la législation en matière criminelle et les projets de loi, s'est réuni, nous avons eu l'occasion de nous asseoir avec un psychiatre qui est venu parler au nom de plusieurs psychiatres qui témoignent régulièrement devant les tribunaux au Québec. Le consensus général qui se dégageait, c'est qu'à leur avis, la législation telle qu'elle existe aujourd'hui est positive dans le sens qu'ils n'ont pas pu, eux, déceler de cas d'injustice. Essentiellement, ces décisions-là sont rendues par des jurys.
Il y a évidemment des éléments d'ajustement, notamment en ce qui concerne la commission d'examen, qui pourraient être mis en place et dont nous pourrons discuter en réponse à vos questions. Mais, à notre avis, il y a d'abord la nécessité de mener une étude approfondie à long terme des verdicts rendus, de la situation des personnes, du nombre d'années pendant lesquelles ces personnes sont suivies, des résultats, du taux de récidive. Ce sont tous des facteurs importants. Une fois que ces études auront été faites, nous pourrons évaluer s'il y a lieu, effectivement, d'apporter des modifications.
C'est essentiellement la présentation que nous avions à vous faire.
[Traduction]


Le président: Merci beaucoup.
Je cède maintenant la parole à la Société canadienne de schizophrénie.


M. Tony Cerenzia (président, Société canadienne de schizophrénie): Merci beaucoup, monsieur le président et messieurs les membres du comité. Je suis heureux de pouvoir vous présenter notre mémoire ce matin.
Le message que je vous transmets au nom de nombreuses familles d'un peu partout au pays diffère peut-être un peu des autres témoignages que vous avez entendus. Nous souhaitons que les gens cessent de traiter les membres de nos familles qui sont malades comme des criminels et qu'ils reconnaissent qu'ils sont simplement malades.
Il y a des personnes qui, sans qu'elles n'y soient pour rien, ont été négligées par le système de soins de santé du Canada et constituent un pourcentage disproportionné des détenus du pays.
La Société canadienne de schizophrénie se réjouit qu'on fasse dorénavant mention de personnes atteintes de troubles mentaux et non plus d'aliénés, un terme désuet. Nous encourageons le gouvernement fédéral à amorcer un dialogue avec les provinces pour assurer l'uniformité de la compréhension et des stratégies visant à répondre aux besoins des Canadiens souffrant de maladies mentales graves et persistantes qui commettent un crime et, encore plus important, pour concevoir des mesures adaptées de traitement de ces personnes avant qu'elles n'aient des démêlés avec la justice.
J'ai six points à soulever. Les quatre premiers sont en fait des recommandations sur des questions qui nous préoccupent et dont vous n'avez pas traité dans votre document de discussion. J'estime que, s'agissant de malades mentaux, on doit mettre l'accent sur le traitement plutôt que sur le châtiment. Nous sommes d'avis que les malades doivent être à l'hôpital et non pas en prison.
La déjudiciarisation est de plus en plus répandue, et les accusés atteints de troubles mentaux doivent recevoir des soins à l'hôpital et non pas une peine d'emprisonnement. Les programmes de déjudiciarisation doivent être élargis et offerts dans tous les ressorts.
Le système judiciaire devrait prévoir des fonds pour la collecte des données pertinentes sur le nombre de malades mentaux qui commettent un crime, sur le nombre d'entre eux qui sont emprisonnés, sur les coûts que cela entraîne et sur les mesures dont ont besoin ces accusés.
Nous recommandons un vaste programme de sensibilisation du public. Un programme de conscientisation continu et systématique doit être prévu pour toutes les personnes associées au système judiciaire, y compris la police, les procureurs de la Couronne, les juges et les gardiens de prison.
Mes deux dernières recommandations se rapportent plus directement à votre document de discussion. Une période d'évaluation de 90 jours serait plus réaliste que les 60 jours actuels. Cette période devrait commencer au moment où débutent l'évaluation et le traitement et ne devrait pas inclure le temps passé en prison à attendre qu'une place se libère à l'hôpital.
Enfin, nous devons prévoir le droit d'imposer un traitement aux accusés jugés non responsables au criminel tout en prévoyant les mesures de protection appropriées. Ce n'est dans l'intérêt ni de la justice ni de l'accusé de laisser celui-ci languir en prison sans lui offrir la possibilité de recouvrer la santé mentale et d'être remis en liberté.
Notre société dessert plus de 300 familles à l'échelle du pays. Il importe de noter que la schizophrénie varie beaucoup en gravité. De nouveaux traitements médicaux découverts au cours des dix dernières années ont eu une incidence positive sur bien des vies et offrent une lueur d'espoir pour l'avenir.
Les schizophrènes qui commettent des crimes nous préoccupent tous. Nous sommes stigmatisés par les manchettes criardes qui accompagnent tout acte de violence perpétré par une personne atteinte d'une maladie mentale grave. Nous sommes alors doublement attristés: nous sommes attristés parce qu'une personne a été victime d'un crime et parce qu'on n'a ni compréhension ni compassion pour l'autre victime, le malade.
Mais ce qui compte encore plus, c'est que nous sommes exaspérés par ce cercle vicieux qu'on ne semble pas vouloir briser. Nous sommes déjà punis par le fait qu'un membre de notre famille est malade sans avoir à assumer le fardeau additionnel de démêlés avec la justice.
Aux États-Unis, il y a près de cinq fois plus de malades mentaux derrière les barreaux que dans les hôpitaux des États. Au Royaume-Uni, 0,7 p. 100 des hommes condamnés présentent une forme quelconque de psychose, contre 0,4 p. 100 dans la population en général. C'est presque le double.
La seule conclusion possible, c'est que nous avons remplacé les lits dans les hôpitaux psychiatriques par la prison, le traitement par le châtiment et la compassion par la cruauté. Nous devons examiner attentivement le traitement qu'on réserve aux malades mentaux dans les prisons et élaborer des stratégies en vue de leur accorder des soins avant qu'ils ne commettent un crime. De telles mesures pourraient même nous permettre de réduire les coûts et certainement de réduire les souffrances et la douleur de nombreuses familles canadiennes.
¿ 
 (0945)
(0945)
Il y a 160 ans, Dorothea Dix a présenté le plaidoyer suivant à l'assemblée législative du Massachusetts:
«Je suis venue vous présenter les revendications de l'humanité souffrante. Je suis venue plaider la cause des faibles et des oubliés, des hommes et femmes aliénés gardés dans des cages, dans des placards, dans des caves, dans des écuries et des enclos, enchaînés, nus, forcés à se soumettre à coups de bâton et de fouet. Je vous supplie, je vous implore, oubliez l'égoïsme et l'intérêt personnel, déposez l'armure de la lutte et de l'ambition politique. Oubliez, je vous en supplie, les biens terrestres et périssables, la pensée sans pitié. Messieurs, je vous confie une cause sacrée!»
Aujourd'hui, nous semblons assister à un retour à la situation qui prévalait avant qu'elle nous fasse comprendre qu'il fallait traiter les malades mentaux avec compassion et les garder à l'hôpital plutôt qu'en prison.
J'ai ici un graphique que je ne peux vous distribuer car il n'est pas traduit en français, mais qui montre que le nombre de lits dans les hôpitaux psychiatriques a baissé au Royaume-Uni de 1950 à 1987, alors que le nombre de détenus a augmenté. La corrélation est moins -0,95, ce qui est inimaginable. Tout étudiant de deuxième ou troisième cycle ou même tout scientifique qui présentait un rapport serait ravi d'obtenir des chiffres de cet ordre. D'ici quelques années, l'Ontario aura réduit de moitié le nombre de lits, et d'autres provinces canadiennes s'apprêtent à en faire autant.
En résumé, la schizophrénie et les autres psychoses sont des maladies cérébrales qui empêchent les personnes atteintes de percevoir le monde comme les autres ou de prendre des décisions rationnelles. Elles commettent parfois en conséquence des gestes illégaux. La loi protège les libertés civiles de tous mais ne protège pas ceux qui sont incapables de reconnaître qu'ils sont malades et de comprendre ce qui se passera s'ils refusent de se faire soigner. La loi protège le droit à la liberté, mais pas le droit au traitement.
Certains prétendent que la maladie mentale n'existe pas et que les médicaments administrés aux malades mentaux sont nocifs, ont des effets psychotropes indésirables et ne servent en fait qu'à créer des emplois pour les psychiatres. Ces allégations sont si ridicules que je crains de leur avoir ajouté foi simplement en les énonçant. Toutefois, un député de l'assemblée législative de l'Ontario a fait une telle déclaration il y a à peine quatre ans dans le cadre des discussions sur les modifications éventuelles à la Loi sur la santé mentale de cette province.
Tous les médicaments, quelle que soit la maladie qu'ils traitent, peuvent avoir des effets secondaires. Il faut peser les risques et les avantages. Tout ce que nous voulons, c'est que tous les parties examinent les données sur la schizophrénie et les autres troubles psychotiques, ainsi que sur les accusés qui en souffrent, participent à la collecte de données additionnelles et élaborent des politiques conformes à ces données. Il est moralement répréhensible et indéfendable de donner aux malades la liberté de commettre des crimes pour ensuite les incarcérer.
Dans un pays civilisé comme le Canada, nous devrions faire l'impossible pour empêcher les gens de commettre des crimes en leur donnant des soins plutôt qu'en les punissant. Je sais que certaines de mes demandes ne sont pas de votre ressort, mais vous exercez certainement une certaine influence. À mon sens, envoyer les malades mentaux en prison plutôt qu'à hôpital psychiatrique équivaut à un transfert de paiements des gouvernements provinciaux au gouvernement fédéral. Peut-être qu'en apportant des changements, les provinces pourraient récupérer une partie de ces sommes.
Je vous remercie de m'avoir invité à témoigner aujourd'hui. Je serai heureux de répondre à vos questions verbalement ou par écrit.
¿ 
 (0950)
(0950)


Le président: Merci beaucoup.
Je cède maintenant la parole à Mme Lyster.


Mme Lindsay Lyster (directrice de politique, British Columbia Civil Liberties Association): Bonjour, monsieur le président et messieurs les membres du comité. Je suis heureuse d'être ici ce matin au nom de la British Columbia Civil Liberties Association.
J'ai remis au comité un mémoire assez long. Je ne vais pas entrer dans les détails ce matin. Plutôt, j'aimerais aborder trois thèmes qui sont au coeur de nos représentations sur les dispositions concernant les troubles mentaux.
Premièrement, il est essentiel que nous ne permettions pas que les principes fondamentaux de notre droit pénal soient foulés au pied par la crainte de la possibilité hypothétique illusoire qu'un verdict d'acquittement ou de non-responsabilité criminelle soit rendu à tort à des accusés atteints de troubles mentaux. Il est essentiel que les principes fondamentaux de notre droit pénal soient maintenus et le plus important de ces principes est celui selon lequel ceux qui ne peuvent être tenus responsables de leurs actes ne doivent pas être reconnus coupables.
Deuxièmement, et à cet égard, j'abonde dans le même sens que M. Cerenzia, je tiens à souligner à quel point il est crucial que des traitements adaptés soient offerts aux malades mentaux ou qui ont des démêlés avec la justice. Peu importe qu'il s'agisse d'accusés inaptes à subir leur procès, d'accusés jugés non responsables au criminel pour cause de troubles mentaux ou d'accusés qui ont été reconnus coupables mais qui sont atteints d'une maladie mentale. Quelle que soit la catégorie, il est essentiel de leur offrir des soins lorsqu'il est possible de traiter la maladie dont ils souffrent.
Troisièmement, à notre avis, il est essentiel que les personnes atteintes de troubles mentaux ne soient pas détenues ou que leur liberté ne soit pas restreinte plus qu'il n'est nécessaire pour protéger le public d'un risque important. Le droit à la liberté des malades mentaux est tout aussi important et vital que le droit à la liberté des autres membres de la société. Ce droit ne devrait être enfreint que lorsqu'il est prouvé qu'il est nécessaire de le faire pour protéger le public d'un risque important.
J'aimerais maintenant aborder trois domaines où ces principes s'appliquent. Premièrement, le traitement des personnes inaptes à subir leur procès; deuxièmement, la promulgation de la disposition concernant la durée maximale et, troisièmement, la défense d'automatisme.
D'abord, s'agissant du traitement de l'accusé inapte, selon les dispositions actuelles sur les troubles mentaux, un accusé inapte peut être libéré sous condition par une commission d'examen ou gardé en détention. L'accusé ne peut recevoir une absolution inconditionnelle conformément à l'article 672.54 du Code criminel. Certains accusés inaptes qui ne présentent aucune menace pour la société et dont il est fort probable qu'ils ne deviendront jamais aptes à subir leur procès ne peuvent se voir accorder une absolution inconditionnelle aux termes du Code criminel sous son libellé actuel.
En revanche, l'accusé jugé non responsable au criminel peut être libéré inconditionnellement si on estime qu'il ne constitue pas une menace importante pour le public. À notre sens, cela est illogique, irrationnel et injuste. Un tribunal a même jugé, dans l'affaire R. c. T.J., dont nous traiton dans notre mémoire, que cette pratique est inconstitutionnelle. C'est aussi notre avis.
Les accusés inaptes à subir leur procès pour cause de troubles mentaux qui peuvent devenir aptes devraient recevoir les soins nécessaires et subir leur procès. Mais ceux qui ne deviendront jamais aptes à subir leur procès—cela pourrait être le cas de certaines personnes souffrant d'une lésion cérébrale ou du syndrome d'alcoolisme foetal et qu'aucun traitement ne pourra rendre aptes—et qui ne représentent pas de menace pour la société devraient être libérés inconditionnellement par la commission d'examen en vertu du pouvoir qu'on lui conférerait.
¿ 
 (0955)
(0955)
J'aimerais maintenant aborder la question de la promulgation de la disposition sur la durée maximale.
Comme vous le savez, lorsque les dispositions sur les troubles mentaux ont été adoptées, elles comprenaient un article sur la durée maximale selon lequel les accusés inaptes à subir leur procès et non responsables au criminel ne seraient détenus que pour une durée déterminée, en général, mais pas toujours, équivalant à la peine maximale qu'ils auraient purgée s'ils avaient été emprisonnés pour l'infraction qu'ils avaient commise.
À l'époque, on a aussi adopté des dispositions sur les accusés dangereux atteints de troubles mentaux qui permettaient essentiellement une détention plus longue ou même indéfinie, une détention à vie, lorsque le crime commis était grave et s'accompagnait de violence. Ces dispositions n'ont pas été promulguées. De l'avis de la B.C. Civil Liberties Association, ces dispositions, autant sur la durée maximale que sur les accusés dangereux atteints de troubles mentaux, doivent être adoptées.
Pourquoi? Parce qu'il faut s'assurer que ces accusés, qu'ils soient inaptes à subir leur procès ou non responsables au criminel, ne languissent pas sous garde pour des périodes indéfinies qui pourraient être beaucoup plus longues que celles qu'ils auraient purgées en prison s'ils avaient été reconnus coupables. Encore une fois, la liberté des personnes atteintes de troubles mentaux est tout aussi importante que la liberté des personnes saines d'esprit.
Il nous apparaît fondamentalement injuste qu'un accusé qui a été déclaré non responsable au criminel reste en détention ou assujetti à diverses formes de privation de liberté peut-être toute sa vie, alors que celui qui a été reconnu coupable du même crime pourrait être remis en liberté après une période déterminée.
On s'inquiète peut-être de la possibilité de libérer des malades mentaux qui représentent une menace importante. N'oublions pas que les dispositions sur les accusés dangereux souffrant de troubles mentaux ont été adoptées et nous demandons qu'elles soient promulguées en même temps que les dispositions sur la durée maximale.
N'oublions pas non plus que ceux qui ont été reconnus coupables d'un crime peuvent aussi représenter une menace importante pour la société, ce qui ne nous empêche pas de les remettre en liberté une fois qu'ils ont purgé leur peine.
Troisièmement, rappelons-nous que les provinces ont toutes une loi sur la santé mentale—du moins en Colombie-Britannique, situation que je connais—qui protège suffisamment le public en prévoyant que les personnes atteintes de troubles mentaux qui présentent un risque pour elles-mêmes ou le public soient internées. Il est donc essentiel de promulguer les dispositions sur la durée maximale.
Maintenant, j'aimerais aborder brièvement la question de la défense d'automatisme qui figurait dans votre document de discussion. C'est une défense extrêmement rare. Elle est rarement invoquée devant les tribunaux pénaux et il est encore plus rare que l'accusé qui l'invoque ait gain de cause. Ce sont les cas très exceptionnels où, à notre avis et de l'avis de la Cour suprême du Canada, il est juste et indiqué de juger non responsable de son geste et d'acquitter l'accusé qui n'a pas commis le crime volontairement.
Toutefois, nous craignons que la Cour suprême n'ait défini de façon trop étroite la défense d'automatisme dans l'affaire de la Reine c. Stone, l'arrêt qui prévaut actuellement à cet égard. Dans cette affaire, une majorité de cinq juges contre quatre a défini de façon à notre avis inutilement et déraisonnablement étroite la défense d'automatisme. Par conséquent, si votre comité envisage une proposition sur cette défense, nous croyons qu'il devrait se fonder sur l'opinion minoritaire dans l'affaire Stone et non pas sur l'opinion majoritaire.
Plus précisément, nous estimons que, encore une fois, il est essentiel en raison de l'importance des principes fondamentaux du droit pénal que la Couronne conserve le fardeau de prouver tous les éléments d'une infraction, y compris le caractère volontaire. L'accusé aura ainsi l'obligation de remettre en question le caractère volontaire de son geste. Cela fait, la Couronne continuera d'assumer le fardeau de la preuve du caractère volontaire du crime.
Deuxièmement, il nous apparaît crucial qu'il n'y ait aucune présomption de troubles mentaux dans les cas d'automatisme. C'est au juge des faits, au jury, de déterminer la présence de maladie mentale en l'occurrence.
Troisièmement, nous croyons que le juge devrait laisser le jury déterminer s'il y a eu automatisme avec aliénation mentale ou sans aliénation mentale. On ne devrait pas offrir qu'une possibilité de verdict au jury.
À 
 (1000)
(1000)
Certains prétendent que la défense d'automatisme devrait être réduite, comme le proposait la majorité, dans l'arrêt Stone, par crainte d'ouvrir toutes grandes les portes à des défenses frivoles, par crainte que des centaines de personnes réussissent à feindre l'automatisme et à échapper ainsi aux conséquences de leurs actes violents.
Nous estimons que cette crainte est injustifiée. Comme l'a dit avec raison le juge Binney, dissident dans l'arrêt Stone:
«J'ai la plus grande confiance dans le simple bon sens du jury canadien moyen. Quiconque pense qu'un jury sera moins sceptique qu'un juge ou un professeur de droit n'a peut-être pas passé assez de temps dans les autobus ou autour des machines à café dans les bureaux.»
Les Canadiens seront extrêmement sceptiques lorsque sera invoquée la défense d'automatisme par des accusés. Ils n'accepteront pas facilement qu'une personne puisse être acquittée pour cause d'automatisme. On peut faire confiance aux jurys à qui ont servira cette défense. Il faut la conserver. Et si on parle de cette défense en envisageant de la codifier, il faut le faire en suivant les juges minoritaires, plutôt que majoritaires, dans l'arrêt Stone.
En conclusion, je veux dire que la façon dont une société choisit de traiter les malades mentaux, quand ils sont accusés d'actes criminels, est un indice de son humanité et de l'engagement de la société à défendre les droits civils pour tous, les malades mentaux compris.
Nous estimons que les dispositions du Code criminel sur les troubles mentaux sont en gros un point de vue juste et humain sur le traitement des personnes atteintes de maladie mentale et accusées d'actes criminels. Mais ce qui est crucial, et ce que je voulais essentiellement vous dire aujourd'hui, c'est que ces dispositions doivent être promulguées entièrement, afin que les dispositions sur la durée maximale soient mises en oeuvre. Il est également crucial que les commissions d'examen aient le pouvoir d'accorder des absolutions inconditionnelles aux accusés inaptes qui ne représentent pas une menace pour la société.
Merci.
À 
 (1005)
(1005)


Le président: Merci beaucoup.
Monsieur Cadman, vous avez sept minutes.


M. Chuck Cadman (Surrey-Nord, Alliance canadienne): Merci, monsieur le président. Je tiens moi aussi à remercier les témoins qui sont venus ce matin.
Pour commencer, comme c'est habituellement Ivan qui avoue être confus à la fin de ces séances, je dois cette fois reconnaître que je suis moi-même confus. J'ai peut-être raté quelque chose.
Madame Lyster, vous avez déclaré qu'il ne faut pas garder enfermées des personnes dont il est établi qu'elles ne représentent pas un risque pour la société. Par ailleurs, vous dites qu'il faut mettre en oeuvre les dispositions sur la durée maximale. J'y vois une contradiction. Peut-être ai-je manqué un élément. Que fait-on d'une personne qui a été accusée d'une agression relativement mineure mais qui deux ans plus tard est toujours réputée être un risque pour la société? Si vous souhaitez la mise en oeuvre des dispositions sur la durée maximale, est-ce que vous nous dites qu'il faut libérer cette personne?


Mme Lindsay Lyster: Oui, c'est ce que je dis. Je dis certainement qu'il faut libérer cette personne. Je ne vois pas là de contradiction.
Au sujet du fait qu'il ne faut pas garder enfermées des personnes plus longtemps qu'il ne le faut, c'est particulièrement vrai dans le cas des accusés jugés inaptes et qui ne représentent aucun risque. Mais dans le cas de toute personne, même celles qui peuvent représenter un risque, une fois qu'elle a passé dans un institut psychiatrique judiciaire une durée équivalente à celle qu'elle aurait passée en prison, si elle avait été condamnée pour ce crime, à moins de relever des dispositions sur les accusés dangereux atteints de troubles mentaux, par exemple si la personne a commis une agression sexuelle ou quelque chose de ce genre, nous estimons qu'il faut la libérer.
Nous estimons que les lois provinciales sur la santé mentale peuvent répondre adéquatement et avec succès à toute crainte relative à la sécurité. Quand ce n'est pas possible, je crois qu'il faut se rappeler que les personnes condamnées peuvent être libérées d'office à la fin de leur peine, peu importe leur degré de dangerosité. Pourquoi les personnes atteintes de troubles mentaux devraient-elles être moins bien traitées que celles qui sont saines d'esprit quand elles commettent un crime?


M. Chuck Cadman: Les autres témoins ont-ils quelque chose à dire là-dessus?


Le président: Monsieur Cerenzia, allez-y.


M. Tony Cerenzia: Je suis du même avis, car depuis des années, trop souvent, à cause de leur maladie, des gens ont été détenus plus longtemps. On semble préférer ne pas libérer des patients malades mentaux, et on hésite à conclure qu'ils ne sont pas dangereux. Par prudence, pour protéger la société, on a tendance à les interner plus longtemps que ce serait le cas si c'était la prison. Oui, c'est une préoccupation.


Le président: Écoutons Me Battista.


Me Giuseppe Battista: Je partage cette préoccupation qui a été bien exprimée. Prenons un exemple très simple. On ne saurait condamner à une peine d'emprisonnement de 10 ans quelqu'un qui commet un méfait, qui casse une fenêtre. Nous convenons tous que ce n'est pas ce que nous souhaitons. Je peux comprendre qu'on veuille imposer une durée maximale, pour éviter ce genre de situation.
Au Barreau du Québec, c'est l'inverse qui nous inquiète. Nous craignons qu'une durée maximale ne donne l'impression que la non-responsabilité au criminel est assimilable à une condamnation. Autrement dit, notre approche privilégie le traitement plutôt que la punition. Cela peut signifier qu'une personne sera traitée plus longtemps. Nous acceptons cette prémisse. Par contre, il n'est pas nécessaire que cette personne soit dans un centre de détention. Il n'est pas nécessaire de la mettre dans un milieu où elle sera privée de liberté.
Nous préférons que la décision soit entre les mains d'une commission d'examen. À notre avis, c'est là que doivent être prises ces décisions. Cela revient à ce que nous disions plus tôt, au sujet des données qui sont nécessaires dans ce domaine.
Est-il vrai que des personnes déclarées non responsables au criminel restent dans un centre de détention, même s'il s'agit d'un hôpital psychiatrique, plus longtemps qu'il ne faudrait? Est-ce un fait? Si c'est le cas, il faut corriger la situation.
Est-ce que les services reçus sont adéquats? C'est un autre aspect de la question.
Rappelons que s'il s'agit d'un méfait, la peine ne peut être de plus de deux ans. La libération doit survenir avant deux ans. On peut être détenu pendant deux ans, sans recevoir de soins. C'est une préoccupation pour nous.
Est-ce que les personnes déclarées non responsables au criminel sont traitées comme elles doivent l'être? Cela signifie que c'est un fardeau pour la société. La société doit assumer cette responsabilité et répondre aux besoins de la personne. Si nous encourageons l'imposition d'une durée maximale, nous créons presque une norme relative à la période de détention qui sera appliquée et qui servira à fixer la période de détention. Ce n'est pas la méthode que nous privilégions.
Nous comprenons la préoccupation exprimée, qui est très légitime. Il ne faut pas laisser des gens croupir dans l'oubli. On peut dire la même chose pour les crimes très violents. Quelqu'un qui commet un crime très violent peut, six mois après, ne plus représenter un danger pour la société.
Si la durée maximale est appliquée, pour certains types de crimes, une durée sera permise et par conséquent, imposée dans certains cas. C'est ce que nous craignons et la raison pour laquelle nous ne sommes pas en faveur de la durée maximale.
À notre avis, l'évaluation de la personne et de ses besoins est au bout du compte la meilleure façon pour la société de se protéger et de permettre à cette personne de s'épanouir en son sein.
À 
 (1010)
(1010)


Le président: Merci infiniment.
Monsieur Lanctôt, vous avez sept minutes.
[Français]


M. Robert Lanctôt (Châteauguay, BQ): Merci, monsieur le président. Je remercie les témoins de leurs témoignages. Encore une fois, on a un panel où des gens sont contre la durée maximale et on a un membre du panel qui est pour, mais vous êtes toujours en minorité. C'est du moins le cas des groupes d'experts que l'on reçoit depuis environ un mois et demi. On revient presque toujours aux mêmes questions pour permettre, entre autres, aux membres du comité d'y voir un peu plus clair, parce que c'est toujours blanc ou noir.
Le problème, à mon avis, c'est un peu de confronter le judiciaire et la santé mentale, les troubles mentaux versus la judiciarisation. On est dans un système de déjudiciarisation. On retrouve des gens « en manque de traitements », des gens que l'on retrouve et que l'on retrouvera dans la rue, selon moi, si on a une durée maximale.
Il y a sûrement de bons côtés à la déjudiciarisation, mais la situation actuelle peut être qualifiée d'extrême. Je ne sais pas si la situation est la même partout, mais au Québec, en tout cas, on retrouve des gens qui sont dans la rue.
On n'a pas besoin de crimes graves pour protéger la société. Un vol, une voie de fait est aussi dommageable à la société qu'un meurtre ou autre chose. Vous essayez de minimiser le fait qu'on libère un accusé ou qu'on lui accorde une absolution inconditionnelle alors qu'il devrait être pris en charge par la société ou traité en milieu hospitalier ou, au moins, bénéficier d'un traitement convenable. Ces gens-là ne sont plus traités, par manque de ressources. On revient toujours à cette question du manque de ressources.
Au Québec, on manque de ressources et sans doute que d'autres provinces font aussi face à ce problème. On a fait mention des transferts. C'est un problème important. À cause de ce manque de ressources, on est obligé d'essayer d'apporter des modifications au Code criminel pour tenter de régler un autre problème. Est-ce vraiment nécessaire de changer le Code criminel? Il serait peut-être préférable d'envisager la question sous l'angle politique, de remettre ces ressources, d'accroître les transferts d'argent aux provinces ou au Québec pour pouvoir enfin réussir à protéger ces gens, à les traiter.
On essaie de faire indirectement ce qu'on ne peut plus faire directement, c'est-à-dire de remettre ces gens-là... Ne croyez-vous pas que vous allez leur nuire? Ces gens ont presque de la chance d'être pris en charge et d'avoir un traitement approprié, au lieu de se retrouver dans la rue au bout, disons, de deux ans. Je m'arrête. J'aimerais avoir votre opinion là-dessus.
À 
 (1015)
(1015)
[Traduction]


Le président: Madame Lyster.


Mme Lindsay Lyster: La distinction qu'on fait entre la santé et la justice, ou la crainte de nos amis du Barreau du Québec, selon laquelle la durée maximale, si elle est mise en oeuvre, deviendra de facto la durée de détention, est une fausse dicotomie. Nous pouvons avoir la santé et la justice, l'un n'exclut pas l'autre.
Si nous adoptons les dispositions sur la durée maximale, toutes les personnes alors détenues en vertu de ces dispositions ne vont pas nécessairement rester en institution psychiatrique judiciaire pour la période maximale prévue par ces dispositions. La décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Winko nous dit que ce n'est par permis, en vertu de la Constitution. Que les dispositions sur la durée maximale soient en vigueur ou non, quand une personne ne représente plus un risque, selon la Constititution, cette personne doit être libérée, et l'arrêt Winko le dit.
Je comprends que mes amis du Barreau du Québec craignent que la mise en oeuvre des dispositions sur la durée maximale ferait en sorte que personne ne serait libéré avant la fin de ce maximum; je crois toutefois que ces craintes ne sont pas fondées. L'arrêt Winko permet de les dissiper.
C'est une fausse dicotomie que de donner à choisir entre la santé et la justice. Comme je l'ai dit dans mon exposé, peu importe qu'on soit enfermé dans un établisement psychiatrique ou dans une prison, il est crucial pour les personnes malades mentales de recevoir le traitement dont elles ont besoin pour surmonter leur maladie, si un tel traitement est disponible.
Mais le fait qu'il est crucial d'offrir le traitement ne signifie pas pour autant qu'on laisse de côté la justice. La justice exige que lorsqu'un crime relativement mineur est commis, comme un méfait ou le vol d'une miche de pain, comme on dit souvent, l'auteur du crime ne reste pas éternellement dans le système judiciaire, le reste de ses jours, même si c'est du côté de la psychiatrie judiciaire de notre système pénal. Je peux vous dire que je connais des cas semblables, et que c'est inacceptable.
Quand de telles personnes représentent un risque pour la société, c'est aux lois provinciales sur la santé mentale qu'il faut recourir. Quand une personne commet un acte criminel, alors qu'elle est atteinte de troubles mentaux, il ne faudrait pas qu'elle tombe pour toujours sous la coupe du système judiciaire. Ce n'est pas une bonne façon d'appliquer le droit pénal. À un moment donné, l'intérêt légitime du droit pénal pour cette personne s'éteint, et c'est aux lois provinciales sur la santé mentale de s'en occuper. Les lois pénales ne peuvent pas le faire pour toujours.


M. Tony Cerenzia: J'aimerais simplement ajouter, comme je l'ai déjà dit, de même que M. Battista, qu'il faut recueillir des données. Quand j'ai fait des recherches, il m'était très difficile d'obtenir des données sur le nombre de personnes détenues au Canada, sur la proportion de personnes malades mentales, etc. On pouvait plus facilement en obtenir d'autres instances, d'autres pays.
Pour mettre au point des politiques raisonnables et rationnelles, de même que justifiées, il est impératif de consacrer des efforts et des fonds à l'obtention de données sûres. Nous aurons alors les chiffres exacts, plutôt que des données anecdotiques, dont nous avons tous entendu parler.


Le président: Monsieur MacKay, vous avez la parole.


M. Peter MacKay (Pictou--Antigonish--Guysborough, PC): Merci, monsieur le président
Je veux remercier tous nos témoins. C'est une question extrêmement complexe, mais très importante, que celle dont nous sommes saisis. Nous avons entendu un grand nombre d'intéressés et de personnes qui ont pu nous fournir des données anecdotiques, mais, encore une fois, à partir des témoignagnes reçus jusqu'ici, il est difficile de déterminer si les données anecdotiques nous donnent un portrait exact de la situation, à savoir si le nombre augmente, si c'est simplement une question de démographie, ou s'il s'agit d'un accroissement du fardeau pour le système. Personnellement, j'ai l'impression que de plus en plus de personnes atteintes de maladies mentales se trouvent dans les prisons, plutôt que de recevoir le traitement qu'il faudrait.
J'ai une préoccupation au sujet du traitement. Je ne vois pas dans notre système de justice pénale--et peut-être qu'on ne peut pas y remédier--des personnes qui, avec un traitement adéquat, n'y seraient probablement pas. Il n'y a pas moyen d'imposer un traitement. Il n'y a pas moyen d'imposer la prise de médicaments. J'ai défendu et j'ai poursuivi aussi des personnes qui refusaient tout simplement de suivre un traitement. Elles affirmaient que les effets secondaires étaient trop pénibles et qu'elles préféraient vivre avec leur maladie. Par conséquent, à cause de leur comportement, qu'elles soient shizophrènes ou bipolaires, elles se retrouvaient de temps en temps dans le système judiciaire.
Madame Lyster, comme vous, je crois qu'on va à l'encontre des principes de la justice en incarcérant quelqu'un pour sa maladie, alors qu'une condamnation en vertu du Code criminel, ou une peine donnée par un juge serait moins longue. Il y a quelque chose de mal et de pervers dans la détention d'une personne au-delà de la peine maximale assortie à l'infraction commise, qui aurait même pu être punissable par voie sommaire. Il reste que je suis réconforté à l'idée qu'une personne dans une unité psychiatrique judiciaire pourrait décider du moment où elle pourra revenir dans la société, de manière à protéger le public, alors qu'un juge ne se fierait qu'aux conseils des experts, de toute façon. Je crois donc qu'on devrait adopter votre suggestion, ou recommandation, visant à donner aux commissions d'examen le pouvoir de prendre ces décisions.
Êtes-vous d'accord avec cette idée? Vous ai-je bien compris? Il faut donner aux commissions davantage de pouvoir pour accorder ces absolutions, tout en précisant peut-être plus clairement qu'en ce cas, les lois provinciales sur la santé mentale entreraient en jeu, de manière que les patients ne soient pas détenus en vertu d'une sanction criminelle, puisqu'on aurait tort de les garder au-delà de ce qui correspondrait à l'échéance du mandat d'incarcération. Mais si, par exemple, une personne est incarcérée pour méfait et qu'après deux ans, il est possible que sa maladie se soit aggravée, pour une raison ou pour une autre, et qu'elle représente un danger pour elle-même et pour la société, en cas de libération, faut-il alors recourir à la loi provinciale, plutôt qu'au droit pénal?
À 
 (1020)
(1020)


Mme Lindsay Lyster: Je crois que vous avez bien compris la position de notre association. Nous croyons en effet que dans la majorité des cas, c'est lacommission d'examen, plutôt qu'un tribunal, qui est la mieux placée pour prendre ces décisions. Nous ne disons pas que le tribunal ne doit pas avoir le pouvoir de le faire, mais dans la grande majorité des cas, c'est plutôt la commission d'examen qui devrait décider. C'est elle qui a la compétence.
Nous disons aussi—comme un autre témoin l'a dit plus tôt—que la commission d'examen devrait en outre avoir le pouvoir d'ordonner des évaluations. Nous estimons qu'elle devrait pouvoir ordonner une évaluation indépendante, quand elle prend une décision, relativement à une absolution.
Nous pensons aussi qu'à un certain moment—au plus tard le jour où cette personne aurait nécessairement été libérée de prison, si elle avait été condamnée—la responsabilité doit être confiée au système de soins de santé mentale de la province. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de modifier la Loi sur la santé mentale, du moins en Colombie-Britannique, pour que ce soit possible, puisqu'elle est déjà assez stricte quant à sa portée. Cette portée est probablement moins grande que ce que regroupe le système de soins de santé mentale judiciaire, du moins pour ce qui est de l'internement involontaire. D'ailleurs, ce régime prévoit la possibilité d'un traitement involontaire. En fait, nous avons quelques objections au sujet du potentiel de traitement involontaire prévu par le régime de soins de santé mentale de la province. Mais cela existe certainement et nous pensons que la loi peut s'appliquer aux personnes libérées à la fin de la période maximale de détention. Et nous croyons que c'est certainement la province qui doit s'en charger.
À 
 (1025)
(1025)


M. Peter MacKay: Vous comprenez que si la durée maximale est promulguée, c'est ce qui se passerait.


Mme Lindsay Lyster: Oui. La loi provinciale sur la santé mentale, en Colombie-Britannique, ne dit pas précisément: «quand une personne a été incarcérée pour la durée maximale». Je ne vous lirai pas cet article, il est dans mon mémoire.
Toute personne qui continue de représenter une menace importante, ou peut importe le degré de menace, pour elle-même ou pour quiconque, au moment de sa libération d'un système de santé mentale judiciaire, devrait être internée en vertu de la loi provinciale, en Colombie-Britannique.


M. Peter MacKay: Bien.
Qu'en est-il du traitement imposé? Cette dicotomie est peut-être le problème caché le plus difficile à résoudre de ce régime.


Mme Lindsay Lyster: Du point de vue des droits civils, c'est une question très épineuse. Nous comprenons que dans certaines situations, une personne peut ne pas être compétente pour prendre des décisions, et qu'il peut convenir que quelqu'un d'autre prenne des décisions à sa place, comme le directeur d'un établissement psychiatrique.
Dans ce cas, à notre avis, l'existence d'un mécanisme d'examen approprié est crucial, pour que soient examinées les décisions prises par le psychiatre traitant ou tout autre décideur. Si la patient a des objections au sujet du régime thérapeutique qui lui est imposé, il doit pouvoir s'adresser à quelqu'un d'autre, pour faire revoir cette décision.
En Colombie-Britannique, c'est le comité d'examen prévu par le régime de santé mentale de la province qui reverra le régime thérapeutique. Nous reconnaissons que dans certains cas, l'état psychologique d'une personne peut l'empêcher de prendre des décisions pour elle-même.


Le président: Monsieur MacKay, je crois que M. Cerenzia veut répondre aussi.


M. Tony Cerenzia: Merci.
Vous avez mentionné que les médicaments avaient des effets secondaires affreux, etc. Je pense qu'il est important de souligner qu'au cours des dix dernières années, une nouvelle génération de médicaments est apparue. Bon nombre des effets secondaires ont été considérablement réduits. Je pense qu'il est important de s'en rappeler. Naturellement, on continue d'y travailler. Les médicaments aujourd'hui sont plus faciles à tolérer qu'auparavant, même plus faciles à tolérer qu'il y a dix ans seulement.
Lorsque j'ai examiné les données, j'ai constaté que 50 p. 100 des personnes souffrant d'une maladie mentale grave n'avaient pas reçu de traitement au cours des 12 derniers mois. Il s'agit là d'une étude récente. Je la mentionne dans mon mémoire. On a d'ailleurs découvert que les gens qui ne sont pas traités risquent davantage de commettre un crime que ceux qui reçoivent un traitement. Je pense que ces données sont assez justes. La moitié des personnes qui n'étaient pas traitées ne l'étaient pas parce qu'elles ne comprenaient pas qu'elles étaient malades, ou encore ne voulaient l'admettre ni le reconnaître.
Je ne pense que personne ici ne serait d'accord pour qu'on permette à une personne souffrant de la maladie d'Alzheimer de se promener nue dans la rue en plein hiver. Je ne comprends pas pourquoi nous ne pouvons pas faire la même chose pour les gens qui ont de la difficulté à raisonner.
On sait pertinemment pour avoir parlé à des familles partout au pays qu'il arrive souvent qu'une personne ne soit pas détenue aux termes de la loi provinciale sur la santé mentale. Il est clair que les familles ont besoin d'aide. Il doit y avoir moyen d'évaluer le besoin et de leur fournir cette aide. Je pense que cela réduirait la population carcérale. Ce serait moins coûteux et certainement plus humain.


Le président: Merci beaucoup.
John McKay.


M. John McKay (Scarborough-Est, Lib.): Merci, monsieur le président.
Merci aux témoins pour leur témoignage. Comme d'autres députés, plus j'écoute, moins les choses sont claires.
Monsieur Cerenzia, je pense que vous avez soulevé un point important lorsque vous dites qu'il y a une corrélation négative entre les congés de l'hôpital et la criminalité accrue. Cela correspond certainement à des faits constatés dans ma propre circonscription, où une personne a reçu son congé de l'unité de santé mentale sur la rue Queen, n'a pas continué de prendre ses médicaments et a assassiné un policier. Je ne comprends absolument pas comment on peut penser qu'il s'agit là d'une bonne politique publique. Selon l'information anecdotique, je pense que vous avez raison. J'aimerais que vous nous expliquiez vos brèves observations plus en détail, c'est-à-dire que vous nous donniez d'autres exemples, d'autres statistiques concernant ce qui semble être une corrélation inverse et ce qui en fait a peut-être beaucoup plus d'importance que tout ce que nous pourrions modifier dans le Code criminel. Voilà ma première question.
Ma deuxième question s'adresse à Mme Lyster. Vous faites valoir que la commission devrait être en mesure d'accorder une absolution inconditionnelle. L'exemple que vous avez donné était celui du syndrome d'alcoolisation foetale. Cela a un certain caractère plausible. Ce ne serait pas là une mesure très satisfaisante pour la victime d'une infraction en particulier. Accorderiez-vous une absolution inconditionnelle pour toutes les infractions, ou seulement pour les infractions mineures? La commission a-t-elle besoin de pouvoirs additionnels pour obliger cette personne à suivre un traitement, des pouvoirs additionnels en vue d'assurer la sécurité du public? Tout ce que vous faites, essentiellement, c'est de renvoyer dans la rue une personne qui non seulement est inapte à subir un procès mais qui souffre peut-être d'une maladie assez importante et qui risque de retomber dans la criminalité.
Ce sont là mes deux questions.
À 
 (1030)
(1030)


M. Tony Cerenzia: Je pense que la première question m'était adressée. Je n'ai pas d'autres données, sauf l'étude qui a été publiée dans la revue Nature, dont je parle dans mon mémoire. Nature est l'une des revues scientifiques les plus prestigieuses au monde.
Je fais partie d'un certain nombre de groupes de travail provinciaux, et ce que nous constatons lorsque nous élaborons les procédures c'est que tant que les équipes de professionnels répondent aux besoins des malades dans les collectivités, tant qu'ils restent au courant et grâce aux nouveaux médicaments, les malades restent en contact avec la réalité, ils s'en sortent assez bien. Au cours des trois à cinq prochaines années, il y aura encore une fois une baisse dans la population hospitalière, et je crains que cette corrélation est si claire qu'on se retrouvera encore une fois de plus avec le même problème. Je n'ai cependant pas de données comparables pour le Canada.


M. John McKay: Une grosse faille dans le système, c'est que la personne doit continuer à prendre ses médicaments. Si la personne ne fait pas cela...


M. Tony Cerenzia: C'est exact. Mais à force de cajoleries, en développant des rapports positifs, en offrant des services, en réduisant les effets secondraires, etc., un plus grand pourcentage des maladies continueront de prendre leurs médicaments. Je le sais lorsque quelqu'un a besoin de médicament ou de traitement. C'est assez clair.
Dans l'étude que j'ai citée précédemment, on a constaté que 50 p. 100 des personnes ne demandaient pas de traitement parce qu'elles ne se croyaient pas malades et qu'elles croyaient que le problème allait tout simplement disparaître.
À 
 (1035)
(1035)


Mme Lindsay Lyster: J'aimerais répondre à la question que vous m'avez posée, monsieur.
Dans le cas de l'accusé inapte, qui est la catégorie des personnes pour lesquelles nous disons que la commission d'examen devrait recevoir le pouvoir additionnel d'absolution inconditionnelle, la commission d'examen a déjà le pouvoir d'ordonner que ces personnes soient internées ou de leur accorder une absolution inconditionnelle. La commission a donc déjà le pouvoir de faire ce que vous dites. Par exemple, elle a le pouvoir de les libérer, mais selon certaines conditions en limitant leur liberté, lorsque la commission le juge approprié.
Nous disons que dans le cas où l'accusé inapte ne représente pas un danger pour la population, et il existe de tels cas, la commission d'examen devrait également avoir le pouvoir d'ordonner une absolution inconditionnelle dans un tel cas. Nous ne parlons donc pas ici d'une personne qui présente une menace. Cette personne ne devrait pas recevoir une absolution inconditionnelle. Cette personne devrait être soit détenue, soit se voir accorder une libération conditionnelle.


M. John McKay: Excusez-moi, mais la personne qui représente déjà un danger important pour le public n'a-t-elle pas déjà commis une infraction au Code criminel? C'est pour cette raison que cette personne en est arrivée là.


Mme Lindsay Lyster: Un accusé inapte n'est pas déclaré inapte parce qu'il représente un risque ou une menace pour qui que ce soit. Un accusé inapte est déclaré inapte parce qu'il ne comprend pas la nature des procédures et ne peut communiquer avec son avocat.


M. John McKay: Mais des accusations ont été portées contre cette personne.


Mme Lindsay Lyster: Cette personne peut avoir été accusée de vol.


M. John McKay: Peut-être, mais c'est toujours une menace pour la société. C'est peut-être une menace vague, mais c'est toujours une menace pour la société.


Mme Lindsay Lyster: Dans le cas d'un accusé inapte, il faut se rappeler qu'il a peut-être été accusé d'une infraction mineure, soit de vol mineur, de méfait, de nuisance publique, enfin un délit qui ne pose, du moins à mon avis, aucune menace pour la société ou pour la sécurité publique, qui était, je crois, ce qui vous préoccupait.
En fait, cette personne n'a pas été trouvée coupable de quoi que ce soit. On a tout simplement déterminé que cette personne était inapte à subir un procès, car elle ne pouvait communiquer avec son avocat ou parce qu'elle ne pouvait comprendre la nature des procédures qui avaient été entamées contre elle.
Donc à mon humble avis, on ne peut présumer ni supposer qu'un accusé inapte pose nécessairement un risque pour qui que ce soit, car ce n'est peut-être pas le cas. Il s'agit peut-être tout simplement d'une personne qui ne comprend pas ce qui se passe, mais qui ne pose aucun risque. C'est justement dans ce genre de cas, où la personne ne pose pas de risque et où il n'existe aucun traitement pour l'aider à devenir apte à subir un procès, que nous disons que la commission d'examen devrait avoir le pouvoir d'accorder une absolution inconditionnelle.
Vous avez dit que cela n'est peut-être pas acceptable pour la victime de l'infraction. C'est peut-être acceptable, si la victime comprend la maladie mentale et, dans le cas où une infraction a été commise, les raisons pour lesquelles elle a été commise. Ce qu'il ne faut pas oublier dans ce cas-ci, je pense, c'est que le double objectif des dispositions relatives aux troubles mentaux, comme la Cour suprême du Canada nous l'a rappelé dans l'affaire Winko, est de protéger le public des malades mentaux qui représentent une menace importante pour la sécurité publique et de sauvegarder le plus possible la liberté de l'accusé. Ce sont là les objectifs importants dans ce cas-ci. Il ne s'agit pas de voir si cela est acceptable ou non pour la victime.


Le président: Merci beaucoup.
Monsieur Cadman.


M. Chuck Cadman: Merci, monsieur le président.
À la suite d'une question qui a été soulevée par M. McKay, vous avez dit qu'un certain nombre de personnes n'allaient pas chercher d'aide parce qu'elles ne se rendaient pas compte qu'elles avaient un problème. J'imagine que ce qui préoccuperait la plupart des gens, surtout du point de vue d'un non-spécialiste, ce sont les gens qui savent qu'ils ont un problème et qui choisissent de ne pas prendre leur médicament pour une raison ou pour une autre et qui commettent ensuite une infraction. D'aucuns diraient que cette personne doit assumer la responsabilité de sa décision de ne pas prendre de médicaments, car elle savait très bien qu'elle avait un problème et quelles pouvaient en connaître les conséquences. Voyez-vous où je veux en venir? Qu'en pensez-vous?


M. Tony Cerenzia: Je suppose que cela dépend de la façon dont on voit les choses. Cela dépend si la personne a choisi de ne pas prendre ses médicaments ou si elle ne les a pas pris parce que son jugement était affaibli. Si on part du principe que la personne a choisi de ne pas prendre ses médicaments et est ensuite devenue malade... Il ne faut pas oublier non plus que ce n'est pas parce qu'une personne prend des médicaments que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Les gens ont des hauts et des bas. Ces maladies sont épisodiques. Une personne pourrait donc prendre une moment donné une décision que nous considérerions comme étant irrationelle en cessant de prendre ses médicaments et voir sa situation se détériorer jusqu'à ce qu'un événement se produise. J'imagine donc que c'est de ce point de vue qu'il faut voir les choses.
À 
 (1040)
(1040)


M. Chuck Cadman: Comment devrait-on s'y prendre avec cette personne en particulier?


M. Tony Cerenzia: Personnellement, je suis d'avis que si la personne est malade et inapte à faire un choix rationnel et raisonnable, je dirais que nous ne pouvons pas la tenir responsable de ce qu'elle a fait tout simplement parce qu'elle a cessé de prendre ses médicaments.
Est-ce que cela répond à votre question?


M. Chuck Cadman: Oui, plus ou moins. J'ai toujours du mal à comprendre ce mot. Je dis que la personne connaît les conséquences de ses actes.


M. Tony Cerenzia: C'est justement de cela dont il s'agit. Vous supposez que la personne connaît les conséquences de sa décision de ne plus prendre ses médicaments--et c'est le cas de certaines personnes.


M. Chuck Cadman: C'est la situation dont je parle.


M. Tony Cerenzia: Par exemple, je connais certaines personnes qui ont décidé de ne pas prendre leurs médicaments pendant quelques jours et qui ont recommencé à les prendre lorsqu'elles se sont aperçues que leurs symptômes revenaient. D'autres cessent de prendre leurs médicaments sans en reconnaître les conséquences. Ce n'est pas noir sur blanc. Il y a toute une zone grise ici.


Le vice-président (M. John McKay): Monsieur Macklin.


M. Paul Harold Macklin (Northumberland, Lib.): Merci.
En ce qui concerne la question fondamentale qui nous préoccupe ici, au moins une autre fois une personne a utilisé l'expression «degré de besoin» et «a besoin d'évaluation». J'ai entendu M. Battista mentionner ces expressions encore une fois aujourd'hui.
Si on faisait table rase sans avoir aucune des procédures actuelles en place à partir du moment où la personne est appréhendée, pourrions-nous revenir en arrière pour déterminer le degré des besoins de la personne? Le système nous permet-il à un moment donné d'établir un processus en vue d'évaluer le degré des besoins d'une personne à un stade précoce? Cela pourrait nous permettre d'éliminer du système les personnes qui souffrent d'un traumatisme crânien ou du syndrome d'alcoolisation foetale ou de tout autre problème pour lequel il n'existe aucun traitement, aucune solution dans le cadre de notre processus normal de traitement en santé mentale.
Pourriez-vous nous faire part de vos commentaires à ce sujet?


Me Giuseppe Battista: Je peux essayer. Il s'agit d'une situation anecdotique, qui se fonde tout simplement sur l'expérience, mais les tribunaux criminels ont souvent du mal à placer la personne et à lui obtenir de l'aide et les meilleurs soins possible. Les hôpitaux et les autres institutions manquent de ressources. Souvent, cette situation pose un problème, même lorsqu'il y a eu une évaluation ou lorsqu'il est nécessaire d'assurer un suivi au niveau du traitement.
Je peux vous dire que dans un cas tout récent dont on a beaucoup parlé dans les médias, les psychiatres ont insisté pour que le tribunal ordonne que la personne soit envoyée dans un hôpital en particulier. Ils craignaient que si on demandait à la commission d'examen de le faire, cette dernière estimerait peut-être que le crime qui a été commis était suffisamment grave pour que la personne soit détenue dans un hôpital psychiatrique médico-légal, alors qu'en fait ce n'est plus nécessaire pour cette personne. Tous les psychiatres, tant ceux de la Couronne que ceux de la défense, étaient d'accord pour dire qu'un hôpital communautaire serait mieux à même de répondre aux besoins de cette personne.
C'est en fin de compte ce qui est arrivé. Le financement pose cependant un problème. Souvent, les hôpitaux n'ont pas les moyens. Ça nous ramène à une autre question—celle de la durée maximale. Qu'arrive-t-il lorsque les fonds ne sont pas disponibles? On dit qu'il faut tout simplement envoyer la personne à l'hôpital et que l'hôpital devra faire quelque chose. C'est la réalité.
Les itinérants qui souffrent d'une maladie mentale se font parfois traitésr lorsqu'ils se font arrêter, sinon ils n'obtiennent pas de traitement. Je ne dis pas que la solution consiste à arrêter les gens, mais c'est la réalité. Les gens doivent obtenir de l'aide. Lorsqu'ils sont dans le système, ils ont besoin d'obtenir de l'aide, et malheureusement cela n'est toujours pas possible. Ce genre de situation se produit.
Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. J'essaie de soulever certaines des préoccupations entourant la question.
À 
 (1045)
(1045)


Le président: Merci beaucoup.
Y a-t-il quelqu'un d'autre que je...?


Mme Lindsay Lyster: J'aimerais moi aussi répondre à cette question, si vous me le permettez.
En Colombie-Britannique, nous avons un problème en ce sens que lorsque les juges disent qu'ils aimeraient qu'une personne en particulier soit évaluée, dans les cas de manifestation d'alcoolisme foetal ou du syndrome d'alcoolisation foetale, les autorités provinciales refusent d'envoyer cette personne dans une institution pour qu'elle subisse une évaluation en disant que le juge n'avait pas vraiment le pouvoir d'ordonner une telle chose. À notre avis, ce n'est pas bien.
S'il était possible grâce au droit criminel de dire clairement que les juges ont les pouvoirs spécifiques d'ordonner une telle évaluation au début du processus, cela serait à mon avis avantageux pour tout le monde.


Le président: M. Cerenzia puis M. Lanctôt.


M. Tony Cerenzia: Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois comprendre qu'en Ontario, si un juge émet une ordonnance de traitement ou d'évaluation, il doit déterminer que cela est possible avant d'exercer... J'imagine que cela dépend du cas. En fait, je pense que c'est plutôt en ce qui concerne les ordonnances récentes de traitement communautaire qui ont été mises en place il y a quelques années. Les services doivent être disponibles avant qu'il puisse exercer ce pouvoir, ou avant que cela puisse être fait.
Le problème, naturellement, c'est que si les gens savent que les services ne sont pas disponibles, est-ce qu'ils abandonnent alors tout simplement...? Encore une fois, il faudrait compiler les données à ce sujet. Par ailleurs, relativement à ce que vous avez dit au sujet d'une évaluation, je pense que c'est justement ce qu'ils tentent de faire avec la déjudiciarisation. Des cliniciens sont à la disposition des tribunaux pour faire des évaluations et tenter de fournir des renseignements sur la bonne mesure à prendre.


Le président: Merci beaucoup.
Monsieur Lanctôt, vous avez trois minutes.
[Français]


M. Robert Lanctôt: Merci, monsieur le président.
Maître Battista, vous avez dit un peu ce que j'ai dit plus tôt, et c'est ce qui est dommage dans tout ça. C'est vrai qu'il ne faut pas envoyer les gens du côté du système criminel afin de pouvoir les soigner, mais la réalité est évidente. C'est presque le seul endroit où quelqu'un peut enfin obtenir une ordonnance pour recevoir le traitement dont il a besoin. C'est incroyable. On est à réévaluer un système, et vous avez complètement raison. Je trouve ça dommage, c'est évident.
Je vais reprendre un peu la question de M. Macklin. Je ne pense pas que vous y avez répondu. C'est une question très intéressante si on veut en arriver à régler les cas d'exception dont parlait Mme Lyster, c'est-à-dire le cas des personnes pour lesquelles aucun traitement n'existe et qui peuvent rester longtemps dans le système. Ce sont sûrement des cas d'exception. Je pense que ça devrait être exceptionnel. Encore là, on parle d'hypothèses parce qu'on n'a pas de données, comme vous l'avez tous mentionné.
La question qui avait été posée cherchait à savoir si, avant de prendre une décision, on pouvait sortir du domaine judiciarisé ou si la commission pouvait donner conseil à un juge pour qu'il accorde une absolution inconditionnelle, un délai, afin qu'il y ait une ordonnance d'évaluation qui vienne dire, dans un cas d'exception comme le disait justement Mme Lyster, qu'aucun traitement n'est possible. Avant de subir son procès, la personne qui se trouve dans une telle situation peut donc attendre longtemps sans qu'aucun traitement pour la soigner, afin qu'elle puisse subir son procès, ne lui soit administré. On parle donc sûrement de cas très exceptionnels. En tout cas, j'espère que la science est rendue plus loin et que l'on est capable d'aider ces gens-là. Disons, toutefois, que ce genre de cas existe.
Est-il possible d'établir un processus d'évaluation un peu plus long pour en arriver à dire que, pour cette personne-là, jamais un traitement n'existera?
Je pense que c'était le but de la question de mon collègue. Est-ce qu'en imposant un système d'évaluation seulement pour amener la personne à subir son procès... On ne parle pas de non-responsabilité et de tout ça; on parle d'un accusé apte à subir un procès. Est-ce qu'un processus possiblement plus long qui nous permettrait d'être certains des résultats obtenus pourrait être établi? On pourrait former un panel de deux ou trois psychiatres ou d'autres gens vraiment responsables qui connaissent le problème. Est-ce qu'un processus comme celui-là pourrait être établi afin d'aider des personnes qui se trouvent dans des situations comme celles que vous avez mentionnées plus tôt afin qu'elles n'aboutissent pas dans le système judiciaire alors qu'au fond, il n'y a aucun traitement disponible pour celles-ci?
À 
 (1050)
(1050)
[Traduction]


Le président: Monsieur Battista.
[Français]


Me Giuseppe Battista: Je m'excuse, monsieur le député, d'avoir mal saisi la portée de la question.


M. Robert Lanctôt: Je ne sais pas si c'était le but, mais enfin.


Me Giuseppe Battista: On n'a pas trop commenté la question lorsqu'elle a été posée.
Au Barreau, nous ne favorisons pas l'idée de permettre à la commission, par exemple, de libérer inconditionnellement une personne dans des circonstances comme celles-là parce que la personne sera ramenée devant le tribunal. Elle doit l'être. La décision peut être prise au niveau du tribunal et du ministère public.
[Traduction]
La décision peut être prise par le bureau du procureur de la Couronne. Les avocats de la Couronne peuvent prendre cette décision.
[Français]
Il y a un dilemme qui se pose. Je suis un avocat de la défense et j'ai évidemment des préoccupations par rapport aux personnes accusées, inculpées dans le système de justice. Si un représentant du ministère public était ici, il vous ferait probablement valoir le fait que les offenses criminelles, lorsqu'il s'agit de crimes graves, ne sont pas prescriptibles au Canada, sauf dans le cas d'infractions de nature sommaire. Si l'on dit, par exemple, que la personne sera libérée après un an ou 5 ans même si elle n'est pas apte, cela peut peut-être répondre à une préoccupation fort légitime voulant qu'une personne malade ait besoin d'aide. Je suis de cet avis. On a souvent dit que le système pénal ou criminel est un mauvais instrument dans ces situations-là.
Par contre, il faut néanmoins que l'on soit objectif. On voit parfois au Canada des poursuites pour des délits commis il y a 20 ou 25 ans. Je ne dis pas qu'il faut que les gens soient détenus pendant 20 ou 25 ans. Je ne voudrais pas être compris de cette façon-là, mais je pense qu'il existe présentement des mécanismes dans la loi qui font en sorte que les gens n'ont pas à être détenus. Quand une personne est sous évaluation ou qu'elle doit subir un suivi psychiatrique, elle n'a pas besoin d'être détenue. La détention, c'est l'exception. Ça ne doit pas être la règle; ça ne doit pas être la norme. C'est l'exception. Il s'agit de cas où nous n'avons aucun autre moyen à notre disposition. Alors, c'est vraiment de ce point de vue-là que je voudrais être compris.
Lorsque la préoccupation se fait sentir, au niveau du délai, entre le moment où la commission étudie le cas, que la personne est prise en charge et qu'on lui apporte les soins nécessaires et la réalisation que, fort probablement, cette personne-là ne sera jamais apte, il me semble qu'il est du devoir du ministère public d'assumer les responsabilités inhérentes à sa fonction et à sa charge et qu'il doit annoncer qu'il ne souhaite pas donner suite à l'accusation, pour des motifs fort judicieux.
À notre avis, il y a une possibilité qui existe et, effectivement, nous pouvons rejoindre ma collègue, Mme Lyster. Peu importe que ce soit une commission d'examen qui prenne la décision ou le ministère public, la décision peut être prise. C'est une question d'opportunité, et je pense que ces choses-là doivent être évaluées. Si les ministères publics n'utilisent pas suffisamment leur discrétion, ça, c'est un autre problème. À ce moment-là, les ministères qui sont responsables, tant au niveau fédéral que provincial--les poursuites pénales sont généralement du ressort des provinces--, peuvent émettre des directives. Il y a une solution. Elle existe. Il s'agit de l'appliquer.
La plus grande préoccupation, à mon humble avis, c'est que les gens ne reçoivent pas les soins dont ils ont besoin, comme le disait Mme Lyster plus tôt. Elle nous a donné l'exemple de personnes que l'on envoie subir des examens. Très souvent, les juges émettent des ordonnances demandant des examens ou des évaluations ou demandant à certains hôpitaux en particulier de recevoir des personnes. Les hôpitaux ne les reçoivent pas faute de lits et faute de moyens de répondre à ces besoins-là. Ça, c'est une réalité.
L'autre réalité, c'est que les juges rendent des ordonnances pour que des personnes soient envoyées à des instituts psychiatriques comme l'Institut Philippe Pinel de Montréal, par exemple. L'institut ne dispose pas d'un nombre suffisant de lits. S'il s'agit d'une femme, on l'envoie donc à la Maison Tanguay; s'il s'agit d'un homme, on l'envoie au Centre de détention de Rivières-des-Prairies. Ces personnes-là rencontrent donc un psychiatre une semaine plus tard.
Les besoins sont là. Ils sont pressants; ils sont urgents. Il faut prendre les moyens pour y répondre. Il ne s'agit pas d'un problème législatif, mais bien d'un problème de moyens.
À 
 (1055)
(1055)
[Traduction]


Le président: Merci beaucoup.
M. Grose et M. MacKay.


M. Ivan Grose (Oshawa, Lib.): Merci, monsieur le président.
Je vais ressasser la même histoire encore une fois, mais je pense que cela est nécessaire.
Nous tentons ici d'améliorer ou de corriger un système, mais peu importe ce que nous faisons, peu importe la conclusion à laquelle nous arrivons, nous nous heurtons constamment au même problème, qui est le système provincial, qui est censé faire partie de la solution, mais qui pose un problème. C'est donc un exercice inutile. Je ne blâme pas les témoins, en fait, c'est notre problème. Cependant, nous n'arriverons à rien car il nous manque un élément sur lequel nous avons très peu de prise--en fait aucune prise. Nous revenons toujours à la même chose. La réponse est toujours que le système provincial est inadéquat. Vous l'avez très bien expliqué, maître Battista; si le système ne peut s'en occuper, on les renvoie en prison. Ce n'est pas ce que nous voulons, mais c'est ce qui va arriver.
Merci, monsieur le président.


Le président: Merci, monsieur Grose.
Je vais maintenant donner la parole à M. MacKay pour qu'il puisse poser ses questions. Si quelqu'un veut répondre à M. Grose en répondant à M. MacKay, libre à vous.
Peter.


M. Peter MacKay: Merci, monsieur le président.
Je partage à peu près le même sentiment que M. Grose. Maître Battista, vous avez exprimé très clairement certaines réalités pratiques qui reviennent sans cesse en ce qui concerne les ressources. J'ai vu des juges ordonner un traitement pour maladie mentale, ordonner un traitement pour la maîtrise de la colère. Je ne sais pas s'ils sont idéalistes ou si parfois ils y vont un peu fort en prenant ces ordonnances dans l'espoir que la province ou le gouvernement fédéral réagiront. Tout le monde qui travaille dans le système--la Couronne, les avocats de l'aide juridique, les membres du personnel du tribunal, les juges--sait que la personne trouvée coupable va sortir de la salle de tribunal. On ne va pas mettre cette personne dans une boîte téléphonique et d'un coup de baguette magique la guérir. Ce n'est pas possible.
Une bonne partie du problème découle du fait, comme on l'a dit, que ces programmes sont insuffisants et que le système est surchargé et qu'il faut sensibiliser les gens à cette situation. J'ai l'impression que bon nombre d'entre vous sont d'accord pour dire que le probème n'est pas uniquement la surcharge de travail des unités médico-légales et l'absence de programmes de santé mentale, mais aussi le fait que le système judiciaire est lui aussi surchargé. La charge de travail de la Couronne et de la défense qui doivent souvent prendre ces décisions très difficiles...
Maître Battista a dit que certaines des solutions de rechange ou des options à l'heure actuelle qui s'offrent à la Couronne consistent à retirer les accusations ou à y surseoir dans la catégorie des accusés inaptes. L'aide juridique se trouve vraiment dans une position difficile. Les avocats de l'aide juridique doivent parfois tenter d'obtenir des directives d'un client qui est incapable de leur donner des directives. Ils doivent donc jouer le rôle de psychologue ou d'un membre de la famille ou d'un parent si la personne n'a pas le système de soutien traditionnel.
J'imagine que la question précise à laquelle je voudrais revenir, pour ne pas tout simplement être d'accord avec tout ce que vous avez dit, est la question d'une sorte de traitement obligatoire. Madame Lyster, vous avez peut-être vu des cas où l'accusé était alcoolique ou toxicomane et où le tribunal a ordonné à cette personne de suivre un traitement en présence d'une personne, d'un membre de la famille ou d'un agent du tribunal. Encore une fois, je sais que du point de vue des libertés civiles, il est très difficile d'ordonner à une personne de suivre un traitement.
Pour revenir à ce que nous pouvons faire pour corriger la situation, est-ce une option que nous devrions examiner? Est-ce quelque chose que nous devrions peut-être insérer dans les dispositions du Code criminel? Nous savons que lorsqu'une personne ne suit pas son traitement, cela déclenche tout un processus et ne fait qu'ajouter au problème. Est-ce une question que nous devrions examiner?
Enfin, comme praticiens, comme personnes qui travaillent dans le système, que recommandez-vous que nous fassions pour tenter de combler cette lacune du point de vue provincial? Nous allons commencer à entendre des témoins des provinces. Quel message à votre avis devrions-nous leur transmettre?
Á 
 (1100)
(1100)


Le président: Avant de laisser les témoins répondre à la question, je voudrais dire que nous avons déjà entamé la période qui devait être consacrée au prochain groupe de témoins, alors je vous demanderais d'être le plus bref possible.
Madame Lyster.


Mme Lindsay Lyster: Je vais tenter d'être très brève.
S'il est une chose que j'aimerais vous dire, à vous écouter exprimer votre frustration et même si je sais que tous ceux qui ont de l'expérience dans ce domaine partagent ce sentiment, c'est que c'est une erreur d'utiliser le droit criminel pour combler les lacunes au niveau des ressources provinciales dans le domaine de la santé ou de la législation provinciale en ce qui a trait à la santé. Le droit criminel c'est très bien, mais ce n'est pas conçu... Comme mon collègue maître Battista l'a dit, c'est un drôle d'outil pour assurer la santé des gens, pour tenter de s'assurer qu'ils s'occuperont d'eux-mêmes, qu'ils seront traités. Je dirais qu'il ne faut absolument pas vous laisser tenter--même si cela serait tout à fait compréhensible--d'utiliser le droit criminel afin d'atteindre les objectifs provinciaux en matière de santé.


Le président: Monsieur Cerenzia.


M. Tony Cerenzia: J'aimerais simplement signaler brièvement, si vous me le permettez, que je suis d'accord avec l'intervention de Mme Lyster, mais en même temps, je crois que le Code criminel ou la loi même ne doit pas empêcher ou entraver le traitement. À notre avis, un des problèmes tient au fait qu'on donne aux gens le droit à la liberté mais pas le droit au traitement. C'est là que la loi peut jouer un rôle.
[Français]


Le président: Maître Battista.
[Traduction]


Me Giuseppe Battista: J'aimerais réitérer un aspect que nous avons déjà mentionné et que M. Cernezia avait mentionné, c'est-à-dire la nécessité de disposer de données et d'études objectives.
Merci.


Le président: Merci beaucoup. Votre exposé a été très instructif. Je peux vous dire d'après les réactions des membres du comité que vous nous avez aidés à mieux comprendre cette question et que nous vous en sommes reconnaissants.
Je vais suspendre la séance pour quelques minutes, le temps que ce groupe de témoins puisse se rendre à la tribune ou peut-être quitter, et que le prochain groupe puisse prendre place à la table.
Á 
 (1102)
(1102)
Á 
 (1107)
(1107)


Le président: Pour que nous ne prenions pas trop de retard, je poursuis la 76e séance du Comité permanent de la justice et des droits de la personne.
Avant de donner la parole aux témoins, j'aimerais régler brièvement une question avec les membres du comité. Comme vous le savez, nous avons reçu un avis de motion de M. MacKay et j'aimerais que nous en débattions jeudi lors de notre prochaine réunion. Règle générale, nous nous occupons de ce genre de chose à la fin de la séance parce que nous ne voulons pas que les témoins invités soient obligés d'attendre pendant que nous discutons de ce genre d'affaires. Si personne ne s'y oppose, nous examinerons la motion en question à la fin de notre séance de jeudi. Merci.
J'en arrive maintenant au deuxième groupe de témoins que nous accueillons aujourd'hui. J'aimerais tout d'abord m'assurer que tous ceux dont le nom figure sur la liste sont bien ici. C'est le cas.
Nous recevons Me Malcolm Jeffcock du Bureau d'aide juridique de la Nouvelle-Écosse ainsi que les représentants du ministère du Procureur général de l'Ontario, MM. Curt Flanagan et Robert Cattrell...


Maître Robert Cattrell (procureur général adjoint de Simcoe, Ministère du Procureur général de l'Ontario): Cattrell.


Le président: Cattrell.
[Français]
Enfin, de l'Association des groupes d'intervention en défense de droits en santé mentale du Québec, on accueille MM. Paul Morin et Jean-Yves Pronovost.
[Traduction]
Je vais d'abord donner la parole au Bureau d'aide juridique de la Nouvelle-Écosse. Je rappelle aux témoins que le comité accorde généralement dix minutes pour la déclaration préliminaire. Quand ce délai sera sur le point d'être écoulé, je vous ferai signe, discrètement au début et puis moins discrètement, puisque nous voulons pouvoir vous poser le plus de questions possible.
Monsieur Jeffcock.


Maître Malcolm Jeffcock (avocat, Bureau d'aide juridique de la Nouvelle-Écosse): Merci, monsieur le président. J'aimerais d'abord remercier le comité de m'avoir invité à comparaître aujourd'hui.
Le sujet dont nous parlons me tient à coeur et bien sûr il revêt beaucoup d'importance en ce qui concerne le réexamen de l'article 672.
J'ai présenté certaines observations écrites le 31 décembre. Compte tenu du délai qui m'est alloué, je vais aborder quatre aspects dont le comité tiendra compte, j'espère, au moment de revoir la loi.
Dans un premier temps, je vais aborder la notion de l'aptitude à subir son procès. À l'heure actuelle, les critères utilisés pour la déterminer sont très peu rigoureux. Beaucoup d'avocats s'interrogent sur la pertinence des normes qui sont appliquées pour déterminer l'aptitude d'un accusé à subir son procès. Cette question préoccupe tout particulièrement les avocats qui s'occupent de personnes dont l'aptitude à communiquer avec leur avocat est discutable.
Est-ce qu'une personne est vraiment capable de charger un avocat de la défendre lorsqu'elle n'est pas en mesure de comprendre les répercussions de ses choix sur sa défense? Il arrive souvent que lorsqu'un avocat traite avec une personne susceptible de faire l'objet d'un verdict de non-responsabilité criminelle à l'issue de son procès, cette personne est encore en proie à des idées délirantes au moment où elle doit prendre des décisions cruciales. En dépit de cela, cette personne est apte à subir son procès parce qu'elle est capable de communiquer avec son avocat. Or, cette communication n'est pas vraiment pertinente pour déterminer si elle est apte ou non à subir son procès.
À la lumière des grands arrêts fondés sur le paragraphe 10(b) de la Charte qui garantit le droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat, nous savons tous qu'il faut que la personne qui exerce ce droit le fasse d'une façon raisonnable. Et pourtant, au moment où l'on détermine si une personne est apte à subir son procès, on considère non pertinent le fait qu'elle ne soit pas en mesure de communiquer d'une façon intelligente avec son avocat ou de lui donner des directives de façon raisonnable. Ainsi, nous devons composer avec ces deux critères qui sont incompatibles. Une personne peut être capable de parler à son avocat pour lui dire qu'il fait beau sans pour autant comprendre le moindrement l'importance et la pertinence de ce qu'elle dit relativement à l'issue de l'affaire qui la concerne, même s'il s'agit de questions qui peuvent nous sembler simples à vous et à moi.
Le droit de garder le silence est important. La personne accusée peut parler à son avocat. Et celui-ci peut lui conseiller de ne pas témoigner parce que ce n'est pas dans son intérêt, étant donné que la poursuite n'a pas présenté une preuve suffisante pour convaincre le juge des faits. Et pourtant la personne, parce qu'elle souffre d'une maladie mentale, veut absolument prendre la parole lors de son procès. Dans ce cas, même si elle est capable de communiquer, elle n'est pas vraiment en mesure de donner des directives à son avocat.
À mon humble avis, je pense qu'il faudrait tenir compte de cet aspect au moment de déterminer les critères qui serviront à déterminer si une personne est apte à subir son procès. J'estime pour ma part que le simple fait de pouvoir communiquer est un critère très insuffisant. Le critère déterminant doit être la capacité de communiquer d'une façon intelligente et lucide de manière à pouvoir non seulement collaborer à sa défense mais aussi à donner des directives à son avocat.
La deuxième question que j'aimerais aborder relativement aux personnes qui pourraient être inaptes à subir leur procès est celle de l'absolution inconditionnelle. J'ai entendu les interventions du groupe de témoins précédent et certaines des questions qu'on leur a posées. Ce qui me frappe c'est que dans ce domaine, tout le monde évoque le scénario le plus catastrophique: si on accorde une absolution inconditionnelle à une personne déclarée inapte à subir son procès, elle ira commettre aussitôt un crime horrible. Cela me semble une façon un peu simpliste de voir les choses.
J'avais certaines statistiques à présenter au comité. Elles auraient peut-être aidé le comité à comprendre la situation dans notre province. Les documents ont été préparés par notre service provincial de psychiatrie médico-légale, en anglais seulement. Je sais que je ne peux les distribuer, mais j'y puiserai certains des renseignements que je vais vous transmettre.
Ces dernières années, on a noté une augmentation spectaculaire du nombre de personnes ayant reçu un verdict de non-responsabilité criminelle en Nouvelle-Écosse. En définitive, cela est directement attribuable au fait que l'on recourt au système judiciaire pour obtenir des traitements psychiatriques. Au cours du dernier exercice, 40 personnes ont fait l'objet d'un verdict de non-responsabilité criminelle. Il y a de quoi s'alarmer lorsqu'on voit le type d'infraction dont ces personnes avaient été accusées: dans plus de 40 p. 100 des cas, elles avaient été accusées d'avoir trompé la paix, proféré des menaces ou commis des méfaits. La catégorie d'infraction la plus fréquente était celle des voies de fait, accusation portée contre 12 personnes (30 p. 100), puis celle d'avoir proféré des menaces (27 p. 100). Aucune de ces personnes n'avait été accusée d'une infraction criminelle grave; j'entends par là, des infractions ayant causé des lésions corporelles, des agressions sexuelles ou des tentatives de meurtre, par exemple.
Á 
 (1110)
(1110)
Il y a eu des infractions. Il y a eu un cas d'incendie criminel, six cas de méfait et deux vols qualifiés—on les a classés dans les introductions par effraction, et je sais personnellement que dans au moins l'un de ces cas, il s'agissait d'une introduction par la force dans la maison de la famille de la personne en question—il y a eu également 12 cas de voies de fait, 11 cas de menace, un cas de conduite dangereuse et deux cas où la paix a été troublée.
C'est généralement de ce type de personnes qu'il est question; pas de personnes qui commettent des infractions criminelles graves. Mais je digresse.
Pour en revenir à la question de l'accusé inapte, je répète mes commentaires selon lesquels les infractions typiques—si une telle chose existe—commises par les personnes atteintes de maladies mentales ne sont pas des actes criminels majeurs. Quand cela se produit, toutes les manchettes en parlent, mais il y en a très peu. Un accusé inapte n'est pas typiquement une personne qui commet un acte odieux, mais pour voir un bel exemple du genre de cas que nous rencontrons parfois, vous pouvez voir un film assez populaire.
Vous vous souvenez peut-être d'un film d'il y a quelques années intitulé Rain Man. Dustin Hoffman jouait le rôle d'un adulte qui avait été un enfant autistique vivant à l'intérieur de son propre petit monde dans un établissement. Son frère l'a fait sortir de cet établissement. Il y a une scène dans le film où le frère essaie de le faire monter à bord d'un avion. Le personnage de Dustin Hoffman réagit en criant, en hurlant et en giflant son frère.
En Nouvelle-Écosse, en particulier après le 11 septembre, si vous agissez ainsi à l'aéroport, il est probable qu'un agent de la GRC vous arrêtera et vous accusera d'avoir fait du tapage, à tout le moins, et peut-être même de voies de fait.
Nous avons donc ce personnage qui donne un bel exemple du type de comportement qui amène les personnes souffrant de troubles psychiques à se retrouver aux prises avec le système de justice pénale: elles commettent un acte mineur, qui n'a pas de répercussion importante sur la sécurité des autres Canadiens, mais cette personne se retrouve quand même aux prises avec le système de justice pénale.
Si vous faisiez passer ce personnage par notre système, il ne pourrait être traité, d'après ce que vous avez pu voir. Cette personne avait des capacités limitées de comprendre des éléments importants de sa vie. Il savait où trouver ses sous-vêtements, il connaissait les moyennes au bâton, mais il n'était pas capable de donner des instructions éclairées à son avocat, d'après moi. Son niveau était tel que je pense que même au Canada, il aurait été jugé inapte à subir un procès. Par conséquent, il se retrouverait dans notre système médico-légal, faute d'une meilleure expression, pour le reste de sa vie, parce que le tribunal n'a pas le pouvoir d'accorder une absolution inconditionnelle.
Je soutiens respectueusement que c'est tout simplement une mauvaise chose que de faire passer une personne comme celle-là, dont le personnage était représenté comme plutôt gentil et non violent, dans le système de justice pénale et exiger qu'il y demeure—même s'il ne présente aucune menace importante pour quiconque. Comment pouvons-nous avoir un système qui permet qu'une personne apte et jugée non responsable criminellement puisse recevoir une absolution inconditionnelle, tandis qu'une personne qui n'a pas été trouvée coupable, ou qui n'a pas vu un tribunal conclure qu'elle avait commis une infraction criminelle, puisse demeurer indéfiniment dans le système? Je soutiens respectueusement que vous devez examiner cette question.
La troisième question dont je veux parler brièvement est celle des durées maximales de détention. Il est manifeste, je pense, certainement d'après les commentaires que j'ai entendus ce matin de la part de certains députés et des témoins précédents, qu'il y a des lacunes dans les lois provinciales. M. Grose a dit que nous en étions arrivés à une sorte de trou noir, dans les lois. En Nouvelle-Écosse, on a rédigé récemment une mesure législative, mais elle n'a pas encore été promulguée—en fait, elle n'a pas été rédigée, elle a été proposée par la Commission de réforme du droit—et cette mesure nous rapprocherait de la loi ontarienne actuelle. On l'a rédigée en se référant à la loi civile de l'Ontario.
Je soutiens respectueusement que vous voudrez peut-être examiner la question de la distinction entre les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité et les actes criminels. Les personnes qui se retrouvent dans le système en raison d'infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité ne sont peut-être pas dangereuses, mais quand on leur applique les instruments d'évaluation du risque, on pourrait déterminer qu'elles représentent un risque significatif. Je ne pense pas que votre comité devrait négliger le fait que c'est avec ces critères principalement qu'on détermine s'il y a lieu de libérer quelqu'un dans ce pays, du moins en Nouvelle-Écosse actuellement.
Á 
 (1115)
(1115)
L'utilisation des instruments actuariels d'évaluation du risque par les psychologues équivaut presque à la même situation qu'on a dans les cas des conducteurs masculins de 16 ans. Ils représentent un risque plus élevé. On utilise des mécanismes et des instruments semblables à ceux que les psychologues utilisent pour dire qu'une personne qui a de tels antécédents entre dans la catégorie du risque; par conséquent, la personne représente un risque modéré ou une menace significative. Les gens perdent leur liberté en fonction de ce critère.
Enfin, comme il me reste environ une minute, je tiens à vous parler de l'alinéa 672.24(1), qui permet qu'on désigne un avocat dans les cas où il semble que l'accusé n'est peut-être pas apte. Cependant, je signale qu'il n'y a pas de disposition semblable dans le Code en ce qui concerne ceux qui sont aptes mais qui ne sont peut-être pas criminellement responsables. Il y a des personnes qui sont aptes mais qui ne seront probablement pas tenues criminellement responsables et qui iront à leur procès sans avocat.
Il y a aussi l'alinéa 672.5(8), qui permet à la commission de désigner un avocat pour l'accusé, si les intérêts de la justice l'exigent. Encore là, ce n'est pas le tribunal devant lequel le procès se tiendra. C'est une autre chose que j'exhorte votre comité à examiner.
Je crois que je n'ai plus de temps et je m'arrête donc ici.


Le président: Merci beaucoup.
Nous passons maintenant à Me Flanagan et à Me Cattrell.


Maître Curt Flanagan (procureur de la Couronne pour Leeds et Grenville, ministère du Procureur général de l'Ontario): Merci beaucoup. Je remercie le comité. C'est un privilège de comparaître devant vous ce matin avec M. Cattrell.
À titre d'introduction, j'informe le comité que M. Cattrell et moi avons une vaste expérience pratique de comparution devant des commissions d'examen et de participation à des comités consultatifs du Procureur général de l'Ontario sur les troubles mentaux.
Nous avons préparé des mémoires—ils ne sont pas traduits, et je m'en excuse—où nous abordons toutes les questions soulevées en plus de faire des suggestions de modifications législatives concernant certaines procédures prévues dans la Partie XX.1 du Code criminel. J'en ai remis six exemplaires, comme je l'ai dit.
Je prévois diviser les dix minutes qui nous sont attribuées entre M. Cattrell et moi-même, et j'ai déjà commencé mes cinq minutes. Nous examinerons deux questions pendant ces dix minutes: je parlerai de l'aptitude à subir un procès et M. Cattrell parlera de la question des durées maximales de détention.
Pour commencer, en ce qui concerne la possibilité d'apporter une modification législative au Code criminel de manière à permettre aux commissions d'examen d'accorder une absolution inconditionnelle aux accusés inaptes, le Procureur général de l'Ontario y est opposé.
Je me permets d'abord de dire que notre position à titre de procureurs de la Couronne, sur le plan concret et pratique, est à bien des égards celle de protecteurs du public—nous nous occupons de la sécurité du public en général par rapport à des personnes qui peuvent être libérées dans la collectivité. L'octroi à la commission d'examen du pouvoir d'accorder une absolution inconditionnelle signifierait qu'on met l'accent sur un seul aspect. C'est là la difficulté. On regarderait alors à travers une seule lentille plutôt qu'à travers deux.
Je suis persuadé que les membres du comité ont entendu d'autres témoins dire que le critère utilisé pour qu'une commission d'examen accorde une absolution inconditionnelle serait semblable à celui qu'on utilise pour un accusé jugé non responsable criminellement, à savoir le fait que la personne pose ou non un risque significatif pour la sécurité du public. J'estime que les procureurs, plutôt que les commissions d'examen, sont bien mieux placés pour déterminer d'abord si une condamnation doit être confirmée ou non. Je dis cela pour deux raisons.
Premièrement, nous possédons souvent beaucoup plus d'informations que celles qui sont présentées à une commission d'examen, car il peut même arriver—je crois que c'est le cas dans certaines autres provinces—qu'un procureur ne soit même pas présent. Nous disposons d'une foule d'informations que nous pouvons évaluer pour déterminer s'il y a un risque significatif. Nous évaluons aussi divers facteurs en plus du risque significatif, comme la victime, ou l'ordonnance du tribunal portant que l'affaire soit renvoyée à nouveau devant un tribunal afin que l'affaire puisse être dûment jugée, ainsi que le meilleur intérêt des personnes accusées. Nous sommes donc d'avis que nous devrions garder cette compétence, parce que nous sommes les mieux placés pour évaluer cette question.
On a aussi demandé ce qu'il en était dans le cas d'un accusé souffrant de troubles mentaux, d'une personne inapte qui—je prends cet exemple qui a été utilisé ce matin—vole un pain. Le fait est que nous ne voyons pas une telle personne devant une commission d'examen, et ce pour la raison suivante. Il y a un certain nombre de mesures de protection découlant du Code criminel et de notre pouvoir discrétionnaire en tant que procureurs, qui permettent de tenir compte des besoins de cet accusé souffrant de troubles mentaux.
En tout premier lieu, à titre de procureurs, nous avons le devoir de nous assurer qu'il y a une possibilité raisonnable d'obtenir une condamnation, mais un fait tout aussi important est que nous avons également le devoir de nous assurer que la poursuite sert l'intérêt public.
Par conséquent, dans le cas de l'accusé souffrant de troubles mentaux qui arrive devant les tribunaux et est déclaré inapte à subir son procès, après une évaluation, j'ai à ma disposition divers moyens de trouver une solution de rechange pour cet accusé: après un processus de sélection, on peut le confier à divers organismes communautaires; on peut le faire surveiller par des parents; ou encore on peut avoir recours à des ordonnances judiciaires de supervision, sans toutefois faire passer ces personnes par une commission d'examen judiciaire ou les envoyer en détention.
Á 
 (1120)
(1120)
En outre, comme on l'a signalé, le Code criminel lui-même prévoit déjà un mécanisme au paragraphe 672.33. Nous avons une obligation, à titre de procureurs de la Couronne, d'examiner chaque personne jugée inapte, dans une période de deux ans, pour déterminer si nous avons une preuve prima facie ou non. Et je peux vous dire qu'à titre de procureurs de la Couronne, nous ne le faisons pas tous les deux ans, nous le faisons plus souvent. Nous le faisons chaque fois qu'une commission d'examen étudie le cas d'un tel accusé. Nous cherchons constamment à servir les intérêts fondamentaux de l'accusé.
Nous, les procureurs, ne tenons pas à faire languir la personne qui vole un pain devant une commission d'examen ou en prison. Il y a donc déjà un mécanisme prévu dans le Code criminel. Vous avez peut-être entendu parler dans le passé de tribunaux pour les accusés souffrant de troubles mentaux, par exemple—on commence à voir surgir de tels tribunaux partout en Ontario. Ils reflètent les besoins spécifiques de ces personnes ayant une déficience et qui ne doivent pas se retrouver en prison ou devant des commissions d'examen, et nous pouvons certainement déjudiciariser leur cas.
L'autre question plus difficile—et elle a été soulevée par un autre groupe de témoins—est de savoir que faire de ces autres personnes qui passent devant notre commission d'examen et qui peuvent présenter un risque significatif. Ces personnes peuvent refuser de prendre leurs médicaments, de sorte qu'elles peuvent aller poser un risque significatif pour le public. Cela nous préoccupe beaucoup, étant donné que nous représentons le public. Je peux informer le comité que nous examinons toutes sortes de renseignements pour évaluer ces situations à titre de procureurs.
Il se peut qu'un jour j'appelle un organisme communautaire pour demander comment s'est comportée telle ou telle personne ces dernières semaines. Il est ensuite possible de fournir cette information à la commission d'examen. Ce n'est pas par hasard, j'en suis persuadé, que des psychiatres que vous avez entendus, ou d'autres professionnels, vous ont dit qu'ils sont heureux de voir des procureurs de la Couronne présents lors d'audiences de commissions d'examen. Je peux vous dire que c'est simplement parce que nous disposons du réseau nécessaire pour apporter des renseignements pertinents. Je répète que nous disposons de certaines mesures de protection.
En dernier lieu, et je pense à certains cas réels, si la commission d'examen—je ne parlerai pas de «fief», je parlerai plutôt de «renvoi»—renvoie un accusé inapte en lui accordant simplement une absolution inconditionnelle, cela équivaut à l'acquitter. La personne n'est pas identifiée comme coupable, aucune peine n'est imposée, il y a un traitement. Mais une difficulté peut survenir. Supposons que cette personne ait besoin de l'appui de sa famille, de parents. Lorsque la commission d'examen accorde une absolution inconditionnelle, la personne sort du système. Que se passe-t-il si cette personne ne suit pas son traitement? À titre de procureur, j'ai vu des parents, des amis et même des accusés venir me dire qu'ils sont heureux qu'il y ait eu une sorte d'ordonnance, car ils peuvent ainsi faire l'objet d'une surveillance constante.
Je pense enfin—et c'est vraiment mon dernier point—qu'il ne s'agit pas de les envoyer en détention. Les commissions d'examen peuvent accorder des absolutions inconditionnelles. Elles peuvent aussi prendre des ordonnances de détention, mais il s'agit d'ordonnances très souples. On peut permettre à une personne de vivre dans la collectivité avec sa famille et l'obliger à se présenter devant quelqu'un une fois par année, ou une fois par mois, et cette personne prend ses médicaments. Je ne veux simplement pas que le comité ait l'impression que parce qu'une personne est inapte, on la fait enfermer dans un hôpital ou dans un établissement de détention.
Enfin, je dois faire une mise en garde. Il se peut que quelqu'un commette un méfait, par exemple, qui ne paraît pas grave à première vue. Nous rencontrons cependant dans le cadre de nos fonctions, des personnes souffrant de paraphilie, des pervers sexuels, de sorte qu'un méfait ou une intrusion illicite la nuit dans la cour d'une maison, ou encore une introduction par effraction motivée par la perversion sexuelle, peuvent ne pas sembler graves à première vue, mais quand on examine les antécédents de l'accusé, on peut juger ces méfaits très graves. Il faut aussi examiner l'infraction. Nous n'examinons pas seulement les cas de meurtres et de vols qualifiés.
Je vous remercie. Je suis désolé d'avoir dépassé les cinq minutes prévues.
Á 
 (1125)
(1125)


Le président: Dites-le plutôt à M. Cattrell. Vous avez 30 secondes.
Des voix: Oh, oh!
Le président: Je vous taquine, mais je vous prie d'essayer d'être aussi bref que possible.


Me Robert Cattrell: Merci.
Permettez-moi de répéter comme Curt, que je suis heureux de pouvoir m'adresser aux membres du comité, même si je dois le faire plus rapidement que je l'avais prévu.
Je suis ici pour parler de la question de la durée maximale. Nous avons essayé de traiter d'un certain nombre de questions par écrit, et nous pensions traiter des deux principales dans notre intervention au comité. Vous entendez évidemment beaucoup parler de la question de la durée maximale, et cela montre, à mon avis, qu'il s'agit d'une question très importante. C'est peut-être la question la plus importante, en ce qui concerne le risque qui pourrait en résulter pour la population, si vous deviez adopter une disposition à cet égard. En ce qui concerne le danger pour la population, les risques qui en découleraient dépassent nettement ceux qui pourraient découler de toute autre modification possible.
Le Procureur général de l'Ontario est d'avis qu'il ne faut pas imposer de durée maximale, et il estime en outre que les dispositions non promulguées à cet égard devraient être retirées du Code criminel. Finissons-en avec cette question. Elle a fait l'objet de plaidoiries, de décisions, et elle a non seulement été déclarée constitutionnelle par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Winko et l'affaire LePage, mais celle-ci lui a même donné sa bénédiction, comme on peut le voir en lisant les arrêtés.
L'argument en faveur de l'imposition d'une durée maximale, à mon humble avis—et c'est la position du Procureur général de l'Ontario—est fondé sur un vice de raisonnement fondamental selon lequel il y a en l'occurrence une sorte de discrimination. La Cour suprême du Canada a examiné de front cette question dans l'affaire Winko et a conclu qu'il n'y avait pas discrimination, parce que la discrimination survient manifestement lorsqu'on fait une distinction entre deux groupes de gens sans motif valable. En l'occurrence, il existe un motif valable.
De fait, on a un régime dans le cadre duquel on essaie d'être sensible aux besoins de contrevenants ayant des troubles mentaux, on veut leur assurer le traitement qu'ils méritent, on les traite d'une manière particulière, qui tient compte du fait qu'ils n'ont pas été tenus responsables criminellement. On les retire donc pour les faire entrer dans ce système. L'idée selon laquelle on gagne alors sur les deux tableaux, ne vaut pas—celui où l'on est déclaré responsable et celui où l'on n'est pas déclaré responsable.
Toute l'idée des peines maximales fait partie d'une doctrine qui a évolué, je crois, au 18e ou au 19e siècle, et elle était fondée sur le fait que lorsqu'une personne rationnelle a commis une infraction, on peut régler les questions de dissuasion et de dénonciation à l'intérieur d'une certaine période, de sorte qu'on peut fixer un plafond. L'idée part du principe qu'une personne rationnelle, lucide, tirera des conclusions de la peine imposée et des moyens de dissuasion utilisés. Cela ne fonctionne pas dans le cas d'une personne irrationnelle, et c'est pourquoi il existe ce régime différent.
Les personnes qui atteignent leur durée maximale ou l'ont dépassée et qui demeurent à l'intérieur du système, en particulier après l'affaire Winko, posent encore par définition des risques significatifs pour la sécurité du public. Sinon, ces personnes auraient été libérées par la commission d'examen, du moins c'est certainement le cas en Ontario.
Je pense que les statistiques concernant l'Ontario montrent très clairement qu'après l'affaire Winko, le nombre d'absolutions inconditionnelles a augmenté, et cela signifie que l'on y prend au sérieux l'affaire Winko; on en applique la décision. Si l'on n'est pas convaincu qu'un accusé présente un risque significatif pour la sécurité du public, cette personne est libérée.
L'idée selon laquelle la Loi sur la santé mentale réglera la question n'est pas confirmée par l'opinion générale des psychiatres légistes. On en a parlé même dans l'affaire LePage, au niveau du tribunal de première instance. Vous demanderiez effectivement à la province de combler un vide créé par le gouvernement fédéral, qui abdiquerait essentiellement sa responsabilité dans un domaine du droit criminel.
Le fait même que les gens qui préconisent l'imposition d'une durée maximale disent que nous pouvons régler cette question en vertu de la Loi sur la santé mentale et des dispositions relatives aux accusés dangereux atteints de troubles mentaux, montre qu'en leur for intérieur même eux reconnaissent qu'on ne peut pas simplement libérer ces personnes sans condition. Denis LePage—qui faisait l'objet de la décision complémentaire à celle de Winko—est encore un homme extrêmement dangereux.
J'ai commencé à participer à des audiences de commissions d'examen à Oak Ridge en 1998. J'ai participé à plusieurs de ces audiences, y compris à celles de M. LePage. Il est l'un des nombreux psychopathes non soignés, des gens qui ont une personnalité antisociale, par exemple, qui se trouvent en Ontario dans un établissement à sécurité maximale—le seul qui existe en Ontario. Il est intéressant de noter que non seulement ces personnes n'ont pas été libérées, mais la commission d'examen, qui cherche aussi dans le cas de ces personnes, les solutions les moins pénibles et les moins contraignantes et essaie de les placer dans des établissements à sécurité moindre et même de les renvoyer dans la collectivité, a maintenu ces personnes dans l'établissement doté du plus haut niveau de sécurité possible. L'imposition d'une durée maximale leur ouvrirait la porte et leur permettrait de sortir.
J'exhorte votre comité à recommander qu'on enterre l'idée d'une durée maximale. Il faudrait abroger les dispositions à cet égard.
Á 
 (1130)
(1130)
En outre, cela donne de faux espoirs aux gens qui ne sont pas tenus criminellement responsables ou qui sont acquittés pour cause d'aliénation mentale. Certains regardent cette disposition sur la durée maximale et quand ils pensent que la disposition pourrait être promulguée, cela leur donne de faux espoirs. C'est anti-thérapeutique pour eux.
Merci.


Le président: Merci beaucoup.
Nous passons maintenant à M. Morin et à M. Pronovost.
[Français]


M. Jean-Yves Pronovost (administrateur, Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec): L'Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec, l'AGIDD-SMQ, tient d'abord à vous remercier de votre intérêt à nous entendre dans le cadre de votre étude détaillée des dispositions du Code criminel concernant les troubles mentaux. Notre association provinciale regroupe 15 organismes régionaux de promotion et de défense des droits en santé mentale, quatre comités d'usagers en hôpital psychiatrique et une vingtaine de groupes d'entraide assurant un mandat de promotion-vigilance en matière de droits. Nos réflexions et recommandations découlent directement des constats et pratiques de nos groupes membres travaillant auprès des personnes ayant un problème de santé mentale.
Le respect du droit à un traitement équitable devant la loi, contribuant grandement à une véritable intégration communautaire, est au centre de nos préoccupations, surtout dans un contexte où, faute de services de santé mentale adéquats, de plus en plus de personnes ayant des problèmes de santé mentale sont judiciarisées tout en étant maltraitées par le système pénal et le système de soins. Voici deux exemples de maltraitance.
Le 27 avril 2000, M. Brian Bédard décède à l'infirmerie du Centre de détention de Rivière-des-Prairies. En pleine crise psychotique, il meurt étouffé suite à l'intervention du personnel. Le rapport d'enquête de la coroner A. Kronström sur les causes et les circonstances du décès de M. Bédard explique que la lettre d'entente et le protocole de partage des responsabilités entre le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et le ministère de la Sécurité publique du Québec pour le contrevenant adulte n'ont jamais été mis en application. Ils datent de 1989.
De commenter Me Kronström:
| Pourtant, les détenus ou prévenus ayant des problèmes de santé mentale ont droit aux mêmes soins que tous les autres détenus, cela en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et les différentes Chartes. À l'heure actuelle, il n'en bénéficient pas. |
En février 2001, M. Laszlo Szabo, un homme de 74 ans souffrant d'importants problèmes de santé physique, menace de se suicider. Suite à l'intervention policière, il est accusé d'avoir utilisé une arme de façon négligente plutôt que d'être hospitalisé. Reconnu non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux, et malgré l'ordonnance de la cour exigeant qu'il soit pris en charge par l'hôpital Charles-Lemoyne, M. Szabo sera détenu 60 jours au Centre de détention de Rivière-des-Prairies avant d'être libéré inconditionnellement par le Tribunal administratif du Québec, qu'on appelle le TAQ.
Les changements législatifs introduits dans les nouveaux articles du Code criminel ont indubitablement renforcé les droits des personnes accusées, mais ces droits s'exercent encore dans un vacuum de services contribuant à enfermer plusieurs personnes dans une spirale sans fin: psychiatrie-justice. Ce vacuum a même fait l'objet d'un jugement de la Cour d'appel du Québec en janvier 2001. Dans la cause Sa Majesté la Reine c. R.P., Institut Philippe Pinel mis en cause, la Cour d'appel a renversé une décision du TAQ qui avait accordé une libération inconditionnelle à la personne. L'un des trois juges de la Cour d'appel, le juge Pelletier, disait ceci, et je cite:
| ...ne peut concevoir que le cloisonnement administratif justifie qu'un organisme relevant de l'État [...]accepte de mettre la sécurité du public en danger au motif qu'il appartiendrait à une autre instance gouvernementale de mettre en oeuvre les moyens qui s'imposent pour régler adéquatement un problème. La population n'a que faire des dissensions internes dans l'appareil de l'État. |
L'inaptitude à subir son procès. Nous sommes d'accord sur la proposition de l'Association canadienne pour l'intégration communautaire et de la Criminal Lawyers' Association de conférer le pouvoir aux commissions provinciales d'examen d'absoudre inconditionnellement une personne accusée inapte à subir son procès. Ces personnes méritent un meilleur sort que d'être maintenues perpétuellement sous l'emprise du tribunal. De plus, cela contribuerait à dégager l'appareil judiciaire.
La durée maximale. Nous souhaitons qu'il y ait adoption des dispositions concernant la durée maximale. L'absence de limites, à l'heure actuelle, fait en sorte que plusieurs personnes accusées de délits mineurs demeurent sous la juridiction du TAQ pour des périodes plus longues que si elles avaient été condamneés. Maintes fois dénoncé, cet état de fait perdure et provoque des situations absurdes.
Á 
 (1135)
(1135)
Ainsi, en avril 1997, à la suite d'une accusation de menaces et de voies de fait, une femme de Saint-Hyacinthe est tenue criminellement non responsable pour cause de troubles mentaux. Sous la juridiction du curateur public du Québec, cette femme pose un problème au système de soins. Relève-t-elle du réseau de la santé mentale ou du réseau de la déficience intellectuelle? Ce qui est certain, c'est qu'on s'acharnera à la traiter, car madame est réfractaire aux traitements. Mais quel traitement lui propose-t-on? Essentiellement de la médication psychiatrique et des méthodes comportementales pour changer son attitude. Une ordonnance de traitement sera obtenue de la Cour supérieure par l'établissement hospitalier en février 1999. Elle en est alors à son 22e mois d'internement.
Finalement, cette spirale de conflits sera dénouée par l'implication du nouveau curateur public qui se rendra en personne à l'établissement. Suivra une décision du TAQ qui remettra les pendules à l'heure. Le protecteur du citoyen a dû également intervenir dans ce dossier, comme en fait foi son dernier rapport annuel.
La question des plafonds de détention ne doit pas être confondue avec le droit au traitement. Le rôle du TAQ est d'abord de protéger la société et non d'assurer les meilleurs soins à une personne. Au Québec, à moins d'obtenir une ordonnance de traitement de la Cour supérieure, un établissement ne peut forcer une personne à suivre un traitement et ce, même pour les personnes qui tombent sous la juridiction du TAQ. Un récent avis juridique de l'Association des hôpitaux du Québec est explicite à cet égard et je cite:
| En pratique, on constate que la Commission d'examen ou le tribunal requiert fréquemment, lors de la mise en liberté provisoire d'un individu, que celui-ci se conforme aux directives de son médecin traitant en ce qui concerne le plan de soins. Parfois, certaines ordonnances indiquent même à titre de modalité que l'accusé reçoive la médication qu'on lui proposera (par voie injectable ou autrement). |
Nous nous opposons vigoureusement à ce que la Commission d'examen ait le pouvoir d'imposer un traitement pharmacologique à la demande du médecin traitant, tel que demandé par l'Institut Philippe Pinel de Montréal. Dans son mémoire, le docteur Arboleda-Florez a justement dénoncé une telle extension de la psychiatrie médicolégale devenue un système de santé mentale parallèle qui enferme les patients dans des ghettos.
Quant aux personnes accusées dites dangereuses et atteintes de troubles mentaux, nous ne voyons pas l'utilité de décréter la mise en vigueur d'une telle disposition. Les dispositions actuelles du Code criminel nous semblent suffisantes à cet égard. La validité de l'expertise psychiatrique demeure toujours aléatoire en matière de dangerosité. Le rapport du juge Leggat en 1984 sur les criminels d'habitude au Canada dénonçait justement l'importance attachée aux expertises psychiatriques et psychologiques dans le système pénal.
Autres considérations. Nous ne pouvons que constater que plusieurs avocats suggèrent à leurs clients d'adopter comme position de défense la non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux et ce, pour des offenses mineures. Cette diversion vers le système médicopsychiatrique se déroule souvent sans que la personne ait compris ce qui l'attend, c'est-à-dire la possibilité de demeurer pendant plusieurs années sous la juridiction d'un tribunal administratif et, pratiquement, d'être obligée de suivre un traitement psychiatrique auquel souvent les accusés sont réfractaires. Il y aurait lieu ici que le Barreau du Québec se penche sur la question afin de donner une formation appropriée à ses membres.
En résumé, l'Association des groupes d'intervention en défense de droits en santé mentale du Québec fait les recommandations suivantes.
Que le gouvernement fédéral investisse de nouvelles sommes en santé et services sociaux, sommes qui pourraient contribuer grandement à la mise en place de services adéquats de santé mentale dans les provinces.
Que le Tribunal administratif du Québec, ou Commission d'examen dans les autres provinces, ait le pouvoir d'absoudre inconditionnellement un accusé jugé inapte à subir son procès.
Qu'on adopte les dispositions du Code criminel concernant la durée maximale.
Que ne soient pas promulguées les dispositions sur les «accusés dangereux atteints de troubles mentaux».
Qu'une formation appropriée soit donnée aux membres du Barreau quant aux conséquences d'une prise en charge par le système médicopsychiatrique pour la personne accusée d'un délit mineur.
Je vous remercie.
Á 
 (1140)
(1140)
[Traduction]


Le président: Merci.
Monsieur Cadman, vous avez sept minutes.


M. Chuck Cadman: Merci, monsieur le président.
Je remercie les témoins d'être venus aujourd'hui.
À l'intention de ceux d'entre vous qui étaient présents lors de la comparution du dernier groupe de témoins, je veux revenir à une question qu'ils ont soulevée. Ils ont mentionné qu'un grand nombre de personnes ne cherchent pas à se faire aider et ne reçoivent donc pas de médicaments, parce qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles ont un problème. J'ai dit qu'on est préoccupé également par les gens qui savent qu'ils ont un problème et à qui l'on a prescrit des médicaments, mais qui décident sciemment de cesser de les prendre pour quelque raison que ce soit, peut-être à cause des effets secondaires. On se demande ce qu'il faudrait faire avec ces gens lorsqu'ils commettent une infraction criminelle ou récidivent, dans ce cas, après avoir décidé en toute conscience de cesser de prendre leurs médicaments. C'est certainement une préoccupation dont m'ont fait part des profanes. J'aimerais donc obtenir vos commentaires à ce sujet.
Á 
 (1145)
(1145)


Me Malcolm Jeffcock: Je vais faire des commentaires.
Souvent, en raison de la nature même de leurs maladies, les gens connaissent des fluctuations dans leurs besoins d'une certaine quantité de médicaments. Il faut ajuster périodiquement la médication. Il arrive parfois que la personne prenne les médicaments prescrits et commence à se sentir malade, qu'elle cesse de comprendre sa maladie et croit par conséquent qu'elle n'a pas besoin de médicaments du tout. Quand vous dites qu'une personne prend sciemment une décision, c'est le même type de décision délibérée qui l'amène à commettre un acte criminel dont elle ne sera pas tenue criminellement responsable. Ce n'est pas la décision délibérée d'un état d'esprit conscient.
Parfois, la raison pour laquelle des personnes continuent de dépendre de la décision de la commission d'examen plus longtemps qu'on pourrait prévoir normalement, est qu'elles prennent leurs médicaments pendant une longue période et qu'elles se sentent bien, au point où elles se mettent à penser qu'elles n'en ont plus besoin, parce qu'elles se sentent bien. Elles cessent donc de les prendre en raison des effets secondaires qu'ils entraînent.
Lorsqu'une personne sait qu'elle est malade et qu'elle doit prendre des médicaments pour se sentir mieux, de sorte qu'elle accepte les effets secondaires, c'est une chose. Mais lorsque la personne se leurre, faute d'une meilleure expression, au point de croire qu'elle n'a pas été malade, qu'elle n'a pas eu de crise depuis 14 mois, de sorte qu'elle n'a plus besoin de ses médicaments et qu'elle n'a donc pas à en subir les effets secondaires et décide de cesser de les prendre, cet arrêt entraîne parfois un effet spectaculaire et immédiat sur sa santé mentale. Lorsqu'une telle personne arrête de prendre ses médicaments, ce n'est pas six mois plus tard qu'elle devient délirante. Dans certains cas, les médicaments quittent l'organisme très rapidement et la personne commence à délirer, à perdre rapidement sa lucidité et à ne plus savoir reconnaître les signes avant-coureurs.
Je ne pense pas qu'il arrive souvent que lorsqu'une personne décide simplement de ne plus prendre ses médicaments, elle le fasse en toute connaissance de cause. Vous dites que la personne fait un choix délibéré, mais je crois qu'il n'arrive pas souvent qu'il s'agisse vraiment d'un choix délibéré, d'un choix éclairé ou lucide, d'arrêter de prendre les médicaments. Les gens arrêtent souvent de les prendre, mais je ne suis pas certain que ce soit un choix lucide.


Le président: Je crois que M. Cattrell avait quelque chose à ajouter à ce sujet.


Me Robert Cattrell: Ce n'est pas une des questions sur lesquelles nous nous sommes penchés en prévision de notre comparution ici. L'idée serait-elle que ces personnes seraient jugées criminellement responsables si l'affaire revenait devant les tribunaux?


M. Chuck Cadman: C'est ce que certains disent effectivement. Il y a responsabilité s'il peut être démontré que la personne a pris la décision en sachant quelles seraient les conséquences.


Me Robert Cattrell: D'accord. Dans la pratique, le poursuivant dans une affaire comme celle-là aurait à prouver l'infraction criminelle, il aurait à plaider l'état mental de la personne au moment où elle aurait commis l'infraction. Dans le scénario que vous nous présentez, la personne aurait vraisemblablement le droit d'invoquer le trouble mental comme motif de défense parce qu'elle serait psychotique au moment du procès. Il serait alors très difficile de plaider les circonstances ayant conduit la personne à ne pas se conformer au traitement médical prescrit. On conclurait sans doute encore une fois à l'absence de responsabilité criminelle.
Lorsqu'une commission d'examen se penche sur un cas, lorsqu'elle a déterminé le risque, la conformité est toujours une considération primordiale. Si la personne a l'habitude de ne pas se conformer, on pourrait refuser de la libérer. Quand il y a des antécédents de non-conformité, la commission d'examen refuse de croire que la personne va se conformer à moins qu'elle se voit imposer une ordonnance. Je ne sais pas si cela répond à votre préoccupation.
[Français]


Le président: Monsieur Morin.


M. Paul Morin (coordonnateur du Collectif de défense des droits de la Montérégie, Association des groupes d'intervention en défense de droits en santé mentale du Québec): Sur la question de la conformité, je pense que nous avons voulu mettre en relief dans le mémoire la confusion qui existe entre le traitement et la sécurité du public. On comprend que parfois des personnes qui ne prennent pas leur médication peuvent effectivement rechuter. Mais est-ce qu'elles vont constituer un risque pour le public? Au Québec, selon notre expérience à nous, de l'AGIDD, et selon celle des groupes de défense et de droits en santé mentale, plusieurs de ces personne ne commettent que des délits mineurs. Je pense que le M. MacKay de la Nouvelle-Écosse l'a bien dit: ce ne sont pas des délits majeurs.
Encore une fois, il faut connaître le système de santé mentale du Québec ou d'ailleurs. Avec la désinstitutionnalisation et l'absence de services au sein de la communauté, il y a de plus en plus de personnes qui sont judiciarisées. On se sert du Code criminel pour traiter les individus. Cela n'a ni queue ni tête. On ne peut pas mettre la coercition au coeur d'un système de traitement. Selon nous, c'est anticonstitutionnel. Ce n'est pas au moyen de la coercition qu'on peut bâtir une alliance thérapeutique.
Á 
 (1150)
(1150)


Le président: Monsieur Lanctôt.


M. Robert Lanctôt: Je pense que vous êtes fatigués de m'entendre, mais je suis complètement d'accord sur ce que vous dites. Je parle toujours du manque de ressources et des transferts aux services sociaux. Je suis un peu fatiguant quand je parle de cela, mais c'est ce qui existe au Québec.
Par contre, je vais vous relancer la balle, bien que je sois complètement d'accord avec vous sur cette partie. Je ne sais pas si vous étiez ici tout à l'heure, mais le Barreau du Québec nous exposait la situation réelle. Je me dis toujours qu'il ne faut pas changer des choses dans le Code criminel pour essayer de pallier quelque chose quand le problème est ailleurs. On sait que le problème est le manque de ressources. On a un problème quand on essaie de corriger la situation en modifiant le Code criminel. Vous essayez de pallier cela par des dispositions sur la durée maximale ou des choses semblables, mais je ne suis pas certain que ce soit la bonne façon de faire. Pour cela, il faut demander des sommes d'argent et des ressources au bon endroit pour qu'on puisse traiter ces patients au lieu de déjudiciariser cette chose et de mettre ces personnes dans la rue. Ensuite, c'est un cercle vicieux: une fois que ces personnes sont dans la rue, quand elles commettent un crime, on essaie de les mettre dans le système judiciaire.
Actuellement, j'ai l'impression qu'on court après deux lapins en même temps. Si on prévoit des peines maximales, avec la réalité d'aujourd'hui, ces gens-là ont «la chance» d'être traitées.


M. Paul Morin: Nous sommes des organismes de promotion et de défense des droits en santé mentale. Ceci est particulier au Québec et n'existe pas dans d'autres provinces du Canada. Le Québec a reconnu que la promotion et la défense des droits étaient quelque chose d'important. Il y a des organismes régionaux. On n'est pas un recours, on accompagne les gens. Donc, on est sur le terrain.
Quand ces gens se battent pour ne pas être traités, je pense qu'ils font un choix rationnel. Le délire psychotique existe, et j'en conviens, mais il y a parfois un acharnement thérapeutique contre ces personnes. La question de la sécurité et du risque pour le public nous apparaît, somme toute, souvent très aléatoire. C'est pour ça qu'on favorise l'établissement d'un plafond. Pourquoi garder un individu, comme, par exemple, la personne dont on ne savait pas si le cas relevait de la déficience intellectuelle ou des troubles mentaux, devant un tribunal administratif du Québec pendant quatre ou cinq ans? Pour régler ce cas, il a fallu l'intervention d'un nouveau curateur public, M. Pierre Gabriel, qui est maintenant sous-ministre. Il est allé lui-même à Saint-Hyacinthe.
Quand on est dans une spirale de conflits et qu'on ne s'en sort pas, personne n'est gagnant. De toute façon, si on établit un plafond et qu'il y a des gens qui sont toujours dangereux, on peut avoir recours à la diversion vers le système civil. La psychiatrie n'est pas une science exacte. On parle beaucoup de la médication et on dit qu'elle est meilleure qu'auparavant, mais quand on connaît le sujet, ce n'est pas si évident que ça. Par exemple, ce n'est vraiment pas évident que les nouveaux antipsychotiques sont aussi performants qu'on le dit.
Regardez le mémoire de l'Institut Philippe Pinel. On veut se servir du système pénal pour traiter des individus. On en est rendu à dire que le mandat premier de la commission d'examen est de traiter les individus et non pas de voir à la sécurité du public. On n'en sort pas. Je comprends votre préoccupation, mais nous sommes là pour défendre les droits des individus.
Pour nous, la meilleure façon de défendre les droits des individus, c'est de changer certaines parties du Code criminel ou encore d'en mettre certaines en application. En même temps, en parallèle, si on ne développe pas des services de santé mentale, ce sera encore le bordel, et j'en conviens.


M. Robert Lanctôt: Je sais que c'est très complexe, et je peux vous dire que c'est encore plus complexe pour nous ici.
C'est la même chose pour les gens de l'Ontario. Vous êtes dans le milieu. Avez-vous des données? On a dit qu'en Ontario, vous aviez des données après Winko sur l'absolution inconditionnelle, et qu'il y en a de plus en plus. Quand ces gens-là sortent avec une absolution inconditionnelle, est-ce qu'ils reviennent dans le système et, si oui, est-ce qu'ils font alors l'objet d'accusations plus graves?
Á 
 (1155)
(1155)
[Traduction]


Le président: Monsieur Flanagan.


Me Curt Flanagan: Merci.
Je n'ai pas sous la main les données que vous cherchez. Je peux toutefois vous dire—et je suis d'accord avec M. Jeffcock—que, depuis la décision Winko, qui a établi le critère, si vous voulez, en matière de risque important, il y a eu un accroissement considérable du nombre de personnes qui sont retirées du système. Il ne faut pas conclure pour autant—et je reviens simplement ici à quelque chose qui a été dit tout à l'heure—qu'il faut entreprendre tout le processus législatif nécessaire pour modifier cette disposition du Code criminel.
Ce qui est important à mon avis—et c'est ce que nous faisons en Ontario—c'est l'éducation et la formation de même que l'échange d'information. C'est là un élément très important qui permettrait de répondre à certaines des préoccupations. Je sais, par exemple, qu'il y a eu une enquête en Ontario dont vous avez peut-être entendu parler, l'enquête Kerr, qui a été menée à la suite d'un incident très grave survenu à l'extérieur des limites de l'hôpital psychiatrique de Brockville. Une des recommandations du jury à cette enquête visait en fait à ce qu'on échange l'information, que les avocats de la poursuite soient présents au procès et que l'on mette sur pied un système à cette fin.
C'est ce que nous avons fait en Ontario. Nous avons établi des cours de formation spécialisée à l'intention des procureurs de la Couronne, afin de les aider à déterminer l'importance du risque et à faire des évaluations actuarielles qui, d'après certains psychiatres, sont le meilleur outil dont nous disposons pour évaluer le risque, et pour les aider aussi à évaluer les personnes souffrant de troubles mentaux et les retirer d'un système où elles ne devraient pas se retrouver.
Il faut donc mettre l'accent sur l'éducation et l'échange d'information. Il existe à mon avis des paramètres dans le Code criminel, et il n'est pas nécessaire de les modifier pour régler ce problème en particulier. C'est plutôt une question d'échange d'information et d'éducation.
J'allais dire que c'est aussi une question d'argent, mais j'estime qu'on a déjà suffisamment parlé de cet aspect-là.


Le président: Merci beaucoup.
Monsieur Morin.
[Français]


M. Paul Morin: Il n'y a pas statistiques au niveau du Tribunal administratif du Québec. Il y a des statistiques globales, mais il n'y a pas suffisamment de ressources financières, semble-t-il, pour faire des statistiques fines qui nous permettraient de voir l'évolution du système, des statistiques précises comme celles que vous demandez.
[Traduction]


Le président: Merci.
Peter MacKay, pour sept minutes.


M. Peter MacKay: Merci, monsieur le président.
Je tiens à remercier tous les témoins de nous avoir aidés à bien comprendre la question à l'étude.
J'arrive à deux conclusions au sujet de la répartition des ressources qui me paraissent inéluctables. Une qui hérisse les provinces, notamment le Québec, est celle qui consiste à dire que le gouvernement fédéral devrait peut-être affecter des ressources à des éléments en particulier du système de soins de santé. C'est là une idée qui ne manque jamais de soulever un tollé.
Il y a une question qui semble, du moins à mon avis, constituer une certaine anomalie. Nous avons entendu plusieurs témoins, dont ceux qui sont devant nous, dire qu'il faudrait habiliter les commissions d'examen à accorder des absolutions inconditionnelles, qu'il faudrait accroître les pouvoirs de ces commissions et leur permettre d'exercer leur jugement pour déterminer si tel ou tel détenu peut être libéré sans problème. Tout en voulant accroître ainsi leur pouvoir, il semble qu'on veuille aussi leur imposer un délai d'exécution, ce qui semble constituer une certaine anomalie. Je trouve contradictoire de dire aux commissions qu'elles doivent exercer leur pouvoir de libérer une personne dans un certain délai, parce que nous ne faisons pas confiance à leur jugement si elles dépassent ce délai. En imposant ainsi un délai, on donne finalement l'impression que les commissions d'examen rendent des décisions erronées quand elles détiennent la personne au-delà de l'échéance normale, comme on dit, du mandat.
Je veux aussi donner à M. Jeffcock l'occasion de répondre à ce qu'a dit M. Flanagan au sujet du contrôle qui peut être exercé sur ceux qui se retrouvent dans des unités de psychiatrie légale. Cette idée de libérer quelqu'un, de le laisser s'en aller dans la nature, si vous voulez...il faudrait accorder une absolution inconditionnelle à la personne parce qu'on renoncerait tout simplement de cette façon à exercer un contrôle.
Si le système actuel nous permet d'imposer des restrictions et s'il est assorti d'un jugement discrétionnaire approprié, il me semble logique d'agir ainsi, surtout à la lumière du témoignage de M. Flanagan, qui nous a dit qu'il arrive que les membres du comité et même l'accusé lui-même disent: «Nous avons besoin de ces mesures de contrôle. Nous préférons avoir un certain contrôle, à avoir des garde-fous qui nous permettront essentiellement d'assurer une transition sans heurt.»
Il y aurait à tout le moins un système de soutien de par la décision de la commission d'examen. En accordant une absolution inconditionnelle, l'État se trouve à renoncer à tout contrôle, et certains diraient que l'État renoncerait ainsi à tout intérêt, et j'estime qu'il ne peut pas faire cela. Ce serait irresponsable à mon avis.
Je vais donc demander au témoin ce qu'il pense de tout cela. M. Jeffcock a cité un exemple très à propos.
J'ai vu une partie du film Rain Man l'autre jour à la télévision. Le type de trouble mental qui y est représenté pose vraiment une menace. Quiconque a travaillé avec des personnes autistes, quiconque a eu affaire à des personnes souffrant de troubles mentaux de ce genre...le syndrome de Gilles de La Tourette est une autre affection qui cause une bipolarité très difficile. Il semble qu'on arrive plus facilement maintenant à établir un diagnostic, mais parfois les traitements ne suivent pas l'évolution des diagnostics.
Pourrais-je savoir ce que vous pensez de ce que je viens de dire?
 
 (1200)
(1200)


Me Malcom Jeffcock: Moi en premier?


M. Peter MacKay: Monsieur Jeffcock.


Me Malcom Jeffcock: Je peux certainement attester vos talents d'acteur pour vous avoir vu...
M. Peter MacKay: Je vous remercie.
Me Malcolm Jeffcock: C'était dans une autre vie.
M. Peter MacKay: Tout à fait.
Le président: Nous avons nous aussi été en mesure de les apprécier.
Me Malcolm Jeffcock: J'allais justement dire que je l'ai moi-même vu à la télévision hier. J'allais être poli, mais je vous remercie d'en avoir parlé. Surtout quand il a parlé de sport amateur et de participation...c'était une des meilleures prestations que j'ai jamais vues. Revenons toutefois à nos moutons.
On semble s'inquiéter beaucoup que la libération inconditionnelle soit utilisée à mauvais escient pour les personnes inaptes. Je suis sûr que le comité a entendu dire à maintes reprises, et je suis sûr que les collègues qui témoignent avec moi aujourd'hui seraient aussi d'accord, qu'il n'y a pas un grand nombre de personnes qui peuvent être qualifiées d'inaptes. Il s'agit d'un petit pourcentage des inculpés qui sont libérés.
Cela me ramène à ce que je disais tout à l'heure au sujet du fait que le seuil pour déterminer si la personne est apte à subir son procès est assez bas. Il convient tout d'abord de préciser que tous ceux qui tombent dans la catégorie de la NRC souffraient de troubles mentaux, qu'elles n'étaient pas en mesure de bien comprendre la nature ou la qualité de leur geste, mais qu'elles étaient aptes à subir leur procès. Il est donc évident que la barre est très basse. Il ne s'agit toutefois pas d'un grand nombre de personnes, mais plutôt de quelques-unes seulement.
Pour ce qui est de votre remarque, monsieur MacKay, à savoir qu'il fallait éviter de permettre simplement à la personne de disparaître dans la nature, je vous dirais que vous présentez en quelque sorte la chose sous un faux jour, car il se peut bien qu'avant de libérer l'inculpé sans condition, la commission ait déjà pris des mesures pour assurer sa réinsertion sociale. Il se peut qu'elle ait déjà donné à la famille l'éducation et l'aide nécessaires pour s'occuper de cette personne qui souffre d'un trouble mental et l'aider à fonctionner en société, et il se peut que la réinsertion sociale soit déjà en cours à la suite d'une libération sous condition.
Il s'agit finalement de savoir pendant combien de temps la personne peut vivre ainsi après avoir été libérée sous condition. Après avoir été jugée inapte, elle peut vivre ainsi pendant des années en étant soumise aux conditions de sa libération. Pourquoi la commission ne pourrait-elle pas lui accorder une libération inconditionnelle? Je ne suis pas sûr que le fait d'accorder une libération inconditionnelle empêcherait nécessairement la Couronne de réinstituer l'accusation pénale initiale. Je ne suis pas du tout persuadé que la libération inconditionnelle exclurait cette possibilité.
 
 (1205)
(1205)


M. Peter MacKay: À ce propos, la réinsertion graduelle dont vous avez parlé est possible dans les deux cas, qu'il s'agisse d'une libération inconditionnelle ou sous condition. En écartant d'office la libération sous condition et en disant qu'il faut privilégier la libération sans condition, ne nous trouverions-nous pas à dissuader le recours à la libération graduelle? Quand nous donnons à la personne une libération «sous condition», cela veut dire qu'elle doit se conformer aux conditions imposées et que nous pourrons lui accorder une libération inconditionnelle quand nous jugerons que les circonstances le justifient.


Me Malcom Jeffcock: Certainement. Et comme M. Cattrell l'a indiqué, bien souvent, un des éléments qui influencent la commission, comme l'a dit l'honorable député—je n'arrive pas à voir votre nom—est justement la question de la non-conformité. Bien souvent, ce qui inquiète le plus la commission, c'est d'avoir l'assurance que l'inculpé comprend bien sa maladie et que, si sa maladie l'oblige à prendre des médicaments, il sait que, pour pouvoir fonctionner normalement, il doit continuer à les prendre.
J'ai donc du mal à imaginer que les personnes détenues dans un hôpital psychiatrique pourraient du jour au lendemain être libérées inconditionnellement et remises en liberté, car la commission aura toujours en tête la question du risque. Voilà ce que suppose la libération inconditionnelle. Si la commission n'est pas persuadée que la personne jugée non criminellement responsable présente un risque important, elle lui accordera une libération inconditionnelle, mais si la personne a montré qu'elle présente un risque du point de vue de la non- conformité, la commission aura généralement des réserves.
En fait, quand on remonte à la décision initiale rendue en Colombie- Britannique, on se rend compte que M. Winko présentait un risque du point de vue de la conformité et que c'est pour cette raison qu'on n'avait pas voulu lui accorder l'absolution. Si l'affaire est allée devant la Cour suprême du Canada, c'est qu'il fallait déterminer à qui incombait le fardeau de montrer que M. Winko constituait une menace importante ou qu'il ne présentait pas de risque important.


Le président: Merci, monsieur Jeffcock.
Je donne la parole à M. Macklin, pour sept minutes.


M. Paul Harold Macklin: Merci.
Je veux revenir à la question que j'ai abordée avec le groupe de témoins précédent. Je crois que M. Flanagan s'en est pris à moi à ce sujet, si j'ai bien compris vos propos. Il s'agissait des personnes souffrant de SAF ou de AF, dont le développement est limité ou dont le cerveau est endommagé.
Quand ces personnes se retrouvent dans le système, c'est-à-dire quand elles se retrouvent dans le système de justice pénale, y a-t-il une façon d'éviter que le système ait à les poursuivre? D'après ce que j'ai compris de vos propos, vous dites qu'en Ontario, vous avez donné une formation aux avocats de la Couronne pour leur expliquer quelle est la discrétion dont ils devraient faire preuve à l'égard de ces personnes. C'est mon premier point.
Deuxièmement, si comme vous dites ces directives font partie d'une formation qui est donnée en Ontario, qui devrait faire cette formation? Qui devrait établir les normes? Que pourrions-nous faire avec ce volet éducation et formation afin d'en arriver à un système où les personnes visées seraient automatiquement soustraites au processus pénal?
Il me semble qu'il faut s'entendre sur certaines choses. Premièrement, le simple fait que les personnes visées ne soient pas très nombreuses n'est pas une raison suffisante pour ne pas s'intéresser à ce problème. S'il y a lieu de corriger le problème ou s'il y a une solution qui peut être apportée au problème, il faut aller de l'avant et chercher à trouver cette solution qui rendrait notre droit criminel aussi efficace que possible.
J'aimerais savoir ce que vous pensez de tout cela, et j'invite aussi les autres témoins à nous dire ce qu'ils pensent de cette idée d'intervenir le plus rapidement possible pour retirer du système pénal ceux qui ne devraient vraiment pas s'y retrouver.
Le président: Monsieur Flanagan.


Me Curt Flanagan: Merci.
En réponse à votre question, je suis bien sûr d'accord pour dire, comme je l'ai indiqué, qu'il faudrait retirer du système de justice pénale les personnes qui, pour certaines raisons, ne devraient pas s'y retrouver.
La formation et l'éducation ont un rôle à jouer, mais il faut aussi une intervention aussi précoce que possible auprès de la personne. Il faut donc amener des professionnels qualifiés à évaluer la personne, dans le cadre par exemple de l'évaluation qui doit être faite de son aptitude à subir son procès, et faire intervenir aussi d'autres professionnels compétents. Quand on a affaire à une personne qui souffre d'un retard de développement et qui ne pose pas de risque important, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on lui fasse emprunter une voie autre que celle de la justice pénale. Il s'agit toutefois d'avoir en place des freins et des contrepoids, et le problème tient au fait qu'il y a des personnes souffrant d'un retard de développement ou souffrant d'une autre maladie mentale qui pose effectivement un risque important. J'ai eu affaire à un certain nombre de personnes souffrant d'un retard de développement qui se retrouvaient dans le système de justice pénale parce qu'elles avaient commis, par exemple, une agression sexuelle. C'est donc tout un défi.
En réponse à votre question, je crois effectivement qu'il faut les évaluer de façon précoce et que la formation et l'éducation sont importantes. J'estime toutefois que les freins et les contrepoids sont aussi très importants.
Pour revenir à ce que disait M. MacKay au sujet de la nature graduelle du processus, c'est là un élément très important. Si l'on invite la commission d'examen à user librement de la libération inconditionnelle, il ne faut pas oublier que c'est comme si on acquittait la personne et qu'on la réintégrait, à son détriment finalement, dans son milieu sans qu'elle ait le traitement ou le filet de sécurité ou encore les garde-fous dont elle a besoin.
Il faudrait donc mettre au point un système qui nous permette d'examiner tous ces éléments à un stade précoce. C'est pourquoi dans notre mémoire nous avons proposé dans les circonstances que la commission d'examen puisse faire elle-même une évaluation, car elle doit disposer d'informations à jour.
 
 (1210)
(1210)


Le président: Merci.
Monsieur Pronovost ou monsieur Morin?
M. Jean-Yves Pronovost: Non.
M. Paul Morin: Non.
Le président: Monsieur Jeffcock?
Me Malcolm Jeffcock: Non.
Le président: Monsieur Cattrell?


Me Robert Cattrell: Je crois que nous n'avons répondu qu'à un des deux points qu'a soulevés le député. Vous avez dit, si je ne m'abuse, que si l'on impose une durée maximale, c'est qu'on a l'impression que les commissions d'examen ne sont pas capables de bien faire leur travail.
L'inclusion du délai s'explique plutôt par le fait que, quand ces dispositions ont été rédigées, on avait des craintes par rapport à la Charte. On craignait que, dans le cas des personnes qui continuent à poser un risque et dont le séjour à l'hôpital pourrait être prolongé indéfiniment, les tribunaux pourraient décider qu'il s'agit d'un châtiment plus sévère que la peine maximale et que ce genre de discrimination viole l'article 15 de la Charte. La question a été examinée à fond depuis, et la Cour suprême du Canada a statué qu'il n'y a pas discrimination aux termes de la Charte puisqu'il s'agit de deux groupes facilement identifiables; ils présentent des caractéristiques qui leur sont propres, c'est pourquoi ils sont traités différemment—il ne s'agit pas d'un traitement différent qui est imposé arbitrairement aux membres d'un même groupe. L'imposition du délai trouve donc son origine dans les craintes qui existaient par rapport à la Charte et qui ont depuis été dissipées.
Ce que les commissions d'examen doivent en retenir finalement, c'est qu'il n'y a pas de problème à libérer la personne si elle ne présente pas de risque. La voie est libre. Si la personne constitue toujours une menace pour le public, l'imposition d'une durée maximale aurait pour effet de les libérer quand même.
Il y a finalement deux paradigmes: celui du châtiment, qui confie la personne au système correctionnel parce qu'elle a été tenue responsable et jugée apte, et celui du traitement, qui part du principe que la personne n'est pas responsable, si bien qu'on l'hospitalise pour pouvoir la traiter. Son cas est évalué du point de vue, non pas du châtiment qu'il faut lui imposer, mais plutôt du risque qu'elle présente. Logiquement, on ne peut pas mêler les deux.
Le fait d'imposer un délai n'équivaut pas du tout à dire que les commissions d'examen sont incompétentes. Si j'en juge par ce qui se passe en Ontario, il me semble qu'elles font bien leur travail.


Le président: Merci.
Je donne maintenant la parole à M. Cadman.


M. Chuck Cadman: Merci, monsieur le président.
Dans un tout autre ordre d'idées, je crois savoir qu'aux termes des dispositions actuelles, les psychologues ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent faire des évaluations. Nous avons entendu la semaine dernière des représentants des psychologues qui nous ont présenté des arguments pour montrer qu'ils devraient être autorisés à faire ces évaluations. Je ne dis pas qu'ils devraient être inclus dans le processus. Je ne sais pas si les psychiatres que nous avons entendus la semaine dernière cherchaient à protéger leur territoire, mais c'est bien ce qu'il m'a semblé. Je suis sûr que vous avez eu l'occasion de travailler avec les deux groupes, et j'aimerais vous entendre sur cette question.


Me Curt Flanagan: La position du procureur général de l'Ontario est que les psychologues devraient être autorisés à faire ces évaluations.


M. Chuck Cadman: Y a-t-il quelqu'un d'autre qui aurait quelque chose à dire à ce sujet?


Le président: Monsieur Jeffcock.


Me Malcom Jeffcock: Vous voulez parler des évaluations de l'aptitude à subir un procès ou de la non-responsabilité criminelle?


M. Chuck Cadman: Je crois que ce sont les évaluations de l'aptitude qui les intéressaient.


Me Malcom Jeffcock: Pour ma part, je ne vois pas d'inconvénient à inclure les psychologues.
Je peux vous dire qu'en Nouvelle-Écosse les évaluations ne peuvent pas être signées par des infirmiers ou des infirmières psychiatriques même si ce sont eux ou elles qui, dans les faits, s'occupent du processus d'évaluation. Le psychiatre ne voit l'inculpé que très brièvement pour déterminer son aptitude. C'est généralement assez rapide.
En Nouvelle-Écosse, on a des travailleurs communautaires qui surveillent les personnes ayant reçu une libération sous condition, etc. Pour accélérer les choses, il est question que ces travailleurs soient appelés dans le cadre de leurs fonctions à évaluer les personnes qui se trouvent dans les cellules de détention provisoire au palais de justice, au lieu qu'on doive les envoyer à l'hôpital. Encore là, cependant, il n'y a encore rien d'officiel.
 
 (1215)
(1215)


Le président: Je vous remercie beaucoup.
Monsieur John McKay.


M. John McKay: J'aurais deux questions; la première à l'intention de M. Pronovost. Vous avez dit, je crois, que vous étiez favorable à la durée maximale, mais que vous ne vouliez pas que les dispositions concernant les ADTM soient proclamées. Je n'ai pas vraiment compris votre argument.
Ma seconde question s'adresse à M. Jeffcock et à M. Flanagan. M. Jeffcock soutient qu'il est illogique de pouvoir conserver dans le système à perpétuité quelqu'un d'inapte à subir son procès alors qu'une personne apte à le faire peut bénéficier d'une absolution inconditionnelle. Si j'ai bien compris, M. Flanagan rétorque que cela n'a pas d'importance étant donné que la Couronne a toute discrétion et que cela ne se produira jamais. Je voudrais donc donner à M. Jeffcock la possibilité de réfuter cette offre alléchante d'un avocat-conseil de la Couronne.


Me Malcom Jeffcock: Je dirais simplement que M. Flanagan vit dans une société beaucoup plus bienveillante que la mienne. Il est certain que le ministère public aurait intérêt à mettre en oeuvre certains des programmes d'éducation dont M. Flanagan a parlé, et j'ai d'ailleurs été impressionné par ce qui se fait en Ontario.
Je dois dire par contre que la Nouvelle-Écosse a pris l'initiative de permettre au ministère public d'être présent à quasiment toutes les auditions de la commission d'examen. Il n'y a que lorsque la libération inconditionnelle semble être l'issue inéluctable que le ministère public n'est pas présent car, sans vouloir s'y opposer, il ne voudrait pas donner l'impression qu'il est favorable à une absolution inconditionnelle pour une personne NRC.
La Nouvelle-Écosse a pris une mesure quasi éducative en ce sens que désormais, il n'y a qu'un seul représentant du ministère public qui comparaît à toutes les auditions de la commission d'examen. Cela produit une certaine continuité et on pourrait même dire qu'il est devenu le spécialiste—faute d'un meilleur terme—dans ce domaine. Donc, même s'il n'y a pas de véritable programme officiel en Nouvelle-Écosse, le ministère public a pris des mesures pour qu'il y ait une solution de continuité.
Mais je me féliciterais que la province adopte un programme semblable à celui dont M. Flanagan a parlé. Il pourrait peut-être en parler à ses confrères provinciaux.


Me Curt Flanagan: En fait, il y a des contacts permanents à ce sujet. Lorsque nous avons organisé ce cours l'an dernier—et nous le faisons chaque été—nous avons eu la chance de pouvoir faire venir deux avocats de la Couronne de la côte Est qui ont examiné la chose sous l'angle des problématiques concernant les inculpés souffrant de troubles mentaux.
Il y a toutefois deux choses que je voudrais signaler. Outre les garanties dont j'ai déjà parlé au sujet des avocats de la Couronne, il existe également une disposition portant qu'un accusé peut en saisir le tribunal à n'importe quel moment en invoquant le paragraphe 672.33 du Code criminel. C'est une disposition qui existe déjà dans le Code. Ainsi, si on juge qu'il n'y a pas vraiment de preuve prima facie, on peut demander qu'il y ait audition. Pas après deux ans, n'importe quand. La disposition existe déjà.
En second lieu—et ce n'est pas si rare que cela—peu importent les commentaires qu'elles pourraient s'attirer en cours de route, il est arrivé que des commissions d'examen précisent dans leurs motifs que l'accusé demeure inapte en raison d'un trouble mental particulier et donc qu'elles ne voient pas la nécessité de maintenir l'ordonnance de détention dans un hôpital. La commission demandait à ce moment-là au ministère public de bien vouloir examiner le dossier et d'en parler à l'audition suivante.
Je peux vous dire que ces observations sont prises extrêmement au sérieux, et il s'agit donc là d'un autre cas d'examen du dossier.


Le président: Je vous remercie, monsieur McKay.
Monsieur Morin.
[Français]


M. Paul Morin: Je vais répondre à la question concernant les personnes atteintes de troubles mentaux et dangereuses. L'AGIDD se prononce contre la mise en vigueur de cet article de la loi parce qu'il est, selon nous, trop basé sur l'expertise psychiatrique ou psychologique en matière de dangerosité. Lorsqu'on parle de dangerosité, on est sur du sable mouvant. On a beau parler de mesures actuarielles, la science psychiatrique ou psychologique n'est pas encore en mesure de dire clairement que telle personne est effectivement dangereuse, de faire un pronostic de dangerosité à long terme. Cette mesure ne nous apparaît pas justifiée. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on fait allusion, dans notre mémoire, à l'enquête du juge Leggatt, en 1984, où on avait quand même fait une recherche assez exhaustive. On disait qu'en matière pénale, on faisait beaucoup trop appel à l'expertise psychiatrique ou psychologique. Donc, nous mettons un fort bémol sur cette expertise et nous ne voulons surtout pas qu'elle soit de plus en plus reconnue par un code ou par une loi.
 
 (1220)
(1220)
[Traduction]


Le président: Je vous remercie.
Monsieur Lanctôt.
[Français]


M. Robert Lanctôt: Juste une précision. M. Jeffcock nous dit que le nombre de personnes inaptes à subir leur procès et qui seront obligées d'être traitées est très, très petit. Donc, ce dont on parle est très exceptionnel.
On parle des associations de psychiatres. Il y a des psychiatres qui sont venus et qui disaient parler et travailler en faveur de ces personnes-là pour les traiter. Votre regroupement, l'AGIDD, veut aussi travailler pour les droits de ces personnes, mais les deux groupes sont complètement à l'opposé l'un de l'autre. Il ne faut pas se cacher la réalité: il y a un manque de ressources et c'est peut-être un bien pour ces personnes, surtout si elles sont en petit nombre. Malheureusement, c'est dans le cadre du système judiciaire, mais elles peuvent au moins avoir les traitements prévus. On espérait qu'elles puissent avoir des traitements dans un autre système, qui est celui de la santé et des services sociaux, mais on n'a peut-être pas l'argent nécessaire pour cela. Ce serait bien qu'on puisse aller chercher ce petit groupe-là. C'est dommage qu'on le fasse dans un cadre judiciaire, mais au moins, elles peuvent avoir les traitements disponibles.
Est-ce pour cela que les deux groupes sont à l'opposé l'un de l'autre? Est-ce simplement en raison de la nomenclature que vous êtes à l'opposé de l'autre groupe, ou si c'est vraiment dans l'intérêt de ces personnes et de leurs droits? C'est peut-être bénéfique pour elles.


M. Paul Morin: Nous partons de notre réalité et de la réalité des personnes que nous accompagnons. Tout le monde est de bonne foi là-dedans. Je ne doute pas de la bonne foi de collègues psychiatres ou psychologues. Ils ont leur prisme et nous avons le nôtre. Notre mandat est de travailler au niveau de la défense des droits, et on accompagne ces personnes depuis une dizaine d'années. Oui, c'est un petit nombre, mais ce petit nombre est en croissance. Le rapport Schneider est très clair là-dessus: il y en a de plus en plus. Au Québec, nous en avons plus que dans d'autres provinces, toutes proportions gardées. C'est un phénomène marginal, oui, mais un phénomène très peu étudié.
Je travaille avec d'autres collègues chercheurs en vue de présenter un projet de recherche sur les pratiques de la commission d'examen ou même sur les pratiques du Québec en la matière. Il n'y a rien. Il n'y a pas de recherche qui est faite. Les statistiques sont très aléatoires. On commence à en avoir, mais c'est quand même très général.
Le rapport de Pinel demande de donner à la commission d'examen le pouvoir d'ordonner des traitements. Pour nous, cela mène à une spirale de conflits. Il faut savoir qu'il y a au Québec des psychiatres qui sont contre cela, parce qu'au Québec, on a le Code civil. On a une société particulière et le Code civil. En vertu du Code civil, depuis 1994, toute la question de la dangerosité est judiciarisée. Les psychiatres sont parfois obligés d'aller en cour et ils n'aiment pas cela. Ils aimeraient qu'on change le système. Comme on utilise de plus en plus le système pénal pour traiter les gens, eh bien, allons-y donc: donnons encore plus de pouvoir à ce système médicopsychiatrique en milieu pénal.
C'est cela que le Dr Florez dénonçait. Est-ce qu'il faut consolider le réseau parallèle ou développer le système général de soins? Pour nous, avoir le stigma psychiatrie-justice est très dommageable pour la santé des individus. Quand on passe par Penetanguishene ou par Pinel, on est marqué pour la vie. On sait très bien qu'il y a beaucoup de préjugés contre les personnes qui ont un diagnostic de schizophrénie ou autre. Quand, en plus, on est bad and mad, c'est le bout de tout. Donc, il faut tout faire pour empêcher que se développe ce système-là.
C'est pour cela qu'on est carrément opposés à certains psychiatres ou associations qui voudraient développer davantage ce système parallèle. Ce n'est pas le système parallèle qu'il faut développer; c'est le système général.
[Traduction]


Le président: Merci beaucoup.
Nous allons passer à Peter MacKay.


M. Peter MacKay: Merci, monsieur le président.
J'aurais une ou deux questions assez précises à poser, en particulier à M. Cattrell et à M. Morin, ou peut-être à M. Pronovost, en ce qui concerne le nombre d'auditions de la commission d'examen tenues en présence d'un avocat du ministère public. M. Jeffcock a donné l'exemple de la Nouvelle-Écosse où je pense que la Couronne assiste à l'audition dans la majorité des cas, à moins qu'elle ne veuille se distancer du verdict final, ce que j'ai pu personnellement constater à quelques reprises en Nouvelle-Écosse également.
Étant donné surtout ce qu'a dit M. Flanagan à propos de la perspective très particulière que le ministère public apporte à ces auditions, et en particulier l'intérêt de la victime pour la conclusion définitive, qui n'est pas l'élément le moins important, j'aimerais savoir si vous avez connaissance de certains exemples au Québec et en Ontario.
Pour revenir d'ailleurs à la question de savoir qui décide en fin de compte qu'il doit y avoir absolution conditionnelle ou inconditionnelle, vous avez dit, monsieur Cattrell, qu'il fallait pouvoir assurer un certain suivi. J'ai le sentiment que ce dont nous parlons en fait ici si nous modifions le Code criminel, c'est de donner à quelqu'un d'autre la responsabilité première de l'issue de tout le processus. Dans l'état actuel des choses, certes, nous faisons énormément confiance aux experts de la psychiatrie et du traitement. Allons-nous désormais donner à ces gens-là entière discrétion en ce qui concerne la conclusion définitive ou devrions-nous avoir plutôt dans notre système de justice pénale un dispositif quelconque qui permettrait d'en saisir à nouveau le tribunal?
Pour ma part, je persiste à croire que le système de justice pénale donne effectivement à la Couronne, à la défense, aux juges et aux psychiatres, un certain pouvoir d'appréciation. Ce pouvoir d'appréciation est indispensable étant donné que les circonstances varient d'un cas à l'autre. En fin de compte, donc, il s'agit de savoir qui est le mieux placé pour se prononcer.
Mon dernier commentaire renchérit sur ce qu'a dit M. Cattrell à propos d'une peine légère prononcée dans le cas d'un délit grave, en ce sens qu'un meurtrier ou quelqu'un qui a été condamné pour viol peut, en se prévalant de la disposition du Code pénal concernant les troubles mentaux, se retrouver libre relativement plus tôt que s'il avait bénéficié d'une libération d'office dans le système pénal ordinaire. L'autre élément de l'équation est bien entendu cette anomalie qui nous interpelle tous, en l'occurrence qu'un délit relativement mineur peut entraîner une très longue peine de prison, une peine disproportionnée, et cela même si les dispositions de la loi concernant le traitement sont censées intervenir.
Voilà donc les deux extrémités de ce paradigme—le risque pour le public par opposition au risque pour l'individu, le risque de devoir passer énormément de temps derrière les barreaux dans un service psychiatrique. Je pense que M. Jeffcock a bien exprimé la chose en disant qu'il est tout à fait horrible de penser qu'une personne qui est malade risque de devoir purger une peine de prison, que ce soit pour vol ou pour méfait, et de se retrouver quasiment comme le masque de fer, enfermée à perpétuité. Mais qui est le mieux placé pour en décider en dernier ressort? Si nous nous en remettons uniquement à la commission d'examen, je me demande simplement qui va surveiller la commission d'examen, si ce n'est pas le juge.
 
 (1225)
(1225)


Le président: Monsieur Cattrell.


Me Robert Cattrell: Je pense qu'il y a là plusieurs questions différentes.
Vous avez commencé par demander ce qu'il en était dans la pratique. En Ontario, depuis l'enquête Kerr qui a eu lieu en 1992, le ministère public assiste à toutes les auditions des commissions d'examen.
L'enquête Kerr a permis de mettre en lumière le fait qu'il arrive, si la Couronne n'est pas présente, par exemple, que l'intérêt public ne puisse pas être suffisamment bien défendu, parce que tout ce qui reste sinon, c'est quelqu'un qui intervient au nom du patient, l'hôpital qui présente sa preuve à la commission d'examen, et cet hôpital risque d'être en conflit d'intérêts dans la mesure où les témoins qu'il cite n'aiment pas toujours dire des choses désagréables au sujet de leurs patients, pour des raisons fort compréhensibles, parce qu'ils doivent travailler avec eux. Ils essaient de les soigner. C'est leur métier, soigner. Il faut donc parfois une tierce partie pour mettre en lumière certaines choses. Par conséquent, depuis l'enquête Kerr, l'Ontario a pour politique de nous faire assister à toutes les auditions.
Il y a, dirais-je, comme l'impression qu'on enferme des gens et que ces gens sont un peu comme Hannibal Lecter, on les enferme dans une cellule isolée après leur avoir passé la camisole de force. En réalité, bon nombre d'entre eux se retrouvent en liberté dans la communauté, même s'ils sont peut-être inaptes ou assujettis à une quelconque ordonnance. Les chiffres de la commission d'examen montrent, je pense, que près de la moitié des gens qui sont ainsi sous surveillance en Ontario sont de fait en liberté dans la communauté, sous le coup soit d'une absolution conditionnelle, soit d'une ordonnance de détention dans un hôpital.
Par conséquent, lorsqu'on pense que ces gens sont en quelque sorte enfermés sous clé dans un hôpital, ce n'est pas nécessairement le scénario qui s'applique. Ils peuvent bénéficier d'une très grande liberté et, dans le cas d'un patient qui a été déclaré inapte à long terme, la commission peut fort bien lui accorder l'entière liberté de ses faits et gestes sans pour autant qu'il s'agisse d'une libération inconditionnelle.
Le Procureur général part du principe que, pour ce qui est de savoir qui est le mieux placé pour rendre cette décision, qu'il s'agisse de maintenir les poursuites ou de les interrompre à un moment donné, c'est toujours le ministère public qui doit au bout du compte assumer cette responsabilité et que si on confie celle-ci en partie à la commission d'examen, on risque de donner à celle-ci un pouvoir qui doit essentiellement revenir au ministère public.
La commission va-t-elle interroger les policiers qui ont fait enquête? Doit-elle rencontrer les victimes? Va-t-elle interroger tous ces gens? A-t-elle une idée de l'impact que le crime en question a eu sur la communauté, des différents facteurs qui doivent entrer en ligne de compte en plus de savoir si la personne en question présente ou non un risque futur? Cela reviendrait à donner à la commission d'examen un pouvoir que même les tribunaux n'ont pas, hormis bien entendu les relaxes fondées sur la Charte.
J'espère avoir répondu à certaines des questions que vous avez posées.
 
 (1230)
(1230)


Le président: Merci beaucoup.
[Français]


M. Paul Morin: Les procureurs sont-ils présents lorsque le Tribunal administratif du Québec se réunit? À ma connaissance, non. Jamais les procureurs du Québec ne sont présents. À tel point que dans le jugement de la Cour d'appel du Québec auquel j'ai fait référence, le Tribunal administratif avait laissé un individu libre dans la communauté, et la Couronne est allée en appel. Un des juges de la Cour d'appel du Québec a dit qu'il avait rendu une décision, mais qu'il aurait aimé avoir plus d'information sur la tentative de meurtre. Donc, manifestement, même les juges de la Cour d'appel du Québec ont dit qu'il manquait de l'information dans le dossier, ce qui veut dire que le dossier de la Couronne n'était pas présent. C'est une autre pratique.
[Traduction]


Le président: Je remercie tous les membres du comité et je vais profiter de ma prérogative pour poser rapidement une dernière question.
La première recommandation de l'Association des groupes d'intervention en défense de droits en santé mentale du Québec est que le gouvernement investisse davantage d'argent. On entend souvent dire qu'il s'agit d'un problème de ressources et, d'ailleurs, nous ne devrions pas recourir au système de justice pénale pour trouver une solution à un problème qui en fait est une question d'argent. Cette recommandation est très précise: le gouvernement fédéral doit investir dans la santé et dans les services sociaux. Mais comme vous le savez, et M. MacKay y a fait allusion un peu plus tôt, ce n'est pas chose facile à faire pour le gouvernement fédéral.
Lorsque nous rédigerons notre rapport, c'est là une question qui va nous interpeller tous, car à mon avis, il serait ridicule de penser que nous n'allons pas au moins en débattre lorsque nous préparerons notre rapport.
Quelle est donc votre opinion à ce sujet? Comment le gouvernement fédéral doit-il investir directement dans la santé et les services sociaux en ayant l'assurance que cet investissement va être la solution au problème dont nous parlons ici?
[Français]


M. Paul Morin: Évidement, c'est un sujet un peu miné. Nous pensons que c'est la compétence des provinces, effectivement. On ne changera pas la Constitution. C'est aux provinces de décider si l'argent ira à la santé et aux services sociaux. Ce sont les provinces, que ce soit le Québec ou une autre, qui vont décider où elles le mettront. Cependant, il faut quand même s'intéresser à la question de savoir comment on peut s'assurer, s'il y a de l'argent supplémentaire dans les provinces, par exemple, qu'il y en a qui va en santé mentale et encore plus spécifiquement à ce sous-groupe en particulier.
Il existe une entité fédérale-provinciale où l'ensemble des provinces et le fédéral se rencontrent et ont des échanges sur les systèmes de santé des provinces. Je me dis que ça pourrait peut-être être une façon de travailler. Cela veut dire que l'ensemble des provinces font une recommandation de demander de l'argent et qu'un sous-groupe en particulier est visé en toute connaissance de cause par rapport aux juridictions. Nous pensons que cela respecterait les compétences provinciales, mais en même temps, il faut quand même que ça marche. Il faut mettre de la pression aussi sur le système. Donc, s'il y a des entités fédérales-provinciales qui disent de ne pas oublier un sous-groupe, cela met de la pression sur le système, et vous pouvez compter sur des groupes comme le nôtre pour faire un suivi au Québec et, je l'espère, dans d'autres provinces, s'il y a des contreparties.
  (1235)
(1235)
[Traduction]

Le président: Je remercie les membres des deux groupes qui sont intervenus aujourd'hui alors que nous sommes aux prises avec un dossier extrêmement complexe. Votre contribution nous a aidés et nous vous en remercions beaucoup.
La séance est levée.