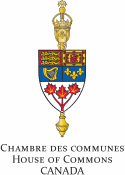:
Je déclare la séance ouverte.
Je vous souhaite la bienvenue à la réunion no 13 du Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités.
Conformément à l'article 108(2) du Règlement et à la motion adoptée par le Comité le lundi 31 janvier 2022, le Comité se réunit pour étudier l'état de la chaîne d'approvisionnement du Canada. La réunion d'aujourd'hui se déroule sous forme hybride, conformément à l'ordre de la Chambre adopté le jeudi 25 novembre 2021. Les députés peuvent participer en personne ou au moyen de l'application Zoom.
[Traduction]
Conformément à la consigne émise le 10 mars 2022 par le Bureau de régie interne, tous ceux qui participent à la réunion en personne doivent porter un masque, sauf les députés qui sont assis à leur place lors des délibérations du Comité.
J'aimerais mentionner quelques points à l'intention des témoins et des députés.
Veuillez attendre que je vous nomme avant de prendre la parole. Si vous participez virtuellement à la réunion, veuillez cliquer sur l'icône du microphone pour activer votre micro et veuillez vous mettre en sourdine si vous n'êtes pas en train de parler. Si vous êtes dans Zoom, vous avez accès à de l'interprétation et pouvez choisir entre les trois options suivantes au bas de votre écran: plancher, anglais ou français. Quant à ceux qui sont présents dans la salle, vous pouvez utiliser l'oreillette et sélectionner le canal de votre choix. Je vous rappelle aussi que tous les commentaires doivent se faire par l'entremise de la présidence.
Si vous êtes dans la salle, veuillez lever la main si vous voulez prendre la parole. Si vous êtes dans Zoom, veuillez utiliser la fonction « main levée ». Le greffier et moi-même ferons de notre mieux pour gérer l'ordre de la liste d'intervenants. Nous vous sommes reconnaissants de votre patience et de votre compréhension.
Chers collègues, nous accueillons aujourd'hui M. Marc Brazeau, président-directeur général de l'Association des chemins de fer du Canada, M. Sébastien Labbé, vice-président, Vrac, Chaîne d'approvisionnement centrée sur le rail de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, Joan Hardy, vice-présidente, Ventes et marketing, Grains et engrais de Chemin de fer Canadien Pacifique, M. Daniel Dagenais, vice-président, Opérations de l'Administration portuaire de Montréal, M. Bruce Rodgers, directeur exécutif, et Julia Kuzeljevich, directrice, Politiques et communications de l'Association des transitaires internationaux canadiens et enfin M. David Montpetit, président-directeur général de la Western Canadian Shippers' Coalition.
Nous allons commencer par les remarques liminaires du représentant de l'Association des chemins de fer du Canada pendant cinq minutes.
Vous avez la parole.
:
Merci, monsieur le président.
Bonjour, honorables députés.
Je m'appelle Marc Brazeau, et je suis le président-directeur général de l'Association des chemins de fer du Canada.
[Français]
L'Association des chemins de fer du Canada représente près de 60 chemins de fer de marchandises et de voyageurs qui transportent des dizaines de millions de personnes et environ 320 milliards de dollars de biens partout au pays chaque année.
De plus, le secteur ferroviaire est un vecteur important de l'économie canadienne. Nos membres emploient plus de 33 000 Canadiens et Canadiennes qui occupent des postes dans les domaines de l'exploitation ferroviaire, de la technologie, de la sécurité, de la sûreté et de la gestion. Ces cheminots acheminent presque 70 % des marchandises expédiées par transport terrestre et la moitié des exportations du Canada chaque année, ce qui nous permet de rester concurrentiels au sein de l'économie mondiale.
[Traduction]
La sécurité est la priorité numéro un de l'industrie ferroviaire canadienne. Au cours des 10 dernières années, les exploitants ferroviaires ont investi plus de 20 milliards de dollars pour assurer la sécurité et l'efficacité de leurs réseaux canadiens, et ils demeurent pleinement engagés à favoriser une solide culture de la sécurité.
Le train est un moyen de transport très efficace et écologique pour le Canada, en plus d'être fiable et sûr. Grâce aux investissements continus dans l'innovation et la technologie, les chemins de fer du Canada sont plus que de simples moteurs économiques — ils sont aussi des gardiens de l'environnement.
Les chemins de fer figurent parmi les plus faibles émetteurs de gaz à effet de serre du secteur des transports du Canada. En 2020, les chemins de fer ne représentaient que 3,8 % des émissions totales de GES du secteur des transports. Plus que jamais, il est évident qu'il faut investir dans les infrastructures fédérales de façon stratégique, étant donné les avantages environnementaux et le bilan solide en matière de sécurité de l'industrie ferroviaire.
L'ACFC et ses membres partagent la conviction que la croissance entraîne des investissements. Chaque année, l'industrie ferroviaire canadienne investit de 20 à 25 % de ses propres revenus dans l'entretien et l'amélioration de son réseau de 43 000 kilomètres, qui est en fait 12 % plus grand que notre réseau national d'autoroutes de 38 000 kilomètres.
Le secteur ferroviaire est l'une des industries à intégration verticale les plus capitalistiques du Canada. Il détient le matériel roulant, l'équipement, les biens immobiliers, les voies ferrées et l'infrastructure avec lesquels il opère. Au cours de la dernière décennie seulement, nos membres ont investi plus de 20 milliards de dollars dans les réseaux canadiens afin d'en améliorer la sécurité, la fiabilité et la fluidité, en concurrence directe avec le secteur du camionnage qui fait affaire sur des infrastructures publiques.
Il est essentiel d'avoir un environnement commercial compétitif pour que le secteur ferroviaire puisse continuer à investir dans son réseau et transporter plus de marchandises et de personnes de la manière la plus sûre, la plus rentable et la plus durable sur le plan environnemental qui soit. Cela dit, l'exploitation sécuritaire et la création de conditions de travail sûres peuvent parfois être mises à mal par des phénomènes météorologiques extrêmes tels qu'une vague de chaleur intense, des froids glaciaux, des feux de forêt, des inondations, des tempêtes et des vents violents, pour n'en citer que quelques-uns.
[Français]
Bien que les compagnies de chemins de fer du Canada aient de solides plans pour faire face aux conditions météorologiques extrêmes et pour aider à atténuer les risques connexes, on ne saurait trop insister sur les répercussions négatives des changements climatiques sur les infrastructures essentielles de transport et de communications.
Quand il faut composer avec les conséquences d'événements météorologiques catastrophiques, les propriétaires et les exploitants de chemins de fer sont les premiers responsables de la protection de leurs actifs et de leurs réseaux.
Voilà quelques années que la résilience ferroviaire est mise à l'épreuve comme jamais auparavant, et c'est, en grande partie, en raison des répercussions des changements climatiques.
[Traduction]
L'automne dernier, par exemple, nous avons été témoins de la résilience du réseau ferroviaire lors de la réponse aux inondations catastrophiques dans le Lower Mainland et ailleurs sur le territoire de la Colombie-Britannique. Les membres de l'ACFC ont réalisé des miracles d'ingénierie pour remettre les voies ferrées en état, enlever les débris, remplacer des voies et remettre les trains en marche, tout en se heurtant à des défis incroyables, et ce, en quelques jours seulement.
Il est impossible d'améliorer la réputation commerciale de notre pays, de faire croître notre économie et de protéger nos intérêts en matière de sécurité nationale sans une recapitalisation considérable et soutenue de la stratégie et des programmes de financement des portails commerciaux. Cela comprend la création d'un programme fédéral de financement du capital conçu précisément pour soutenir les investissements dans les infrastructures des lignes ferroviaires sur courte distance qui serait semblable aux programmes qui existent au Québec et aux États-Unis.
En termes simples, le Canada a besoin d'un plan à long terme pour régler les problèmes de fiabilité dans les chaînes d'approvisionnement et dans les corridors commerciaux, ainsi que d'investissements proportionnels dans les infrastructures. Cela comprend l'amélioration des portails et des corridors commerciaux actuels, tout comme la construction à long terme de nouveaux ports maritimes et intérieurs et d'installations de transport routier, ferroviaire et aérien en soutien à la circulation de marchandises et de passagers requise pour le commerce international.
Je vous remercie, honorables députés, et je serai heureux de répondre à vos questions.
[Français]
Merci.
[Traduction]
Je m'appelle Sébastien Labbé et je suis le vice-président de la section Vrac au CN. Je vous remercie de me donner l'occasion de participer à cet examen des chaînes d'approvisionnement du Canada, monsieur le président. Il s'agit d'un enjeu important.
Comme vous le savez probablement, le CN est le principal acteur dans nos chaînes d'approvisionnement. Il favorise le commerce ici et à l'étranger. Il stimule l'économie canadienne, et ce, de façon sûre et efficace.
La solidité de nos chaînes d'approvisionnement est une question de confiance jusqu'à un certain point. Les expéditeurs et les clients doivent avoir la certitude que l'infrastructure nécessaire pour stimuler et soutenir la croissance économique est solide et protégée. Nous avons tous besoin de savoir qu'il existe des stratégies pour faire face au changement climatique, et nous devons voir une collaboration et un transfert de savoir entre le gouvernement et l'industrie. Tout cela est nécessaire pour créer des capacités et de la résilience, ainsi que pour veiller à ce que notre économie soit sûre et efficace.
Nos chaînes d'approvisionnement ont été malmenées à quelques reprises au cours des dernières années. On peut penser à la rivière atmosphérique qui est apparue en Colombie-Britannique en décembre dernier et aux graves inondations qui ont suivi. C'était une situation d'urgence catastrophique et le CN a dû réagir rapidement. Sur une période de trois semaines de perturbations généralisées, le CN a fait face à 58 pannes sur une distance de 150 miles. Le réseau ferroviaire a mobilisé plus de 400 travailleurs et plus de 110 pièces d'équipement lourd, et les travaux se sont poursuivis 24 heures sur 24, sept jours sur sept pour rétablir le service sur la voie ferrée. Nous avons déplacé 282 000 verges cubes de roche, de terre et de matériaux de remblayage pour restaurer les sites endommagés. Pour vous donner une idée, cela représente plus de 25 000 chargements de camion.
Nous avons aussi aidé à évacuer des centaines de résidents bloqués, acheminé des soins médicaux dans les régions isolées par les inondations et livré des fournitures médicales essentielles. De plus, le CN a pu utiliser son accès exclusif au port de Prince Rupert pour détourner des cargaisons à destination et en provenance de Vancouver. Il a fallu du personnel et des ressources supplémentaires pour y arriver, mais nous avons veillé à ce que les biens de consommation provenant d'outre-mer continuent d'être acheminés vers les diverses collectivités du réseau nord-américain. Si nous avons pu réagir aussi rapidement et efficacement, c'est grâce aux investissements stratégiques que nous avons faits en matière de capacité au cours des dernières années. Nous sommes plutôt fiers de ce que nous avons accompli.
Le changement climatique est l'un des principaux défis du CN. Les inondations en Colombie-Britannique sont survenues après des feux causés par la température la plus chaude sur la planète, et l'hiver qui a suivi a été exceptionnellement glacial. Les plans de préparation aux conditions météorologiques extrêmes du CN nous ont permis de passer au travers. Nous avons pu continuer à faire circuler les marchandises grâce à des plans efficaces d'intervention d'urgence, des évaluations constantes des risques et des vulnérabilités, des adaptations structurelles et physiques, et aussi au déploiement de notre plus récente technologie en matière de surveillance. C'est notre nouvelle réalité.
Nous pensons que le gouvernement peut travailler de concert avec l'industrie, en particulier pour soutenir, par exemple, la transition vers des technologies plus vertes, y compris les carburants de remplacement et les locomotives à pile. Nous encourageons fortement le gouvernement à continuer d'utiliser le Fonds national des corridors commerciaux comme levier. Ce fonds offre un soutien essentiel à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Augmenter le financement, la portée et l'efficacité du processus d'approbation ne peut que renforcer la fluidité de la chaîne d'approvisionnement. Cela aidera à acheminer davantage de produits canadiens vers les marchés.
Nous avons le regard tourné vers l'avenir. Nous nous attendons à une bonne récolte de céréales cette année et nous resterons concentrés sur nos clients. Compte tenu de la situation internationale actuelle, nous savons qu'il y aura une forte demande pour tous les produits, et particulièrement pour les exportations canadiennes. Comme je l'ai dit, le CN n'est peut-être qu'un maillon de la chaîne d'approvisionnement, mais il est essentiel. Avec nos partenaires, nous continuerons d'innover et de mettre en œuvre des solutions, et nous accueillerons avec plaisir toute aide gouvernementale.
Enfin, je tiens à vous remercier de m'avoir donné l'occasion de comparaître devant vous.
:
Merci, monsieur le président.
Bonjour, je m'appelle Joan Hardy et je suis la vice-présidente dans la section Ventes et marketing, Grains et engrais de Canadien Pacifique. Je vous suis reconnaissante de me donner l'occasion de vous faire part du point de vue du CP.
Le premier point que j'aimerais souligner est qu'il n'existe pas qu'une seule chaîne d'approvisionnement au Canada. Chaque produit dispose de sa propre chaîne d'approvisionnement unique, interdépendante et complexe qui relie son producteur à l'utilisateur final. Dans le secteur des céréales, cela comprend chaque élément distinct de la chaîne qui relie l'agriculteur à l'entreprise céréalière, au chemin de fer et au terminal portuaire pour l'exportation. Chacun de nos clients a une chaîne d'approvisionnement unique, et le CP n'est qu'un élément du système global.
Le CP investit en capital de façon historique afin d'améliorer la sécurité, la capacité et la résilience de notre réseau ferroviaire. La sécurité est un pilier de tout ce que nous faisons au CP. Nous sommes des chefs de file dans l'industrie et nous avons la plus faible fréquence d'accidents ferroviaires en Amérique du Nord depuis les 16 dernières années. Au cours de la dernière décennie, le CP a investi plus de 14,3 milliards de dollars dans ses infrastructures, sa technologie et son matériel roulant. Cela comprend un investissement de 500 millions de dollars dans de nouveaux wagons-trémies à céréales de grande capacité.
Notre programme de capital s'ajoute aux investissements de nos clients et des gouvernements, ce qui comprend des projets financés par l'entremise du Fonds national des corridors commerciaux. Le CP est en faveur d'investissements fédéraux dans des projets qui améliorent l'efficacité et la résilience de la chaîne d'approvisionnement. Nous saluons le fait que le gouvernement se soit engagé à verser un montant supplémentaire de 450 millions de dollars pour le Fonds national des corridors commerciaux dans le dernier budget. Malheureusement, le processus d'approbation de projets par l'entremise de ce fonds s'échelonne souvent sur des années. Nous exhortons Transports Canada à investir plus rapidement dans des projets qui pourraient améliorer immédiatement et concrètement les chaînes d'approvisionnement au pays.
La force des chaînes d'approvisionnement du Canada s'évalue essentiellement en fonction de leur résilience. Dans quelle mesure nos chaînes d'approvisionnement peuvent-elles supporter des événements ou des perturbations extrêmes? Au cours de la dernière année, la résilience du CP a été testée à plusieurs reprises. En Colombie-Britannique seulement, nous avons dû surmonter des feux de forêt extrêmes, des inondations et des dommages catastrophiques aux infrastructures tout en gérant un haut taux d'absentéisme attribuable à la COVID.
Les tragédies de la saison des feux de forêt de l'an dernier en Colombie-Britannique sont bien connues. Le CP a déployé des efforts extraordinaires pour maintenir la sécurité des opérations sur le territoire britanno-colombien tout au long de cette période. Nous avons mobilisé d'importantes ressources pour protéger nos infrastructures et pour que les trains puissent continuer de circuler. Nous avons entre autres construit quatre trains pour l'extinction des incendies et fait venir des pompiers industriels d'aussi loin que le Texas.
Puis, fin novembre, une rivière atmosphérique extraordinaire s'est formée en Colombie-Britannique, ce qui a causé de terribles inondations le long des canyons du Fraser et de la Thompson. Les pluies historiques ont emporté 32 voies distinctes sur notre ligne principale et ont causé une interruption de service de huit jours sur la partie la plus critique de notre réseau qui connecte l'Amérique du Nord au port de Vancouver. Le CN n'a pas pu opérer pendant plus de deux semaines pendant cette période, ce qui n'a fait qu'amplifier les répercussions sur les chaînes d'approvisionnement ferroviaires desservant le port.
Nous avons travaillé de concert avec les autorités fédérales, provinciales et locales ainsi qu'avec les communautés autochtones pour rétablir le service et livrer des biens essentiels tels que de l'eau, de la nourriture et des médicaments aux communautés affectées qui se trouvaient à proximité de notre réseau. Une fois le service rétabli, nous avons adopté une approche équilibrée pour reprendre la livraison de toutes les marchandises, ce qui a permis au réseau ferroviaire de se rétablir en quelques semaines.
Pour que la chaîne d'approvisionnement soit résiliente, il faut également que le système de chemin de fer réponde rapidement à la dynamique changeante du marché et à la demande des clients. La réponse du CP à l'augmentation de la demande pour le transport de céréales et de maïs américains vers les Prairies canadiennes pour l'alimentation du bétail cet hiver en est un bon exemple. Le CP a répondu à cette demande imprévue et sans précédent en travaillant de concert avec ses clients pour créer une toute nouvelle chaîne d'approvisionnement pour la livraison d'aliments pour le bétail au Canada, expédiant plus de 26 000 wagons d'aliments à ce jour, soit plus de 20 fois le volume de l'an dernier.
Le CP a démontré sa résilience remarquable au cours de la dernière année en se remettant de catastrophes naturelles et en se mobilisant rapidement de concert avec ses clients. Le CP et ses cheminots ont surmonté d'incroyables obstacles pour maintenir le système ferroviaire en fonction au service de ses clients et de l'économie canadienne en général et nous ne nous contentons pas de rester les bras croisés en attendant la prochaine perturbation.
Nous continuons de relever des améliorations possibles des infrastructures de notre réseau pour devenir encore plus résilients.
En Colombie-Britannique, nous sommes en train d'améliorer notre système d'écoulement des eaux pluviales en renforçant et en recréant des pentes, en installant de nouveaux ponceaux et en construisant de nouvelles clôtures contre les roches et les débris. De plus, nous avons investi dans la voie ferrée et la signalisation à Cisco Bridge pour améliorer la connectivité avec le CN, ce qui améliorera notre capacité à maintenir la circulation de trains en cas de panne dans la zone de circulation directionnelle entre Hope et Kamloops.
Nous prévoyons construire trois nouveaux ponts en 2023 afin d'améliorer la résilience de notre réseau britanno-colombien. Nous planifions aussi de travailler de concert avec Transports Canada pour faire progresser des projets dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux pour rendre les chaînes d'approvisionnement du Canada plus résilientes.
Je serai heureuse de répondre à vos questions.
Merci.
:
Merci beaucoup, monsieur le président, de nous avoir invités, M. Rodgers et moi, à vous parler de cet enjeu critique.
[Français]
Monsieur le président, mesdames et messieurs les membres du Comité, au nom de l'Association des transitaires internationaux canadiens, je vous remercie de me donner cette occasion de m'adresser à vous aujourd'hui.
[Traduction]
C'est tout en votre honneur de consacrer du temps à ce sujet très important. Nos membres vous sont reconnaissants de réaliser cette étude, et nous avons hâte de lire vos recommandations.
Pour les importateurs — comme les détaillants — ou les exportateurs — comme les fabricants canadiens —, l'efficacité du transport et du passage frontalier est essentielle. Ils ne veulent pas passer beaucoup de temps à régler les détails complexes du transport ou à gérer la réglementation frontalière, puisqu'ils font des affaires dans de nombreux pays. Ils engagent donc des entreprises d'expédition de fret membres de notre association et laissent leurs quelque 20 000 employés prendre le contrôle de leurs produits pour les déplacer selon le meilleur mode de transport, au meilleur prix.
Un pourcentage important du transport des marchandises du Canada est effectué par les transitaires, ce qui signifie que nos membres forment de loin le plus important expéditeur du pays. Nos membres font le suivi en temps réel des chaînes d'approvisionnement entrantes et sortantes avec grand soin.
Comme vous avez déjà entendu des témoins à ce sujet, vous comprenez que la chaîne d'approvisionnement se porte toujours mal aujourd'hui.
Considérez ceci: il faut environ 22 jours à un navire pour parcourir les 10 000 kilomètres qui séparent Hong Kong de Vancouver. Or, vendredi dernier encore, la compagnie de transport Maersk a fait valoir que le temps d'attente moyen pour un quai au port de Vancouver était toujours d'environ quatre semaines, et le taux de congestion au triage est de 120 %. Comme le taux opérationnel optimal d'un port se situe plutôt autour de 80 %, le portrait est assez clair.
Deux facteurs clés déterminent le niveau de concurrence de notre chaîne d'approvisionnement: le processus réglementaire et les infrastructures.
:
Tout au long de la pandémie, l'Agence des services frontaliers du Canada a fait des efforts pour réduire les retards associés aux inspections, et ces mesures sont les bienvenues, mais nos membres se trouvent toujours dans une situation cauchemardesque.
Il n'y a pas longtemps, nous avons reçu un message de l'un de nos membres, qui illustre bien la situation. Un conteneur avait été désigné aux fins d'une inspection par l'ASFC. C'était le 23 octobre. Le conteneur ne s'est pas retrouvé sur le lieu de l'inspection avant le 24 novembre. L'ASFC a réalisé l'inspection le 2 décembre. Il lui a fallu moins d'une journée pour ce faire. Le jour suivant, le conteneur a été récupéré et retourné au port. Les douanes ont accordé la mainlevée pour la livraison le 4 janvier. On parle donc d'un processus de 73 jours pour une inspection d'une journée par l'ASFC.
Cet exemple démontre que même si l'ASFC travaille le plus vite possible, le système est toujours complètement bloqué. Ce genre de retard entraîne des frais de surestarie et de détention importants pour les importateurs et, au bout du compte pour les consommateurs canadiens. Dans ce cas particulier, le transporteur océanique a remis une facture de 8 730 dollars américains à l'importateur en surestaries.
Parmi les plus importants développements qui ont été réalisés au cours de la pandémie se trouvent les mesures mises en œuvre par les autorités pour réduire les retards. Ces mesures ont été très bien accueillies et démontrent la souplesse et l'évolutivité de notre chaîne d'approvisionnement que demandent bon nombre des témoins.
J'exhorte le Comité à entendre des témoins de l'Agence des services frontaliers du Canada pour expliquer les mesures prises par l'Agence et les conséquences associées aux raccourcis dans l'exécution des mandats, et pour nous dire si l'Agence peut maintenir ces processus accélérés ou si elle prévoit revenir en arrière. De plus, nous aimerions savoir quelles autres mesures — comme un meilleur échange interministériel de données — l'Agence compte prendre. Le pouvoir des systèmes de TI en vue de faciliter le commerce est important, et nous avons besoin de mesures agressives dans ce domaine. Enfin, nous voudrions savoir quelles sont les mesures en place ou requises pour une meilleure coopération avec les autorités frontalières américaines, surtout en temps de crise.
Au bout du compte, la capacité du système de répondre à des volumes accrus et à maintenir la compétitivité dépend d'infrastructures plus modernes. Les récentes annonces du gouvernement sont encourageantes. Elles doivent toutefois être mises en œuvre de façon efficace.
Malheureusement, par le passé, certaines promesses n'ont pas été tenues ou les examens ont été interminables. Les études sur le projet de terminal 2 de Robert Banks, à Vancouver, ont été entreprises en 2011. Nous ne savons toujours pas si ce projet pourra être réalisé.
J'aimerais vous faire part d'un exemple particulièrement choquant. En 2015, le gouvernement fédéral avait promis, dans son budget, d'acheter un système d'imagerie à grande échelle pour l'inspection rapide dans la nouvelle installation d'inspection des conteneurs de Tsawwassen, en Colombie‑Britannique. Non seulement le système n'a pas encore été installé, mais nous tentons depuis des années d'obtenir une réponse de la part du ministère sur l'état du projet. J'espère que le Comité usera de son pouvoir pour obtenir une quelconque explication pour ce retard.
Certains témoins ont exhorté le gouvernement à modifier la loi sur la concurrence afin d'empêcher les sociétés de transport océanique d'organiser des cartels. Nous appuyons une telle mesure. Il est grandement temps de modifier la Loi dérogatoire sur les conférences maritimes. De nombreux autres pays du monde ont annoncé qu'ils n'accepteraient plus ces pratiques monopolistiques; il est temps pour le Canada de faire de même.
Pour conclure, je dirais que les chaînes d'approvisionnement efficaces profitent à tout le monde, dans toutes les régions et dans tous les milieux. J'espère que le Comité pourra contribuer aux efforts en vue d'améliorer la nôtre.
Nous serons heureux de répondre à vos questions. Merci beaucoup.
Bonjour, monsieur le président, mesdames et messieurs les membres du Comité.
Au nom de la Western Canadian Shippers' Coalition, WCSC, je tiens à vous remercier de l'invitation à participer à la présente séance. Je m'appelle David Montpetit. Je suis le président-directeur général de la WCSC.
Le siège social de la WCSC se trouve dans l'Ouest canadien. Nous représentons les expéditeurs de produits de base de nombreux secteurs, et bon nombre d'entre eux dépendent entièrement du réseau ferroviaire. Parmi nos membres se trouvent certains des plus grands expéditeurs canadiens et nord-américains. Ensemble, les membres fournissent des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects dans les collectivités du Canada, expédient des milliards de dollars de produits chaque année et dépensent plus de 3,5 milliards de dollars en transport. Le point commun entre nos membres, c'est le recours aux fournisseurs de transport ferroviaire, portuaire et par camion.
Les expéditeurs font face à d'importantes perturbations de la chaîne d'approvisionnement depuis l'automne 2019, à la suite de la grève du CN et des problèmes de service associés aux conditions météorologiques inhabituelles. Alors que les expéditeurs étaient en train de se rétablir, les barrages de 2020 ont perturbé les lignes de chemin de fer de l'ensemble du Canada, Transports Canada a donné un ordre de marche au ralenti à la suite d'un déraillement en Saskatchewan et les chaînes d'approvisionnement et les opérations ont subi une pression supplémentaire en raison de la pandémie de COVID‑19. La situation ne s'est pas améliorée en 2021, puisque la chaleur extrême, les feux de forêt de la Colombie-Britannique et les inondations ont fait stagner ou ralentir la chaîne d'approvisionnement dans certaines régions de l'Ouest canadien. L'interruption de travail du CP en mars cette année et les effets de la guerre en Ukraine mettent à nouveau à l'épreuve la résilience d'une chaîne d'approvisionnement déjà fragilisée. Par conséquent, les membres de la WCSC travaillent dans un contexte opérationnel très difficile.
La perturbation de la chaîne d'approvisionnement de tous les modes de transport — par rail, par camion et par conteneur dans les ports — a entraîné une augmentation des coûts, des problèmes en matière de planification et des retards d'expédition. La pénurie de chauffeurs dans l'industrie du camionnage n'est pas un phénomène nouveau. Les compagnies de chemins de fer de catégorie I ont réduit de façon drastique les effectifs et l'équipement actif en 2020 et en 2021, et ont du mal à revenir aux niveaux précédents. Dans de nombreuses régions, elles n'ont pas ce qu'il faut pour répondre à la demande et n'ont pas la résilience nécessaire pour gérer les procédures d'exploitation normales. En fait, étant donné les problèmes de services dans l'ensemble du système ferroviaire en raison d'une association de crises météorologiques — qui ne sont pas du tout la faute des compagnies de chemin de fer, et je dois les féliciter pour leur excellent travail — et d'un déficit en matière de personnel et d'équipement, certains de nos membres ont dû fermer leurs usines de façon temporaire et fonctionner à capacité réduite pendant de longues périodes. En plus de leur impact sur les sociétés membres, ces pressions nuisent à l'image du Canada à titre de fournisseur fiable de biens et de ressources. La compétitivité du Canada et sa réputation à titre de nation commerçante dépendent de notre capacité à acheminer les produits vers les marchés.
Nous devons nous tourner vers l'avenir. La WCSC croit qu'un examen exhaustif de la chaîne d'approvisionnement est nécessaire pour déterminer ce dont auront besoin les grands corridors commerciaux du Canada pour maximiser le rendement de nos routes, de nos chemins de fer et nos ports. Il faudra notamment déterminer la capacité actuelle et future, les économies au premier et au dernier milles et les goulots d'étranglement dans les zones congestionnées comme le Lower Mainland de Vancouver et le Nord de l'Alberta.
Nous proposons également des efforts accrus en matière de planification d'urgence. En 2022, la chaîne d'approvisionnement doit être mieux préparée à faire face à certains événements climatiques — comme ceux que nous avons connus — et à d'autres perturbations comme les grèves, les barrages, les pandémies et maintenant la guerre. La WCSC recommande la mise en place de groupes de travail régionaux, provinciaux et fédéraux de façon similaire à ce qui avait été fait lors des inondations de la Colombie-Britannique en 2021.
Il faut aussi miser sur la résilience. Les corridors commerciaux subissent des pressions importantes et, dans certaines régions, commencent à faire défaut. Un examen exhaustif de tous les modes de transport afin de cibler les problèmes s'avère nécessaire. Il faudra notamment désigner les goulots d'étranglement et les corridors sous-utilisés, et modifier le financement des corridors commerciaux nationaux et les priorités d'infrastructure en conséquence.
Il y a aussi la planification saisonnière par opposition à la planification hivernale. Il faut changer notre méthode en la matière, puisqu'elle ne fonctionne pas. Selon la WCSC, la planification doit tenir compte des événements climatiques, des autres perturbations des corridors commerciaux — comme je l'ai décrit plus tôt — et de la fluctuation saisonnière des produits de base et biens manufacturiers dans la chaîne d'approvisionnement. En gros, nous avons besoin d'un carnet de route.
Enfin, nous croyons qu'il faut se centrer sur les données et les mesures. Il faut plus de renseignements régionaux détaillés en temps réel. Les données sur la capacité seront nécessaires à titre de point de repère pour que nous sachions ce que peuvent supporter les corridors commerciaux. Les expéditeurs sont responsables de créer les tableaux de bord internes en matière de visibilité et ont besoin de mesures régionales détaillées avec lesquelles comparer leur rendement et leurs chaînes d'approvisionnement.
Nous voulons également examiner les prochaines mesures législatives et en établir l'ordre de priorité, notamment ce qui est proposé dans le projet de loi , et songer à des domaines ou à des recommandations qui n'ont pas été abordés par le passé. Nous pensons aussi à un examen de la modernisation des ports et à ce que nous pourrions faire, notamment à des mécanismes semblables à ceux en place dans le domaine ferroviaire, à l'élimination des frais excessifs et à certains changements à apporter à la loi pour y inclure des mécanismes pour aider les expéditeurs.
Enfin, nous souhaitons un examen de la Loi sur les transports au Canada et nous nous demandons quand il sera réalisé. La Loi aura bientôt 10 ans. En fait, elle a été mise en œuvre il y a plus de huit ans; il faut donc songer à la réviser.
Je vous remercie de m'avoir écouté et je serai heureux de répondre à vos questions.
Je vous remercie de nous donner l'occasion de prendre la parole dans le cadre des travaux du Comité.
Permettez-moi d'abord de souligner l'écoute appréciable dont le gouvernement et ses parlementaires font preuve afin d'améliorer la résilience des chaînes d'approvisionnement canadiennes.
Je m'appelle Daniel Dagenais, vice-président, Performance portuaire et développement durable, à l'Administration portuaire de Montréal. Je représente un service d'utilité publique de premier plan. Comme il s'agit du seul port à conteneurs sur le Saint‑Laurent, il dessert les marchés du Québec et de l'Ontario. Étant donné que près d'un conteneur canadien sur trois transite par nos installations, nous sommes un maillon essentiel et stratégique dans une chaîne d'approvisionnement qui dessert des milliers d'entreprises et qui contribue autant au dynamisme économique du Canada qu'au bien-être des familles.
Avant la pandémie et les deux interruptions de travail qui ont affecté nos opérations, notre volume de conteneurs connaissait une croissance marquée et nous maintenions une balance commerciale équilibrée. Nous sommes aujourd'hui une plateforme diversifiée, soutenue par un écosystème logistique qui compte plus de 6 300 entreprises. Plus de 100 milliards de dollars de marchandises transitent annuellement par nos installations.
En dépit des perturbations mondiales qui affectent les chaînes d'approvisionnement, la clientèle de Montréal n'a pas à composer avec la congestion que nous observons dans les ports concurrents, notamment aux États‑Unis. Comme nous sommes un port de destination, notre modèle d'affaires nous permet d'offrir une solution fluide, fiable et efficiente. La raison est simple: les navires sont entièrement chargés et déchargés à Montréal.
Comme plusieurs quais sont disponibles, il n'y a pas de navires en attente à l'ancrage. Par conséquent, le Port de Montréal, par son modèle, permet entre autres d'éviter les émissions de gaz à effet de serre générées par les navires en attente. Il permet aussi aux importateurs et aux exportateurs de profiter d'un port fluide, autant par navire, par train que par camion.
Notre performance est due notamment aux investissements réalisés par nos partenaires privés et à l'aide financière du gouvernement. Les collaborations entre l'écosystème du port et la supergrappe en intelligence artificielle Scale AI nous ont permis d’innover, que ce soit avec un portail de camionnage intelligent prédictif ou avec l'élaboration d'un algorithme permettant de cibler le traitement rapide de marchandises requises pour combattre la COVID‑19.
Bien que nous nous apprêtions à réaliser la plus importante expansion de notre histoire, avec l’ouverture à Contrecœur d’un nouveau terminal comptant plus de 1 million de conteneurs, le Port de Montréal est aujourd’hui un port plus vert, plus intelligent et certainement plus fluide. Nous entendons bien le demeurer, et ce, malgré l’ampleur des défis qu'il reste à relever en matière de main-d’œuvre, d’infrastructure, de verdissement et d’innovation.
Les emplois dans le secteur de la logistique et du transport sont de bons emplois, occupés par des gens compétents. Or, comme ces emplois évoluent, il faudra former davantage la main-d'œuvre afin qu'elle puisse relever les défis technologiques de demain. Depuis deux ans, le système portuaire canadien a démontré de la souplesse. Toutefois, il ne fait aucun doute que nous devons développer notre capacité et faire montre de résilience, en particulier au regard des changements climatiques.
Il ne suffit pas de se doter d'infrastructures supplémentaires. Ce qu'il nous faut, ce sont des infrastructures adaptées qui permettront aux ports d'optimiser leurs activités, notamment en acquérant des terrains pour la manutention et le stockage des marchandises. À l'heure du « au cas où », l'administration est préoccupée par les coûts de maintien et de gestion d'inventaire, coûts qui font augmenter le prix des produits importés et exportés. Nous devons donc être un solide allié des entreprises. L'établissement de corridors stratégiques pourrait permettre les investissements conjoints et faciliterait la collaboration entre les gouvernements. Cela serait à l'avantage de tous.
Les chaînes d'approvisionnement à faible émission de carbone sont essentielles pour l'avenir. Que ce soit par l'électrification ou l'utilisation de bioénergies, nous pouvons réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à nos plateformes, et ce, au moyen d'un équipement moderne. Les ports doivent jouer un rôle clé dans la transition énergétique. En outre, le gouvernement canadien peut accélérer cette transition énergétique en écartant les risques visant les investissements privés à venir.
Une chaîne est aussi solide que son maillon le plus faible, et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement ne peut pas se faire sans un cadre commun entre les principaux acteurs: l'accès aux données, la numérisation et la collaboration sont essentiels. Nous devons construire un cadre favorisant la visibilité et l'optimisation des chaînes d'approvisionnement. La gouvernance des données et les régimes de partage améliorés sont des fruits mûrs que seul le gouvernement canadien peut cueillir. Pour prendre de meilleures décisions, nous avons besoin de meilleures informations.
En conclusion, je crois fermement que les ports ont un rôle essentiel à jouer dans la résilience des chaînes d'approvisionnement canadiennes. En travaillant ensemble, sous la direction du gouvernement canadien, nous pouvons relever les défis liés à la main-d'œuvre, aux infrastructures, aux énergies vertes et à l'innovation pour offrir aux Canadiens des chaînes d'approvisionnement plus résilientes.
Je vous remercie.
:
Je vous remercie pour votre question. La différence entre le Canada et les États-Unis en ce qui a trait à l'appui de l'infrastructure des chemins de fer d'intérêt local représente un enjeu de longue date.
Aujourd'hui, nous avons le CN et le CP, qui sont deux transporteurs de catégorie I. Ils ont la capacité de réinvestir de manière importante dans nos infrastructures. Comme je l'ai dit plus tôt, 20 à 25 % des revenus annuels sont réinvestis dans le renouvellement de leurs infrastructures. Malheureusement, les compagnies de chemin de fer d'intérêt local n'ont pas la capacité de faire de tels investissements.
Nous militons pour un programme dédié, similaire à ceux offerts aux États-Unis. Il s'agit de programmes d'État et de programmes fédéraux destinés spécifiquement aux chemins de fer d'intérêt local, qui permettent d'assurer un réinvestissement dans les infrastructures et dans le matériel roulant, afin de répondre aux besoins associés au lien entre le premier et le dernier milles jusqu'aux chemins de fer de catégorie I des États-Unis. Nous croyons que ces programmes se sont avérés très avantageux pour les compagnies de chemin de fer d'intérêt local aux États-Unis, et nous militons pour la mise en œuvre de programmes semblables au Canada.
Je tiens à féliciter...
:
Certainement. Merci. C'est une bonne question, car cela fait plusieurs années déjà que nous réclamons cela.
Comme nous l'avons proposé et le proposons toujours, il s'agirait d'examiner l'ensemble des modes de transport, en particulier le transport ferroviaire et le camionnage aux ports, de façon à obtenir un portrait global de la chaîne d'approvisionnement en cernant les occasions, les inefficacités et les goulets d'étranglement. Cela nécessitera très probablement la participation de tiers ainsi que l'obtention de renseignements auprès des sociétés ferroviaires, des expéditeurs et des provinces, probablement, notamment le transport routier, les lignes ferroviaires sur courtes distances, etc. Essentiellement, ce serait un examen holistique de la chaîne d'approvisionnement, ce qui n'a jamais été fait, je crois, ou, si cela a été fait, cela remonte à des années, peut-être 40 ans. Je ne me souviens pas exactement, mais cela fait longtemps.
Ce qu'il faut retenir des divers points qui ont été soulevés ici, même les commentaires de M. Brazeau, etc., c'est que la chaîne d'approvisionnement a été durement éprouvée. Les sociétés ferroviaires ont été mises à rude épreuve. Les expéditeurs ont été malmenés. Nous avons été frappés de plein fouet par les phénomènes météorologiques, les blocages, etc. Je n'avais jamais rien vu de semblable dans ma carrière.
Je pose les questions suivantes au gouvernement: que pouvez-vous faire? Quelle visibilité et quel financement pouvons-nous accorder à un examen global? Avant de dépenser des fonds en infrastructure, il faut savoir où dépenser. D'importantes sommes ont déjà été dépensées. Je crois que Mme Hardy a fait un commentaire — corrigez-moi si je me trompe — sur le temps nécessaire à la réalisation des projets d'infrastructure. Cela prendra beaucoup de temps, mais avant de dépenser, et de dépenser judicieusement, il faut d'abord savoir où dépenser et pourquoi.
Je vous remercie pour cette question.
:
Très bien, c'est intéressant.
De tous les témoins, M. Dagenais est le seul à avoir mentionné la pandémie.
Je soulève cette question, monsieur le président, car le a dit, lors du sommet qu'il a tenu, que la COVID‑19 était le seul grand facteur de perturbation de la chaîne d'approvisionnement. Je pense qu'il est important de le mentionner au Comité, en particulier pour les analystes, alors que nous nous dirigeons vers le rapport final.
J'aimerais maintenant poser quelques questions à Mme Kuzeljevich.
Dans votre exposé, vous avez indiqué que le port de Vancouver accusait un retard de quatre semaines et qu'il fonctionnait à 120 % de sa capacité.
Ai‑je bien compris ces chiffres?
:
Cela nous surprendrait aussi.
Encore une fois, il y a des problèmes en Chine en raison du confinement, ce qui a une incidence sur les départs de navires. Dans certains cas, comme on l'a mentionné plus tôt, des départs sont annulés et des navires font des traversées à vide. Les activités sont arrêtées.
Selon un rapport que j'ai lu ce matin, les exportations ont baissé de 40 %. Cette diminution des exportations vers le Canada nous permettra d'éliminer l'arriéré actuel, mais je dirais que c'est à très court terme. Lorsque le port sera rouvert et que la circulation aura repris, je m'attends à un retour de la congestion, et ce, tout au long de l'été.
:
Je vous remercie, monsieur le président.
Je vais essayer de dire tout ce que j'ai à dire en cinq minutes. D'abord, j'invite les témoins à nous envoyer de l'information après la réunion. Nous pouvons transmettre les renseignements que vous n'avez pas l'occasion de présenter ici. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous prie de nous l'envoyer après la réunion, de sorte que ces renseignements se retrouvent dans le rapport préparé par les analystes.
En guise d'introduction, je vais dire ceci — mes commentaires se rapportent à ceux de M. Montpetit au sujet de la stratégie, et bien sûr, une stratégie implique des plans d'action.
Nous avons déjà rédigé un rapport préliminaire à propos de l'établissement d'une stratégie canadienne sur les transports et la logistique. Ce rapport contient quelque 31 recommandations. Notre comité est en train de réaliser une étude sur la chaîne d'approvisionnement, et une autre sur la modernisation des ports. Tout cela étant dit, pour maximiser les ports multimodaux, il nous incombe de réunir tous ces travaux et de regrouper l'ensemble des recommandations, y compris l'étude que nous menons en ce moment, en vue d'accomplir exactement ce dont parle M. Montpetit. Il nous faut une stratégie et des plans d'action fondés sur les recommandations que vous et d'autres nous avez présentées.
Le budget de 2022 souligne, dans ce cas‑ci par l'intermédiaire du , que le Fonds national des corridors commerciaux, ou FNCC, sera axé davantage sur les chaînes d'approvisionnement — à tel point qu'on mentionne même dans le budget que le ministre pourrait renommer le Fonds afin de refléter l'accent mis sur les investissements dans les chaînes d'approvisionnement.
Encore une fois, quand on considère l'orientation nationale et stratégique que vous prenez, on voit toute l'importance de renforcer la chaîne d'approvisionnement. Je le répète, vous devez absolument nous présenter des recommandations sur la capacité et sur l'intégration de la logistique de distribution, et ce, non seulement en cinq minutes ou durant la réunion d'aujourd'hui, mais aussi par la suite. J'espère recevoir beaucoup plus de recommandations après la réunion.
Je sais, par exemple, que dans la région du Niagara, nous avons créé le corridor commercial des ports du Niagara sur les Grands Lacs, en partenariat avec l'Administration portuaire de Hamilton-Oshawa et avec les municipalités. Il s'agit d'un centre multimodal qui met à profit le canal Welland, le transport ferroviaire sur courtes distances et les lignes ferroviaires principales, le transport aérien, les routes et, de façon générale, l'emplacement de la région du Niagara. La gestion de certains terrains situés à l'intérieur du corridor du canal Welland a été déléguée à l'Administration portuaire de Hamilton-Oshawa, en partenariat avec le secteur privé dans certains cas, ainsi qu'avec d'autres modes de transport.
J'aimerais que vous répondiez à deux questions, si le temps le permet. Vous pourrez nous envoyer vos réponses par écrit après la réunion. Ma première question se rapporte aux observations de M. Labbé à propos de la capacité et de la résilience. Afin d'améliorer la capacité et la résilience ainsi que la fluidité, le CN et d'autres considèrent-ils la possibilité de s'associer aux secteurs public et privé? Comment faites-vous pour établir de tels partenariats, et quand le faites-vous?
Je pose la même question à M. Brazeau et à M. Montpetit, surtout en ce qui concerne, du côté de M. Labbé, les activités de manœuvre, l'expansion des activités et la possibilité non seulement d'élargir les activités du CN, mais aussi, du point de vue multimodal, de favoriser le développement économique.
Monsieur Brazeau, en tenant compte de vos observations sur le réseau multimodal et des remarques de M. Montpetit, en particulier sur les investissements dans les infrastructures, quelles recommandations feriez-vous à l'égard de l'ancien FNCC, qui est maintenant le fonds de la chaîne d'approvisionnement? D'après vous, comment ce fonds sera‑t‑il utilisé?
Je demanderais à M. Labbé de commencer.
:
Je vous remercie, monsieur Badawey.
Par rapport au FNCC, il va sans dire que nous travaillons déjà sur de nombreux projets. Certains sont terminés, d'autres sont en cours. Dépenser l'argent judicieusement et comprendre là où il est nécessaire sont des éléments de départ essentiels. Il y a beaucoup de bons échanges à ce sujet aujourd'hui.
En ce qui concerne l'avenir, nous devons modifier légèrement notre façon de penser. Nous avons parlé des parcs de transport. Vous avez mentionné, entre autres, ce que vous faites dans la péninsule du Niagara... À mon avis, il faut absolument considérer d'autres possibilités et trouver de nouvelles façons de faire les choses.
Finalement — je ne saurais trop insister sur ce point —, les données, les mesures et les renseignements sont aussi essentiels à la chaîne d'approvisionnement. La visibilité et l'amélioration de la visibilité au moyen des renseignements — j'insiste là‑dessus — sont probablement les éléments les plus importants à financer.
Je vous remercie.
:
Merci beaucoup, monsieur le président.
Ma question s'adressera à M. Dagenais, de l'Administration portuaire de Montréal.
Dans votre allocution, vous avez vraiment mis l'accent sur l'importance du projet de Contrecœur pour le Port de Montréal. Ce nouveau terminal du Port de Montréal se trouverait dans ma circonscription.
On a notamment mentionné qu'il était important que la mise en œuvre du projet se fasse dans le respect de l'environnement. Des conditions ont été établies par le ministère de l'Environnement lors de l'autorisation du projet de Contrecœur. On sait que le dragage est une étape qui peut avoir beaucoup de conséquences et qui peut causer beaucoup de perturbations dans l'habitat du poisson.
Je vais vous lire le paragraphe 3(2) de la Déclaration de décision émise aux termes de l'article 54 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). C'est le paragraphe qui porte sur le poisson et son habitat:
3.2 Le promoteur réalise le dragage requis pour la construction en utilisant une ou des méthode(s) de dragage de moindre impact afin de réduire les émissions de matières en suspension dans la colonne d'eau et de réduire les dépositions de sédiments dans les herbiers submergés situés en aval du projet désigné.
Or,on sait que plusieurs de méthodes de dragage sont possibles. Il existe le dragage traditionnel avec des grosses pelles mécaniques qui laissent beaucoup de matières en suspension, mais il existe aussi un système de dragage où on fait plutôt l'aspiration de la terre, et donc des sédiments. Cette méthode, qui génère moins de sédiments en suspension, est utilisée notamment par une entreprise dans la région de Contrecœur qui pourrait la mettre en place.
Le Port de Montréal va-t-il donner la priorité à cette méthode de dragage, étant donné ses obligations?
:
Je vous remercie, monsieur le président.
Plusieurs témoins ont parlé aujourd'hui des blocages ferroviaires de 2020 et de leur incidence sur la chaîne d'approvisionnement. Là où j'habite, dans le Nord-Ouest de la Colombie-Britannique, le CN est le chemin de fer principal; je vais donc adresser mes questions à M. Labbé.
Quand le corridor ferroviaire ou le chemin de fer a été construit au Canada, la compagnie n'a pas obtenu le consentement des Premières Nations. Dans de nombreuses régions, il n'y avait pas de traités. Aujourd'hui, quand je me rends dans les collectivités autochtones de Skeena—Bulkley Valley dont le territoire est traversé par le chemin de fer, j'entends beaucoup d'histoires sur les répercussions de la construction du chemin de fer et sur l'incidence continue du transport ferroviaire sur les collectivités.
Ma question s'adresse spécifiquement au CN. Je vois qu'en 2021, vous avez dégagé un bénéfice d'exploitation de 5,6 milliards de dollars. À combien s'élèvent les ressources que le CN investit dans le projet de réconciliation?
:
Je vous remercie, monsieur le président.
Je remercie également tous les témoins qui sont avec nous aujourd'hui. C'est très intéressant d'entendre ce qu'ils ont à dire sur l'état actuel de la chaîne d'approvisionnement du Canada.
J'aimerais revenir sur une question posée par un de mes collègues au sujet de l'incidence de la pandémie sur notre chaîne d'approvisionnement. D'après ce que j'entends, ce n'est pas le problème principal. Les changements climatiques semblent être un enjeu plus important. Nous devons tenir compte de tous ces facteurs, mais ce que j'entends depuis le début de la réunion, de la part de presque tous les témoins... Comme Mme Kuzeljevich l'a dit, les processus réglementaires et les infrastructures... L'infrastructure est la priorité. Nombre d'autres témoins nous ont dit la même chose — qu'il faut faire quelque chose pour accélérer considérablement le transport des produits au Canada.
Ma question concerne les formalités administratives qu'il faut remplir pour lancer un projet, car c'est un sujet dont j'entends sans cesse parler depuis sept ans, que ce soit par rapport au gouvernement fédéral, provincial ou municipal. Je le répète, les autres enjeux sont souvent considérés comme secondaires. Ce sont des réalités, mais je pense que la clé, c'est l'infrastructure. Ma question pour vous tous est la suivante: trouvez-vous qu'il est encore trop difficile de faire avancer les projets rapidement? La situation s'est-elle améliorée?
On parle toujours de choses comme le financement et les partenariats fédéraux. Tout cela est très bien, mais si les entraves sont trop nombreuses pour que les projets soient lancés, est‑ce possible de réaliser des progrès? Est‑ce la raison principale pour laquelle notre chaîne d'approvisionnement connaît des difficultés? Est‑ce lié à notre manque d'infrastructures, peu importe les autres enjeux?
J'aimerais aussi vous demander, brièvement, quelles sont les mesures que nous pourrions prendre facilement et rapidement pour accélérer le transport des produits.
:
Merci, monsieur Iacono.
Effectivement, la pandémie de la COVID‑19 a d'abord eu des répercussions sur la disponibilité de la main-d'œuvre et sur les opérations, étant donné l'ensemble des mesures d'hygiène qui ont été prises au cours des premiers mois.
Naturellement, par la suite, la majeure partie des répercussions était liée à la gestion de la synchronisation entre les importations et les exportations. Comme vous l'avez sûrement entendu, les marchandises et les navires doivent arriver dans un intervalle de temps précis, selon un calendrier qui est déterminé souvent des semaines, sinon des mois, à l'avance. En effet, la chaîne logistique à l'intérieur du continent prévoit l'arrivée d'un navire à une certaine date, mais si le navire arrive à une autre date, avec cinq ou six jours de retard occasionné par des difficultés dans des ports situés ailleurs sur la planète...
:
Je pense que la pénurie de camionneurs est un problème beaucoup plus vaste. Si vous regardez dans tout le pays à l'heure actuelle, vous verrez que de nombreuses provinces sont touchées par cette pénurie, mais plus particulièrement l'Ontario, la Colombie‑Britannique et l'Alberta. Des camionneurs prennent leur retraite, d'autres quittent le marché du travail après tout ce que nous avons vécu, y compris ce que vous avez décrit, et des gens n'intègrent pas le marché du travail.
L'une des études que j'ai vues quand la B.C. Trucking Association a fait des déclarations à l'une de mes réunions ici en février était... Nous avons probablement une pénurie de 25 000 camionneurs dans l'ensemble du pays, voire plus à ce stade‑ci. Il s'agit donc d'une situation beaucoup plus vaste qu'un problème lié à la COVID. Il s'agit d'un problème permanent, qui continue de s'aggraver. Nous ne semblons pas avoir de solution pour l'instant.
Je pense que nous y prêtons une attention particulière et, d'après ce que je comprends, le gouvernement et les autorités fédérales ont pris certaines initiatives à cet égard en collaboration avec les provinces, mais il s'agit d'un problème général de main-d'œuvre que nous avons. Il n'est pas différent de certains autres problèmes, comme celui des compagnies ferroviaires, auquel certains de mes membres sont également confrontés, mais les pourcentages semblent être beaucoup plus élevés dans l'industrie du camionnage.
:
Merci, monsieur le président.
Merci à tous nos témoins aujourd'hui. J'ai trouvé très intéressant de vous entendre relever, je suppose, les principales causes des problèmes de chaîne d'approvisionnement dans l'ensemble du pays.
Lorsque nous parlons de tous les problèmes liés aux feux de forêt en Colombie-Britannique et dans l'Ouest canadien, aux inondations et au froid extrême, ainsi que de la situation nationale et internationale, nous entendons les gens parler des problèmes de la chaîne d'approvisionnement causés par la COVID.
Je suppose que c'est une question très simple, de base, pour ceux qui veulent s'exprimer sur ce sujet. Admettons que nous vivions dans un monde où la COVID n'avait pas existé depuis les deux dernières années, serions-nous aux prises avec les mêmes problèmes de chaîne d'approvisionnement?
M. Brazeau et M. Montpetit peuvent peut-être se prononcer là‑dessus.
:
Dans l'Ouest, et plus particulièrement à Vancouver, des travaux ont été réalisés au cours des 5 à 7 dernières années, je dirais. Une partie de ce travail a été couronné de succès. Je pense que tout ce que nous pouvons faire pour contribuer financièrement, avec le financement du corridor commercial national, entre autres, sera certainement utile. Chaque petit geste compte. La question est de savoir où nous dépensons l'argent et si nous en avons vraiment pour notre argent, pour ainsi dire.
Pour revenir aux remarques précédentes, je pense que la gestion d'un tableau de bord, pour ce qui est de la manière dont nous utilisons les fonds, serait importante. J'ai vu une mise à jour il y a quelque temps. Je pense que c'était en décembre en fait, sur la situation des projets approuvés par rapport aux projets terminés et les délais. Certains d'entre eux sont beaucoup plus rapides — nous pourrions les appeler des solutions faciles — et bon nombre d'entre eux sont des changements majeurs qui doivent être apportés à l'infrastructure.
Je pense que nous avons accompli quelques progrès, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Pour couronner le tout, nous avons eu les feux de forêt et les inondations, qui ont compliqué les choses, mais qui nous ont aussi ouvert les yeux sur ce que nous devons faire, non pas maintenant, mais au cours des 50 prochaines années, pour gérer à nouveau une initiative de la sorte.
:
Merci, monsieur le président.
Ma question s'adressera à M. Dagenais.
Au Bloc québécois, nous plaidons beaucoup en faveur de l'électrification des transports, dont celle des camions et celle de toutes les infrastructures portuaires. C'est notamment le cas de mon collègue , dont la circonscription, La Pointe‑de‑l'Île, se trouve près des installations de Montréal. Premièrement, nous trouvons que c'est moins bruyant et plus écologique; deuxièmement, cela augmente en même temps l'acceptabilité sociale de ces types de projets.
J'aimerais savoir ce qui est prévu pour Contrecœur en matière d'électrification, mais aussi où en est le Port de Montréal, de façon générale, à cet égard. Y a-t-il des projets de ce côté-là?
:
Je vous remercie de votre question.
Pour ce qui est de Contrecœur, dans un premier temps, au moment des premières prises de contact avec l'ensemble des partenaires pour obtenir les autorisations, nous nous sommes engagés, dès le départ, à procéder à l'électrification là où c'était techniquement possible. Ainsi, des mesures en vue du déploiement de l'électrification de l'équipement de manutention et des navires à quai vont être mises en place dès le départ. Nous avons déjà pris un engagement à cet égard.
Sur l'île de Montréal, où il y a un cadre bâti, l'Administration portuaire et ses partenaires privés, les locataires du port, ont fait des investissements majeurs.
Nous avons fait des investissements importants dans l'électrification de l'équipement. Je pense aux grues-portiques dans les cours pour la livraison des conteneurs ou à la transformation de génératrices à conteneurs réfrigérés. De concert avec Hydro-Québec, nous avons modifié des branchements électriques à la grille d'hydro-électricité.
Nous avons aussi mis en avant une stratégie assez ambitieuse. En fait, nous avons créé un réseau de branchements électriques à quai de plus de 25 connexions, qui permettent de réduire l'émission de milliers de tonnes de gaz à effet de serre par année lorsque les navires sont amarrés au port de Montréal.
:
Merci beaucoup, madame Koutrakis.
[Traduction]
Je vous remercie beaucoup, monsieur Montpetit.
Chers collègues, je vous remercie pour vos excellentes questions aujourd'hui.
Je tiens à profiter de l'occasion pour remercier, au nom du Comité, tous les témoins pour leurs témoignages et le temps qu'ils nous ont consacré aujourd'hui. Vos propos ont été très utiles.
J'aimerais demander une dernière chose à nos témoins. Si vous avez des renseignements supplémentaires à nous fournir ou des éléments à ajouter aux réponses que vous avez données, n'hésitez surtout pas à nous les transmettre. Nous allons veiller à ce que nos analystes en tiennent compte lorsqu'ils prépareront le rapport final.
Mme Gladu m'a aussi demandé de vous encourager à embaucher des visiteurs ukrainiens. Pour l'instant, nous ne les appelons pas des « réfugiés », mais plutôt des visiteurs. Ils viennent au Canada et ils sont à la recherche d'un emploi.
Cela étant dit, je vous remercie tous encore une fois. La séance est levée.