FAAE Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
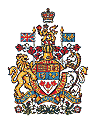
38e LÉGISLATURE, 1re SESSION
Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international
TÉMOIGNAGES
TABLE DES MATIÈRES
Le mercredi 6 avril 2005
| º | 1600 |
 |
Le président |
 |
M. Jeffrey D. Sachs |
| º | 1605 |
| º | 1610 |
| º | 1615 |
 |
Le président |
 |
M. Stockwell Day (Okanagan—Coquihalla, PCC) |
 |
Mme Belinda Stronach (Newmarket—Aurora, PCC) |
 |
Le président |
 |
M. Jeffrey D. Sachs |
| º | 1620 |
| º | 1625 |
 |
Le président |
 |
M. Pierre Paquette (Joliette, BQ) |
 |
Le président |
 |
M. André Bellavance (Richmond—Arthabaska, BQ) |
| º | 1630 |
 |
Le président |
 |
M. Jeffrey D. Sachs |
| º | 1635 |
 |
Le président |
 |
L'hon. Keith Martin (Esquimalt—Juan de Fuca, Lib.) |
| º | 1640 |
 |
Le président |
 |
L'hon. Dan McTeague (Pickering—Scarborough-Est, Lib.) |
 |
Le président |
 |
M. Jeffrey D. Sachs |
| º | 1645 |
| º | 1650 |
 |
Le président |
 |
Mme Alexa McDonough (Halifax, NPD) |
 |
Le président |
 |
M. Jeffrey D. Sachs |
| º | 1655 |
| » | 1700 |
 |
Le président |
 |
M. Kevin Sorenson (Crowfoot, PCC) |
 |
Le président |
 |
Mme Beth Phinney (Hamilton Mountain, Lib.) |
| » | 1705 |
 |
Le président |
 |
M. Jeffrey D. Sachs |
| » | 1710 |
 |
Le président |
 |
M. Jeffrey D. Sachs |
 |
M. John W. McArthur (gérant, Projet du Millénaire, Nations Unies) |
 |
Le président |
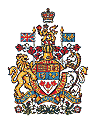
CANADA
Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international |
|
l |
|
l |
|
TÉMOIGNAGES
Le mercredi 6 avril 2005
[Enregistrement électronique]
* * *
º  (1600)
(1600)
[Traduction]

Le président (M. Bernard Patry (Pierrefonds—Dollard, Lib.): La séance est ouverte. Conformément au paragraphe 108(2) du Règlement, nous poursuivons notre étude sur la politique internationale.
Nous allons entendre aujourd'hui un témoin des Nations Unies. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous M. Jeffery Sachs, directeur du Projet Objectifs du Millénaire et conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies, relativement aux Objectifs du Millénaire pour le développement.
C'est un grand plaisir pour moi d'accueillir M. Sachs à notre comité. Comme je viens de le dire, M. Sachs est directeur du Projet Objectifs du Millénaire des Nations Unies et conseiller spécial de M. Kofi Annan, le secrétaire général, relativement aux Objectifs du Millénaire de l'ONU pour le développement. Il est également directeur du Earth Institute de l'Université Columbia où il enseigne la politique et la gestion de la santé. Sa notice biographique que nous avons distribuée fait état de ses nombreuses réalisations universitaires ainsi que de ses autres distinctions. Nous avons la chance d'avoir en M. Sachs un témoin de grand calibre qui va nous entretenir des résultats de son projet, en particulier des recommandations de son récent et important rapport intitulé Investir dans le développement: Plan pratique pour réaliser les Objectifs du Millénaire pour le développement.
Nous écouterons également avec intérêt les points de vue et les conseils de M. Sachs relativement au rôle que doit jouer le Canada pour relever ces défis en matière de développement mondial.
[Français]
Je précise que l'intérêt de notre comité pour ces questions est loin d'être nouveau. Je tiens aussi à dire à M. Sachs que le comité a tiré grandement profit de ses importants travaux de recherche sur les problèmes du développement, l'endettement, l'adaptation de l'économie et les politiques du FMI et de la Banque mondiale, notamment pour rédiger ses rapport sur les politiques et les programmes du Canada en matière d'aide publique au développement ainsi que sur la dette du tiers-monde et les réformes des institutions financières et internationales.
[Traduction]
Prenons note également du message que nous livre M. Sachs dans son nouvel ouvrage exposant comment mettre fin à la pauvreté dans le monde dans lequel il nous rappelle que cet impératif est indispensable à notre sécurité et à notre avenir commun en tant que communauté planétaire.
Juste avant Pâques, nous avons eu le privilège d'entendre M. Wolfensohn, président de la Banque mondiale. Votre point de vue sera certainement un complément fort utile à ce témoignage.
M. Sachs, je vous laisse la parole et je vous invite à faire votre déclaration préliminaire, après quoi je laisserai mes collègues vous poser des questions. Merci beaucoup et bienvenue.


M. Jeffrey D. Sachs (Directeur du Projet Objectifs du Millénaire et conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies relativement aux Objectifs du Millénaire pour le développement ): Monsieur le président, mesdames et messieurs les membres du comité, c'est un honneur et un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. J'espère vraiment que je vous serai d'une certaine utilité lorsque vous vous pencherez sur la très importante question de la stratégie du Canada en matière d'aide au développement, tant au chapitre des montants que des types d'aide, et sur la façon de promouvoir les objectifs mondiaux en vue de réduire la pauvreté, de réduire les maladies, de diminuer la souffrance et par le fait même d'accroître la sécurité internationale.
Notre rencontre se produit à un moment très important. L'année 2005 est une année charnière. En fait, nous pensons même qu'il s'agit d'une année critique pour les objectifs du millénaire en matière de développement. Nous éprouvons en effet une certaine inquiétude, puisque ces objectifs ont été fixés en l'an 2000, pour l'année 2015 et qu'il nous reste une décennie. Et je peux vous dire que la situation telle qu'elle se présente sur le terrain en Éthiopie, au Kenya, au Sénégal ou dans les autres régions où je me suis rendu récemment, paraît plutôt inquiétante.
Cependant, je crois que pour une personne avertie et compte tenu de l'expérience et de l'apport de plus de 200 collègues qui ont participé au projet Objectifs du Millénaire—la situation a beau paraître alarmante pour plusieurs raisons, elle n'est pas désespérée. Il existe des approches pratiques qui permettent de lutter contre la pauvreté extrême, de réduire la souffrance, de sauver des vies et d'aider des régions où l'espoir semble totalement inexistant à prendre le chemin du développement et d'une plus grande sécurité et stabilité.
Nous avons décidé de formuler un plan pratique, parce que nous voulions nous éloigner de la théorie pure et nous intéresser aux mesures concrètes que l'on peut prendre: des choses aussi simples que des moustiquaires traitées à l'insecticide afin de réduire de plusieurs millions le nombre de décès annuels d'enfants qui meurent actuellement de la malaria en Afrique; des choses aussi simples que la collecte de l'eau de pluie et la restauration des éléments nutritifs du sol afin de permettre à la population africaine de cultiver suffisamment de produits alimentaires pour se nourrir et de déclencher ainsi le développement économique. Voilà des investissements simples et très concrets qui doivent être faits. Nos observations nous ont menés à un constat accablant... et j'étudie moi-même cette situation de manière intensive depuis plus de 20 ans, et dans le cadre de notre projet depuis trois ans, et auparavant pendant de nombreuses années dans le cadre de mes fonctions à l'Organisation mondiale de la santé où j'étais chargé d'étudier les situations de crise engendrées par les maladies. Nos conclusions fondamentales sont les suivantes.
Il y a des mesures concrètes que l'on peut prendre. Ce sont essentiellement des investissements de trois types différents. Investissement dans les personnes, c'est-à-dire dans la santé, l'éducation, la nutrition et la santé sexuelle et génésique, y compris la planification des naissances; l'investissement dans l'environnement physique, c'est-à-dire dans les sols, l'eau, la terre et l'habitat pour la biodiversité; et l'investissement dans les infrastructures de base, c'est-à-dire les routes, les transports motorisés, l'électricité, les combustibles sûrs pour la préparation des aliments et les communications. Voilà les trois types d'investissements. Si la pauvreté fait tant de victimes, c'est tout simplement parce que les populations ne disposent pas des outils nécessaires dans ces trois catégories: investissement dans leur propre capital humain, comme disent les économistes—expression affreuse que nous continuons à utiliser—investissement dans l'environnement où ils vivent et investissement dans l'infrastructure de base.
Il est possible de chiffrer ces investissements, monsieur le président. Ce qui est incroyable sur notre planète, c'est que les pauvres sont maintenant si pauvres, la technologie est si avancée, les riches sont si riches et le pourcentage d'humains vivant dans la pauvreté extrême ayant diminué considérablement depuis un demi-siècle, que le fameux 0,7 p. 100 du PIB est suffisant pour effectuer les investissements nécessaires pour éradiquer la pauvreté extrême et offrir aux pauvres un moyen de s'en sortir. Voilà actuellement ce que permet de faire le 0,7 p. 100. Cette enveloppe est suffisante pour mener avec succès une lutte globale contre la pauvreté extrême. Il ne fait aucun doute que si l'on dispose de l'argent et si l'on applique la bonne approche rigoureuse et scientifique, il reste un énorme défi supplémentaire à relever qui consiste à transformer l'aide en résultats tangibles sur le terrain.
º 
 (1605)
(1605)
Il y a des endroits dans le monde où je pense que cela n'est pas possible pour le moment. En Afrique, nous venons dernièrement d'assister encore à des élections frauduleuse au Zimbabwe. C'est un pays où la corruption et la violence sont généralisées. Je ne vois pas comment le Zimbabwe pourrait actuellement atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, étant donné que la gestion publique est si déplorable qu'il n'existe aucun mécanisme permettant de transformer l'aide en résultats tangibles sur le terrain à l'échelle nécessaire.
Mais, monsieur le président, beaucoup trop de gens font souvent l'erreur, surtout dans mon pays, de croire que l'Afrique est un seul et même pays. Ils lisent les nouvelles sur le Zimbabwe et ils en déduisent qu'il n'y a plus aucun espoir. Quant à moi, je voyage évidemment beaucoup en Afrique et j'aime rappeler à mes compatriotes que l'Afrique subsaharienne compte 49 pays. Beaucoup d'entre eux sont des sociétés ouvertes, paisibles et soucieuses de réformes, mais elles sont tout simplement terriblement pauvres et se meurent de leur pauvreté. Il y a deux semaines, j'étais au Sénégal. Récemment, je me suis rendu également au Ghana et en Éthiopie. Ces pays sont en paix, Dieu merci, et leurs gouvernements sont décidés à aider leurs populations à se sortir de la pauvreté extrême, mais ils n'ont pas les moyens pour le faire. Dans notre rapport, nous affirmons que nous devrions aider ces régions de manière plus proactive, plutôt que de nous lamenter sur les terribles tragédies des Zimbabwe de ce monde. Nous devrions cesser de penser que les terribles tragédies que représentent les pays mal gouvernés, sont des obstacles qui nous empêchent de venir en aide aux pays bien gouvernés.
Je ne sais pas si c'est par manque de compréhension ou si c'est un prétexte, mais j'entends tout le temps dire qu'il n'y a pas moyen de venir en aide à ces pays, parce que leur gestion publique n'est pas convenable. Ce n'est certainement pas le cas. C'est vrai dans certains pays, mais pas partout. Il est regrettable que certains pays appauvris, même s'ils sont stables et relativement bien gouvernés, ne reçoivent pas l'aide dont ils auraient besoin pour faire les investissements fondamentaux dans leur population, dans leur environnement et dans leur infrastructure pour pouvoir améliorer leur sort.
En résumé, nous proposons que tous les pays donateurs s'engagent... Mais ils se sont déjà engagés, aussi permettez-moi de reformuler ceci. Nous proposons que tous les pays donateurs honorent leur engagement de verser 0,7 p. 100 de leur PIB, non pas sous la forme d'un chèque en blanc ou d'un versement automatique, mais plutôt dans une attitude pratique et déterminée.
Nous ne devrions pas imposer des contraintes actives aux pays qui proposent des plans sensés nécessitant un investissement et visant à répondre aux besoins de leur population. Nous ne devrions pas dire à ces pays, comme nous le faisons actuellement—je pourrais vous en faire la liste, puisque cela fait 20 ans que je constate cette attitude—«Ne voyez pas si grand. Ne pensez pas que vous pouvez survivre. Ne pensez pas que vos enfants devraient avoir des moustiquaires. Ne pensez pas qu'il faudrait éliminer la faim. Nous ne pouvons pas vous aider.» Voilà ce que nous leur disons actuellement. Ce n'est pas dit exactement dans ces termes, mais notre attitude est presque aussi choquante.
Ce que je dis, c'est que nous devrions être prêts à honorer nos engagements. Trouvons l'argent nécessaire pour appuyer les plans qui sont authentiques. Aidons nos concitoyens à comprendre que nous sommes, que vous êtes, les gérants de leur argent. Je le dis en sachant très bien que les travailleurs et travailleuses ont de la difficulté à gagner de l'argent et qu'il faut par conséquent exercer une grande responsabilité dans l'usage que nous en faisons. Cependant, il y a des pays auxquels on pourrait venir en aide alors que rien n'est fait actuellement, ce qui entraîne la mort de millions d'enfants. Je ne pense pas que des Canadiens ou des citoyens des États-Unis souhaitent vraiment que cela continue de se passer ainsi.
º 
 (1610)
(1610)
Par conséquent, l'engagement est le suivant: soyons prêts à assurer le financement, engageons-nous à mettre de côté 0,7 p. 100 avant l'année 2015. Comme l'a dit le secrétaire général, il faut prendre le taureau par les cornes et ne pas se contenter de solutions faciles. Il faut s'engager auprès des pays. Il faut dire que nous sommes prêts à en faire plus. Nous, pays donateurs, sommes prêts à aider en proposant des ressources réelles et des plans d'action réels. Si nous le faisons, je connais des chefs d'État des pays pauvres du monde qui s'efforceront d'être des partenaires efficaces et responsables dans le but d'améliorer le sort de leur société. Je connais des pays qui pourraient retirer des avantages considérables de la simple mise en oeuvre de programmes visant à sortir leur population de l'extrême pauvreté. Le moment est venu de passer à l'action.
Jusqu'à présent, le gouvernement canadien ne l'a pas fait. Je pense que c'est une grave erreur et je l'ai dit. Je connais assez bien le premier ministre Paul Martin et je pense que cette cause lui tient personnellement à coeur. Je sais que le ministre des Finances vient de signer le rapport de la Commission africaine qui est conforme à ce plan d'action. Je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi le Canada ne fait pas partie des pays qui ont pris un engagement clair. En effet, c'est le pays qui, le premier, a eu la vision de cet objectif, à l'époque de Lester Pearson, en 1969. Nous nous sommes faits les champions de cette cause. Le Canada est un pays à l'économie florissante, disposant d'un budget généreux et d'une équipe dirigeante nationale bien intentionnée. L'opposition appuie également ces objectifs. Je ne vois aucun obstacle. Je ne vois pas ce qui empêche actuellement le Canada de donner l'exemple.
Voilà pourquoi je suis content d'être ici aujourd'hui. Je crois que le Canada est sur le point d'exercer le rôle de leader qui lui convient tout naturellement dans la société mondiale.
Merci.
º 
 (1615)
(1615)


Le président: Nous allons passer aux questions de l'opposition. Chaque parti disposera de dix minutes. Nous allons commencer par les conservateurs qui partageront leur temps entre M. Day et Mme Stronach.


M. Stockwell Day (Okanagan—Coquihalla, PCC): Je comprends les solutions pratiques que vous avez évoquées. Vous avez les compétences nécessaires pour savoir où et comment utiliser le mieux l'argent de l'aide.
Je reconnais avec vous qu'il y a un risque de transformer la pauvreté en ballon politique et nous ne voulons pas que cela se produise. Notre gouvernement devrait s'engager envers ces objectifs et en exposer les résultats.
La pauvreté, pas plus que la prospérité, n'est un produit du hasard. Je partage votre point de vue sur les sociétés. Vous avez parlé du Zimbabwe. Si nous accordions une aide financière massive à ce pays, il y aurait peut-être plus de routes, mais ces dernières seraient éventuellement contrôlées par les mauvaises personnes, ce qui aurait pour effet d'augmenter le nombre de pauvres.
Tout en sachant que nous ne voulons pas imposer nos normes culturelles à d'autres groupes, nous devons reconnaître qu'il y a certains principes de base qui mènent à la prospérité ou à la pauvreté. Comment exercer des pressions sur les régimes politiques douteux afin de nous assurer que l'argent que nous leur donnons ne sera pas gaspillé?


Mme Belinda Stronach (Newmarket—Aurora, PCC): Merci, monsieur Sachs et monsieur McArthur pour le rôle de leadership que vous avez adopté et merci d'être venus aujourd'hui.
Que devrait faire le Canada pour assurer le leadership moral à l'échelle mondiale dans ce domaine? Où en sont les autres pays du G-8 par rapport au niveau de 0,7 p. 100?


Le président: Monsieur Sachs, s'il vous plaît.


M. Jeffrey D. Sachs: Un mot d'abord sur les régimes douteux—et il y en a beaucoup. Le mieux que l'on puisse faire, c'est d'aider les bons gouvernements. Si l'on veut changer la situation au Zimbabwe, il faut aider le Mozambique, aider la Tanzanie. Il faut aider ces pays à sortir de la pauvreté extrême.
L'ironie dans tout cela, c'est que nous n'aidons même pas les pays bien gouvernés à sortir du piège de la pauvreté. Il est très difficile d'amener des mauvais régimes à modifier leur façon de faire ou à leur accorder une aide conditionnelle, parce qu'ils ne respecteront probablement pas les conditions. Je dois dire également que, de manière générale, je ne crois pas aux sanctions économiques, parce que je suis convaincu qu'elles ne fonctionnent pas et qu'elles pénalisent les populations.
Par contre, je crois qu'il faut s'exprimer. Je pense qu'il faut expliquer que le Zimbabwe n'est pas un pays avec lequel on peut collaborer en ce moment. Je crois que l'on peut surveiller les élections et exiger que les pays respectent les normes morales internationales, etc.
Mais je crois également que ce que l'on peut faire de plus efficace, c'est reconnaître que beaucoup de gouvernements cherchent désespérément de l'aide et qu'ils seraient prêts à collaborer avec le Canada et d'autres pays à la mise en oeuvre de plans pratiques visant à répondre à leurs besoins urgents.
Je peux vous dire qu'actuellement—c'est difficile à expliquer, parce que c'est quasiment incroyable—il n'y a pas d'argent sur le terrain pour mettre en oeuvre des actions concrètes. Vous ne pouvez pas savoir combien je dois me débattre pour recruter des infirmiers et infirmières lorsque survient une catastrophe sanitaire. Je me bats depuis des années pour obtenir la distribution gratuite de moustiquaires pour lutter contre la malaria. L'USAID et le DIFID veulent vendre ces moustiquaires. C'est franchement ridicule. Comme vous le voyez, je ne mâche pas mes mots, parce que c'est la vie des enfants qui est en jeu. Les organismes n'ont pas suffisamment d'argent pour tout simplement distribuer ces moustiquaires, alors ils font du marketing social. C'est un échec complet, puisque nous ne pouvons vendre ces moustiquaires à des gens qui sont totalement démunis. La seule chose qu'ils ont, c'est la malaria. Ils n'ont pas d'argent pour acheter des moustiquaires antimalaria.
Il est impossible de mener à bien de par le monde les actions les plus concrètes parce qu'il n'y a tout simplement pas d'argent pour les investissements pratiques. C'est scandaleux. Voilà la réalité que j'essaie de transmettre après avoir travaillé pendant 20 ans dans ce domaine.
Au Kenya, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est un pays en transition qui avait jusqu'à présent un gouvernement assez mauvais et qui est actuellement entre les mains d'une classe dirigeante composée en partie de certains éléments de la vieille garde et en partie d'éléments très réformistes. J'ai fixé pour le Kenya cinq objectifs très concrets en 2005: engager 4 000 infirmiers/infirmières, ce qui nécessitera probablement environ 15 millions de dollars; distribuer plusieurs millions de moustiquaires pour combattre la malaria—je pourrais vous donner les détails du calendrier, mais cela ne vaut pas la peine; traiter 100 000 personnes par une thérapie antirétrovirale contre le SIDA; former plusieurs milliers de travailleurs et travailleuses communautaires de la santé pour intervenir dans les villages; et équiper plusieurs dizaines d'hôpitaux régionaux auxiliaires pour qu'ils soient en mesure de donner des soins obstétriques d'urgence, y compris effectuer des césariennes.
Ce sont là des objectifs très concrets, simples, quantifiables et contrôlables. Il n'y a rien de magique là-dedans.
J'ai travaillé pendant un an et demi avec la communauté de donateurs, comme on l'appelle, pour faire avancer les choses. D'après ce que j'ai pu constater, il ne se passe rien.
La souffrance... Quand je visite les cliniques dans ces villages, je constate qu'il y a trois malades dans chaque lit d'hôpital; les infirmiers et infirmières ont chacun 70 patients et ils me disent qu'ils travaillent pendant huit heures chaque jour et qu'ils n'ont le temps de rien faire. Ils passent trois ou quatre minutes avec les mourants.
La situation dans les hôpitaux est absolument catastrophique et pourtant, lorsque je m'adresse à eux, les donateurs ne cessent de tergiverser: «Nous devons étudier la situation sur le plan des ressources humaines. Nous ne sommes pas certains. Est-ce que les services des infirmiers et infirmières seront utilisés de manière efficace?» Mais, allez donc visiter une clinique! Branchez-vous sur la réalité!
En passant, lorsque je quitte ces cliniques, les responsables de l'hôpital m'interpellent: «Pouvez-vous nous envoyer quelques infirmières, s'il vous plaît, monsieur Sachs?» Je me démène pour faire quelque chose et je me fais dire par les donateurs, par USAID, mes propres concitoyens américains, que j'avais bien raison et que leur budget d'aide a encore été amputé; une partie de leurs crédits ont été réorientés vers l'Iraq, l'Afghanistan ou ailleurs.
º 
 (1620)
(1620)
Voilà la réalité: au-delà des discours pompeux, il n'y a pas d'argent sur le terrain pour mener à bien des actions concrètes. Comment peut-on parler du Zimbabwe quand on n'aide pas d'autres pays où l'on pourrait intervenir? Non pas que nous ne devrions pas parler du Zimbabwe; on devrait au contraire en parler, mais nous devrions aider là où nous pouvons appliquer des mesures concrètes.
La ministre de la Santé du Kenya, par exemple, compte parmi les dirigeants africains les plus ouverts aux réformes. Charity Ngilu a combattu bravement l'ancien régime. Elle a contribué à rassembler les forces démocratiques. J'ai sillonné le pays avec elle. Elle est absolument décidée à prendre des mesures pour que les mères du Kenya ne meurent plus en couches et qu'elles n'aient plus à voir mourir leurs enfants de la malaria, comme je le vois moi-même régulièrement. C'est absolument désespérant de constater les ravages d'une maladie que l'on peut traiter pour un dollar. Cependant, le Kenya est si pauvre qu'il n'a pas les moyens de payer les médicaments.
Nous sommes incapables de mettre au point des mesures concrètes. Nous faisons des études.
Le vice-président de la Banque mondiale m'a fait parvenir l'an dernier une lettre que j'ai trouvée scandaleuse. Il écrivait: «Merci pour votre lettre, monsieur Sachs, au sujet des infirmiers et infirmières, mais nous ne sommes pas certains que le Kenya utilise efficacement son budget santé.» Dans ma réponse, je lui ai demandé carrément si c'était une plaisanterie. Le budget de la santé du Kenya équivaut à 6 $ par personne et par an. Comment parler d'utilisation efficace de 6 $ par personne et par an? La réalité, ce sont des morts massives. On ne peut pas administrer un système de santé quand on dispose de 6 $ par personne et par an. Au Canada et aux États-Unis, nous dépensons chaque année des milliers de dollars par personne, mais il voulait vérifier l'utilisation de ces 6 $ avant de reconnaître qu'il aurait fallu augmenter ce montant à 20 $, 25 $, 30 $ ou 35 $. Réveillez-vous! Désormais, les gens ne m'envoient plus des lettres comme celle-là, parce qu'ils savent que je vais les lire en comité parlementaire.
C'est honteux, parce qu'on dirait que c'est un jeu. À mes yeux ce n'est pas un jeu, c'est une tragédie. Il faut aider les pays à qui nous pouvons fournir une aide.
Que fait le Canada dans la pratique? Le Canada devrait s'engager à verser 0,7 p. 100 de son PIB d'ici 2015, se donnant peut-être une cible intermédiaire de 0,5 p. 100 d'ici 2009. C'est ce que le secrétaire général a recommandé.
Le Canada devrait s'associer aux autres pays qui ont accepté de verser un tel mondant, afin de ne pas être l'avant-dernier. Je ne pense pas que le Canada occupera le dernier rang. Washington ne lui laissera pas la dernière place. Mais je pense que le Canada pourrait bien être l'avant-dernier. C'est affreux, parce que plus vite le Canada agit et plus vite le système international prendra ses responsabilités, tandis que le Canada exercera un rôle direct.
Le Canada devrait prendre en charge au moins une douzaine de pays. Vingt-cinq, ce serait peut-être trop, si l'on réfléchit bien. Le Canada devrait pouvoir dire qu'il intervient dans 12 pays pour collaborer avec d'autres nations afin de réaliser les objectifs du millénaire. Et nous nous rendons à l'évidence. Le Canada doit se rendre à l'évidence, ce qu'il ne fait pas actuellement.
Je m'arrête ici.
º 
 (1625)
(1625)


Le président: Merci.
Nous allons maintenant passer à M. Paquette, s'il vous plaît.
[Français]


M. Pierre Paquette (Joliette, BQ): Merci, monsieur le président. Je vais partager mon temps avec mon collègue M. Bellavance.
Merci aussi pour vos présentations. La documentation est assez impressionnante. Évidemment, nous n'avons pas pu prendre toute la mesure des informations contenues dans la documentation que vous nous avez distribuée.
J'aimerais revenir sur la question de la dette. C'est quand même un débat assez important, et il n'y a pas de consensus sur l'approche qu'on devrait adopter pour ce qui est de la dette extérieure des pays pauvres. Dans votre document, vous parlez d'une approche selon laquelle il devrait y avoir un allégement de la dette étendu et généreux. J'ai aussi compris qu'on devrait avoir une politique différente selon le degré de pauvreté. J'aimerais que vous nous en parliez davantage. En effet, pour beaucoup de pays, le problème de la dette extérieure fait en sorte que l'aide publique qui arrive dans le pays est souvent inférieure aux capitaux qui en sortent pour payer les intérêts sur cette dette.
Un autre élément dont vous avez parlé et que j'aimerais que vous développiez est l'importance de la coordination entre les différentes institutions internationales et régionales concernant les aspects financiers. Je pense que nous serons tous d'accord sur cela. Vous parlez, entre autres, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, des banques régionales de développement. Sur ce plan, y a-t-il vraiment une coordination, ou à tout le moins une volonté de travailler avec l'équipe des Nations Unies pour le développement? Je sais qu'il y a eu des critiques très virulentes, en particulier au sujet des politiques d'ajustement structurel. J'aimerais vous entendre à ce sujet.
Mon collègue pourrait peut-être poser sa question tout de suite.


Le président: Monsieur Bellavance, s'il vous plaît.


M. André Bellavance (Richmond—Arthabaska, BQ): Merci, monsieur le président.
Merci, monsieur Sachs, de votre présence.
Ma question touche l'aide internationale. Le Canada n'est plus un modèle. Au milieu des années 1980, 0,5 p. 100 de notre PIB était consacré à l'aide internationale. Nous étions donc près de l'objectif de 0,7 p. 100. On aurait pu imaginer qu'une vingtaine d'années plus tard on l'atteindrait, mais au contraire, moins de 0,3 p. 100 de notre PIB est maintenant consacré à l'aide internationale. Nous sommes donc loin d'être un modèle, en dépit des promesses faites par le premier ministre Paul Martin à Bono et à d'autres personnes.
Pouvez-vous nous en parler? Par ailleurs, quel genre de pression l'ONU peut-elle exercer sur des pays développés comme le Canada qui ont des tendances à la baisse plutôt qu'à la hausse? Bien que nous connaissions actuellement une remontée, je le répète, nous consacrons tout de même moins de 0,3 p. 100 de notre PIB à l'aide internationale.
M. Day parlait tout à l'heure de pressions qui peuvent être exercées sur des pays en voie de développement, mais j'aimerais savoir s'il y a des pressions possibles sur les pays développés.
º 
 (1630)
(1630)


Le président: Professeur Sachs.
[Traduction]


M. Jeffrey D. Sachs: Merci.
Je n'ai pas complètement répondu à la question tout à l'heure, aussi je vais vous expliquer maintenant où en sont les pays actuellement par rapport à l'objectif de 0,7 p. 100.
Le Comité d'aide au développement, le CAD, regroupe actuellement 22 pays donateurs. Cinq d'entre eux ont adopté depuis longtemps la norme de 0,7 p. 100. Ce sont les pays nordiques comme la Suède, la Norvège et le Danemark, ainsi que le Luxembourg et les Pays-Bas. Six autres pays se sont récemment engagés à atteindre le niveau de 0,7 p. 100 avant l'année 2015. Il s'agit de la France, du Royaume-Uni, de la Belgique, de l'Espagne, de l'Irlande et de la Finlande. Je crois que l'Allemagne annoncera bientôt son calendrier. Si c'est le cas—et on nous l'a assuré en privé, mais aucune déclaration publique n'a encore été faite—je pense qu'il y a de bonnes chances que les 15 pays donateurs européens qui constituaient l'UE avant son élargissement, prendront le même engagement. Il faudrait donc ajouter à la liste l'Italie, la Grèce et le Portugal.
Ce qui motive entre autres choses l'Allemagne, c'est le lien entre le Conseil de sécurité des Nations Unies et la norme de 0,7 p. 100. Les deux rapports qui ont été remis au secrétaire général et le rapport du secrétaire général lui-même ont établi ce lien en précisant que les pays qui aspirent à exercer un leadership international ont une obligation spéciale de remplir leurs engagements. L'Allemagne et le Japon en ont pris note. J'ajouterais que si le Canada aspire à diriger le L-20, par exemple, il doit également faire un effort, car, comment peut-on prétendre exercer un leadership sans assumer la responsabilité qui découle des engagements?
Il faut d'ailleurs préciser que la norme de 0,7 p. 100 n'a pas été établie à notre demande, mais qu'il s'agit d'engagements qui ont déjà été pris plusieurs fois, à de multiples reprises, et qui n'ont pas été respectés.
Aussi, je pense que les pressions qui s'exercent sur le Canada sont les pressions de ses pairs, les pressions de l'histoire et de la politique internes et les pressions de la responsabilité pratique et morale. Je crois que tout converge dans la même direction et nous amène à nous demander pendant combien de temps le monde sera-t-il divisé entre les nantis et les pauvres qui meurent de leur misère alors qu'on reste là sans rien faire, espérant que le monde continuera à tourner? Je pense d'ailleurs que le monde ne tourne pas rond et je ne crois pas que la situation sera favorable pour nous, ou pour nos enfants si nous manquons l'échéance de 2005.
Quant à la dette et à la coordination, le G-7 s'est prononcé à plusieurs reprises en faveur de l'annulation complète de la dette de nombreux pays, mais il s'est montré incapable de décider comment procéder pour le faire. C'est pourquoi, j'ai proposé aux présidents et premiers ministres africains de tout simplement cesser leurs paiements en attendant que les créanciers trouvent une formule. En effet, les pays créanciers ont accepté que les pays débiteurs cessent leurs remboursements tout en ne sachant pas comment appliquer les modalités pratiques; ils ne savent pas si ce sont les États-Unis ou quelqu'un d'autre qui absorbera la différence, ou si c'est la Banque mondiale qui devrait le faire, ou encore s'il faudrait puiser dans les réserves d'or.
Alors, pendant que nos ministres des finances se livrent à ces débats techniques, l'Éthiopie, le Sénégal, le Ghana et d'autres pays continuent à rembourser leurs dettes pendant que les pays riches se penchent sur les modalités de cessation des remboursements. Je leur dis, quant à moi, d'arrêter tout simplement les remboursements. Je leur dis qu'ils contribueraient ainsi à régler le dilemme des pays créanciers parce que, d'après moi, cela n'a aucun sens. Plus précisément, je leur dis aussi de bien s'assurer, lorsqu'ils arrêtent les remboursements, d'agir en toute transparence et de faire en sorte que l'argent qu'ils économisent soit placé dans un compte de garantie bloqué ou directement orienté vers l'aide d'urgence aux enfants, afin de prendre les mesures nécessaires pour les garder en vie—grâce à l'achat de moustiquaires, à des programmes d'immunisation ou, de soins de santé primaires ou d'instruction élémentaire. Autrement dit, je leur demande d'établir un lien clair entre la fin du service de la dette et les investissements dans l'enfance. Ce n'est pas un jeu. Ils ont pour responsabilité d'assurer la transparence.
º 
 (1635)
(1635)
Mais je conseille sérieusement aux dirigeants africains de suspendre les remboursements, étant donné que les créanciers ont déjà approuvé cette mesure. Ils se chamaillent sur les questions de la valeur-or, alors que cela peut durer une éternité. Entre-temps, il y a des enfants qui meurent. C'est absolument inconcevable que des enfants continuent à mourir pendant que le secrétaire du Trésor américain et les ministres des Finances d'Europe et du Canada s'entendent sur les modalités de non-remboursement de la dette des pays pauvres. Voilà comment je vois essentiellement les choses.
Pour ce qui est de la coordination, la situation est assez positive dans la communauté professionnelle, monsieur le président. Je ne vais pas vous ennuyer par mes réponses trop longues, mais permettez-moi de vous décrire la situation mondiale actuelle sur le terrain. En 2003, j'ai inauguré, avec le premier ministre de l'Éthiopie, un événement public concernant les objectifs du millénaire pour le développement. Le premier ministre a présenté une brillante allocution sur la modernisation de l'agriculture en Éthiopie. Un membre de l'assistance lui a posé la question suivante: «Monsieur le ministre, que pensez-vous faire pour la santé? Nous avons une espérance de vie de 42 ans.» Il a répondu: «La santé devra attendre que nous soyons plus développés.»
Quand nous nous sommes retrouvés dans son bureau, un peu plus tard, je lui ai dit: «Monsieur le premier ministre, je ne suis pas d'accord avec vous», et il m'a répondu «Je n'ai pas le choix, Jeffrey. Le FMI vient de me préciser que notre pays n'avait pas d'argent pour la santé. Voilà ce que nous dit le FMI.» Je trouve personnellement que c'est scandaleux.
Le lendemain, je suis retourné à New York et j'ai appelé la direction du FMI. La vice-directrice générale adjointe du FMI m'a répondu et m'a demandé: «Eh bien, Jeff, de quoi allez-vous vous plaindre aujourd'hui?» «Aujourd'hui, je viens me plaindre au sujet de l'Éthiopie.» «J'écoute.» «Vos représentants disent au premier ministre de ne pas mettre en place un programme de santé.» Elle m'a répondu: «Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous n'avons aucune aide de la part des donateurs pour la santé en Éthiopie.» J'ai répliqué: «Mais, vous savez, on ne donne pas à l'Éthiopie la possibilité d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Les Éthiopiens ont une espérance de vie de 42 ans.» «Essayez de comprendre, a-t-elle répondu, que l'Éthiopie n'a aucune chance de respecter les objectifs du millénaire pour le développement.» Je lui ai dit que je n'étais pas d'accord et qu'il serait possible d'atteindre ces objectifs si l'on consentait les investissements nécessaires. «Jeffrey, m'a-t-elle répondu, il n'y a pas d'argent pour l'aide internationale. Que peut-on faire? Nous ne pouvons pas imprimer de l'argent.» Alors, je lui ai dit: «Adressez-vous aujourd'hui au Cercle national des journalistes et dites-leur ce que vous venez de me révéler. Dites la vérité au public.»
Eh bien, elle n'a jamais fait ce discours, puisque notre public ne veut pas savoir pourquoi les enfants meurent. Notre public ne veut pas savoir combien de vies on pourrait sauver. Notre public ne veut pas savoir qu'il ne s'agit pas de chiffres, mais de millions de vies chaque année. On ne dit pas ces choses-là, parce que le FMI s'efforce en ce moment d'appliquer les restrictions budgétaires que nous, le monde des donateurs, avons fixées plutôt que de révéler la vérité et d'expliquer au public ce que l'on pourrait faire. Cela désespère le personnel professionnel du FMI, mais on n'a toujours pas trouvé de solution à ce problème. Voilà la vérité.


Le président: Merci, monsieur Sachs.
Nous allons maintenant passer à M. Martin et M. McTeague.
Monsieur Martin, allez-y.


L'hon. Keith Martin (Esquimalt—Juan de Fuca, Lib.): Merci beaucoup.
Je vais partager mon temps avec M. McTeague.
Monsieur Sachs, je vous remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui. Je partage votre point de vue au sujet de l'Afrique. Je me suis rendu 23 fois sur le continent africain et j'y ai rencontré bien plus de personnes remarquables, tenaces et pleines d'initiative que nulle part ailleurs dans le monde. Comme vous l'avez dit, elles veulent qu'on leur donne une chance.
J'ai deux questions. Premièrement, je me demande ce qu'il faudrait faire pour que notre aide soit plus efficace sur le plan pratique. Nous constatons tous que les VUS sont omniprésents. Comment le Canada peut-il agir, en tant que membre de la communauté des pays donateurs, afin de collaborer avec d'autres pays pour que notre aide produise de meilleurs résultats, en mettant l'accent sur les cinq grandes questions que vous avez mentionnées dans votre ouvrage?
Ma deuxième question se rapporte au conflit et à la corruption massive—telle qu'illustrée par exemple par le Kenya. Vous reconnaîtrez sans doute avec moi que nous disposons actuellement d'une merveilleuse structure judiciaire mondiale qui n'a malheureusement pas de mécanisme d'application. Nous avons la responsabilité de protéger, sans aucune obligation de le faire. Comment pourrions-nous, monsieur Sachs, en tant que pays, encourager la mise au point de ce mécanisme d'application dont nous avons besoin et aussi l'obligation de protéger qui doit être assortie à la responsabilité que l'on évoque si souvent?
º 
 (1640)
(1640)


Le président: Merci.
Monsieur McTeague.


L'hon. Dan McTeague (Pickering—Scarborough-Est, Lib.): Merci, monsieur le président.
Monsieur Sachs, merci d'être venu et merci pour vos réflexions si éloquentes et si directes. Nous vous avons écouté religieusement.
J'aimerais peut-être ajouter un complément à la question posée par mon collègue M. Martin sur le principe de l'allègement de la dette. Je pense que vous avez été très éloquent et très clair quant à l'initiative que notre gouvernement pourrait prendre à ce sujet en vue d'éliminer carrément la dette. Pourriez-vous également éclairer le comité sur la façon de procéder? Il ne faudrait d'ailleurs pas se limiter à l'ambitieux objectif de 0,7 p. 100 énoncé au cours de l'ère Pearson, comme vous l'avez souligné. Cela fait également partie de nos objectifs.
Quelle serait, à votre avis, la formule appropriée pour amener les pays à conjuguer leurs efforts au sujet des mécanismes de coordination, non seulement entre donateurs, ONG et autres organisations, mais également entre les pays? Pensez-vous à d'autres organismes, organisations ou mécanismes qui pourraient obtenir de meilleurs résultats?
Enfin, quelles sont nos chances de succès dans la lutte contre la malaria ou les autres maladies liées au VIH/SIDA, les maladies transmises par l'eau et la tuberculose, si les médicaments continuent d'être inaccessibles, quels que soient les résultats obtenus au sommet d'Al-Dawha et tous les succès dont on s'est beaucoup vanté? Est-ce que 0,7 p. 100 serait suffisant si nous devons assumer ces coûts qui paraissent impossibles pour les pays donateurs, et encore plus pour les personnes qui ont désespérément besoin de cette aide?


Le président: Monsieur Sachs.


M. Jeffrey D. Sachs: Pour répondre à votre question sur l'aide à fournir et la façon de l'organiser, je recommanderais d'abord que nous dressions une liste de quelques pays prometteurs où nous pourrions commencer tout de suite. Je peux vous nommer quelques pays d'Afrique qui me viennent à l'esprit—même s'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive—et je pourrai vous expliquer la situation de ceux d'entre eux qui vous intéressent plus particulièrement. Il y a le Sénégal, le Ghana, le Kenya, l'Éthiopie, le Mozambique, le Malawi, Madagascar et le Mali—mais ce n'est qu'un début.
Dans le cas du Kenya, j'ajouterai que je connais assez bien le gouvernement kényen. Il s'est fait là-bas des choses assez déplorables, mais aussi des réformes tout à fait remarquables, et je suis convaincu que nous pourrions trouver le moyen de faire quelque chose. Je tenais à le préciser.
De façon générale, pour tous les pays que j'ai nommés, je pense qu'il est possible de déterminer les mesures concrètes à prendre, de trouver des mécanismes pour que les investissements atteignent les villages—où vivent la plupart des pauvres—, de suivre ce qui se fait, de faire des vérifications sur ce qui a été fait et de produire des résultats. Je pense que c'est ce qu'il faut faire.
Ce qu'il faut, à notre avis, c'est que les pays et leurs partenaires donateurs... Nous devons vraiment insister sur ce terme parce qu'après tout, Lester Pearson parlait de «partenaires dans le développement». C'est vraiment lui qui a inventé l'expression. De nos jours, les partenaires dans le développement sont à peine des partenaires. Mais nous voulons un véritable partenariat. À mon avis, les pays et les donateurs devraient signer un accord très clair dans lequel seraient énoncés quelques principes de base—pas une centaine d'ententes d'aide individuelles, mais un accord global par lequel les deux parties s'engageraient à respecter des normes très claires.
Premièrement, l'aide devrait servir à soutenir une stratégie fondée sur les OMD. Cela peut paraître plutôt obscur comme jargon, mais l'idée, c'est de chercher à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Ce sont des objectifs quantitatifs, avec des échéances définies, et il faudrait élaborer des stratégies visant à les réaliser.
Deuxièmement, l'aide devrait être accordée sur dix ans parce que nous essayons d'atteindre les objectifs d'ici 2015. C'est pourquoi il est tellement important d'arriver à 0,7 p. 100 d'ici 2015. Nous avons besoin de ces dix ans pour faire le travail.
Troisièmement, l'aide devrait être fournie de manière transparente, afin de soutenir les objectifs du pays bénéficiaire, et non les projets chouchous du pays donateur. C'est assez évident. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est évident.
Quatrièmement, l'aide devrait être assortie de buts quantifiables, de mesures de suivi et de vérifications, et les pays devraient être tenus de signer un accord en ce sens. J'aimerais que nos firmes de vérification privées se promènent dans les villages de ces pays-là pour vérifier si les moustiquaires ont été installées, si les cliniques ont été construites, si les médecins sont arrivés. Ce n'est pas une blague. C'est une proposition d'affaires. Et cette proposition d'affaires, c'est que nous les aidons vraiment et qu'ils font vraiment ce qu'ils ont à faire. Actuellement, il ne se fait ni l'un ni l'autre. Quand je travaillais en Pologne, on disait «Nous faisons semblant de travailler et vous faites semblant de nous payer», et aujourd'hui, on dit «Nous faisons semblant de vous aider et vous faites semblant d'apporter des réformes».
Le temps est venu de passer aux choses sérieuses.
Ce que nous proposons, c'est un contrat en bonne et due forme, en fait, tout particulièrement pour un certain nombre de pays. Je veux que les donateurs signent ce contrat, ce qu'ils n'aiment pas faire. Ils vont certainement protester: «Nous ne signerons pas simplement parce que M. Sachs le demande, ou parce que l'ONU le demande.» Sérieusement, je veux un document signé dans lequel les responsabilités mutuelles seront énoncées en détail. Les pays bénéficiaires s'engageront à permettre des vérifications, et les pays donateurs promettront un approvisionnement de fonds constant, cohérent et fiable pour soutenir un programme d'investissements quantifiés.
J'aimerais aussi que vous puissiez dire à la population canadienne que les choses ne se passeront pas comme d'habitude, que nous pourrons mesurer étape par étape ce qui aura été fait. Nous ne donnerons pas d'argent pour des moustiquaires qui ne se retrouveront pas dans les communautés. Il s'agit de quelque chose de nouveau et de concret, par rapport à des buts précis. Et nous allons atteindre ces buts parce que c'est ce que les gens veulent. La population de ces pays-là veut rester en vie.
º 
 (1645)
(1645)
Les villages sont bien organisés, soit dit en passant. Ils ont de bonnes structures de comités. Ils sont capables de faire le nécessaire. Ils ne jouent pas à des petits jeux; c'est une question de vie ou de mort pour eux. Donc, si nous réussissons à acheminer les marchandises et l'aide jusqu'à eux, nous y trouverons une bonne gouvernance.
De façon générale, nous devons cesser de négocier indéfiniment des projets individuels qui tiennent à coeur des donateurs. Il nous faut un contrat, et il nous faut du suivi et des évaluations par rapport, essentiellement, à un programme national établi dans une perspective de dix ans.
Tout cela est possible. Nous allons travailler avec un certain nombre de gouvernements, et j'aimerais bien que le gouvernement canadien se fasse le champion de cette formule dans quelques endroits pour que le Canada prenne la tête et dise: «Oui, nous allons aider à réunir les donateurs pour que, de notre côté, le pays n'ait plus à s'occuper de 22 processus distincts, mais qu'il y ait vraiment un partenariat, et nous allons essayer d'en arriver à quelque chose de ce genre.» Prenons quelques endroits où la gouvernance n'est pas si mal, où ce serait réalisable et où nous pourrions obtenir un accord des gouvernements. Il y aura bien sûr des vérifications. Si les pays bénéficiaires reçoivent une aide concrète, ils devront être prêts à subir des vérifications.
Pour ce qui est de la lutte contre les maladies, et plus particulièrement contre le paludisme, le coût d'un programme complet de lutte antipaludique—compte tenu des prix des médicaments de la nouvelle génération qui seront nécessaires, et ainsi de suite—est de 3 $ par personne par année dans le monde riche. Il y a un milliard de personnes dans le monde riche, c'est-à-dire au Canada, aux États-Unis, en Europe, au Japon et dans quelques autres pays développés—un milliard de personnes! À 3$ chacune, cela fait 3 milliards de dollars par année. Ce serait suffisant, selon des données scientifiques rigoureuses, pour sauver plus d'un million de vies par année. C'est incroyable!
Le traitement de choix pour combattre le paludisme, à l'heure actuelle, c'est ce qu'on appelle la polythérapie à base d'artémisinine, et c'est Novartis qui est le principal producteur du médicament de base. La compagnie s'est engagée à offrir ce médicament au prix coûtant, sans faire de profit. Elle s'est engagée à accroître considérablement sa production pour qu'il y ait 220 millions de doses de traitement disponibles en 2007. Elle travaille très fort, mais nous avons besoin d'un projet pour financer tout cela, et il faut que les donateurs se débarrassent de cette manie d'essayer de vendre des choses à des gens qui n'ont rien.
Je vais donc proposer au Secrétaire général—en espérant qu'il transmettra très bientôt cette proposition au G-8—ce que nous considérons comme un moyen de vaincre rapidement la malaria. C'est un projet précis qui fera en sorte que, d'ici 2008, tous les Africains qui en auront besoin auront accès gratuitement à des moustiquaires imprégnées d'insecticide et à des médicaments efficaces qui leur permettront de guérir quand ils seront malades. Il y a donc un aspect prévention et un aspect traitement.
º 
 (1650)
(1650)


Le président: Merci, monsieur Sachs.
C'est maintenant au tour de Mme McDonough, s'il vous plaît.


Mme Alexa McDonough (Halifax, NPD): Merci beaucoup, monsieur le président.
Monsieur Sachs, merci d'être ici aujourd'hui et merci aussi de l'extraordinaire leadership que vous exercez, tant par votre passion que par votre sens pratique, pour essayer de faire avancer les choses dans le sens des objectifs du Millénaire pour le développement.
À certains égards, nous traitons peut-être les visiteurs comme vous de manière tout à fait injuste. D'abord, nous vous demandons d'exercer un leadership à l'échelle internationale, et ensuite nous vous invitons à venir ici pour partager nos angoisses sur le fait que notre pays n'est pas à la hauteur de ses engagements. Nous en demandons vraiment beaucoup à nos leaders internationaux.
J'aimerais vous poser quelques questions qui font suite à votre présentation, mais également au discours qu'un de vos collègues qui exerce lui aussi un leadership international en matière de développement, Stephen Lewis, a prononcé hier soir dans ma propre province, dans ma circonscription de Halifax; il a présenté un plaidoyer extrêmement éloquent en faveur des objectifs du Millénaire pour le développement.
À la base, nous avons le sentiment que c'est ce que les Canadiens veulent que nous fassions. Vous avez probablement une idée de la frustration et de la honte que nous ressentons à cause du fait que, plutôt que d'être à l'avant-garde et d'amener les pays développés à atteindre l'objectif de 0,7 p. 100, nous nous retrouvons au contraire parmi les traînards. Les Canadiens ordinaires semblent bien comprendre la situation et veulent faire leur part. Partout, les membres des clubs Rotary et les simples citoyens veulent aider, dans leur propre communauté et dans la communauté mondiale, et ils semblent tous éprouver la même frustration.
Mes quelques questions portent sur les moyens à prendre pour profiter de ce sentiment profond afin de faire les bons choix. Il s'agit de savoir quels éléments mettre en place, et non de faire de grandes phrases creuses. Nous avons pris des engagements depuis longtemps, et nous n'avons pas cessé de reculer depuis.
J'aimerais savoir notamment si vous pensez qu'il pourrait être utile que nous essayions de faire pression sur le gouvernement canadien pour le convaincre d'adopter un cadre législatif dans le genre de celui qui a été mis en place au Royaume-Uni, par exemple, pour l'aide au développement international, et si vous pouvez nous donner des exemples qui pourraient nous inspirer et que nous pourrions suivre, peut-être pas intégralement, mais dans leurs grandes lignes.
Deuxièmement, la question qui est soulevée très souvent au niveau local, c'est de savoir si nos efforts de collecte de fonds pour contribuer au développement international—et pour inciter si possible le gouvernement à se montrer plus généreux—devraient être dirigés vers les grandes ONG, qui ont l'infrastructure et les moyens nécessaires, ou s'il faudrait plutôt encourager les communautés à développer des partenariats au niveau local.
Troisièmement, la question que nous nous posons à notre niveau, celui du gouvernement national, c'est celle des choix à faire entre le multilatéralisme, le bilatéralisme—de pays à pays—et l'envoi d'argent par l'intermédiaire des ONG.
Je sais que ce sont des questions plutôt générales, mais je pense que nous pourrions profiter des conseils que vous êtes prêts à nous donner sur ces trois éléments. Merci.


Le président: Monsieur Sachs.


M. Jeffrey D. Sachs: Merci beaucoup. C'est une question extrêmement importante et très concrète.
Permettez-moi de vous dire, pour commencer, que la population américaine est elle aussi tout à fait prête à faire ces choses-là—quand elle est au courant. Aux États-Unis, le principal problème, c'est que les gens ne savent pas à quel point nous en faisons peu. Un sondage réalisé là-bas a révélé que les Américains se pensent à peu près 30 fois plus généreux qu'ils le sont en réalité; ils surestiment donc considérablement la situation. De façon générale, les Américains pensent que l'aide ne sert à rien, à cause de la corruption par exemple; alors, ils disent qu'ils aimeraient bien faire quelque chose, mais qu'ils ne pensent pas que ce soit utile.
Il y a donc un certain scepticisme au sujet de ce qui se fait, mais ce n'est pas parce que les gens ont le coeur dur. C'est certain. Il y a de la confusion et du scepticisme, mais ce n'est pas par manque de générosité. Nous l'avons vu lors du tsunami; les gens ont répondu de façon absolument incroyable. Ils sont touchés et émus, pour des raisons morales tout autant que pour des raisons pratiques, quand ils savent que ce qu'ils font peut aider. Au Canada, nous avons la campagne «Abolissons la pauvreté», qui réunit beaucoup d'ONG, et dans laquelle énormément de gens sont engagés. Comme je parle beaucoup de ces questions, comme vous pouvez vous l'imaginer, je constate qu'il y a un sentiment très répandu aux États-Unis. Les gens ne disent pas «Ne venez pas piger dans mon portefeuille», ou «Je ne suis pas intéressé». Ils posent une foule de questions sur ce qu'il faut faire, sur les moyens de démontrer que cela fonctionne, sur ce qui est possible concrètement et sur la contribution qu'ils peuvent apporter. Il faut en tirer profit, et je soupçonne que c'est un sentiment très fort au Canada également—encore une fois, quand on attire l'attention des gens, parce qu'ils ne pensent pas nécessairement au problème au jour le jour. Mais quand ils s'en rendent compte, ils veulent faire quelque chose.
En ce qui concerne un possible cadre législatif, je recommanderais de faire des objectifs du Millénaire pour le développement l'élément central de votre stratégie d'aide à l'étranger pour que nous visions à peu près tous les mêmes buts. Les Suédois l'ont fait de façon magistrale. Ils ont adopté un cadre législatif très cohérent qui s'articule autour de leur politique étrangère. Ils disent: «Nous avons établi des buts et nous voulons être certains, dans tous les aspects de notre politique, d'atteindre les buts que nous avons adoptés sur le plan international et que nous partageons avec d'autres, dans les domaines de l'aide et du commerce, notamment.» Je pense que c'est un modèle très impressionnant. D'autres pays que je connais trop bien disent: «Oh, nous avons signé quelque chose? Cela ne me dit rien.» C'est l'approche contraire. Donc, je vous recommanderais d'adopter un cadre législatif pour vous assurer que vos engagements seront respectés de manière cohérente.
Mais comment contribuer? L'APD est vitale, et il est important de se rappeler d'où vient l'objectif de 0,7 p. 100. Il remonte à l'époque où on a demandé aux pays riches de donner aux plus pauvres 1 p. 100 de leur revenu national, dont 0,7 p. 100 devait venir du secteur public et 0,3 p. 100 du secteur privé. Le modèle, qui remonte à Lester Pearson et même avant, n'était pas de 0,7 p. 100 comme tel, mais plutôt de 1 p. 100 réparti entre les efforts privés et les efforts publics. Nous avons besoin de ces deux aspects-là. Ils servent à des rôles différents et ont des fonctions différentes. Les ONG privées peuvent faire beaucoup de choses créatives que les bureaucraties ne font pas aussi bien. Elles peuvent expérimenter et explorer; elles ont des contacts de personne à personne; elles font toutes sortes de choses merveilleuses. Elles nous font participer, individuellement et collectivement, à des initiatives qui ne seraient jamais possibles si nous nous contentions de payer des impôts pour l'aide au développement. Nous avons donc besoin des dons publics et des dons privés.
Mais nous avons aussi besoin d'une réponse qui soit à l'échelle des défis à relever à l'étranger. Ce n'est pas en lançant un petit projet après l'autre que nous réussirons à nous attaquer à l'extrême pauvreté en Éthiopie. Il y a 70 millions de personnes là-bas, et nous avons besoin de quelque chose qui soit à la hauteur de ce défi. Ce qu'il faut donc vraiment, à grande échelle, c'est une aide publique au développement combinée à l'aide d'autres donateurs, pour soutenir une stratégie d'investissement appliquée par le gouvernement, et aussi un mécanisme de mise en oeuvre.
º 
 (1655)
(1655)
Cela fait beaucoup de jargon, et je ne veux pas donner l'impression que c'est sans espoir et que c'est un processus bureaucratique, parce que ce qu'il faut vraiment, c'est trouver un moyen pour que tous les villages aient de l'eau potable, des moustiquaires, une clinique, une école, et de l'aide pour que les agriculteurs puissent cultiver plus de nourriture. Il faut une stratégie qui comporte assez d'aide financière et assez de mécanismes pour qu'il soit possible d'investir réellement sur le terrain, dans des milliers et des milliers de villages dans chaque pays.
Les ONG ne sont pas très bien placées pour fournir cette réponse à grande échelle, parce qu'elles ont plutôt tendance à travailler au niveau communautaire. Elles peuvent parfois apporter une aide de plus grande envergure. C'est le cas d'Oxfam et de quelques autres grandes ONG, mais nous devons aussi simplifier le processus d'acheminement de l'aide.
Autrement dit, le meilleur moyen de sortir ces pays de la pauvreté, ce n'est pas d'y envoyer une foule de gens d'ici, même si les visites et les contacts directs sont merveilleux du point de vue humain. Ces gens-là ont besoin d'aide pour s'aider eux-mêmes. Il y a des agriculteurs, des infirmières, des agents de santé communautaire, mais ils n'ont pas d'outils, pas de médicaments, pas de moustiquaires, pas d'engrais, pas de semences approuvées et pas de systèmes d'irrigation au goutte-à-goutte; il n'ont aucun des outils qui leur permettraient d'échapper à la pauvreté. La première chose à faire, ce n'est pas d'envoyer de l'aide technique, ni des coopérants, même s'ils sont importants du point de vue des contacts humains. La première chose, c'est de financer les investissements de base nécessaires à grande échelle pour mettre fin à la faim chronique, à l'agriculture sous-performante, au manque d'accès à l'eau potable et aux médicaments.
Heureusement—comme on le voit quand on a l'expérience que j'ai amassée au cours de mes 23 visites—, les gens, dans les communautés, sont prêts à travailler. Ils savent parfaitement ce dont ils ont besoin, mais ils manquent de ressources. Nous devons les aider. Il ne s'agit même pas de leur envoyer de l'argent; envoyons-leur plutôt des moustiquaires, et des médicaments. Ces gens-là veulent des outils pour se développer. Ils ne veulent pas d'argent, ils veulent des outils de développement, mais à une échelle proportionnelle à l'ampleur du défi.
» 
 (1700)
(1700)


Le président: Merci, monsieur Sachs.
Je vais laisser M. Sorenson poser une question sans préambule, puis Mme Phinney. J'aurai moi aussi une question à poser, après quoi nous lèverons la séance.
Monsieur Sorenson, s'il vous plaît.


M. Kevin Sorenson (Crowfoot, PCC): Et si nous leur envoyions plutôt du blé? Ou d'autres céréales? Je pense que nous avons une politique visant à en acheter et à essayer d'en livrer aussi rapidement que possible; nous n'envoyons pas nécessairement des céréales produites chez nous dans certains cas, mais ce n'est pas de cela que je voulais vous parler. Ma question se rattache plutôt à celle que le secrétaire parlementaire vous a posée au sujet de la remise de dette. Un des témoins que nous avons entendus plus tôt nous a dit que beaucoup de pays rejetaient le programme de remise de dette parce que cela nuirait à leur cote de crédit. Certains pays riches sont tout à fait prêts, peut-être pas à éliminer la dette complètement, mais à en annuler une partie, mais il y a des pays en développement qui craignent que cela nuise à leur crédit s'ils veulent emprunter plus tard.
Qu'en pensez-vous?


Le président: Madame Phinney, votre question, s'il vous plaît.


Mme Beth Phinney (Hamilton Mountain, Lib.): Je sais que nous ne devons pas faire de préambule, mais récemment, à Haïti, il y a des représentants gouvernementaux qui ont pris certains engagements. D'après ce que j'ai pu comprendre, il y a un peu de cette reddition de comptes dont vous avez parlé, parce que chaque pays devait lancer un projet et faire rapport de ses progrès. J'ai l'impression que cela se rattache un peu à la reddition de comptes que vous réclamez, n'est-ce pas?
Mon autre question est la suivante: est-ce que vous suggérez que nous prenions notre 0,7 p. 100—ou quelque autre montant que ce soit—et que nous envoyions quelqu'un en Éthiopie pour demander combien de personnes ont besoin de moustiquaires, après quoi nous achèterions ces moustiquaires—après les avoir fabriqués, je suppose—et nous les enverrions là-bas? Est-ce ainsi que vous voudriez nous voir procéder? Donc, plutôt que de recueillir de l'argent à Hamilton et d'envoyer 43 moustiquaires, par exemple, pendant que la Croix-Rouge en envoie 5 000 de son côté, nous mettrions tout cela en commun et nous enverrions une seule personne là-bas pour conclure une entente? Et est-ce que nous devrions aussi y envoyer quelqu'un plus tard pour nous assurer que les moustiquaires se sont bien rendues?
» 
 (1705)
(1705)


Le président: Ma question est la suivante, monsieur Sachs. Dans un de vos rapports, vous recommandiez notamment que les donateurs d'aide internationale dressent une liste d'au moins une douzaine de pays capables d'absorber une augmentation rapide de l'aide. Vous avez nommé quelques pays. C'est bien. Cela semble très intéressant.
Ce que j'aimerais savoir, c'est ce qui se passera—si nous décidons de nous concentrer sur un nombre réduit de pays, avec la coordination ou l'aide d'États poursuivant les mêmes objectifs que nous—pour les gens qui sont dans le besoin dans d'autres pays.


M. Jeffrey D. Sachs: Parlons tout d'abord de l'aide alimentaire. L'aide alimentaire—l'envoi de céréales—est une mesure de dernier recours, quand tout le reste a échoué. C'est de la pure charité, ce qui n'aide absolument pas les gens à échapper à la pauvreté.
À l'heure actuelle, en Afrique, la production céréalière par hectare est environ trois fois moins élevée que ce qu'elle devrait être, et ce qu'elle pourrait être. C'est parce qu'il n'y a pas d'engrais, et presque pas de gestion de l'eau, ce qui fait que les semences améliorées coûtent trop cher. C'est donc un désastre sur le plan agronomique.
Quand on envoie de l'aide alimentaire, c'est comme quand on fait la charité: on aide les gens à survivre, mais cela ne règle rien. C'est la chose à faire quand il y a une famine et que les gens risquent, autrement, de mourir de faim. Mais nous devons plutôt chercher à aider les agriculteurs à se nourrir. C'est de cette façon-là que l'Asie a échappé au piège de la pauvreté il y a 40 ans, grâce à une révolution verte.
L'Afrique a besoin aujourd'hui d'une révolution verte. Les plus grands agronomes du monde se sont penchés sur la question ces dernières années, tant au sein de ce qu'on appelle l'InterAcademy Panel on International Issues—qui réunit les académies scientifiques nationales du monde entier et qui a produit un rapport l'an dernier—que dans le cadre de notre projet dirigé par deux des pagronomes les plus réputés du globe, M.S. Swaminathan et Pedro Sanchez, qui ont également produit un rapport. Les auteurs de ces deux rapports ont conclu que l'Afrique pourrait tripler sa production de céréales si elle disposait de bonnes bases scientifiques. C'est à cela qu'irait une partie du financement, et c'est vital.
Pour le moment, nous envoyons les agriculteurs africains cultiver des sols morts, qui ne peuvent pas produire assez de nourriture pour rester en vie sur le plan biophysique; ils sont donc condamnés. Ces agriculteurs travaillent dans les champs pendant de longues heures, à la sueur de leur front, et tout ce qu'ils obtiennent, c'est une récolte d'une tonne par hectare, ce qui représente le tiers de ce qu'ils devraient obtenir dans ces conditions. Et ensuite, nous leur envoyons de l'aide alimentaire d'urgence; nous devrions plutôt les aider à cultiver plus de nourriture.
Pour ce qui est de la remise de dette et des cotes de crédit, c'est peut-être tout à fait vrai pour le Brésil, mais pas pour le Malawi. Le Malawi n'a pas de cote de crédit; il n'a aucun espoir d'en avoir une et ne devrait même pas en rêver. Il aura un jour une cote de crédit si toutes ses dettes sont annulées, si les objectifs du Millénaire pour le développement sont atteints et s'il se lance dans des activités économiques commerciales. Mais pas avant.
Donc, c'est la mauvaise façon d'aborder la question. Nous parlons des endroits les plus pauvres de la planète. Si ces pays-là ont une cote de crédit, je soupçonne que c'est une cote E dans bien des cas, mais ce n'est pas une question à laquelle ils devraient penser ou dont ils devraient s'inquiéter. Ils sont en train de se noyer, et leurs enfants sont en train de mourir; ce qu'il leur faut, c'est une remise de dette. C'est de ces endroits-là que je veux parler. Il est important de faire la distinction.
Quant à savoir comment nous devons acheminer l'aide, si vous demandiez aux Éthiopiens combien il leur faut de moustiquaires, ils vous citeraient un chiffre. Avec 70 millions de personnes, ils diraient probablement qu'il leur faut environ 20 millions de moustiquaires, et de moustiquaires solides et durables.
J'ai travaillé avec le ministre d'État à la Santé. Cet homme-là ne veut pas votre argent; il veut vos moustiquaires. Il pourrait dresser la liste de ce qui manque dans les cliniques et de ce qu'il faut pour assurer des soins de santé de base parfaitement rigoureux et efficaces sur le plan épidémiologique. Il n'est pas là pour voler quoi que ce soit; il doit approvisionner les dispensaires.
Il a en fait demandé qu'un programme quinquennal soit mis en place pour construire des dispensaires là où il n'y en a pas actuellement. C'est tout à fait concret. Il n'y a rien de spécial là-dedans. Pour chaque groupe de 5 000 personnes, il faut une petite structure pour loger le dispensaire, pour abriter un microscope, pour offrir un traitement d'urgence contre la malaria, et ainsi de suite.
Tout cela a des coûts précis et facilement identifiables. Il est possible de montrer, district par district, où sont les besoins. Et puis, quand je demande l'aide des donateurs, ils me disent: «Hum... Eh bien, nous allons étudier le problème.» Et ils ajoutent ensuite, tout bas: «Nous n'avons pas d'argent.»
Donc, la réponse est «oui», et si les gouvernements ont les moyens nécessaires, ils vont y arriver. Ce que nous devrions leur dire, c'est: «Nous allons vous donner un peu d'argent—parce qu'ils vont devoir acheter certaines choses, verser des salaires, et ainsi de suite—et nous allons aussi vous fournir beaucoup de matière première à l'échelle nationale, parce qu'il devrait y avoir un système d'achats centralisés pour certaines de ces choses. Et nous allons effectuer des vérifications. Nous allons vous envoyer quelqu'un de chez PwC ou quelqu'un d'autre, et nous allons effectuer une vérification sérieuse dans six mois, un an ou deux ans.» Et vous savez ce que dirait le gouvernement? Il dirait: «C'est merveilleux! Nous vous serions vraiment reconnaissants si vous nous aidiez à sortir de ce trou.» Donc, vous avez tout à fait raison.
»  (1710)
(1710)
Pour ce qui est des autres pays, ce que nous disons en réalité, c'est qu'il y a des endroits où tout est prêt, sauf que les gens sont trop pauvres. Nous devons commencer à les aider le plus tôt possible, à une échelle différente. Ce que nous disons, c'est qu'il ne faut pas laisser les pays où les choses vont moins bien retarder ceux qui sont prêts.
Nous avons parlé d'au moins une douzaine de pays, pas d'une douzaine exactement. Nous avons dit «au moins une douzaine» parce que nous ne faisons pas confiance aux donateurs. Donc, nous n'avons pas voulu nous limiter à 12 parce que nous ne vous faisons pas confiance. Parce que, si nous vous avions demandé de choisir des pays où il faudrait intervenir en priorité, vous en auriez choisi un ou deux, peut-être, alors que nous savons qu'il y en a beaucoup plus. Donc, c'est une preuve de notre méfiance, qui est très grande, parce que nous n'avons pas confiance que les fonds ou les ressources vont effectivement être là.
Nous voulons des engagements concrets et des résultats tangibles. Ce que j'ai dit au gouvernement aujourd'hui, c'est que le Canada pourrait décider d'apporter lui-même sa contribution, mais aussi de prendre la tête des opérations pour organiser les choses dans quelques pays parce que l'ONU ne peut pas le faire. Il faut que ce soit un des pays qui prennent la chose au sérieux; il faut qu'il parle aux autres donateurs et qu'il leur dise: «Soyons sérieux. M. Sachs a raison. Vous le savez, et nous le savons aussi, alors soyons sérieux.» J'ai demandé au Canada de prendre la tête des opérations dans quelques cas, et pas seulement d'y participer.


Le président: Merci beaucoup.
Merci beaucoup, monsieur Sachs. C'est merveilleux de vous avoir ici cet après-midi. Notre comité travaille généralement par consensus. Or, notre consensus à tous, c'est que votre présentation a été fabuleuse. Nous espérons que vous aurez du succès auprès de nos ministres aussi; en tout cas, nous allons faire pression sur notre ministre, vous pouvez en être assuré.
Merci.


M. Jeffrey D. Sachs: Parfait. Merci beaucoup.


M. John W. McArthur (gérant, Projet du Millénaire, Nations Unies): Monsieur le président, si j'ai bien compris, ceux qui voudraient poursuivre la conversation pourront se retrouver en bas, dans la pièce 160.

Le président: Merci.
La séance est levée.