FAAE Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
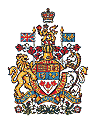
38e LÉGISLATURE, 1re SESSION
Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international
TÉMOIGNAGES
TABLE DES MATIÈRES
Le jeudi 12 mai 2005
| ¿ | 0905 |
 |
Le président (M. Bernard Patry (Pierrefonds—Dollard, Lib.)) |
 |
M. Derek H. Burney (professeur auxiliaire et chargé de cours distingué principal, The Norman Paterson School of International Affairs, Université Carleton) |
| ¿ | 0910 |
| ¿ | 0915 |
 |
Le président |
 |
M. Jocelyn Coulon (professeur invité, Centre d'études et de recherches internationales (CÉRIUM), Université de Montréal) |
| ¿ | 0920 |
| ¿ | 0925 |
 |
Le président |
 |
Mme Alexa McDonough (Halifax, NPD) |
| ¿ | 0930 |
 |
M. Jocelyn Coulon |
| ¿ | 0935 |
 |
Le président |
 |
M. Derek H. Burney |
| ¿ | 0940 |
 |
Le président |
 |
Mme Alexa McDonough |
 |
Le président |
 |
L'hon. Mark Eyking (Sydney—Victoria, Lib.) |
 |
M. Derek H. Burney |
| ¿ | 0945 |
| ¿ | 0950 |
 |
L'hon. Mark Eyking |
 |
Le président |
 |
L'hon. Mark Eyking |
 |
M. Derek H. Burney |
 |
Le président |
 |
M. Jocelyn Coulon |
| ¿ | 0955 |
 |
Le président |
 |
L'hon. Dan McTeague (Pickering—Scarborough-Est, Lib.) |
 |
Le président |
 |
L'hon. Dan McTeague |
 |
Le président |
 |
L'hon. Dan McTeague |
| À | 1000 |
 |
Le président |
 |
M. Derek H. Burney |
 |
L'hon. Dan McTeague |
 |
M. Derek H. Burney |
| À | 1005 |
 |
Le président |
 |
M. Jocelyn Coulon |
 |
Le président |
 |
M. Derek H. Burney |
 |
Le président |
 |
M. Derek H. Burney |
| À | 1010 |
 |
Le président |
 |
Mme Alexa McDonough |
| À | 1015 |
 |
M. Derek H. Burney |
 |
Mme Alexa McDonough |
 |
M. Derek H. Burney |
 |
Mme Alexa McDonough |
 |
M. Derek H. Burney |
 |
Mme Alexa McDonough |
 |
M. Derek H. Burney |
 |
Mme Alexa McDonough |
 |
M. Derek H. Burney |
 |
Mme Alexa McDonough |
 |
M. Derek H. Burney |
 |
Le président |
 |
M. Derek H. Burney |
 |
Le président |
 |
M. Derek H. Burney |
 |
Le président |
 |
M. Jocelyn Coulon |
 |
Le président |
| À | 1020 |
 |
L'hon. Lawrence MacAulay (Cardigan, Lib.) |
 |
M. Derek H. Burney |
 |
L'hon. Lawrence MacAulay |
 |
M. Derek H. Burney |
| À | 1025 |
 |
L'hon. Lawrence MacAulay |
 |
M. Derek H. Burney |
 |
L'hon. Lawrence MacAulay |
 |
M. Derek H. Burney |
 |
Le président |
 |
M. Jocelyn Coulon |
| À | 1030 |
| À | 1035 |
 |
Le président |
 |
M. Jocelyn Coulon |
 |
Le président |
 |
M. Derek H. Burney |
| À | 1040 |
 |
Le président |
 |
M. Maurizio Bevilacqua (Vaughan, Lib.) |
 |
M. Derek H. Burney |
 |
L'hon. Maurizio Bevilacqua |
 |
M. Derek H. Burney |
| À | 1045 |
 |
L'hon. Maurizio Bevilacqua |
 |
M. Derek H. Burney |
 |
L'hon. Maurizio Bevilacqua |
 |
M. Derek H. Burney |
 |
Le président |
 |
Mme Alexa McDonough |
| À | 1050 |
 |
M. Jocelyn Coulon |
 |
Mme Alexa McDonough |
 |
M. Jocelyn Coulon |
 |
Mme Alexa McDonough |
 |
M. Jocelyn Coulon |
 |
Le président |
 |
M. Derek H. Burney |
| À | 1055 |
 |
Mme Alexa McDonough |
 |
M. Derek H. Burney |
 |
Le président |
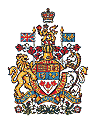
CANADA
Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international |
|
l |
|
l |
|
TÉMOIGNAGES
Le jeudi 12 mai 2005
[Enregistrement électronique]
* * *
¿  (0905)
(0905)
[Français]

Le président (M. Bernard Patry (Pierrefonds—Dollard, Lib.)): Bonjour.
Avec votre permission, nous allons débuter cette séance.
[Traduction]
Ce matin, à l'ordre du jour, nous avons l'examen de la politique internationale. Comme témoins nous avons de l'Université Carleton, M. Derek H. Burney, qui est professeur auxiliaire et chargé de cours distingué principal de la Norman Paterson School of International Affairs,
[Français]
et aussi, de l'Université de Montréal, M. Jocelyn Coulon, professeur invité au Centre d'études et de recherches internationales, le CÉRIUM.
Bienvenue à vous deux.
[Traduction]
Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous ce matin.
Je dois m'excuser de ne pas avoir à cette réunion le parti de l'opposition officielle, les conservateurs, ainsi que le Bloc québécois. Il semble que pour eux la chose la plus importante soit la politique, de la mesquinerie politique, plutôt que la politique réelle, parce que la politique réelle consiste à faire ce pourquoi vous avez été élu, c'est-à-dire entendre des témoins ici.
Vous êtes très bienvenus.
Nous allons commencer par vous, professeur Burney, allez-y.


M. Derek H. Burney (professeur auxiliaire et chargé de cours distingué principal, The Norman Paterson School of International Affairs, Université Carleton): Merci beaucoup, monsieur le président. Comme diraient les Chinois, nous vivons une époque intéressante.
Tout d'abord, je voudrais dire que je suis ravi de me retrouver devant ce comité. Je pense que cela fait au moins 16 ans, je crois, que je me suis présenté à ce comité, mais c'est agréable d'y revenir.
Je dois dire, dès l'abord, que je n'aime pas particulièrement les examens de politique. Selon moi, les gouvernements devraient formuler, mener et conduire la politique étrangère et ce qu'ils font est plus important que ce qu'ils disent, car les mots sont une chose, mais les actions en sont une autre. Comme je l'ai dit dans un exposé que j'ai présenté en début d'année, l'exposé Simon Reisman, aucun pays n'a fait d'examen, n'a réfléchi et n'a consulté à propos de sa politique étrangère plus souvent et plus ouvertement que le Canada. Ceci en soi devrait être un message de mise en garde pour quiconque songerait à une démarche prescriptive. Ce que cela suggère réellement, cependant, est qu'il existe au Canada un doute de soi sous-jacent à propos de notre rôle et de notre position dans le monde, ainsi qu'un manque de leadership pour ce qui est de la formulation et de la mise en oeuvre de politiques et de programmes qui servent réellement les intérêts canadiens et reflètent les capacités canadiennes.
Monsieur le président, je pense qu'il existe également une certaine hésitation en ce qui concerne la façon de mieux gérer ce qui est manifestement notre relation la plus vitale. C'est ce que j'appelle « l'énigme de la politique étrangère » au Canada : comment réconcilier le besoin, d'un côté, d'un engagement constructif en ce qui concerne la sécurité, le commerce, l'environnement et d'autres questions, lorsque la plupart de nos intérêts extérieurs sont en jeu, avec le désir, de l'autre côté, d'être une entité différente, moins indépendante, plus distincte en Amérique du Nord. Cela crée une certaine obsession vis-à-vis du langage, une certaine confusion, particulièrement avec des termes comme souveraineté, indépendance, valeurs—des termes qui peuvent être narcissiques, voire naïfs, dans ce monde interdépendant d'aujourd'hui. C'est ce qui fait la différence entre un acteur sérieux et un dilettante.
J'ai travaillé dans le ministère qui s'appelle à l'heure actuelle les Affaires étrangères pendant plus de 30 ans et j'ai constaté diverses approches avec des résultats aussi variés. Mon point de vue, tel qu'il est, est une réflexion de cette expérience : 15 ans au ministère, 15 ans à l'extérieur du Canada, tout particulièrement en Asie et aux États-Unis. Je crois que les objectifs de politique étrangère du Canada devraient être clairs. Nous cherchons un Canada plus prospère, plus sûr, dans un monde stable et plus humain. Dans mon exposé Simon Reisman, j'ai souligné le besoin de davantage de cohérence et de moins de prétention en ce qui concerne la politique, les instruments et les ressources qui y sont affectés. Je n'élaborerai pas, mais je serai heureux de répondre à vos questions.
En réalité, le monde ne s'arrête pas de tourner pour attendre le résultat du dernier examen de conscience du Canada. Les questions et les événements évoluent, exigeant des actions ou des réactions. Les Canadiens en voyage ont besoin d'assistance. Les exportateurs canadiens veulent avoir des conseils, ainsi qu'un meilleur accès et un accès plus sûr pour leurs produits. On n'est pas en pénurie de défis en ce qui concerne le maintien de la paix ni la sécurité et nous avons certainement de plus en plus besoin de planification, d'idées et de ressources pour soulager la pauvreté et la maladie dans les pays en voie de développement.
Néanmoins la complaisance envers les États-Unis ne devrait pas exister. Je crois, fondamentalement, que nous pouvons faire les deux à la fois sur la scène mondiale, c'est-à-dire, que nous pouvons trouver un moyen d'améliorer nos relations avec les États-Unis, tout en contribuant de manière plus tangible à la stabilité et à la prospérité internationales. Ce ne sont pas des objectifs incompatibles, mais il faut que nos bases soient les bonnes.
Je crois que le Service extérieur constitue une carrière professionnelle et une source de fierté pour les Canadiens. Ce peut être un aimant, attirant les bonnes personnes au fonctionnariat et il ne devrait pas être utilisé sans discernement pour servir d'autres buts. Monsieur le président, ceci est également un message.
Ceci dit, avec tout le respect que je dois aux auteurs du récent énoncé de politique internationale, tant les auteurs canadiens que des auteurs internationaux, je déclare dans mon bref examen, que le comité devrait avoir reçu, que cet énoncé, récemment publié, offre un mélange sensé, bien qu'un peu impalpable, de réalisme et d'idéalisme pour la politique étrangère canadienne.
La force de cet énoncé est un appel tardif mais bienvenu à plus de concentration et plus d'engagement, particulièrement envers une assistance officielle au développement, envers la modernisation des Forces armées canadiennes qui ont été longtemps négligées et envers la sécurité nord-américaine, y compris le renouvellement du NORAD. Sa faiblesse est cette hésitation permanente de reconnaître le besoin d'une approche intégrée et exhaustive à la gestion de notre relation la plus vitale, relation qui exige d'être réparée, avant que nous puissions même penser à une revitalisation quelconque.
Les menaces extérieures les plus sérieuses au bien-être du Canada, monsieur le président, sont les sentiments de protectionnisme de plus en plus violents du Congrès des États-Unis et les retombées possiblement négatives à notre frontière, d'un manquement à la sécurité ou d'une nouvelle attaque terroriste. Les orientations proposées dans cet énoncé offrent un ordre du jour au coup par coup, de type travailleur, pour les fonctionnaires, reflétant les derniers communiqués de presse, mais elles ne font passer ni un appétit, ni une conviction envers un engagement politique de haut niveau.
¿ 
 (0910)
(0910)
Un leadership véritable et efficace demande l'expression des priorités avec confiance et clarté, sur la manière dont nous allons gérer nos relations avec les États-Unis. Fondamentalement, pour le Canada, il s'agit d'un choix entre s'engager ou rester sans importance, entre s'attaquer aux questions de fonds essentielles à notre bien-être ou danser à la surface des choses et entre prendre la tête pour faire avancer nos intérêts à long terme ou suivre les caprices à court terme de l'opinion publique.
Parler d'une intégration plus importante ou d'une cohérence plus grande est contradictoire avec la fragmentation plus évidente des instruments de prestation de la politique étrangère, que ce soit par les décisions inutiles de séparer les ministères autrefois intégrés des Affaires étrangères et du Commerce international ou que ce soit en sous-traitant les vestiges de politiques étrangères aux provinces. Et ajouter plus de ressources à nos consulats aux États-Unis ne fera pas grand-chose si la substance même de nos relations est faussée par des décisions inexplicables concernant les politiques de base prises à Ottawa.
Cela me mène à une stratégie ou à une série de remèdes—que je vous donnerais bien volontiers—en ce qui concerne ce que j'aimerais bien voir en termes de relations avec les États-Unis. Tout d'abord, nous devrions rapidement renégocier le NORAD et rétablir un palier de confiance et de respect pour la défense de notre continent et pour une meilleure approche afin de contrer le terrorisme. Si quiconque hésitait à croire que c'est la préoccupation principale à Washington, les événements d'hier dans cette même ville prouvent que c'est bien le cas.
Nous avons besoin de plus de dialogue, pas de moins de dialogue. Nous avons besoin d'un engagement plus systématique au plus haut niveau, plus de discipline, et moins de réactions réflexes anti-américaines. Lorsque Lee Hamilton, dans le Global and Mail d'aujourd'hui, dit qu'il s'agit d'une situation grave pour les deux gouvernements, permettez-moi d'insister que c'est un message que l'on devrait prendre sérieusement. C'est un membre du Congrès américain raisonnant, un ancien combattant qui n'a pas tendance à exprimer ses préoccupations légèrement.
Nous avons besoin de nouveaux engagements et de nouveaux investissements, qui utilisent des technologies novatrices pour mieux sécuriser nos frontières et éviter les congestions. L'Ontario perd 10 milliards de dollars par année à cause des congestions aux frontières. L'État de New York perd pratiquement le même montant d'argent. Les deux gouvernements doivent trouver une solution à cette situation, avec plus que des comités et plus que des communiqués de presse.
Le secteur de l'énergie, monsieur le président, réclame à grands cris un haut niveau d'attention et de direction et c'est une force canadienne en Amérique du Nord.
En ce qui concerne le commerce, nous pouvons rechercher des normes communes et harmonisées, pour soulager la paperasserie et les procédures inefficaces qui retardent les expéditions et causent des congestions inutiles à la frontière. Nous pourrions également négocier des tarifs douaniers extérieurs communs, pour réduire, ou éliminer, les obstacles découlant de la règle d'origine à la fabrication, dans ce qui est désormais un marché nord-américain de plus en plus intégré.
En ce qui concerne l'environnement, dans l'esprit de Kyoto, nous pourrions négocier de véritables réductions des émissions de gaz à effet de serre ici en Amérique du Nord, élaborant des normes communes et des engagements communs. Ce serait mieux pour notre environnement, ainsi que pour notre économie.
Aucune de ces mesures ne compromettrait notre souveraineté. Elles renforceraient au contraire notre capacité à relever les défis de la mondialisation et les pressions émanant de nos concurrents, tout particulièrement ceux qui ont des convictions fortes et des capacités en développement. Ceci, monsieur le président, devrait être la priorité pour tout chef canadien.
Nous aurons d'énormes défis à relever au cours de la prochaine décennie. Nous nous sommes reposés pendant des décennies sur la richesse de nos ressources et l'oxygène économique de nos relations avec notre voisin du sud tout puissant. Mais la vie facile chez-nous et l'attitude détachée et extrêmement sentimentale vis-à-vis de notre place dans le monde ne nous préparent pas pour les complexités de la mondialisation ou pour la concurrence émanant de ceux qui ont des convictions et des capacités plus fortes. Il est possible que nous soyons au seuil de l'âge d'or, comme le dit l'énoncé, en ce qui concerne nos ressources, mais le climat en ce qui concerne les exploitations manufacturières concurrentielles au Canada se détériore par rapport à une monnaie revalorisée, des taux de productivité qui traînent la patte et des niveaux d'investissement qui ne cessent de décliner.
Nos exportations vers la Chine, vers le Japon et vers les puissances qui émergent, ne correspondent pas à celles de nos concurrents naturels, notamment l'Australie. Les estimations optimistes en ce qui concerne les possibilités de relations commerciales avec ces pays, masquent le peu de résultats que nous avons obtenus jusqu'à présent dans des négociations prolongées mais non conclues avec des pays plus petits. Si nous voulons garder le rythme, nous avons besoin d'avoir le courage de nos convictions—qui est le coeur même du leadership—et des remèdes concrets pour agir et contrer la saveur désastreuse de la plupart de l'analyse qui se trouve dans l'énoncé de principe de politiques internationales.
Bien sûr, la politique étrangère canadienne ne se réduit pas à la manière dont nous gérons notre relation bilatérale la plus importante, mais elle n'est pas équivalente à zéro. Si nous ne sommes pas prêts à confronter de façon systématique et avec fermeté ceux avec qui nos enjeux sont les plus importants, il est encore moins probable, selon moi, que nos aspirations mondiales stimulent un écho quelconque.
¿ 
 (0915)
(0915)
Merci.


Le président: Merci, monsieur Burney.
Je voudrais signaler à mes collègues que M. Burney a été ambassadeur du Canada aux États-Unis de 1989 à 1993.
[Français]
Monsieur Coulon, vous pouvez faire votre communication, s'il vous plaît.


M. Jocelyn Coulon (professeur invité, Centre d'études et de recherches internationales (CÉRIUM), Université de Montréal): Monsieur le président, je vous remercie de m'avoir invité à venir m'exprimer devant votre comité.
[Traduction]
Je vais parler français.
[Français]
Évidemment, je n'ai pas l'expérience de Derek Burney, que ce soit à l'intérieur du ministère des Affaires étrangères ou dans les postes qu'il a occupés à l'étranger pendant plusieurs décennies. M. Burney a une expérience profonde et, en fin de compte, très présente des affaires étrangères. Ce que je voudrais transmettre comme message ce matin est plutôt une impression générale sur la politique et sur l'Énoncé de politique internationale du Canada, en faisant une comparaison avec celui de 1995, puisque lorsque nous portons un jugement sur un énoncé semblable, c'est que nous avons aussi en tête l'énoncé précédent. C'est à partir de ces deux documents qu'on est en mesure de voir et de constater s'il y a eu des progrès et si les énoncés se ressemblent ou s'ils vont plutôt vont dans d'autres directions.
Mon premier sentiment est que le premier ministre et son gouvernement ont réussi ce test qu'est la rédaction d'un énoncé de politique étrangère. Ce n'est pas un travail facile: voyez le nombre de pages que contiennent les différents aspects de cet énoncé, le travail immense qui a été mis dans la rédaction, mais aussi dans l'analyse des questions soulevées dans cet énoncé de politique étrangère.
Bien entendu, le texte va soulever des commentaires et certainement des oppositions, en particulier de la part de ceux qu'on appelle les nationalistes canadiens, qui qu'ils soient.
En accouchant d'une politique étrangère réaliste, Paul Martin ramène le Canada à sa véritable place dans le monde et reconnaît les limites de son influence. On peut dire que depuis la grande époque de Lester B. Pearson, dans les années 1950 et 1960, le Canada a toujours voulu offrir beaucoup au monde entier — beaucoup trop sans doute pour ses modestes moyens. Au fur et à mesure que le poids du Canada déclinait sur la scène internationale, ses objectifs en matière de politique étrangère, de défense et d'aide au développement devenaient prétentieux, vains et, finalement, risibles.
Ainsi, jamais les grandes promesses sur les capacités d'intervention militaire à l'étranger contenues dans le Livre blanc sur la défense de 1994 ne purent tenir la route, ne fût-ce que quelques semaines après la publication de ce document.
En 1995, le gouvernement libéral rendait public son énoncé sur la politique étrangère. C'était le premier de ce gouvernement. Le ton — peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent — était carrément moralisateur et volontariste: le Canada serait de tous les combats, défendant la veuve et l'orphelin, rappelant aux grands leurs responsabilités, fixant des objectifs et des quotas à atteindre. On avait même droit au couplet célèbre mais combien éculé du Canada, puissance non coloniale, champion du multilatéralisme constructif et médiateur efficace. L'histoire a un peu modulé cette vision idyllique de notre présence dans le monde.
Le nouvel Énoncé de politique étrangère a une tout autre facture, tant sur la forme que sur le fond. Il nous épargne les envolées larmoyantes sur notre caractère indispensable pour s'arrêter à ce que le Canada peut réellement accomplir sur la scène internationale. Il a le mérite d'énoncer clairement les choses et d'établir une adéquation entre la rhétorique et les moyens. Le gouvernement canadien ne promet rien qu'il ne peut livrer avec un minimum d'assurance. Certains seront sans doute déçus par le caractère modeste de ses ambitions, mais il est préférable de jouer pianissimo que de sombrer une nouvelle fois dans le ridicule.
À l'évidence, le premier ministre tenait à ce que le nouvel énoncé soit, de la part de son gouvernement, une oeuvre collective et substantielle; elle l'est. Paul Martin et quatre de ses ministres — Affaires étrangères, Coopération internationale, Défense nationale, Commerce international — signent le document. Si chacun a voulu laisser sa marque, tous vont dans la même direction et dans cet ordre: sécurité et multilatéralisme.
¿ 
 (0920)
(0920)
Cette hiérarchie des priorités éclaire les véritables intérêts du Canada. Le 11 septembre a changé la donne internationale, et cela est d'autant plus vrai pour le Canada que son voisin, les États-Unis, a fait de la sécurité l'alpha et l'oméga de sa politique étrangère. Le Canada n'a donc pas le choix de suivre le courant, mais il le fait à sa manière.
Pour Ottawa, la sécurité n'est pas seulement affaire de lutte au terrorisme. Il s'agit aussi d'édifier un monde où la protection des individus, la non-prolifération des armes de destruction massive, le respect des droits humains, les outils offerts aux pays en développement et la responsabilisation des humains de toute la planète devant les menaces environnementales sont au coeur de notre vouloir vivre ensemble et de notre épanouissement. Voilà la partie idéaliste et certainement wilsonnienne de cet énoncé. Nous aurions tort de croire qu'il s'agit encore ici d'un effet de rhétorique.
Le premier ministre y met les moyens. Sa première priorité porte, avec justesse, sur les relations avec les États-Unis. Tant du point de vue sécuritaire que militaire et commercial, cette relation sera renforcée et approfondie grâce à l'augmentation du budget de la défense, au renforcement de la coopération pour assurer la sécurité des frontières et du continent, et à la simplification des procédures pour assurer une plus grande fluidité des échanges humains et commerciaux.
Les nationalistes canadiens seront sans doute irrités; à tort, je crois. Le Canada a tout à gagner à retisser les liens avec nos voisins du Sud. En fait, historiquement, lorsqu'on regarde et qu'on analyse notre relation avec les États-Unis, nous avons toujours gagné à l'approfondissement des liens économiques et politiques avec les États-Unis.
Aussi importante soit-elle, la relation avec les États-Unis ne peut à elle seule assurer l'influence du Canada dans le monde. Le premier ministre l'a bien compris, et sa deuxième priorité est d'être à l'écoute du monde. Il a ainsi saisi que ce n'est pas en lançant mille initiatives que le Canada comptera vraiment sur la scène internationale. Certes, l'aide au développement sera augmentée, mais elle sera dorénavant consacrée à 25 pays. À mon avis, ce n'est pas ce qui est le plus important. La grande ambition du premier ministre est de fonder le multilatéralisme sur des bases nouvelles. Les organisations internationales actuelles doivent retrouver un nouveau souffle et se montrer sensibles, tant à la sécurité qu'à la prospérité des peuples comme des États.
Le Canada a toujours été bien servi par le multilatéralisme et compte encore sur le système des organisations internationales pour rendre plus humaines et plus justes ses relations internationales. D'où, entre autres, la proposition du premier ministre de créer un regroupement de 20 pays, en développement ou développés, dont la mission serait de discuter des questions les plus urgentes, une tâche que se sont appropriée les membres du G8, un forum puissant, certes, mais combien exclusif et confiné aux puissances occidentales seulement.
Lorsque j'ai lu ce document, lorsque j'en ai terminé l'analyse, je me suis dit que le gouvernement venait de se donner une bonne carte routière pour permettre au Canada de faire sa juste part dans le monde. Il lui faudra maintenant prendre les commandes, et cela l'obligera parfois à affronter ses amis dont certains, les États-Unis en tête, lui mettront des bâtons dans les roues.
J'espère que, pour cette fois-ci, l'Énoncé de politique étrangère tiendra la route et sera, au jour le jour, par ce gouvernement ou par n'importe quel autre gouvernement, appliqué, car c'est vraiment une politique intéressante pour le Canada.
Merci.
¿ 
 (0925)
(0925)


Le président: Merci beaucoup, monsieur Coulon.
Nous allons maintenant passer
[Traduction]
aux questions et réponses. Je vais commencer avec Mme McDonough; allez-y.


Mme Alexa McDonough (Halifax, NPD): Merci beaucoup, monsieur le président, et merci à nos deux témoins d'être venus. J'espère que vous n'avez pas l'impression que votre temps n'est pas utilisé à bon escient, parce que deux partis politiques ne sont pas représentés. Nous pensions que nous avions été envoyés à Ottawa pour faire notre travail, ainsi, c'est ce que certains d'entre nous continuent de faire.
J'ai écouté attentivement, particulièrement l'exposé de M. Burney, mais également jusqu'à un certain point l'exposé de M. Coulon, et je dois dire que je ne me sens vraiment pas à l'aise devant la description des aspirations qui sont souvent formulées, pas uniquement par les exposés de principe du gouvernement, mais aussi, je crois, par les observations émanant encore et encore de la part des Canadiens. Vous qualifiez ces aspirations, en quelque sorte, de prétentieuses et vaines. Je veux en parler un petit peu, parce qu'il me semble que nous avons formulé et reformulé à plusieurs reprises des objectifs en matière de politique, puis le gouvernement n'a pas réussi à faire ce qui serait nécessaire pour atteindre concrètement ces objectifs en matière de politique.
Je pourrais donner quelques exemples. Je ne veux pas parler en général.
Nous avons signé l'accord de Kyoto, contrairement à nos voisins américains. Nous avons dit que nous allions réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 p. 100 aujourd'hui, et elles ont augmenté de 20 p. 100. Nous n'avons toujours pas de programme efficace pour cet accord de Kyoto.
En ce qui concerne l'aide publique au développement, le Canada a été le porte-étendard défendant le 0,7 p. 100 d'APD. Est-ce que vous trouvez que c'est vain et prétentieux pour le Canada de déclarer une telle chose? Il me semble que le problème, c'est qu'après cela nous n'élaborons pas de plan de mise en oeuvre et nous ne prenons pas les mesures concrètes.
Cela ne signifie pas que nos objectifs, que ce soit pour Kyoto ou pour l'APD, ne peuvent être atteints, parce que d'autres pays, en fait, les ont formulés et ont pris des mesures. Alors je me demande si le problème n'est peut-être pas celui que vous avez formulé, mais ne réside pas plutôt dans le fait que le gouvernement ne cesse de formuler des objectifs en matière de politique, pour lesquels il ne prend aucune mesure concrète.
Je vais donner un troisième exemple précis, peut-être parce qu'il est plus utile de parler concrètement. Je représente la ville d'Halifax, je suis très fière de représenter la ville d'Halifax. Il y a à peu près un an, il s'y est tenu le plus grand rassemblement préélectoral de relations publiques très bien orchestré à propos du nouvel engagement du Canada pour renforcer la sécurité dans nos ports. C'était dégoûtant et c'est le mot qui convient. C'était tellement évident qu'il s'agissait de relations publiques, une annonce en grande fanfare sur le fait que le Canada allait améliorer la sécurité portuaire, le besoin qu'on avait de cela et l'engagement qu'on allait prendre.
En fait, je suis persuadée qu'il est extrêmement important que nous améliorions la sécurité dans nos ports. Au bout du compte, de la première distribution de 115 millions de dollars pour la sécurité portuaire, Halifax, qui est le troisième port du Canada, a obtenu 220 000 $. On leur a refusé tout argent pour des mesures qu'ils avaient déjà prises, afin d'être responsables, dépendant en cela des montants assez conséquents, y compris un patrouilleur équipé d'appareils techniques très sophistiqués. Ils étaient là pour dire : « Nous avons besoin de faire cela et nous le faisons. »
Ce que j'essaie de savoir de votre part, c'est si vous avez l'impression que le problème vient du fait que le Canada énonce des objectifs prétentieux et non réalistes, ou si vous avez l'impression que le problème réel, c'est le fait que le gouvernement ne prend pas de mesures concrètes pour faire ce qu'il dit.
¿ 
 (0930)
(0930)
[Français]


M. Jocelyn Coulon: Madame la députée, je ne suis pas en mesure de répondre à tous les aspects de votre question, en particulier à la question spécifique à Halifax, qu'il s'agisse de son aéroport ou de son port.
Lorsque nous disons que le gouvernement publie des énoncés de politique prétentieux et vains, cela a d'abord trait au langage utilisé pour décrire non seulement la position du Canada dans le monde, mais son positionnement dans ce monde, la façon dont le monde devrait fonctionner selon le Canada.
Vous connaissez l'expression: « si le monde avait plus de Canadas, le monde irait mieux ». Évidemment, le monde n'est pas fait comme cela. Le Canada est un jeune pays face à un monde qui a une très grande histoire, qui a ses propres codes et son propre développement social, politique et économique.
Par conséquent, dans les énoncés, en particulier dans celui de 1995 et un tout petit peu dans celui de cette année, il y a ce caractère un peu prétentieux d'un Canada qui se perçoit pratiquement la source du bien. Est-ce à dire que le reste est le mal? C'est une autre question.
Donc, il est prétentieux dans cet aspect déclaratoire; vain dans cette idée d'adopter continuellement, en particulier dans l'énoncé de 1995, des quotas, des repères, des paramètres. On se fixe, par exemple, l'objectif de 0,7 p. 100 du PIB dans l'aide au développement, que l'on n'atteint jamais. Pourquoi alors cette insistance sur ces quotas, sur ces chiffres à atteindre, sur ces objectifs qui, à mon avis, sont illusoires et ne répondent pas nécessairement à ce que nous pouvons et devons faire sur la scène internationale?
Nous avons des moyens relatifs à l'aide au développement. Peut-être devraient-ils toujours être améliorés. Pourquoi se fixer ce genre d'objectifs, que nous ne pouvons pas réaliser?
Je trouve que, dans l'énoncé de 2005, on a laissé tomber, justement, ces quotas, ces objectifs, ces paramètres, pour éviter d'être ensuite accusés de ne pas les respecter. Cela me semble la prudence même.
C'est la réponse que je peux vous offrir.
¿ 
 (0935)
(0935)


Le président: Monsieur Burney.
[Traduction]


M. Derek H. Burney: Je souscris certainement à ce que vient de dire M. Coulon, en ce sens qu'à mon avis, l'énoncé de politique internationale est plus réaliste que ce à quoi s'attendaient beaucoup de gens, ce qui explique peut-être pourquoi il a fallu l'attendre si longtemps. Mais vous me semblez abonder dans le même sens que moi.
À mon avis, nous nous sommes soit fixé des objectifs ou des normes théoriques pour nos actions dans le monde, objectifs et normes que nous n'avons pas réussis à atteindre. Le résultat, c'est qu'on nous a considérés comme... je n'aime pas utiliser ce genre de terme, mais les autres le font à notre sujet. Je préfère parler, pour ma part, de narcissisme. Nous nous regardons dans le miroir et nous avons l'impression que le Canada est beaucoup plus important qu'il ne l'est.
Les paroles s'envolent mais les actions restent. Ce que l'on remarque, ce sont les actions, et si nous ne concrétisons pas nos belles paroles, cela ne passe pas inaperçu et nous donne une réputation de dilettante; on ne nous prend donc plus au sérieux dans le reste du monde, et je pourrais vous en parler en citant des sources sûres.
Nous parlons du multilatéralisme comme si c'était une fin en soit, et c'est faux. Il n'y a aucune gloire à assister à une réunion multilatérale si elle n'aboutit à rien; mais au Canada, chaque réunion à laquelle nous assistons est considérée comme une réussite. Comme les autres le savent bien, participation n'égale pas réalisation.
Je pourrais reprendre chacun de vos commentaires... pourquoi hésitons-nous à ce point à nous engager à faire passer notre APD à 0,7 p. 100? Pourtant, nous augmentons notre aide et nous nous sommes fixé comme objectif 2015. Il faut comprendre que les Européens n'hésitent jamais à faire des prédictions ni à se fixer des objectifs, même s'ils n'ont aucunement l'intention de les atteindre. Mais eux jouent à un jeu tout à fait différent et font preuve d'un autre type de narcissisme. Et je ne comprends pas pourquoi un gouvernement qui nage à ce point dans l'argent de mes impôts hésite à s'engager à faire grimper son aide à 0,7 p. 100 d'ici 2015, ce qui correspondrait tout à fait à la politique du Canada. Je ne comprends pas que le gouvernement hésite à le faire.
Vous avez mentionné Kyoto, et je vous ai répondu là-dessus. À mon avis, le Canada a fait preuve de naïveté lors des négociations de Kyoto. Les Américains n'ont pas signé le protocole, et tous croient que c'est parce que George Bush l'avait décidé. George Bush n'a rien décidé : c'est le Sénat américain qui a rejeté à 98 voix contre deux le traité de Kyoto. Vous demandez-vous pourquoi? C'est parce que les engagements imposés au Canada étaient beaucoup plus stricts que ceux qui étaient imposés à tous les autres pays européens mis ensemble.
Si nous étions le moindrement futés, au lieu de vouloir paraître nobles et d'afficher nos bonnes intentions... nos intentions sont toujours pures et nous adhérons à toutes les ententes internationales si elles nous semblent nobles. C'est quand vient le temps d'agir que le bât blesse. Vous l'avez dit vous-même : il aurait mieux valu, à mon avis, que le Canada mette au défi les Américains de s'engager ici même en Amérique du Nord à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cela aurait bien mieux valu pour le reste du monde et pour nous.
Rappelez-vous : c'est ce que nous avons fait dans le dossier de la pluie acide. Nous avons négocié avec les Américains là-dessus pendant une décennie et avons organisé pourparlers sur pourparlers sans agir de quelque façon. Puis, nous avons fini par les mettre au défi en envoyant des émissaires spéciaux et nous leur avons dit que s'ils étaient prêts à s'engager à réduire les émissions d'oxydes de soufre et d'azotes de 50 p. 100, nous leur emboîterions le pas. Il nous a fallu déployer énormément d'efforts auprès de l'administration américaine et auprès du Sénat américain, qui mettaient sérieusement en doute nos motifs.
Washington ne nous considère pas comme des boy-scouts. Nous nous percevons peut-être nous-mêmes comme tels devant le reste du monde, mais dans d'autres pays, on considère que nous servons nos propres intérêts. Et les Américains étaient inquiets devant la possibilité que nous songions à protéger notre accès à leur marché en proposant une telle réduction des pluies acides. Mais je ne digresserai pas.
Ce que je demande simplement c'est si ces pratiques sont réalisables. Quand un pays fait des choses pratiques et réalisables, le reste du monde le reconnaît et le prend au sérieux. Un des objectifs de longue main du gouvernement canadien, ce ne fut pas le multilatéralisme comme fin en soit, mais ce fut de maintenir les États-Unis dans le multilatéralisme, que l'on songe au système de sécurité, au commerce international ou dans les Nations Unies, car faute de multilatéralisme, on choisit l'unilatéralisme et l'isolationnisme.
Sachez que si les Américains ne s'engagent pas à fond dans la voie du multilatéralisme, tous les efforts déployés par le Canada dans le cadre de réunions et d'associations auront été en vain. Nous pouvons exercer une certaine influence en aidant à garder les Américains au sein de l'OMC, de l'OTAN et des organisations qui sont essentielles pour notre sécurité et notre prospérité.
Or, si nous perdons de vue cet objectif, nous nous retrouvons encore une fois devant le miroir. La pire critique que puisse formuler un diplomate étranger à l'égard du Canada, c'est de nous étiqueter comme étant naïf. Or, on nous accuse de naïveté beaucoup trop souvent, ce qui me déplaît.
Mais je ne monterai pas aux barricades.
Des voix: Oh, oh!
¿ 
 (0940)
(0940)


Le président: Merci, monsieur Burney.


Mme Alexa McDonough: Je voudrais revenir à cela.


Le président: Vous en aurez l'occasion, j'en suis sûr.
Nous allons passer à M. Eyking, s'il vous plaît.


L'hon. Mark Eyking (Sydney—Victoria, Lib.): Merci, monsieur le président, et je voudrais remercier les témoins d'être venus.
Mes questions s'adressent pour la plupart à M. Burney.
Il y a, dans vos commentaires, beaucoup de pessimisme par rapport à la façon dont nous gérons nos relations internationales, mais si c'est la façon dont vous voyez les choses, j'imagine qu'il vaut aussi bien appeler un chat un chat.
Je ne vais pas faire un long préambule. Je vais poser trois questions.
L'une concerne les nouveaux marchés. Je sais que vous vous intéressez beaucoup à notre commerce avec les États-Unis et, je suis d'accord, c'est quelque chose d'important, voire de très important. Au ministère du Commerce international, nous considérons également le fait d'essayer d'éparpiller nos risques, je suppose, et de considérer les nouveaux marchés.
Ma première question est la suivante : comment devrions-nous faire les choses? Est-ce que nous devrions faire les choses différemment des États-Unis? Devrions-nous prendre une approche différente? C'est difficile pour nos sociétés de s'engager dans ces domaines, à cause du fait que nous sommes extrêmement près de la frontière américaine.
La deuxième chose, concerne notre examen de la politique internationale et l'idée d'avoir séparé le commerce, pour que ce soit un ministère qui se concentre sur son propre travail. D'autres pays font cela en ce moment, manifestement, pour faire en sorte que le ministère soit plus réactif, plus rapide, plus concentré. Donc, j'aimerais entendre votre opinion là-dessus.
J'ai une troisième question. J'ai lu l'article de Lee Hamilton et j'ai entendu votre exposé, et il y a beaucoup de plaintes sur la façon dont nous avons géré notre affaire avec les États-Unis. De quelle autre façon devrions-nous gérer nos litiges concernant le boeuf et le bois d'oeuvre? Nous avons fait tout ce que nous pouvons, je suppose, à part aller aux États-Unis, leur rendre visite et s'impliquer davantage. Mais devrions-nous exercer un petit peu plus de pression? Devrions-nous utiliser la réglementation de l'OMC?
Quels seraient les risques pour nous, si nous décidions de jouer les durs?


M. Derek H. Burney: À propos des marchés émergents, je pense que c'est une erreur de croire que les petits voyages éclairs d'Équipe Canada sont la bonne formule. On entasse tout un groupe d'hommes d'affaires avec tout un groupe de ministres et de hauts fonctionnaires, tout ce monde débarque dans un pays pendant trois jours, remue beaucoup d'air, signe un paquet de contrats et s'en va. Désolé, ce n'est pas suffisant.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Dans un marché comme la Chine, ces missions ont un effet modeste. Mais il faut qu'il y ait un suivi. Prenez s'il vous plaît l'exemple de l'Australie. Ses exportations vers la Chine ont augmenté de plus de 50 p. 100 au cours des trois dernières années, alors que les nôtres n'ont augmenté que de 17 p. 100. Les Australiens sont notre concurrent naturel, ils vendent les mêmes produits que nous à la Chine. Où est la différence? C'est qu'ils ont une stratégie globale vis-à-vis la Chine. Il ne s'agit pas simplement de commerce, il y a d'autres éléments aussi. Ils attirent des étudiants chinois vers les universités australiennes et ils leur donnent l'occasion de rester en Australie par la suite s'ils le souhaitent.
Dans une certaine mesure, c'est un effort collectif. Mais curieusement, il n'est absolument pas question du ministère des Finances dans l'énoncé de politique internationale, alors que c'est ce ministère qui contrôle nos contributions aux institutions financières multilatérales. Le ministère des Finances a un rôle crucial dans l'élaboration de notre aide publique au développement, et pourtant il n'en est absolument pas question dans ce document. Enfin, c'est un aparté.
Ce que je dis, c'est qu'il faut avoir une stratégie globale face à un pays comme la Chine. On ne peut pas atteindre ses objectifs simplement avec de petits voyages éclairs à vocation commerciale; ce n'est pas suffisant. Les Australiens essaient de négocier un accord de libre-échange avec la Chine. Que faisons-nous de notre côté? Nous ne négocions pas; nous n'avons pas avec les Chinois un dialogue qui leur montrerait que nous sommes conscients de leur potentiel. Je crois personnellement que la Chine présente à la fois le plus grand potentiel et le plus grand risque pour les décennies à venir.
Il nous faut une stratégie sélective et complète pour ces marchés émergents. Nous ne pouvons pas nous contenter de penser qu'ils vont se tourner vers nous simplement parce que nous avons les ressources dont ils ont besoin. Nous devons aller plus loin.
Il faudrait évidemment faire certaines choses en partenariat avec les États-Unis, compte tenu de l'ALENA, mais cela ne signifie pas que nous devons agir exclusivement avec les États-Unis. Nous devrions avoir des initiatives ciblées sur la Chine, le Brésil et d'autres pays.
Les Australiens ne laissent pas leurs États partirent vaille que vaille en Chine en fonction de leur humeur. Toutes les visites australiennes en Chine sont organisées dans l'optique de ce qu'ils appellent « une stratégie homogène du pays », une stratégie à un seul axe. Nous faisons le contraire. Si les provinces veulent envoyer des missions à l'étranger, nous les appuyons. Si elles veulent faire autre chose, c'est très bien, nous les appuyons aussi. Je peux vous garantir que cela entraîne beaucoup d'activités mais pas beaucoup de résultats. Je pourrais continuer encore, mais je vais m'abstenir.
Pour ce qui est de la scission du ministère, j'ai une opinion bien marquée. J'ai vécu l'intégration de ce ministère en 1982-1983. C'était un don du ciel. Personne dans les deux ministères ne l'avait demandé, mais les organismes centraux ont estimé que c'est comme cela qu'il fallait restructurer le gouvernement. En dix-huit mois d'efforts très pénibles, nous avons réussi à lancer ce ministère. Au bout de trois à cinq ans, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a vraiment commencé à fonctionner comme une unité homogène.
Alors pourquoi vouloir le redécouper? À quoi cela devrait-il servir? Il faut bien comprendre que cela va paralyser toute la stratégie pendant dix-huit mois à deux ans. Le ministère va être ravagé par les guerres intestines. J'ai suffisamment d'expérience de ce genre de choses pour savoir que c'est la recette de la paralysie et non du succès. Si l'objectif est de créer un ministère du Commerce puissant et distinct, ce n'est pas la bonne façon de faire. Vous avez dit que d'autres pays faisaient ce genre de découpage, je suis désolé, c'est le contraire. D'autres pays combinent au contraire les deux ministères. Le commerce est au coeur de la politique étrangère du Canada. Le commerce est vital pour nous.
Si vous voulez un ministère du Commerce complètement distinct, donnez-lui les tarifs douaniers. Donnez-lui les recours commerciaux dont disposent d'autres ministères aujourd'hui. Vous aurez peut-être à ce moment-là un ministère puissant. Pour l'instant, il n'a guère de pouvoir. Il y a probablement aujourd'hui plus de gens qui s'occupent de commerce au ministère de l'Agriculture qu'au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.
Alors quel était l'objectif de cette scission? Étais-ce de donner plus de pouvoirs au ministre à la table du Cabinet? Je peux vous garantir que cela ne posait absolument pas de problème à M. Lumley, ni à Mike Wilson ou John Crosby. Ils n'avaient nullement besoin d'un ministère distinct pour s'imposer aux réunions du Cabinet.
¿ 
 (0945)
(0945)
Ce n'est pas une question de structure, c'est une question d'individu.
Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on constate aussi dans le secteur privé que la restructuration débouche très rarement sur les résultats escomptés. La plupart du temps, c'est un fiasco. Et je vous garantis que cette initiative ne va déboucher sur rien. Ce n'est pas en changeant de place les chaises longues à Fort Pearson qu'on change le cours de l'histoire.
Encore une fois, si l'idée est d'avoir un ministère du Commerce puissant, ce n'est pas la bonne façon de faire. Si ce n'était pas cela l'objectif, alors quel était le but recherché? Qui, dans la clientèle de ces deux ministères, souhaitait un changement? Pour moi, c'est toujours la même chose : si vous êtes en bonne santé, ne touchez pas aux médicaments. Qui avait besoin de ce changement?
Enfin, en ce qui concerne le boeuf et le bois d'oeuvre, n'oubliez pas que l'affaire du bois d'oeuvre remonte aux années 1820. Ce n'est pas exactement une nouveauté. Je n'ai pas vraiment d'objection à la façon dont le gouvernement canadien gère ce dossier. Je reconnais, comme vous sans doute, qu'il s'agit d'une question provinciale qui relève de l'autorité des provinces. Or, nos provinces ont des priorités et des aspirations très différentes pour le règlement de ce différend. Et à l'intérieur des provinces, les représentants de ce secteur eux-mêmes sont divisés.
Le gouvernement fédéral joue un rôle minime dans cette question du bois d'oeuvre. À l'époque où nous avions des rencontres à ce sujet à l'Ambassade de Washington, nous étions obligés de les organiser dans l'auditorium en raison du nombre d'avocats qui y participaient. Il y en avait des centaines, parce qu'ils représentaient chacune des provinces et chacune des entreprises.
Le problème du bois d'oeuvre vient des Américains. Ce sont eux qui se servent abusivement et avec une grande désinvolture du mécanisme de règlement des différends. Ils mériteraient qu'on leur rende la pareille. Mais nous, nous semblons plutôt nous orienter vers un autre règlement commercial. Autrement dit, nous allons demander la paix parce que nous voulons régler ce problème sans engloutir une fortune en avocats.
Je comprends bien cette position. Nous sommes passés par là cinq fois depuis 20 ans. Je ne critique absolument pas le gouvernement. Je crois que le rôle du gouvernement, c'est de négocier le meilleur consensus possible avec les provinces et avec le secteur du bois d'oeuvre.
S'ils décident de se battre, comme je l'espère, très bien. S'ils veulent conclure une entente, c'est bien aussi. Mais si nous voulons transiger, assurons-nous d'avoir une clause de sortie. Prenons bien soin d'avoir une porte de sortie de la prison une fois que nous y serons entrés, car je n'aime pas du tout ce que j'entends jusqu'ici. Ce sont les Américains qui vont décider quand nous pourrons sortir de prison. Ce n'est pas ce que j'appelle une entente.
Le problème du boeuf, c'est que maintenant que nous avons pu circonscrire le problème avec l'administration au Congrès, le troisième élément du système américain, la magistrature, dresse sa tête hideuse et vient s'en mêler.
En outre, cette affaire provoque de violents remous au Sénat américain. Le vote au Sénat nous a été très défavorable et nous a permis de voir quels étaient nos véritables amis là-bas. Ils prétendent que c'est au moyen d'analyses scientifiques qu'on doit régler le problème. Vous savez bien ce que cela veut dire. Quand on ne veut pas s'attaquer au vrai problème, on essai de le faire passer pour un problème scientifique. Ce n'est absolument pas un problème scientifique. C'est la même chose que l'autre problème commercial que nous avons avec les États-Unis. Nous voulons avoir accès à leur marché, et eux ne le veulent pas. C'est uniquement une question de part du marché.
Là encore, je crois que la seule solution, c'est de remettre la question sur le tapis systématiquement, énergiquement et sans relâche à chaque fois que nous discutons avec eux. C'est une situation néfaste pour leur industrie, qui en souffre tout autant que la nôtre.
Je ne critique pas vraiment notre tactique. Je crois simplement qu'il faut bien comprendre qu'il y a maintenant un troisième élément de l'administration américaine qui s'en mêle.
Il y avait naguère un inspecteur des viandes qui arrêtait régulièrement les camions au Montana. Nous avons fini par l'inviter à notre barbecue du 4 juillet pour qu'il puisse goûter notre viande et voir qu'elle était excellente. Il n'est pas venu, mais le boycott à la frontière a cessé. Il faut utiliser toutes les tactiques possibles pour les empêcher de bloquer le jeu impunément.
Excusez-moi d'avoir été aussi long.
¿ 
 (0950)
(0950)


L'hon. Mark Eyking: Non, c'était parfait. J'espérais avoir un débat avec vous, mais ce n'est pas mon rôle.


Le président: Non, pas de débat, Mark.


L'hon. Mark Eyking: En parlant de représailles, vous disiez que nous devrions leur rendre la pareille dans le cas du bois d'oeuvre. Vous pensez vraiment que c'est ce qu'il faudrait faire et que nous devrions durcir le ton?


M. Derek H. Burney: Nous contre-attaquons sur l'amendement Byrd, et ce n'est pas trop tôt. Il y a longtemps que nous aurions dû le faire. Je suis sûr que ceux d'entre vous qui ont siégé au Cabinet savent à quel point il est difficile de décider d'exercer des représailles.
J'ai vécu cela et je sais ce que c'est. Les gens se demandent si cela veut dire que l'on va faire payer plus cher aux Canadiens les choses qu'ils achètent. Ils se demandent ce que cela signifie.
Je dis simplement que quand nous avons de bonnes raisons d'exercer des représailles, il faut simplement le faire, mais en choisissant la meilleure tactique de rétorsion. Par exemple, nous allons relever les droits de douanes sur le jus d'orange de 50 %. Le jus d'orange vient de Floride, n'est-ce pas? Mais si vous proposez cela au Cabinet, on va vous dire que les gens achètent du jus d'orange tous les jours, alors ce n'est pas évident.
Ce n'est pas aussi simple que cela en a l'air. Mais si nous avons une cause légitime qui nous autorise à exercer des représailles dans le cadre de l'OMC ou de l'ALENA, il ne faut pas hésiter.
[Français]


Le président: Monsieur Coulon, voulez-vous répondre aussi?


M. Jocelyn Coulon: Je voudrais répondre à M. le député et, en même temps, faire miens les propos de Derek à cet égard, surtout en ce qui concerne l'idée que le Canada doit se tenir debout dans certains aspects de ses relations avec les États-Unis. Je ne suis pas un spécialiste des questions commerciales ou financières comme l'est Derek Burney, mais je me penche sur les relations internationales sur le plan de la sécurité en particulier.
Je prendrai les exemples de la guerre en Irak et du bouclier antimissile. Je sais que ce sont des questions qui ont divisé les Canadiens. Peut-être même que plusieurs d'entre vous étaient divisés. Je retourne un peu à l'article de Lee Hamilton, selon lequel nos relations sont difficiles en ce moment et nous vivons un moment de tension mutuelle. Dans la crise irakienne, d'après moi, ce qui a le plus blessé les Canadiens n'est pas le fait que certains Américains mettent en doute notre alliance avec les États-Unis. Pour les Américains, le plus blessant n'a pas été les quelques critiques ou insultes qui sont venues de certains députés ou journaux. Le plus blessant est survenu lorsque les leaders des deux pays, par l'entremise de certains membres importants de leur gouvernement — je parle davantage des États-Unis que du Canada —, se sont mis à s'intimider et à ne pas croire aux bonnes raisons qu'avait l'autre de ne pas s'engager dans une politique semblable.
Par exemple, lorsque je vois Mme Condoleezza Rice pratiquement dénigrer, sinon ridiculiser, la position de Jean Chrétien sur la question irakienne lors d'une émission de télévision, restée célèbre, avant la guerre en Irak, je trouve cela particulièrement scandaleux. En effet, ce n'est pas dans des relations de ce niveau qu'on devrait échanger des insultes, et encore moins des intimidations.
Deuxièmement, je vous ferai remarquer le comportement absolument scandaleux de l'ambassadeur américain Paul Cellucci depuis deux ans. Je sais qu'il est parti maintenant. Personnellement, j'étudie les relations internationales depuis 25 ans et je n'ai jamais vu un ambassadeur d'une grande puissance se comporter de cette façon dans le pays où il est accrédité. À deux reprises, M. Cellucci a remis en cause non seulement la position canadienne sur l'Irak ou sur la défense antimissile, mais la crédibilité même du premier ministre du Canada.
Je m'excuse, mais cela colore nos relations avec les États-Unis. Nous avons beau dire que les États-Unis sont notre grand partenaire, qu'ils sont nos amis, mais lorsque nos amis commencent à nous insulter, à dénigrer et à discréditer la personne du premier ministre du Canada, je crois que la ligne rouge est franchie. Comme le disait Derek, il faut savoir choisir ses combats. Or, à cet égard, le gouvernement a choisi ses combats. Quant à moi, il n'est pas allé assez loin avec l'ambassadeur Cellucci, mais c'est une autre histoire. C'est la même chose pour la question du bouclier antimissile.
Donc, non seulement le Canada doit pouvoir défendre courageusement les positions qu'il adopte, mais il doit aussi savoir qu'il a les moyens de faire face aux États-Unis. Après tout, nous sommes le premier partenaire commercial des États-Unis, n'est-ce pas? J'entends des industriels canadiens dire que, si les États-Unis se fâchent, ils risquent de fermer la frontière avec le Canada. Voyons donc! Les industriels américains vont-ils tolérer de fermer la frontière avec le Canada alors qu'ils importent de leurs succursales canadiennes? Ils vont se tirer dans le pied. Donc, ne soyons pas intimidés par cela. Défendons nos positions, qu'elles soient commerciales ou politiques, de la meilleure façon possible.
Merci.
¿ 
 (0955)
(0955)


Le président: Merci beaucoup, monsieur Coulon.
Nous allons maintenant passer à M. McTeague.
Monsieur McTeague.
[Traduction]


L'hon. Dan McTeague (Pickering—Scarborough-Est, Lib.): Monsieur le président, étant donné la très grande importance des témoignages que nous entendons—et je dois dire que je suis très heureux d'y assister depuis quelques temps car ces échanges ont été extrêmement fructueux—, je me demande si vous pourriez juger que, puisque nous avons six députés présents dont un de l'opposition, nous pourrions considérer que le comité a le quorum.


Le président: Non, nous n'avons pas le quorum. Il nous faut sept membres pour avoir le quorum. Il nous fait un représentant de l'opposition, mais nous ne sommes que cinq du côté ministériel.
Allez-y, monsieur McTeague.


L'hon. Dan McTeague: Puisque nous sommes six, il ne nous manque qu'un seul député, monsieur le président?


Le président: Un député de l'opposition.


L'hon. Dan McTeague: Monsieur le président, vous êtes dur en affaires. Il s'en faut juste d'un. C'est l'éternel histoire de ma vie.
Enfin, j'aimerais remercier
[Français]
les deux témoins qui sont avec nous aujourd'hui. Je sais que votre comparution ici est très importante pour le comité.
Nous avons abordé les grandes questions de la politique qui a été énoncée il y a quelques semaines. Notre comité attendait avec une certaine impatience de vous entendre aujourd'hui. Alors, merci encore d'être venus.
[Traduction]
Je voudrais demander tout d'abord à M. Burney s'il pense que l'investissement massif que nous avons réalisé, plus de 10 milliards de dollars déjà et cela continue, pour assurer la sécurité à la frontière, et pour essayer d'atténuer les problèmes de congestion...
Vous avez parlé précisément du problème de l'Ontario et de l'État de New York. J'imagine que vous vouliez parler précisément de l'importance du passage à Fort Erie, et aussi à Niagara Falls. Peut-être serait-il bon d'envisager un autre pont. Compte tenu de l'impératif de sécurité, je me demande si même en construisant deux ou trois ponts supplémentaires on réussira à régler le problème s'il y a toujours cet impératif de sécurité.
Vous avez aussi parlé de la montée du protectionnisme aux États-Unis. C'est quelque chose qui m'intéresse, et pas seulement sur le plan commercial.
Ceci m'amène au sujet que je voulais vraiment aborder, le commerce. J'ai souvent constaté qu'il était difficile de travailler aux Affaires étrangères en raison du nombre de ministères qui ont une composante affaires étrangères. Sachant que la mondialisation implique pratiquement une forme de spécialisation, je me demande si un ministère du Commerce distinct ne nous permettrait pas d'agir de façon plus ciblée. Les Australiens le font, par exemple, et ils réussissent très bien, en dépit de leur vision du fédéralisme, notamment dans le domaine commercial.
Enfin, j'aimerais peut-être avoir—je sais bien que cela fait beaucoup de choses—vos commentaires sur la motion ou plus exactement le projet de loi d'initiative privée présenté par un député conservateur pour obtenir une espèce de reconnaissance de jure de Taïwan en tant qu'État. Pensez-vous que cela nous serait utile dans nos rapports avec la Chine?
Je crois que vous avez justement fait un commentaire il y a quelques instants à propos de la Chine. Cela m'intrigue.
À 
 (1000)
(1000)
[Français]
Monsieur Coulon, d'après vous, la grande décision de ne pas participer au bouclier antimissile va-t-elle avoir des conséquences néfastes dans l'avenir pour le NORAD?
[Traduction]


Le président: Nous sommes censés avoir cinq minutes pour la question et la réponse, mais je vais être très souple ce matin. Prenez tout le temps qu'il vous faut.
Une voix: Pas de quorum, pas de Règlement.


M. Derek H. Burney: Je vais essayer d'être bref, mais toutes ces questions mériteraient de longues réponses, et j'espère que vous me pardonnerez d'être très bref.
Pour ce qui est de la congestion à la frontière, si je vous comprends bien, vous vous demandez si la solution serait d'avoir plus de ponts. Je ne pense pas que ce soit la seule réponse, et de loin, car au rythme où nous progressons sur ces questions, il nous faudrait 10 ans pour en construire un même si nous décidions de le faire dès aujourd'hui. Je ne pense donc pas que la solution absolue soit de construire de nouveaux ponts à Windsor, Fort Erie ou ailleurs.
Ce que j'ai essayé de suggérer dans mes remarques, c'était d'essayer de faire de la frontière un élément de la solution plutôt qu'un élément du problème, en la reculant de façon à ce que tout le travail de paperasserie qu'on fait actuellement à la frontière puisse se faire ailleurs grâce à des moyens technologiques, ce qui éviterait aux camionneurs de devoir présenter tout un tas de documents à la frontière, ou encore en harmonisant les normes et en trouvant d'autres moyens de réduire plutôt que d'alourdir toute la paperasserie et les procédures exigées pour le passage à la frontière.
Je ne critique absolument pas les initiatives prises jusqu'ici pour mettre en place une frontière intelligente. Je dis simplement que ce n'est pas suffisant. Le sentiment d'urgence qui a suivi le 11 septembre s'est estompé. Si c'était moi qui menais la barque, je donnerais les pleins pouvoirs à quelqu'un pour s'attaquer à ce problème de congestion à la frontière et j'inviterais les Américains à faire de même. Je sortirais le problème du domaine politique et je laisserais ces responsables s'en occuper régulièrement sans devoir attendre que notre vice-premier ministre en discute avec le directeur du Homeland Security. Voilà en deux mots ma réponse sur ce point.
En ce qui concerne la séparation du commerce, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question.


L'hon. Dan McTeague: Monsieur Burney, à ce propos, seriez-vous ou non favorable à une union douanière?


M. Derek H. Burney: C'est une question à laquelle il faut réfléchir. Ce n'est pas ce que je propose. Avant de nous lancer dans le libre-échange, nous avons demandé à une Commission royale d'examiner la question, et elle nous a fourni les bases intellectuelles de la négociation. Je ne vois pas sur quelle analyse de ce genre je pourrais me fonder pour faire une recommandation. Ce que j'ai dit publiquement, c'est qu'à mon avis c'est une idée qui mérite d'être soigneusement étudiée. Qu'on parle d'union douanière ou non, à partir du moment où l'on s'engage sur l'idée d'un tarif douanier commun, on peut prendre certains éléments d'une union douanière pour s'attaquer aux problèmes de règles d'origine qu'on a, comme je le disais, à la frontière. Quand on sait qu'une très grande partie de notre commerce avec les États-Unis se fait au sein d'entreprises situées de part et d'autre de la frontière, il est clair qu'il faudrait essayer de trouver les moyens d'accélérer le transit des marchandises de part et d'autre. L'une des façons de le faire, comme je le disais, serait d'avoir un tarif extérieur commun. Ce n'est pas la seule solution.
Je ne cherche pas à me dérober; je dis simplement qu'il faudrait que je creuse plus la question pour pouvoir... Et qui sait si les Américains souhaitent vraiment négocier cela? C'est quelque chose qui marche dans les deux sens.
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question sur la séparation du commerce. J'ai dit tout à l'heure que je n'aimais pas l'idée de bouleverser les choses dans un ministère qui fonctionne bien. Je n'en vois pas l'utilité. Je ne crois pas que les exportateurs réclament un meilleur ministère du Commerce. Je crois que personne ne se plaignait du rôle de promotion commerciale qu'exerçaient nos ambassades. Franchement, il y a bien d'autres pays qui envient ce rôle de promotion commerciale que jouent nos ambassades. Les Américains sont jaloux de ce que font nos ambassades à travers le monde en fournissant des conseils, de l'aide, et tout cela.
Je n'ai jamais entendu les exportateurs canadiens se plaindre et demander une scission du ministère.
Encore une fois, si on ne comprend pas l'objectif, comment diable peut-on avoir une idée de la mission? Je n'ai encore entendu personne m'expliquer ce qu'on essayait de réparer, car à mon avis il n'y avait rien de casser.
En ce qui concerne Taïwan, je n'ai pas vu le projet de loi d'initiative privée dont vous parliez, mais le contentieux entre la Chine et Taïwan est manifestement aussi chargé d'hostilité que celui du Moyen-Orient. Quand on dit qu'on marche sur des oeufs quand on parle du Moyen-Orient, on pourrait largement en dire autant dans le cas de Taïwan.
Il faut faire bien attention quand on décide de reconnaître... Vous savez, le Canada a été l'un des premiers pays à reconnaître la Chine continentale au début des années 1970. J'ai été en poste au Japon à l'époque. Nous avons pris note de la revendication de la Chine sur Taïwan, un point c'est tout. À ma connaissance, c'était notre position dans les années 1970, et je m'excuse de ne pas être plus à jour sur la question; c'était toujours notre position quand j'ai quitté le gouvernement en 1993. Je ne sais pas si elle a changé depuis. Mais à mon avis, nous devrions nous y tenir. Si cette résolution contredit ou fragilise cette position, si elle risque de hérisser certaines personnes, il faut faire très attention car on joue avec le feu. Comme nous l'avons appris quand nous avons essayé de transférer une ambassade à Jérusalem, ce genre d'action compte plus que de simples paroles.
À 
 (1005)
(1005)
[Français]


Le président: Monsieur Coulon, allez-y.


M. Jocelyn Coulon: Si j'ai bien compris, votre question portait sur le bouclier antimissile et la participation au NORAD. Je rappellerai simplement ce que le chef d'état-major sortant, le général Ray Henault, disait l'automne dernier. Je pense que c'était dans un discours devant les associations de défense. Il a dit que le NORAD resterait toujours une organisation de sécurité essentielle pour la protection de l'Amérique du Nord, même sans la défense antimissile que les Américains voudraient voir inclure dans son mandat.
Le NORAD a d'abord et avant tout un mandat de surveillance aérienne et de détection des missiles. C'est essentiellement pour cela que cette organisation a été créée à la fin des années 1950. On pourrait lui ajouter d'autres nouvelles fonctions. En fait, au cours des dernières années, on lui ajouté des fonctions de lutte contre le trafic de drogue, par exemple.
Certains spécialistes voient très bien un NORAD ou une autre structure pouvant s'occuper de la protection des accès maritimes dans le nord du Canada. Cela pourrait-il se faire par l'entremise du NORAD, ou serait-ce une autre organisation? Les militaires pourront le dire mieux que nous. Cependant, vous avez vu, avant que le premier ministre ne prenne sa décision sur le bouclier antimissile, combien la propagande — permettez-moi d'utiliser ce mot — était parfois hystérique de la part des pro-bouclier antimissile et de certains experts américains qui disaient que ce serait la fin du monde si nous n'y participions pas.
C'est toujours la fin du monde pour ces gens-là si on ne participe pas à une de leurs politiques, mais le monde se porte bien depuis 2 000 ou 3 000 ans. Nous avons toujours survécu à ce genre de crise et de propos hystériques, à mon avis. Il faut donc savoir évaluer nos intérêts et nos engagements, et toujours nous dire que nous aussi avons des moyens. Nous ne sommes pas seulement passifs, dans cette relation avec les États-Unis. Nous avons nos moyens.
Merci.


Le président: Merci, monsieur Coulon.
[Traduction]
Vous avez un commentaire à ce sujet, monsieur Burney?


M. Derek H. Burney: Je le crains bien, en effet.


Le président: C'est pour cela que je vous ai posé la question. J'en étais à peu près sûr.


M. Derek H. Burney: C'est un sujet sur lequel Jocelyn et moi ne sommes manifestement pas d'accord. Je crois qu'il est regrettable que les témoins soient en désaccord, mais je pense que nous avons une vision un peu différente des choses. Je vais essayer de rester très général.
Les discours font mal dans les deux sens. Vous vous souvenez de cette réplique dans le film Cool Hand Luke : « Là, nous avons un problème de communication »? Nous avons un vrai problème de communication de nos jours avec les Américains, et les invectives ne sont pas venues que d'un seul côté. Il y en a eues des deux côtés et il est temps de calmer le jeu.
Je me souviens d'un conseil que George Shultz a donné à Joe Clark à l'époque où il était notre ministre des Affaires étrangères, et je ne l'ai jamais oublié car je crois que c'était un excellent conseil. Il lui a dit à un moment : « Vous savez, Joe, si vous voulez nous donner un coup de pied dans les tibias, faites-le en privé. » L'aigle n'aime pas se faire arracher les plumes en public. Les Américains trouvent que c'est du cirque, et il y en a eu trop de notre côté.
Effectivement, certains propos américains sont choquants et quand c'est le cas, il faut les relever. Je suis enchanté que mon successeur à Washington, M. McKenna, ait repris Newt Gingridge de cette façon, et repris Fox News de cette façon. C'est exactement ce qu'il faut faire. Mais qu'il soit bien entendu que cela fonctionne dans les deux sens. Les Américains sont comme tout le monde. Vous les insultez, ils vous insultent, et vous pouvez repartir.
Franchement, pour être aussi diplomate que je le peux—et je me suis retiré de la diplomatie depuis 12 ans—ce qui me dérange dans notre décision à propos de la défense antimissile balistique, c'est qu'elle était inexplicable. On ne l'a pas expliquée. Le gouvernement ne l'a expliquée ni aux Canadiens, ni aux Américains. En diplomatie, la façon de faire passer le message est parfois aussi importante que le fond même de ce message.
Les Américains avaient toutes les raisons de s'attendre à ce que le Canada se joigne à l'initiative de défense antimissile balistique parce que nos ministres et le premier ministre avaient fait des déclarations publiques en ce sens. Donc quand on leur a dit à la dernière minute... et le président américain était venu au Canada, il avait eu un entretien privé avec notre premier ministre. Si notre premier ministre avait des réserves à propos de ce dispositif, il aurait dû le dire en privé au président, ce qui aurait évité à celui-ci de nous demander publiquement de nous joindre à cette initiative quand il est allé à Halifax.
Ce que je veux dire, c'est que quand nous ne sommes pas d'accord avec les Américains—et j'adore ne pas être d'accord avec les Américains—, il faut que nous soyons capables de leur expliquer que c'est en fonction de notre intérêt bien compris que nous ne sommes pas d'accord. Si nous le faisons, qu'il s'agisse de pluies acides, de guerre des étoiles, ce qui n'a rien à voir avec la défense antimissile balistique, ou d'autres questions de ce genre, si nous pouvons leur expliquer que ce n'est pas dans notre intérêt, les Américains ne seront peut-être pas contents, mais ils comprendront.
Mais quand ils ne comprennent pas l'intérêt que poursuit le Canada en s'opposant à eux sur une question qui leur semble aussi vitale, alors nous avons un problème, parce que nous n'avons pas clairement exprimé notre position. En tergiversant pendant des années sur la question et en envoyant des signaux contradictoires aux Américains lors de réunions privées au NORAD ou par d'autres canaux, nous avons créé une surprise à la dernière minute et la dernière chose que l'on souhaite en diplomatie, ce sont les surprises.
Je ne vais pas m'étendre sur les tenants et aboutissants de la question. Nous n'en avons pas le temps. Ce que je veux dire simplement, c'est que nous devons prendre grand soin d'expliquer au nom de quel intérêt le Canada prend une position différente de celle d'un pays dont nous dépendons aussi étroitement, que cela nous plaise ou non, pour notre propre sécurité. Nous sommes maintenant devenus de simples spectateurs sur la question de la sécurité nord-américaine qui est une question de grande importance. Je n'aime pas être un simple spectateur de ce qui se passe sur notre continent.
À 
 (1010)
(1010)


Le président: Merci, monsieur Burney.
Nous revenons à Mme McDonough.


Mme Alexa McDonough: Merci, monsieur le président.
Monsieur Burney, je dois dire que vous venez de nous dire avec encore plus de force et de clarté ce que d'autres témoins n'ont cessé de nous dire depuis deux ans, à savoir que le problème n'est pas que nous prenions une position différente sur certaines questions, c'est que tout notre...enfin, c'est pire que de ne pas être capable de s'exprimer et de communiquer clairement. C'est le fait que nous envoyons des messages totalement contradictoires, que nous disons une chose et son contraire et que finalement, évidemment...
Cela me met un peu mal à l'aise d'être tellement d'accord avec vous.
Des voix: Oh, oh!
À 
 (1015)
(1015)


M. Derek H. Burney: Et moi donc, madame McDonough.


Mme Alexa McDonough: Oui, et je dois dire sans vouloir vous manquer de respect que pendant que vous parliez je lisais l'article de Hamilton que je n'avais pas encore lu. Je l'ai rencontré à Washington. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit ici, ce qui est plus ou moins la version américaine de ce que vous venez de nous dire.


M. Derek H. Burney: En effet. Je ne sais pas vers quoi nous nous aventurons.


Mme Alexa McDonough: Avant de perdre complètement mon orientation, j'aimerais approfondir quelques points que vous avez effleurés, et j'espère que nous pourrons le faire rapidement. Je veux parler de la séparation des affaires étrangères et du commerce international. Je dois dire que c'est précisément pour les raisons que vous venez de mentionner que nous nous sommes battus pour rejeter cette proposition à la Chambre.


M. Derek H. Burney: Et je m'en réjouis.


Mme Alexa McDonough: Mais quand vous prédisez—et je ne dois pas exagérer—une paralysie de 18 mois à deux ans avant que les choses se mettent en place, je suis épouvantée. J'aimerais donc savoir s'il y a des conseils que vous nous suggéreriez de donner au gouvernement pour rectifier le tir, parce que c'est vraiment la pagaille.
Vous pourriez peut-être répondre à cette question, et ensuite j'en aurais une ou deux autres à vous poser.


M. Derek H. Burney: Tout d'abord, je dois dire que je suis enchanté de voir à quel point nous sommes d'accord tous les deux.


Mme Alexa McDonough: Cela risque de me poser sérieux ennuis politiques. Mais ce n'est pas votre problème.


M. Derek H. Burney: Vous pouvez dire ce que vous voulez du point de vue politique.
Je suis moi-même perplexe devant le fait que malgré le résultat du vote au Parlement, qui semblait assez clair, le clivage semble être maintenu. C'est presque comme s'il importait peu que le Parlement soit minoritaire. Mais ce sont là des commentaires politiques dont je devrais m'abstenir.
Tout ce que je puisse vous dire, c'est que la situation se poursuit et paralyse le Parlement en causant des guerres de clocher. Or, on sait bien que détenir l'information vous donne les clés du pouvoir. Tout d'un coup, on dit aux ambassades qu'elles doivent rendre compte de différents dossiers à différents intermédiaires, de sorte que certains sont au courant et d'autres pas. C'est la bonne vieille méthode de diviser pour régner, et voilà ce qui se passe actuellement. Nos ambassades se font dire que les agents commerciaux doivent rendre compte au ministère du Commerce et qu'il est même possible de contourner l'ambassadeur. C'est la pire des tactique!
Je n'ai pas entendu moi-même, mais lorsque le ministre des Affaires étrangères a fait ces déclarations, j'avais cru comprendre qu'il mettrait sur pied un comité qui se pencherait sur la question, ce qui me semblait très sain, et qu'il réévaluerait peut-être la situation pour voir si cela correspondait bien aux objectifs. Mais je n'ai rien entendu depuis, et je ne sais même pas si le fameux comité a été formé. Je n'en ai même pas entendu parler et je ne sais donc rien.
Quoi qu'il en soit, c'est l'occasion idéale pour le gouvernement de faire une pause, d'écouter et de réfléchir. Je répète que vous démoralisez complètement un ministère d'une grande fierté pour qui des milliers de Canadiens veulent toujours aller travailler. Dans le cadre de mes cours, mes étudiants me demandent aujourd'hui ce qui les pousserait à joindre les rangs d'un ministère qui est aujourd'hui déchiré sans que personne ne soit en mesure de le justifier.
Que dire de plus? Mon seul espoir, c'est que ce comité ne décidera pas d'avance des résultats de sa réflexion. Si les intentions étaient sincères au départ, le gouvernement devrait avoir la bonne grâce d'avouer qu'il s'est trompé cette fois-ci et que la séparation n'est pas vraiment nécessaire ou que si elle l'est, c'est parce qu'il avait un objectif précis en tête.
Comme je le disais, si le gouvernement veut un ministère du Commerce autonome, je veux bien. Mais alors, qu'il sorte tous les délégués commerciaux de l'Agriculture, et aussi des autres... J'oublie lequel d'entre vous signalait que beaucoup de ministères jouent un rôle dans la politique étrangère, ce qui est vrai. Je crois même que plus de 17 ministères sont représentés à Washington, et qu'il y en a sans doute tout autant dans certaines de nos missions en Europe. C'est une erreur que de prétendre que le ministère du Commerce international regroupe tous les agents commerciaux au gouvernement. C'est faux.
Si on veut vraiment former un ministère fort, qu'on lui donne du pouvoir, et qu'on lui permette d'agir du côté des tarifs et du côté des recours commerciaux. Qu'on lui donne véritablement les pouvoirs d'investir, mais il faut aussi reconnaître que même si on lui donne l'autorité voulue, il traversera au moins deux ans de perturbations, de réorganisations et guerres de clocher


Mme Alexa McDonough: Que nous ne pouvons nous permettre d'avoir.


M. Derek H. Burney: Malheureusement, la Terre n'arrête pas de tourner tandis que nous nous réorganisons.


Le président: Je voulais vous signaler, monsieur Burney...


M. Derek H. Burney: Que je me répète?


Le président: Non, je n'oserais jamais vous dire cela.
Je voulais seulement vous signaler que M. Peterson a comparu mardi dernier au comité et qu'il a fait remarquer qu'il y aura un comité d'experts qui se penchera sur cette question. J'espère que cela se concrétisera.


M. Derek H. Burney: Du moment que les experts sont du bon côté.
[Français]


Le président: Monsieur Coulon, avez-vous un commentaire à ajouter?


M. Jocelyn Coulon: Non, pas à ce sujet.
[Traduction]


Le président: M. MacAulay.
À 
 (1020)
(1020)


L'hon. Lawrence MacAulay (Cardigan, Lib.): Merci.
Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agit certainement d'une conversation intéressante, où chacun a son franc-parler.
Si j'ai bien compris, monsieur Burney, vous voudriez que le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international acquière plus d'importance plutôt que le contraire. Si vous me permettez d'exprimer la vue d'un simple profane s'adressant à un expert qui doit s'occuper de divers genres de marchés, je tiens à vous signaler que dans mon coin de pays on n'aime pas le fait que le ministère semble avoir utilisé le poisson comme outil de marchandage dans d'autres domaines. Nous considérons que le ministère a utilisé le poisson à mauvais escient dans le passé. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. C'est un problème pour nous et pour l'industrie de la pêche de l'Atlantique. Je me trompe peut-être à ce sujet. Peut-être que les profanes se trompent et que les experts ont raison.
Je voudrais aussi que vous commentiez la politique relative à la frontière intelligente à laquelle j'ai contribué un peu. Je traverse la frontière deux ou quatre fois par semaine et cela m'étonne toujours que je doive passer par toutes les formalités. Je me demande si c'est vraiment nécessaire quand les gros camions remorques traversent constamment la frontière. Vous avez parlé de la technologie à la frontière. Je croyais que l'on aurait davantage recours aux nouvelles technologies. Ne devrait-on pas avoir un mécanisme quelconque qui permettrait simplement de lire une micropuce pour savoir qui vous êtes?
Je voudrais aussi que vous nous en disiez davantage au sujet du recul de la frontière. Il faut du temps pour construire des ponts, mais nous avons la technologie voulue et nous devons garantir la circulation à la frontière. Je voudrais que vous nous expliquez comment nous pouvons reculer la frontière grâce à la technologie.
Le Canada est le principal marché d'exportation pour 39 ou 40 des 50 États. Leur avons-nous dit combien de millions et de milliards de dollars sont perdus à cause des retards à la frontière? Si les États savaient l'importance de ces pertes, ils pourraient exercer des pressions sur le gouvernement à Washington. Même si l'on parle au président, il peut toujours s'arranger avec le Congrès et ce qu'il a dit à l'étranger ne compte plus.
C'est vraiment malheureux que nous perdions tous ces milliards de dollars des deux côtés de la frontière malgré les moyens technologiques à notre disposition. J'ignore si le problème est dû à la politique, à quelques personnes en particulier ou à un manque de compréhension.


M. Derek H. Burney: Merci, monsieur le ministre.
Pour ce qui est de la pêche, je ne sais trop ce que vous attendez de moi. Je porte encore les cicatrices des négociations en matière de pêche auxquelles j'ai pris part, directement ou indirectement. Je me rappelle également avoir obtenu une exemption pour la région de l'Atlantique lors des négociations du libre-échange, et que cette exemption n'avait pas été bien accueillie par la Colombie-Britannique. Mais je n'en dirai pas plus là-dessus.
La pêche est une question extrêmement politique, que l'on parle de commerce ou simplement de vie politique. Avons-nous fait toujours ce qu'il fallait dans ce dossier? Quand on dit « nous », je ne sais trop de qui on parle, puisque c'est le gouvernement de l'heure qui entre dans des négociations en matière de pêche avec les Européens ou avec les Américains. Je suis un peu perplexe.


L'hon. Lawrence MacAulay: Quand je dis « nous », je parle du Canada comme nation depuis 50 à 100 ans. Je ne vise personne en particulier, mais c'est que la pêche sert parfois de monnaie d'échange.


M. Derek H. Burney: Vraiment? Dans les années 70 et 80, c'est-à-dire plutôt au milieu des années 80, nous négocions avec les Français au sujet de la pêche et des navires, quand il s'agissait de sous-marins nucléaires. Mais les diplomates n'aiment pas beaucoup faire le lien entre différents dossiers.
Passons maintenant à l'initiative sur la frontière intelligente. Je suis très sensible aux efforts que vous tous avez déployés pour lancer cette initiative après les événements du 11 septembre, mais vous conviendrez sans doute avec moi que l'initiative s'est essoufflée depuis.
Vous avez tout à fait raison de dire que la technologie existe déjà pour diminuer la congestion à la frontière. Mais je ne sens pas un sentiment d'urgence en ce sens. Vous savez très bien ce qui arrive lorsque les dossiers s'essoufflent au lieu de prendre la vitesse.
Voilà pourquoi j'ai dit plus tôt que si c'était moi qui tirais les ficelles, j'essaierais d'obtenir du premier ministre et du président qu'ils nomment des envoyés spéciaux, ou peu importe le titre qu'on leur donnera. Je parle ici des gens qui regrouperaient tous ceux qui ont des préoccupations légitimes dans les États et dans les provinces au sujet de la congestion à la frontière. Vous pourriez obtenir des conseils scientifiques sur la façon dont la technologie peut être utilisée à meilleur escient à la frontière. Si vous vous en remettez aux réunions ministérielles épisodiques, après quelques soubresauts, la pression finit par s'évanouir.
Hilary Clinton, par exemple, sait très bien que l'État de New York perd huit milliards de dollars par année, tout comme l'Ontario en perd 10. Ces chiffres m'interpellent et me font comprendre que les Américains choisiraient sans doute de nommer un émissaire de très haut niveau dans ce dossier, dans le but de ne pas essuyer les attaques de l'un des États les plus importants aux États-Unis.
Nous pensons avoir réglé le problème en lançant l'initiative pour la frontière intelligente, mais c'est faux. Les choses ne feront qu'empirer. Vous qui avez été solliciteur général, vous savez sans doute mieux que moi que s'il y a une autre intrusion par la frontière, c'est nous qui allons payer le gros prix la prochaine fois.
À 
 (1025)
(1025)


L'hon. Lawrence MacAulay: J'aimerais que vous nous en disiez un peu plus sur la participation de l'État. Il faudrait que les pressions internes soient plus fortes. Quand une personne perd de l'argent, elle est plus susceptible de ne ménager aucun effort pour que la situation change.


M. Derek H. Burney: Vous avez raison. Vous avez dit que nous ne faisions peut-être pas suffisamment bien savoir aux Américains à quel point le commerce avec le Canada est important pour eux. Si ce n'est pas vous qui l'avez dit, c'est quelqu'un d'autre.
C'est très juste. Il ne suffit cependant pas simplement d'augmenter le personnel de nos consulats. Ce n'est pas la solution.


L'hon. Lawrence MacAulay: En effet. Qu'en est-il des rapports avec les États? Nous intervenons déjà auprès des particuliers et des entreprises qui perdent de l'argent.


M. Derek H. Burney: Si j'étais à la place du premier ministre du Canada aujourd'hui, j'amènerais le premier ministre de l'Ontario, le premier ministre du Québec et les premiers ministres de l'Atlantique à s'entendre sur la nomination d'une personne qui serait chargée de s'attaquer au problème de la congestion aux frontières. Je demanderais au président des États-Unis de faire de même, pour sa part, avec les États que le problème affecte. Ces deux responsables du dossier feraient régulièrement rapport à leur gouvernement respectif de l'évolution de la situation.
Je m'inquiète du fait que nous ne consacrions plus beaucoup d'efforts à essayer de régler cette question parce que nous pensons l'avoir déjà réglée. Or ce n'est pas le cas. Je crains une autre atteinte à la sécurité qui causera un problème encore plus grave.
Vous avez absolument raison. Prenons le cas des aéroports. Nous sommes parvenus à faire en sorte qu'il soit plus facile aux résidents de nos deux pays de voyager par avion d'un pays à l'autre. Il faudra maintenant présenter un passeport à la frontière. Il faudra présenter de nouvelles pièces d'identité. Jusqu'au président qui n'a pas beaucoup aimé cette idée lorsqu'il en a entendu parler, mais comme vous l'avez dit, il ne peut pas s'opposer à la volonté du Congrès et c'est une initiative qui est venue du Congrès. Il faut que des personnes de haut niveau soient chargées de trouver une solution à ce problème si nous voulons faciliter le passage des biens et des personnes à la frontière.
J'ai parlé de l'harmonisation des normes. Si nous pouvions harmoniser nos normes ou accepter nos normes mutuelles dans le domaine du transport des marchandises, cela en soit permettrait d'éliminer beaucoup de tracasseries administratives. Cette mesure supprimerait peut-être aussi quelques emplois et c'est peut-être la raison pour laquelle elle n'a pas été mise en oeuvre. Vous comme moi savez qu'il y a des inspecteurs qui pensent que leurs normes sont meilleures que celles des autres.


Le président: Merci.
J'aimerais poser une question à MM. Coulon et Burney. J'accorderai ensuite la parole à monsieur Bevilacqua.
Monsieur Coulon, compte tenu des problèmes auxquels les Nations Unies sont confrontées, quel rôle envisagez-vous pour le Canada dans les opérations de maintien de la paix? J'aimerais que vous nous disiez quelques mots sur les opérations de maintien de la paix et sur le genre d'interventions qui sont indiquées dans des situations comme celle qui prévaut actuellement dans la région du Darfour, au Soudan. Quel devrait être le rôle du Canada dans ces opérations?
Monsieur Burney, j'aimerais que vous nous disiez ce que nous pouvons faire d'autre pour obtenir la confiance et le respect de Washington. Vous l'avez déjà fait, mais j'aimerais en savoir davantage. Comment pouvons-nous espérer en arriver à un règlement des différends commerciaux compte tenu des puissants lobbys qui exercent des pressions sur les membres du Congrès?
Voudriez-vous commencer monsieur Coulon.
[Français]


M. Jocelyn Coulon: Merci, monsieur le président.
La question des Nations Unies est quelque peu complexe parce que, comme vous le savez, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, les opérations de maintien de la paix ont beaucoup évolué. Au départ, il s'agissait d'un travail et d'une responsabilité qui incombaient aux Nations Unies parce que, historiquement et politiquement, les Nations Unies étaient responsables de la paix et de la sécurité.
À partir de 1948, et surtout à partir de 1956, l'ONU a mis sur pied des opérations de maintien de la paix classiques, c'est-à-dire qu'il s'agissait de déployer des troupes entre des États qui acceptaient le principe d'un cessez-le-feu. C'était donc une responsabilité des Nations Unies, c'était une responsabilité simple. Toutefois, à la fin des années 1980 et au début des années 1990, le maintien de la paix s'est transformé considérablement. Il n'était plus question d'intervenir entre des États, mais d'intervenir à l'intérieur de certains États. Puisque l'ONU intervenait à l'intérieur des États, elle était de plus en plus amenée ou invitée à départager des factions qui n'étaient pas nécessairement des acteurs du système international. L'ONU était habituée à travailler avec des acteurs qui avaient des obligations. En s'impliquant à l'intérieur de ces États, elle ne pouvait plus vraiment jouer ce rôle. En plus, elle n'avait ni les ressources financières militaires ni l'appui politique du Conseil de sécurité pour mener à bien ses opérations à l'intérieur de ces États.
On a vu, au cours des années 1990, de plus en plus d'organisations régionales ou sous-régionales obtenir des mandats pour le maintien ou l'imposition de la paix. Cela — l'imposition de la paix — était souvent ce qui manquait au mandat des Nations Unies. Elles ne pouvaient que maintenir la paix. Toutefois, cette imposition posait un problème aux Nations Unies. L'OTAN, l'Union européenne, l'Union africaine, d'autres organisations sous-régionales se sont mises à intervenir. Par conséquent, cette transformation des opérations de paix a poussé le Canada à intervenir plus souvent avec l'OTAN qu'avec l'ONU, et ce, pour deux raisons essentielles.
D'abord, l'OTAN est formée de nos alliés naturels et principaux. Les missions de maintien de la paix auxquelles nous avons participé se sont passées, essentiellement, à la fin des années 1990 dans les Balkans. Ce n'est qu'en 2001 que l'OTAN s'est déplacée en Afghanistan. Nous avons suivi ce déplacement parce que nous voulions faire du maintien de la paix dans le cadre de l'OTAN. Cela nous a concurremment désengagés des opérations de paix de l'ONU parce que nous avions des ressources limitées. Nous ne disposions que de 2 000 à 3 000 soldats. S'ils sont en Bosnie, au Kosovo ou en Afghanistan, ils ne peuvent pas être ailleurs.
Il faut dire aussi que l'ONU, en parallèle, a obtenu l'appui d'autres pays. Lorsque l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh ou d'autres fournissent entre 5 000 et 10 000 soldats pour le maintien de la paix, le Canada n'a pas vraiment à y participer.
Le Canada pourrait-il encore participer aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies? J'ai l'impression que cela restera, encore là, conjoncturel. Cela dépendra des missions de paix qui seront mises sur pied, cela dépendra des activités de l'OTAN ou d'autres organisations régionales auxquelles nous appartenons et avec lesquelles nous estimons devoir travailler plus souvent.
Cependant, j'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit d'une dérive qui m'apparaît dangereuse. Lorsque Lester B. Pearson a conçu et que les Nations Unies ont créé la première mission de maintien de paix en 1956, on avait en tête l'universalité des opérations de paix. Ce principe d'universalité veut dire que le Canada devrait pouvoir servir au Congo, que la Zambie peut servir en Afghanistan, etc., même si, en réalité, les moyens ne sont pas les mêmes. Au moins, le principe d'universalité est respecté.
Or, depuis une dizaine d'années, à quoi assiste-t-on? On assiste à des missions de maintien de la paix dirigées par des occidentaux blancs dans des missions prétendument sérieuses, comme dans les Balkans ou en Afghanistan, et à des opérations de maintien de la paix des Nations Unies dans les pays du tiers monde opérées et gérées par des pays du tiers monde.
C'est comme si la division du travail s'était faite au détriment du principe de l'universalité du maintien de la paix.
C'était ma réponse à la première partie de votre question. Pouvez-vous me rappeler quelle était la seconde?
À 
 (1030)
(1030)
À 
 (1035)
(1035)


Le président: Que pensez-vous de la situation au Darfour?


M. Jocelyn Coulon: Le problème du Darfour, comme tous les autres problèmes africains, peut être géré par l'entremise des organismes africains que sont l'Union africaine et d'autres organisations sous-régionales, avec des soldats africains et l'appui logistique des pays occidentaux. Cette possibilité est d'ailleurs en train de se négocier avec l'OTAN, ce qui est intéressant, à mon avis. Cependant, le principe d'universalité, encore une fois, n'est pas respecté. Il n'y a pas de soldats occidentaux au Darfour. Y en a-t-il un besoin immédiat? Je ne le sais pas. Peut-être faudrait-il une analyse plus fine de ce qui se passe au Darfour, mais il serait bien que des pays occidentaux participent aussi au règlement de la tragédie du Darfour, pour montrer que cela nous préoccupe et pour montrer que nous sommes même, parfois, prêts à sacrifier nos soldats pour le Darfour.
Depuis dix ans, mon sentiment est le suivant. Les Occidentaux sont très réticents à sacrifier leurs soldats en les envoyant au Rwanda, au Congo ou au Darfour. Je le déplore.


Le président: Merci monsieur Coulon.
Monsieur Burney, vous avez la parole.
[Traduction]


M. Derek H. Burney: En réponse à votre première question sur la confiance et sur le respect, la première chose que nous devons faire, c'est d'admettre qu'il existe un problème à cet égard. Cela ne va nécessairement de soi. Nous devons d'abord reconnaître qu'il y a un problème sur lequel nous devons nous pencher et nous devons trouver un moyen de le faire. Nous devons cesser ces débats acrimonieux et changer le ton du dialogue public avec les États-Unis.
Le Canada devrait prendre l'initiative de demander une renégociation du NORAD. L'accord n'expire pas avant 2006, mais nous devrions prendre l'initiative. Nous devrions joindre l'acte à la parole et s'assurer de ne pas dire que nous allons faire quelque chose pour ensuite ne pas le faire. Nous devrions bien expliquer au public ainsi qu'aux Américains nos objectifs pour renégocier le NORAD et nous devrions les amener à participer au processus le plus tôt possible.
Les ministres ainsi que le premier ministre doivent convenir des objectifs que nous poursuivrons pour que nous puissions régler certains des problèmes qui se posent et pour que nous développions un véritable respect mutuel afin que nous n'ayons pas continuellement à faire face à des surprises.
Un engagement de haut niveau dans ce domaine ne permettra pas de régler tous les problèmes qui se posent entre nos deux pays, mais cela nous permettra d'accomplir deux choses. Lorsque les communications sont bonnes aux échelons supérieurs, cela se transmet aux échelons inférieurs et l'objectif devient celui-ci : « Comment pouvons-nous réduire, sinon éliminer, certains irritants? » Le message devient très clair et c'est ce que les fonctionnaires, que cela leur plaise ou non, se sentent tenus de faire. Si ce sont d'autres types de messages qui sont transmis aux échelons supérieurs, le message qui est donné aux fonctionnaires est celui-ci : « Trouvez des façons d'insister sur nos différences et de les exploiter. » J'ai pu constater les deux types d'attitudes.
La diplomatie repose sur l'accès aux dirigeants d'un pays. Lorsqu'on a cet accès, on s'en sert. Lorsqu'on ne l'a pas, il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire. Si le ton adopté aux échelons supérieurs n'est pas positif, nos diplomates à Washington n'auront pas le même type d'accès aux dirigeants américains que celui qui peut mener à un véritable respect. C'est assez difficile d'obtenir du respect si personne ne veut vous rappeler. C'est assez difficile d'obtenir du respect si personne ne veut vous rencontrer. Le message doit donc venir des échelons supérieurs. Il faut que nos dirigeants s'entendent sur la nécessité de trouver une solution au problème des communications ainsi que sur le fait que nous voulons trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Nous devons ensuite mettre les Américains au défi de répondre à notre invitation.
Quant à la meilleure façon de combattre le protectionnisme, même si nous ne sommes pas la cible... la cible ces jours-ci est la Chine et on peut s'attendre à tout du Congrès si le déficit commercial avec la Chine continue d'augmenter.
Je suis un ancien joueur de football et un ancien joueur de hockey. Parfois, la meilleure façon de se défendre est d'attaquer. Nous devons donc nous entendre avec les Américains sur une politique commerciale constructive. Il ne faut pas nécessairement aller aussi loin qu'une union douanière. Nous pouvons faire beaucoup pour réduire la tension et les sources de friction comme la congestion à la frontière dont nous avons parlé, mais nous devons prendre l'initiative. Nous ne pouvons pas demeurer passifs. Nous devrions prendre l'initiative et proposer aux Américains des solutions qui seront aussi avantageuses pour eux que pour nous.
À mon avis, la plus grande menace à notre prospérité à long terme, c'est de tenir pour acquise la relation que nous avons avec les États-Unis. Nous pouvons organiser des missions commerciales dans le monde entier, mais quel que soit leur succès, nos échanges avec les pays visés ne représenteront même pas 2 p. 100 de nos échanges commerciaux quotidiens avec les États-Unis. Nous devrions le reconnaître. Une offensive positive est la meilleure défense contre le protectionnisme américain.
À 
 (1040)
(1040)


Le président: Merci, monsieur Burney.
Nous allons maintenant passer à M. Bevilacqua avec une ou deux questions, après quoi nous terminerons avec Mme McDonough.
Vous avez la parole.


M. Maurizio Bevilacqua (Vaughan, Lib.): Merci, monsieur le président.
Monsieur Burney, je vous remercie de votre exposé.
Nous avons parlé de toutes sortes de choses depuis la confiance jusqu'aux irritants en passant par les relations. Mais quelle que soit la relation, tout revient à la clarté de l'objectif, ce que nous voulons atteindre. Nous pouvons bien parler du bois d'oeuvre ou de la crise de la vache folle, mais la grosse question demeure si nous voulons ou non créer un véritable espace économique nord-américain. Comment voyons-nous la frontière? Voulons-nous vraiment discuter sérieusement d'une frontière étanche? Tout découlera de cela.
Peut-être le problème tient-il vraiment au fait que nous avons une attitude minimaliste, à l'exception manifestement de l'accord de libre-échange qui est en soi quelque chose de très gros. Le temps est-il venu d'abandonner cette attitude minimaliste pour tendre plutôt vers un coup d'éclat? À force de traiter les dossiers sous l'angle le plus minimaliste, on ne pense plus au tableau d'ensemble. Il s'agit de l'espace économique nord-américain. Comment allons-nous nous y prendre?
Déjà, dans nos usines, le pré-dédouanement, et cela a réduit l'effet joué par la frontière.


M. Derek H. Burney: Tout à fait.


L'hon. Maurizio Bevilacqua: C'est donc la frontière qui est le problème. J'aimerais avoir votre réflexion à ce sujet.


M. Derek H. Burney: Mais dans ce genre de terminologie, je prends bien garde d'éviter des expressions comme « coup d'éclat. »
À 
 (1045)
(1045)


L'hon. Maurizio Bevilacqua: Mais vous me comprenez, n'est-ce pas.


M. Derek H. Burney: Je vous comprends tout à fait, et certains de mes anciens collègues épousent tout à fait cette opinion. Et peu importe pour moi comment on qualifie cela. Il nous faut un agenda commun. J'ai tenté de délimiter un certain nombre de secteurs où à mon avis, si j'avais dû rédiger un communiqué lors de la rencontre entre le premier ministre et le président, nous aurions pu parler de certains dossiers relativement gros. Tant et aussi longtemps que les deux dirigeants veulent vraiment un résultat concret plus qu'une simple conférence de presse, à ce moment-là il se passera quelque chose.
Ce qui m'inquiète, c'est que bien souvent, les communiqués de presse tracent des programmes pour les fonctionnaires. C'est ce que j'ai pu constater à l'issue de la rencontre de Waco en novembre. Les réunions qui ont eu lieu depuis six mois ont délimité un programme raisonnable, un plan de travail de terrain, et c'est ce qu'on trouve dans l'énoncé de politique international. Par contre, je n'ai senti chez les instances dirigeantes au sommet aucun véritable enthousiasme politique qui leur aurait fait dire : « Dans ce dossier, nous voulons des résultats. » Si on ne fixe pas d'échéance aux fonctionnaires, ils trouveront toujours tout le temps du monde pour continuer à étudier ce genre de choses jusqu'à plus soif.
Je n'aime donc pas des expressions comme « Coup d'éclat ». Nous devons faire quelque chose pour attirer leur attention. À l'heure actuelle, nous ne sommes même pas sur les écrans radar de Washington, que cela nous plaise ou non. Peut-être cela plaît-il à certains Canadiens.
Pour commencer, nous devons attirer leur attention. Pendant les négociations sur le libre-échange, l'un de nos plus gros problèmes était que nous ne parvenions pas à attirer leur attention. Nous avions un négociateur à Washington, un fonctionnaire de second rang qui n'avait aucun contact quel qu'il soit avec des instances supérieures. C'est pour cela que les négociations ont piétiné pendant environ un an et demi. Ce n'est que lorsque le président et le secrétaire du Trésor sont intervenus que nous avons pu avoir un résultat.
Alors il ne faut pas nous leurrer, comme nous avons souvent tendance à le faire au Canada, et il ne faut pas que nous pensions que si, tout d'un coup, nous avions un accès de courage et si nous décidions de faire quelque chose de grand avec les Américains, que ceux-ci n'attendraient que cela et qu'ils seraient prêts à répondre à l'appel. Il faut d'abord nous raccommoder avec eux, retrouver leur confiance et leur respect avant qu'ils soient prêts à répondre à un agenda positif.
Est-ce possible? Tout à fait, mais ce n'est pas le genre de choses qu'on peut faire une fois tous les trois mois. Il faut une insistance de tous les instants. Peut-être n'aimons-nous pas cela, mais c'est la réalité. Nous avons dû travailler d'arrache-pied pour que les Américains mobilisent leur attention à la table de négociations du libre-échange. Ils ignoraient totalement l'importance du libre-échange pour le Canada, à tel point que nous avons pratiquement échoué. Lorsqu'ils se sont réveillés, c'était déjà presque trop tard.
Il ne faut donc pas partir de l'idée fausse que, pour la seule raison que, tout d'un coup, nous déciderions de nous réunir et de négocier toutes sortes de choses avec les Américains, ceux-ci vont répondre présent? point. L'un de nos plus gros problèmes c'est qu'actuellement, Washington n'a pas vraiment très envie de faire quoique ce soit avec le Canada.
Vous vouliez de la provocation? Que dites-vous de cela.


L'hon. Maurizio Bevilacqua: En effet.
Au bout du compte, les pays agissent surtout dans leur propre intérêt. Ainsi, pour les États-Unis, l'énergie est un intérêt par rapport au Canada. Même un pays aussi puissant que les États-Unis sait fort bien que le Canada pourrait en fait l'aider passablement.
À mon avis, ce que nous devons souligner, c'est le fait qu'en Amérique du Nord nous n'avons pas encore vraiment tiré parti au maximum d'une véritable zone de libre-échange. Je ne pense pas que, dans le domaine de la productivité, nous ayons gagné autant que nous aurions pu le faire, et la même chose pour ce qui est de l'innovation. Même en ce qui concerne la question du travail, nous n'avons pas autant profité que nous l'aurions pu, de sorte qu'il reste beaucoup de travail à faire.
La seule façon pour nous de parvenir à vendre cela aux Américains, ce serait manifestement de leur dire très clairement où sont leurs intérêts.


M. Derek H. Burney: Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire, mais il ne faut jamais perdre de vue le fait que, s'il n'y avait pas eu l'accord de libre-échange, notre productivité serait bien plus mauvaise et ce serait la même chose pour toute une série d'autres domaines. Mais cela, c'est une autre question.
J'ai dit que l'énergie était l'un des points forts du Canada. C'est quelque chose qui devrait attirer leur attention, mais regardez ce qui se passe dans le cas de la vallée du Mackenzie. Où allons-nous? Nulle part. Et que font-ils en Alaska? L'Alaska avance à toute vapeur avec des subventions comme on n'en a jamais vues. Le Congrès est prêt à les subventionner à mort, alors que nous restons embourbés dans le labyrinthe réglementaire. Nous avons 30 000 pages de mémoire, le consortium a déjà dépensé 350 millions de dollars pour obtenir les autorisations nécessaires, et on parle maintenant de 2011, pas même de 2009 ou même de 2010, mais de 2011.
Pourquoi ne pas nous décider à faire quelque chose qui répondrait en premier lieu aux intérêts du Canada? Un intérêt égoïste? Tout à fait, mais ce serait également un excellent atout que nous pourrions utiliser dans le cadre de négociations élargies avec les Américains.
Réfléchissez-y un peu. Si le Venezuela, avec son régime actuel, quel que soit le nom qu'on veuille lui donner, décidait du jour au lendemain de ne plus livrer son pétrole aux États-Unis—ce qu'il pourrait fort bien faire s'il avait un accord parallèle avec la Chine ou un autre pays—, est-ce que le Canada pourrait le remplacer? Si vous posez la question à l'industrie, elle vous répondra oui, du point de vue de la ressource, mais que nous n'avons pas les installations pour livrer ce pétrole étant donné que nous n'avons rien investi à cet égard pour répondre à la demande du marché américain.
Alors, demandez-vous un peu pourquoi nous ne l'avons pas fait. Ne serait-il pas logique pour le gouvernement fédéral de faire ce genre de choses? Est-ce que cela n'empiétera pas sur les compétences provinciales en matière de ressources? Est-ce que le transport n'est pas précisément un domaine dans lequel le gouvernement fédéral devrait prendre l'initiative? Je pense que si. C'est ce qu'il devrait faire à mon avis.
On pourrait continuer longtemps. On pourrait parler du cours inférieur du Churchill. On pourrait parler de toutes sortes de choses que nous pourrions faire dans notre propre intérêt avant tout, mais qui serviraient à un programme nord-américain au sens plus large. Je ne pense pas qu'en cela le Canada se sente vraiment pressé d'agir. Nous préférons laisser les choses se passer et permettre à tout le monde de dire son mot. Fort bien, mais au bout du compte, il y a un prix à payer.


Le président: Merci, Monsieur Burney.
Nous passerons à Mme McDonough.


Mme Alexa McDonough: Merci, monsieur le président.
Il y a deux choses que je voudrais rapidement approfondir parce que je sais que nous allons manquer de temps. Tout d'abord, je suis toujours un peu mal à l'aise avec l'idée de M. Coulon que s'il est impossible pour nous d'arriver à nos objectifs, pourquoi les annoncer? N'est-il pas préférable de simplement les abandonner?
Je voudrais également des éclaircissements sur ce que vous voulez dire en parlant de l'APD. L'une des choses qui a tout à fait enragé les gens, et je parle ici de ce prétendu énoncé de politique nationale, cela a été le refus de fixer des objectifs et de faire après cela ce que sait fort bien faire notre premier ministre, contre vents et marées, fixer des cibles et des échéances autour d'un plan d'exécution. Nous avez-vous bien dit qu'à votre avis, il est impossible pour nous d'atteindre nos objectifs d'APD, de les fixer et de les atteindre?
En second lieu, monsieur Burney, j'aimerais aussi approfondir un peu certaines préoccupations qui ont été largement commentées, et que je partage d'ailleurs, comme je l'ai déjà dit ce matin, en l'occurrence que si nous nous contentons de gestes de relations publiques ou de simples actes de petite politique pour donner suite aux questions pourtant très sérieuses de sécurité, cela n'est guère productif et au contraire, les conséquences pourraient être même vachement graves.
J'ai cité le cas du port d'Halifax. Je sais que mes collègues, les députés venant de Windsor, Brian Masse et Joe Comartin, se sont coupés en quatre pour essayer d'apporter une solution aux problèmes de la sécurité de la frontière, etc.
Et je voudrais dans le même ordre d'idées parler d'un autre secteur de préoccupation, en l'occurrence le fait qu'au nom de la sécurité, on fait beaucoup en invoquant la sécurité, mais cela en portant très gravement préjudice à la vie des gens. Je vais dire deux mots de l'enquête Arar. Au nom de la sécurité, nous avons oblitéré la transparence, nous avons totalement négligé de divulguer des choses, nous avons foulé au pied les droits humains et les libertés civiles, tout cela au nom de la sécurité dans le cadre de ce qui est censé être une enquête publique. Comme quelqu'un d'autre l'a dit, dès lors qu'on foule au pied des droits humains en invoquant la sécurité publique, au bout du compte il n'y a plus de droits, ni de sécurité.
Je voudrais donc votre avis sur cette chose très grave qui consiste à prétendre que nous travaillons vraiment pour la sécurité. Peut-être devrions-nous songer à ces vedettes de patrouille pour nos ports, peut-être devrions nous songer à faire quelque chose pour la frontière, mais il faut également réfléchir davantage à tout ce que nous faisons au nom de la sécurité et qui, en fait, provoque beaucoup d'insécurité et a des conséquences assez dangereuses.
À 
 (1050)
(1050)
[Français]


M. Jocelyn Coulon: Merci, madame la députée, de me permettre de préciser certaines choses.
Comme vous le savez, le débat sur l'aide au développement dure maintenant depuis 30 ou 35 ans. C'est Lester B. Pearson, si je me souviens bien, qui a fixé l'objectif du taux de 0,7 p. 100. Ce taux de 0,7 p. 100 est devenu, avec le temps, une espèce de mythe, de vache sacrée intouchable, un symbole auquel il faut constamment se référer pour pourvoir atteindre des objectifs de politique étrangère, bien sûr, et d'aide au développement.
Pourquoi s'en tenir à ce taux? L'important pour le Canada est d'augmenter son aide au développement, de mieux la cibler et de l'accorder aux États qui en ont véritablement besoin. Il semble qu'on a parfois aidé des pays en développement qui sont pratiquement devenus des pays industrialisés. C'est d'ailleurs un peu pour cela que l'ACDI a commencé à réviser la liste des pays en développement. On s'est dit qu'au lieu d'aider 120 ou 130 pays, il serait peut-être mieux de se concentrer sur 25 pays. Cependant, l'idée d'atteindre un objectif...
[Traduction]


Mme Alexa McDonough: Ce sont là des choix parfaitement légitimes en matière politique, mais ma question portait précisément sur l'APD. Il y a beaucoup de pays—qui ont souvent d'ailleurs moins de ressources que nous—qui ont déjà atteint, voire dépasser l'objectif en matière d'APD.


M. Jocelyn Coulon: Je le sais.


Mme Alexa McDonough: Si on n'atteint pas ces objectifs, cela veut dire que tout ce qui a été fait autour des objectifs en matière de développement pour le millénaire passe à la poubelle. Est-ce que vous remettez en question cet objectif de 0,7 p. 100 et l'élaboration d'un plan d'exécution, est-ce selon vous quelque chose dont nous devrions nous passer? En fait, je vous demande simplement de répondre par oui ou par non parce que nous allons manquer de temps.
C'est ma question.
[Français]


M. Jocelyn Coulon: Oui. Je pense qu'on ne doit pas fixer de règles absolues, de norme absolue. On doit faire de l'aide au développement, point à la ligne. C'est comme pour le maintien de la paix. Nous n'avons pas à dire que nous allons déployer 3 000 soldats et n'en déployer que 2 000, car ensuite, on nous reprochera de ne pas avoir respecté notre décision. Cela me semble illusoire et cela nous met dans une position inconfortable à chaque fois.
[Traduction]


Le président: Monsieur Burney, une dernière intervention.


M. Derek H. Burney: Je pense que ce serait idiot de laisser entendre que j'ai la réponse à votre question, parce que je n'en ai pas. Je reconnais qu'il y a un problème et je partage vos préoccupations, parce que c'est manifestement un domaine dans lequel il nous faut atteindre un équilibre délicat entre la protection des droits des particuliers et l'assurance d'une sécurité appropriée dans notre pays.
En vous écoutant poser la question, j'ai pensé que je fais partie de plusieurs conseils d'administration et, comme vous le savez, la gouvernance d'entreprise est à la mode ce mois-ci. De plus en plus d'efforts sont consentis au sein des entreprises pour s'assurer que les employés, qui sont témoins d'exemples de méfaits de toutes sortes, aient un accès direct au conseil d'administration, aient un accès direct aux cadres supérieurs de l'entreprise, d'une façon, très honnêtement, sans précédent.
Je ne peux m'empêcher de penser que nous avons besoin de voir, en tant que gouvernement, les voies de communication que les citoyens pourraient utiliser, que ce soit un ombudsman ou un protecteur du citoyen, que ce soit pour un dénonciateur, ou que ce soit quelque chose de ce genre, afin que nous ne nous retrouvions pas pris dans ce miasme de...
Vous savez, je n'ai pas suivi l'affaire Arar d'aussi près que vous, manifestement.
À  (1055)
(1055)


Mme Alexa McDonough: C'est difficile à suivre. C'est dans une chambre fermée pendant 67 jours.


M. Derek H. Burney: Et tout est occulté.
La seule suggestion que j'aurais—et je ne prétends pas que c'est une réponse complète à votre question tout à fait légitime—serait de considérer certains des recours qui émergent au nom de la gouvernance d'entreprise pour la conduite de sociétés privées, pour voir s'il existe un parallèle quelconque là, afin que les citoyens dont les droits ont été transgressés n'aient pas à attendre cinq ans pour un minimum de justice de la part du système.

Le président: Merci beaucoup, monsieur Burney.
Monsieur Coulon, merci beaucoup d'être venu ce matin. C'était très intéressant et nous avons beaucoup apprécié.
Je vais interrompre la séance pendant deux minutes, puis nous allons commencer avec la délégation de Croates pendant à peu près 15 à 17 minutes. La cloche sonne et nous allons devoir voter à 11 h 25 à la Chambre. J'interromps cette séance pendant deux minutes.