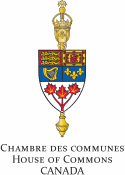:
Merci beaucoup d'avoir bien voulu m'inviter à témoigner aujourd'hui.
J'ai pensé consacrer une ou deux minutes à mettre en contexte l'initiative de finance sociale de la Banque Royale du Canada, avant de passer à une description et à l'explication des différents éléments du marché que nous identifions et avant de vous faire part de nos observations quant au rôle du gouvernement pour faire progresser ce domaine des finances.
Pour commencer, laissez-moi clarifier la façon dont nous définissons la finance sociale. Pour nous, la finance sociale est l'utilisation de capitaux privés dans les marchés financiers pour le bien de la société. Toujours pour bien mettre les choses en contexte, laissez-moi préciser que nous voyons dans le marché de la finance sociale trois éléments distincts, similaires à ce qu'on trouve dans n'importe quel marché financier: l'apport de capitaux, d'un côté, soit l'argent qui va à la finance sociale et au bien de la société; de l'autre côté, les entreprises, sociétés et associations qui ont besoin de capitaux pour apporter un bien à la société; et au milieu, bien sûr, les intermédiaires.
L'offre peut provenir de particuliers fortunés, de gouvernements, de banques ou d'investisseurs providentiels, par exemple. Côté demande, on trouve des sociétés à but non lucratif contribuant au bien de la société, des sociétés à but non lucratif, des projets, des coopératives, etc. Dans le volet intermédiaire, nous inclurions les institutions financières, les fonds et tout intermédiaire facilitant les flux de capitaux entre ceux qui disposent d'argent et ceux qui en ont besoin.
Une fois ceci posé, il est utile aussi, du moins dans notre secteur, d'envisager la gamme de la finance sociale. Quand on prend des capitaux et qu'on les utilise pour le bien de la société, les investisseurs qui assurent l'offre de capitaux, ont différentes façons de choisir l'emplacement. Il peut s'agir d'investissements traditionnels, où l'on choisit, parmi les sociétés cotées en bourse, celles qui sont les moins nuisibles dans leur secteur; ou, à l'autre extrême, d'investissements pour les répercussions ou de philanthropie de risque, où l'on recherche un placement ayant des répercussions sociales profondes, sans nécessairement se soucier de rendement. Il existe en fait un continuum d'investisseurs souhaitant fournir de l'argent dans le domaine de la finance sociale et il ne faut pas le perdre de vue.
En 2012, la Banque Royale du Canada a lancé sa propre initiative de finance sociale. L'idée était de faire en sorte que la banque soit positionnée comme catalyseur de la finance sociale au Canada et ce, grâce à quatre piliers.
Le premier pilier était d'investir dans le marché. Nous avons réservé une petite somme de capital, 10 millions de dollars, à l'investissement dans des sociétés en phase précoce ayant une mission sociale ou environnementale — mais uniquement des sociétés à but lucratif.
Le deuxième pilier était de prouver le pouvoir des fondations et des dotations oeuvrant dans cet espace. Nous nous sommes engagés à prendre au moins 10 millions de dollars de la RBC Dominion Security Foundation et de les investir pour le bien de la société. En fait, nous en sommes actuellement à environ 15 millions de dollars de dotation. Il s'agit plutôt d'investissements responsables, mais c'est quand même une pratique inhabituelle pour des fonds de dotation et des fonds institutionnels.
Le troisième pilier de l'initiative était celui ayant le plus d'effet, pour une grosse société comme la Banque Royale du Canada: jouer un rôle de catalyseur pour la finance sociale, imprimer le mouvement par le biais du leadership et de partenariats. C'est en fait l'élément essentiel pour développer ce pan du marché et permettre aux sociétés ayant besoin de financement de devenir de meilleurs placements. Nous parlons d'accélérer les accélérateurs, en fournissant du financement et un partenariat à des accélérateurs pour entreprises naissantes qui permettent de développer de meilleurs entrepreneurs et de meilleures entreprises sociales.
Le quatrième et dernier pilier consistait à identifier les occasions pour la Banque Royale du Canada d'incorporer la finance sociale dans ses affaires de base, soit les marchés de capitaux, la gestion de patrimoines, la gestion d'actifs, etc.
Voici donc les quatre piliers de l'initiative. La mesure du succès est bien sûr de savoir jusqu'à quel point on joue un rôle de catalyseur de la finance sociale, de savoir combien d'argent nous avons investi pour avoir des répercussions et de savoir combien d'entrepreneurs sociaux nous avons aidés.
Nous voulons aussi améliorer le bien commun dans divers secteurs par l'entremise de nos investissements. L'emploi est un secteur qui nous intéresse, surtout chez les jeunes et chez les personnes difficiles à placer. L'eau et l'énergie sont aussi des secteurs qui nous intéressent.
Évidemment, nous évaluons les incidences sur notre propre secteur. La finance sociale intéresse grandement nos collègues travaillant en gestion de patrimoines. Bien sûr, nous voulons nous assurer, lorsque c'est approprié, de cultiver nos relations d'affaires en maximisant les retombées positives découlant du leadership dans ce secteur dont fait preuve la Banque Royale du Canada.
Cela dit, nous avons jusqu'à présent investi près de 4 millions de dollars dans le but d'obtenir des retombées. Nous investissons depuis environ 18 mois. Nous comptons sept investissements. Nous avons aussi six partenariats stratégiques avec des accélérateurs de jeunes entreprises. Nous constatons que, grâce à nos investissements, nous avons aidé 80 personnes difficiles à placer à obtenir du travail en 2014 seulement. Nous recueillons donc diverses données.
Cela dit, ce qui nous importe le plus, c'est la raison d'être de notre initiative: ce que nous apprenons.
Voici quelques exemples de ce que nous avons appris.
La première chose que nous avons apprise c'est que les fonds disponibles pour la finance sociale au Canada croissent rapidement à partir d'une très petite base. Nous avons appris cela grâce à quelques études que nous avons menées l'an dernier. Il y a environ 1 billion de dollars d'actifs socialement responsables gérés au Canada, mais environ 4 à 5 milliards de dollars seulement de ce montant sont investis dans des domaines qui ont des retombées profondes, c'est-à-dire le genre d'investissement dont les retombées sociales sont profondément ancrées.
Nous constatons aussi que les investisseurs institutionnels, les fondations et les dotations, résistent à l'investissement à impact. Dans certains cas, il y a des raisons pour cette réticence que j'aborderai dans quelques instants.
Nous avons aussi découvert qu'au Canada environ 45 % des particuliers très fortunés croient que d'avoir une incidence sociale positive est très important ou extrêmement important. Fait intéressant, 75 % des gens âgés de moins de 40 ans sont de cet avis. Nous pensons que les investissements privés dans le bien commun susciteront bientôt une immense vague d'intérêt.
Nous avons découvert que les faibles possibilités d'investissement de qualité au Canada sont l'une des entraves à la croissance de l'investissement à impact. Dans le contexte gouvernemental, il importe de noter que les mesures et les données disponibles sur les incidences sociales et environnementales sont inadéquates. Il est donc difficile d'en déterminer les retombées.
Qu'est-ce que cela signifie pour le gouvernement?
Voici ma réponse en six points.
Commençons par la masse monétaire. En ce qui a trait à l'offre de capitaux pour la finance sociale, le gouvernement peut accomplir trois choses s'il souhaite jouer un rôle de premier plan. Dans certains cas, le gouvernement joue déjà un rôle.
Premièrement, il y a le rehaussement des crédits. Dans le secteur bancaire, cela est synonyme de garantie. Il s'agit de capital de première perte. En gros, il faut garantir l'investissement de départ dans les secteurs où vous souhaitez voir des investissements. C'est particulièrement important pour réduire le risque lié aux investissements précoces, que les petits investisseurs, qui ne peuvent se permettre de perdre de l'argent mais qui veulent participer à la finance sociale, seraient plus enclins à faire s'il y avait une certaine garantie quant au capital.
Deuxièmement, le gouvernement peut jouer un rôle important dans le développement de l'approvisionnement. Il faut préciser l'obligation fiduciaire des investisseurs institutionnels. À l'heure actuelle, et selon l'administration, les administrateurs de fonds de pension et de dotation au Canada ne savent pas s'ils vont à l'encontre de leur obligation fiduciaire en investissant dans le but d'obtenir des répercussions sociales plutôt que strictement dans le but d'obtenir un rendement.
Troisièmement, le gouvernement peut rendre les capitaux accessibles aux intermédiaires des fonds de placement. C'est le modèle employé par la Big Society Capital au Royaume-Uni, qui rend disponibles des fonds sans nécessairement injecter de l'argent provenant du gouvernement dans les entreprises.
Si le gouvernement rendait disponibles des données précises sociales au niveau des communautés, cela nous aiderait grandement. Par exemple, quelle est l'incidence sociale d'investir dans quelque chose? Quelle est la valeur donnée d'un problème social particulier et quel est le rendement qu'obtient la société en réglant ce problème? Par exemple, j'invente des chiffres pour les besoins de la cause, on obtient un rendement de 50 000 $ par année si une personne ne va pas en prison. Ou bien nous obtenons un rendement de x milliers de dollars par année en assurant qu'un enfant reste sur les bancs d'école, etc.
Bref, il s'agit de savoir quelle est la valeur financière des différents problèmes sociaux. Il faut rendre cette information disponible, il faut permettre aux gens de savoir facilement quand ils ont résolu un problème donné et permettre au gouvernement de savoir quelle répercussion cela a sur le contribuable et les coûts sociaux.
:
Bonjour depuis Vancouver. C'est brumeux aujourd'hui, comme d'habitude.
Monsieur le président et chers membres du comité, j'aimerais vous remercier de m'avoir invité à venir discuter du rôle que peut jouer le financement privé et institutionnel dans la solidarité sociale et le renforcement des collectivités canadiennes.
Je vous ai fourni quelques diapositives, quoiqu'un peu en retard. En fait, je ne vais pas suivre ces diapositives, mais si vous vous posez des questions à leur sujet, je serai heureux d'y répondre pendant la période de questions.
Je suis vice-président de l'investissement social à Vancity depuis septembre 2010. Vancity est la plus grande coopérative de crédit canadienne. Elle est située en Colombie-Britannique, et compte des actifs de plus de 19 milliards de dollars et un demi-million d'adhérents. Nous avons été fondés il y a 68 ans avec pour objectif de financer ceux qui ne pouvaient obtenir des crédits de la part des banques commerciales à l'est de la rue Main à Vancouver. Ce projet s'est avéré une très bonne affaire. C'était à la fois un bon investissement social et un bon projet commercial. En tant qu'institution financière en copropriété, Vancity se considère comme une entreprise sociale et prend très au sérieux ses investissements locaux, à un point tel que ce métier est chapeauté par un vice-président. C'est moi, et je travaille avec une équipe de 30 personnes.
Notre équipe travaille sur plusieurs fronts pour permettre à nos membres et leurs communautés locales d'avoir un meilleur accès au capital. Nous nous intéressons en particulier au logement abordable, aux aliments biologiques locaux et naturels, à l'efficacité énergétique, aux énergies renouvelables, aux communautés autochtones ainsi qu'à la finance sociale ou le capital-risque social. Nous nous employons à mettre le bilan de notre coopérative au profit de ces divers groupes. Autrement dit, nous nous occupons du développement commercial de notre coopérative.
Chez Vancity, nos investissements commerciaux sont fondés sur leurs retombées sociales, notamment dans les domaines susmentionnés. À l'heure actuelle, environ 40 % de notre portefeuille de 2 milliards de dollars est consacré aux investissements à impact social.
Il y a quatre ans, avec l'appui de la province de la Colombie-Britannique et de la Fondation Vancouver — c'était l'une des remarques de Sandra — nous avons établi le programme Resilient Capital, qui est un fonds constitué d'emprunt. Nous avons recueilli environ 15 millions de dollars de 24 investisseurs, y compris des établissements d'enseignement, des syndicats, l'État et des sources privées, dont des personnes bien nanties, et nous avons constitué un fonds pour appuyer des entreprises sociales. Ce fonds a permis de faire 26 investissements.
Nous participons et orientons BC Partners for Social Impact, table ronde panprovinciale et multisectorielle sur la finance sociale. Nous participons également au groupe spécial national sur la finance sociale sous l'égide du G7. De plus, nous coprésidons une table nationale sur l'investissement en finance sociale.
Je travaille en étroite collaboration avec un nouvel intermédiaire, New Market Funds, dont vous trouverez les détails dans les diapositives. Je travaille également de près avec Community Forward Fund, qui est un fonds pancanadien pour des prêts locaux.
Avant de me joindre à Vancity, j'ai été PDG de Housing Vermont, ce qui a beaucoup façonné ma vision des choses. C'est une organisation à but non lucratif qui détenait le fonds d'action immobilier Green Mountain et Vermont Rural Ventures. Essentiellement, c'est une société de développement et d'investissement à but non lucratif. Nous avons recueilli environ 125 millions de dollars en capital privé et administré des portefeuilles d'investissement privé constitués de logements abordables et d'installations publiques dont la valeur s'élève à environ 350 millions de dollars.
Housing Vermont a réparti ces fonds pour combler des besoins sociaux, immobiliers et économiques de concert avec les incitatifs fédéraux et étatiques qui existaient aux États-Unis. Ces incitatifs se déclinaient en plusieurs formes, à savoir des crédits d'impôt pour de nouveaux marchés, des crédits d'impôt pour le logement abordable et d'autres programmes étatiques et fédéraux, qui encourageaient les investisseurs privés à combler des besoins locaux.
De mon point de vue, c'est essentiel pour la réussite de la finance sociale. Il s'agit de conjuguer la discipline et les compétences qu'on retrouve dans les marchés de capitaux privés avec une volonté de faire des investissements charitables à l'échelle locale. Housing Vermont, c'était Vancity il y a 68 ans. Toute mesure que pourrait prendre le gouvernement pour créer un environnement propice à la finance sociale se traduira par un accroissement de l'investissement privé pour le bien de la société et des communautés.
La finance sociale au Canada n'en est qu'à ses débuts. On ne semble pas savoir sur quoi se concentrer. Souvent, on travaille sans obtenir de véritables résultats. Je suis certain que vous avez entendu bien des témoignages intéressants. À la base, le problème c'est que ce secteur est doté d'une capacité limitée. Sandra a notamment parlé d'améliorer le profil de ceux qui pourraient profiter des investissements. Je voudrais également faire remarquer que le secteur à but non lucratif a une perspective traditionnelle sur le capital et sa répartition.
La capacité de la communauté a largement réagi en fonction du financement gouvernemental, qui repose sur un profil de gestion des risques différent de celui des capitaux privés, ou bien elle a réagi en fonction d'oeuvres philanthropiques. Encore une fois, aucun des deux modèles ne fonctionne réellement pour la gestion des capitaux privés.
Il y a beaucoup de discussions sur les obligations à impact social. Selon mon expérience, ici en Colombie-Britannique et aux États-Unis, je demeure tout de même sceptique par rapport à cet engouement pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a un manque général de clarté sur ce que sont les obligations à impact social. Du point de vue de l'investissement, il s'agit de paiements convenus ou de rémunération au rendement. Le deuxième problème, qui je pense est plus important à ce stade précoce de la finance sociale est le suivant: dans un environnement où on met l'accent sur la réduction des dépenses gouvernementales, où l'on songe à économiser les deniers publics, il est difficile de faire adopter des obligations à impact social. Cela pourrait servir de manière à perturber ou réduire la prestation de services gouvernementaux cruciaux plutôt que d'en améliorer la réalisation ou l'efficacité.
J'encouragerais une analyse prudente de ces programmes, mais je préconiserais fortement que l'on travaille directement pour appuyer le développement d'une infrastructure de finances communautaires robuste au Canada.
Et je pense que ce travail commence avec l'ARC et le changement du régime réglementaire qui rend extrêmement difficile à l'heure actuelle le regroupement des investissements privés et des objectifs caritatifs, il faudrait établir clairement que des organismes caritatifs, des fondations et des investisseurs institutionnels peuvent investir dans des partenariats limités et faire en sorte d'éliminer les interdictions directes ou indirectes voulant que les organismes à but non lucratif puissent créer et détenir des revenus nets.
Les organismes à but non lucratif et le secteur communautaire en général doivent renforcer leur bilan. S'ils veulent gérer des fonds privés avec succès, comme on l'a vu aux États-Unis et en Grande-Bretagne, ce travail doit commencer par mettre fortement l'accent sur l'établissement de ce bilan. Tant aux États-Unis qu'en Grande-Bretagne, il y a eu une grande souplesse visant à permettre aux organismes à but non lucratif et caritatifs de mener à bien leurs initiatives avec des partenaires fournissant des capitaux privés. Il faut créer ce genre d'environnement, et c'est au coeur des problèmes qu'il faut régler d'emblée.
Un autre outil habilitant important consisterait à modifier légèrement les exigences des établissements financiers en matière de rapport, et je présente mes excuses à Sandra. Tous les établissements financiers et toutes les coopératives de crédit devraient obligatoirement faire rapport de leur niveau d'investissement dans la collectivité en fonction d'une norme commune. Il ne serait pas obligatoire de faire ces investissements, seulement d'en faire rapport. Le marché lui-même, comme l'a signalé Sandra, où un grand nombre de personnes de moins de 40 ans veulent s'assurer que leur argent est investi à bon escient aideront les marchés financiers plus officiels à déterminer comment s'y prendre dans le bon environnement. Créer un environnement réglementaire qui incite les établissements financiers à faire rapport sur plusieurs résultats plutôt qu'uniquement sur les bénéfices est absolument crucial.
Et finalement, le gouvernement fédéral devrait en faire davantage pour appuyer le rôle essentiel joué par les intermédiaires — et ça revient à ce que disait Sandra — comme la Banque Royale, Vancity, ainsi que des entités aussi petites que de nouveaux fonds du marché monétaire qui figurent dans le Fonds communautaire à terme.
Puisque les règlements fédéraux concernant les coopératives de crédit sont en cours de rédaction, je vous demanderais de vous rappeler — et je pense que c'est à l'étude devant le Parlement à l'heure actuelle — que le Canada n'a pas vraiment besoin davantage de petites banques. Les exigences de Bâle III ont été conçues pour palier les lacunes des grandes banques dans le secteur financier mondial, et elles ne devraient pas être l'instrument qui aplanit les différences apportées par les coopératives de crédit, c'est-à-dire notamment l'accent qu'elles mettent sur la construction des collectivités où vivent leurs membres.
Ces établissements et d'autres joueront un rôle essentiel dans la mise sur pied des capacités communautaires nécessaires pour gérer les capitaux privés et aussi pour la création de gestionnaires de fonds qui seraient en mesure de parler aux investisseurs privés et à leur rendre des comptes.
Aux États-Unis et en Grande-Bretagne, la finance sociale s'est développée en marchés robustes qui permettent de recueillir et de déployer d'énormes quantités de capitaux tout en respectant divers objectifs financiers. Si le gouvernement du Canada établit une politique et un environnement aussi conviviaux, les retombées seront très importantes.
Je suis prêt à répondre aux questions que vous pourriez avoir par rapport aux documents d'exposé que je vous ai fournis.
Je vous remercie.
:
Merci, monsieur le président.
Je tiens à remercier les membres du comité de nous avoir invités à participer à cette rencontre.
La Caisse d'économie solidaire Desjardins est une institution financière de nature coopérative qui est membre du Mouvement Desjardins, le premier groupe financier coopératif au Canada. Fort d'un actif de 227 milliards de dollars, le Mouvement Desjardins est considéré comme la quatrième institution financière la plus sûre en Amérique du Nord selon le magazine Global Finance, et la deuxième plus solide au monde selon l'agence d'information financière Bloomberg.
Avec son actif de 737 millions de dollars, la Caisse d'économie solidaire Desjardins joue depuis 44 ans un rôle prépondérant et reconnu au Québec en matière de finance sociale. Son actif a plus que doublé en 10 ans et les prêts aux entreprises sociales ont augmenté de 122 % au cours de la même période.
Le membership de la caisse est composé de 3 000 entreprises associatives ou coopératives issues de divers secteurs d'activité et de 12 000 individus. La caisse est un intermédiaire entre l'épargne — l'offre — et le financement des entreprises de l'économie sociale — la demande. Elle propose le placement à rendement social, soit un dépôt garanti par l'assurance-dépôts du Québec. En 2014, le volume de cette épargne était de 617 millions de dollars et le volume de prêts était de 622 millions de dollars, dont 477 millions de dollars pour financer directement des projets à impact social.
La caisse offre à ses emprunteurs une gamme de produits de crédit, de prêts à terme et de marges de crédit, et ce, généralement avec garanties, pour soutenir les activités et le développement des projets à finalité sociale.
Elle est aussi un membre très actif de Cap finance, le Réseau de la finance solidaire et responsable, que vous avez reçu récemment. Elle collabore avec ses partenaires financiers naturels issus des réseaux syndicaux ou associatifs pour compléter dans les montages financiers la portion sans garantie, soit du capital patient ou du capital de risque.
Dans le réseau du financement de l'économie sociale au Québec, elle est l'institution la plus importante. Elle compte pour plus de 40 % du volume total en finance sociale. Au Québec, selon le dernier portrait de la finance sociale, on parlait de 1,4 milliard de dollars. Au Canada, selon l'Association pour l'investissement responsable, cette finance sociale représente 4,3 milliards de dollars.
Il y a quelques exemples que je voudrais fournir à cet égard.
La caisse joue un rôle important dans le développement de l'habitation collective en permettant le financement de près de 10 000 logements sociaux au Québec. En 2014, ce secteur représentait plus de 50 % du portefeuille de prêts, pour une valeur de 262 millions de dollars.
La caisse est un partenaire financier de longue date de la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec, qu'elle finance à hauteur de 30 millions de dollars. Conjointement, nous avons mis en place des comptoirs de services financiers accessibles à la population inuite dans plusieurs villages. C'est un projet qui se consolide actuellement avec le Mouvement Desjardins. L'impact social est l'accès à un compte bancaire pour une population éloignée et répartie sur un vaste territoire.
La caisse est une institution financière solide et rentable. Dès sa création, son intention était de permettre, par la finance, que progresse une économie plus équitable, une économie au service de l'humain. La finance est donc un moyen et non une fin en soi. La recherche de rentabilité la distingue de l'action philanthropique. Cette rentabilité est nécessaire pour la survie des projets financés.
Les surplus dégagés par ses activités d'intermédiation financière sont en partie capitalisés pour assurer sa solidité financière. Depuis les débuts, les membres ont accepté que la partie des surplus qu'ils pourraient recevoir individuellement soit retournée à la communauté sous forme de ristournes collectives. Depuis plusieurs années, cela équivaut à près de 1 million de dollars remis annuellement sous forme de dons. Grâce à ces dons, la caisse a été la cofondatrice d'un réseau québécois innovant d'échange de services pour les personnes en situation de pauvreté. Cette initiative québécoise, appelée l'Accorderie, a été reprise en France et au Maroc.
Le logement, l'accès aux services financiers, la réinsertion en emploi, l'alphabétisation, les soins de santé, l'itinérance, la sécurité alimentaire et la protection de l'environnement sont des exemples d'enjeux auxquels les entreprises financées par la caisse ont choisi de s'attaquer afin de trouver des solutions.
Il existe une finance sociale parce qu'il existe une autre économie, à savoir l'économie sociale. La caisse voit la finance sociale comme une alternative à la finance traditionnelle. Elle a sa place au sein d'une économie mixte à côté de l'économie privée et de l'économie publique afin de soutenir le développement d'initiatives entrepreneuriales animées par une volonté de répondre aux besoins des personnes et des communautés, et non uniquement et en premier lieu par une recherche de profit et d'enrichissement personnel.
Cette économie sociale et la finance sociale qui la soutient méritent d'être reconnues et encouragées. Nous saluons l'initiative de ce comité et souhaitons que la finance et l'économie sociales soient reconnues et soutenues par le gouvernement fédéral, par exemple par les programmes suivants, à savoir des programmes d'aide au démarrage, des enveloppes pour la recherche-développement destinées aux entreprises d'économie sociale, des programmes de formation tant pour les administrateurs que pour les gestionnaires de coopératives ou d'associations et, finalement, des programmes de recherche pour documenter les répercussions et les innovations des entreprises sociales.
Je vous remercie.
:
Merci pour cette invitation.
Je crois que les panélistes précédents vous ont parlé de la finance sociale au sens large, des entreprises sociales, des obligations à impact social et du financement des fondations. Ce sont des sujets très importants et très prometteurs, mais je vous propose d'examiner la finance sociale sous un angle légèrement différent.
À Social Capital Partners, nous nous demandons souvent comment mobiliser le secteur privé dans la finance sociale et les investissements à impact social. Dans quelles conditions les acteurs du secteur privé auraient-ils envie d'améliorer notre société sans compromettre leur rendement financier? Répondre à cette question, c'est peut-être le meilleur moyen d'améliorer graduellement le rendement des deniers publics.
Je vais vous donner un exemple concret sur lequel nous avons travaillé, mais je tiens surtout à faire observer que, si nous pouvons innover dans ce domaine émergent qu'est la finance sociale, nous pourrons mobiliser le secteur privé comme jamais auparavant.
Mais avant, je souhaite vous parler brièvement de Social Capital Partners. Nous sommes une organisation à but non lucratif fondée par le philanthrope Bill Young, qui était membre du Groupe de travail canadien sur la finance sociale, dont vous avez entendu parler lors de séances précédentes. Nous nous consacrons à la finance sociale depuis 14 ans. Nous avons commencé par des investissements dans des entreprises sociales.
Après cinq ans, nous avons appris que les entreprises à vocation sociale peuvent avoir une véritable influence tout en étant financées en grande partie par leurs propres revenus, mais il est difficile de les faire croître. De par leur nature même, il est difficile de développer une jeune entreprise et encore plus difficile quand il faut se concentrer à la fois sur le rendement financier et les retombées sociales.
Nous ne pouvions conclure qu'un marché par année, car il fallait analyser le modèle économique de l'entreprise et veiller à ce qu'elle engrange des revenus sur le long terme. Nous nous sommes alors tournés vers le secteur privé et des modèles économiques fondés sur la croissance. Nous avons financé, à des taux attrayants, des entrepreneurs qui voulaient acheter ou développer des succursales, comme Mr. Lube ou Boston Pizza. En contrepartie, l'entrepreneur s'engageait à faire appel aux prestataires de services sociaux, comme le YMCA et Goodwill, pour doter une partie de son personnel.
Notre rendement financier était lié à notre impact social: pour chaque embauche, les taux d'intérêt diminuaient d'un pourcentagage x. Aujourd'hui, nous investissons dans environ 80 entreprises et, en moyenne, 25 % des employés de chaque entreprise proviennent de ces prestataires de services sociaux. Ces employés, à titre d'exemple, pourraient avoir un handicap, être au Canada depuis peu ou être un jeune à risque.
Nous servons d'intermédiaire entre les entrepreneurs et des organisations comme le YMCA. Nous veillons à ce que l'embauche soit dans l'intérêt des deux parties. Quelques travailleurs ont gravi les échelons, et nous pensons qu'ils pourront bientôt ouvrir leurs propres succursales. Nous serions, bien entendu, ravis de les financer.
Ce modèle a fait ses preuves à la fois du point de vue social et du point de vue financier. Le rendement de notre portefeuille s'élève à 7 %, le taux de prêts non remboursés étant de 2,4 %. Et à partir de là, quelle serait la prochaine étape? Comment faire passer notre portefeuille de 80 à 10 000 prêts? Imaginez que les banques adoptent la finance sociale dans toutes leurs succursales. Leur prêt de base serait assujetti par exemple à un taux d'intérêt correspondant au taux préférentiel plus 2 %, mais les clients pourraient faire baisser ce taux d'intérêt de 0,5 % en embauchant une personne défavorisée par l'intermédiaire de ces programmes. Peut-être vous demandez-vous qui va assumer le coût de cette réduction du taux? Je vais y répondre dans un instant.
Nous avons fait des analyses avec Deloitte. À partir du moment — cela dépend des groupes démographiques et des systèmes sociaux — quelqu'un passe de l'aide sociale à un statut d'employé, l'État économise environ 6 000 $ par personne après six mois d'emploi.
Comparez cela au coût de réduction du taux d'intérêt d'un demi pour cent pour un prêt de 200 000 $, soit un coût d'environ 3 000 $. Nous croyons que c'est dans l'intérêt économique du gouvernement de payer le coût de cette réduction du taux d'intérêt d'un demi pour cent par embauche puisque les économies sont de deux fois ce montant du coût. La réduction du taux d'intérêt n'entrera en vigueur qu'après une période d'emploi de six mois, de sorte qu'il y aura très peu de risques pour le gouvernement. Il s'agit d'un simple modèle de paiement en fonction de la réussite. On tire parti de certains éléments d'une obligation à impact social — je sais qu'on vous a fait des exposés sur le sujet — tout en minimisant la complexité d'une telle structure.
Nous avons présenté cette idée au ministère du Développement économique, de l'Emploi et de l'Infrastructure de l'Ontario, qui veut en faire un projet pilote. Nous avons travaillé avec les banques au cours des derniers mois et hier, nous avons tenu un atelier pour parler des modalités d'une entente avec les trois banques intéressées. Nous allons faire de même avec les caisses populaires dans deux semaines.
Au sujet de cette possibilité — et je ne suis pas là aujourd'hui pour vous vendre une idée, mais simplement pour vous la signaler —, Deloitte estime qu'avec 10 000 prêts, le gouvernement pourrait faire des économies nettes d'environ 140 millions de dollars, que 40 000 postes pourraient être comblés par des personnes vulnérables, qu'on pourrait voir une réduction du taux d'intérêt de 2 % pour les employés, et que les agences communautaires et certaines institutions financières pourraient fournir un soutien à l'embauche et réduire les taux d'intérêt, ce qui augmenterait les retombées sociales. Nous croyons qu'il s'agit d'un argument persuasif, mais ce que je veux dire c'est que quand on commence à avoir la participation des intervenants dans le secteur privé, on peut très rapidement augmenter l'impact social de manière exponentielle.
Je crois que des tendances et des modèles très intéressants se font jour et que la conjugaison de leurs effets pourrait donner des résultats très encourageants. Je pense à la finance sociale, aux valeurs partagées que prône Michael Porter, aux retombées collectives, aux laboratoires d'innovation, aux mesures d'incitation et aux théories sur les comportements. En fait, je pense que la Maison-Blanche a annoncé la semaine dernière la mise sur pied d'une équipe semblable à celle qui a été créée par le gouvernement du Royaume-Uni pour étudier ces questions.
On n'a pas le temps d'en parler en détail, mais, à mon avis, l'essentiel c'est qu'il faut changer les comportements, encourager de nouvelles façons de travailler et associer de nouveaux intervenants. Nous changeons le comportement des employeurs pour qu'ils embauchent les personnes handicapées, des néo-Canadiens, des jeunes à risque, etc. Nous offrons un incitatif peu cher qui prend la forme d'une réduction du taux d'intérêt et nous utilisons les canaux de distribution des banques et des caisses populaires pour faire augmenter de 80 à 10 000 le nombre d'employeurs qui participent.
Finalement et dans la même veine, nous pensons qu'il serait très intéressant d'examiner les programmes gouvernementaux qui visent le secteur privé, et d'y ajouter un aspect social. Je pense au programme de financement des petites entreprises du Canada. Essentiellement, le gouvernement se porte garant à hauteur de 80 % du prêt donné par les institutions financières à des petites et moyennes organisations auxquelles les banques ne feraient pas de prêts en raison des risques. Imaginez qu'on ajoute à cela un aspect social, que ce soit par le biais des embauches, des panneaux solaires installés sur le toit des entreprises, ou autre chose. À notre avis, ce serait un modèle très intéressant. Il y a bien d'autres modèles comme celui-là, et ce serait très intéressant de les étudier.
Merci.
:
Merci beaucoup de me donner l'occasion d'entretenir les membres du comité au sujet de cette question très importante.
Mes observations vont dans le sens de celles formulées par Magnus à propos du rôle du secteur privé comme facilitateur en matière de finance sociale. Je commencerai par offrir au comité ma perspective sur la finance sociale, qui diffère peut-être un peu de ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant.
Quand je pense à la finance sociale, je pense d'abord aux parties prenantes. L'idée d'investir pour entraîner un rendement social et financier, ou un rendement mixte, est souvent l'apanage des organismes de bienfaisance ou à but non lucratif. Toutefois, la finance sociale ne concerne pas exclusivement les organismes de bienfaisance. Si on pense à un rendement mixte, il est tout aussi valable d'envisager d'appliquer la finance sociale aux activités des organismes à but lucratif et des entreprises comme celles dont Magnus a parlé.
En effet, de plus en plus d'entreprises intègrent dans leur mandat le souhait de vraiment s'attaquer aux problèmes sociaux qui existent dans la société. Dans cette optique, l'aspect juridique n'est pas un préalable à la finance sociale.
Ma perspective porte aussi sur le volet de la finance sociale qui va au-delà de l'investissement comme tel. Tout un éventail d'acteurs participent à la finance sociale sous une forme ou sous une autre, et dans certains cas, il peut y avoir bien des raisons de distinguer les acteurs de l'investissement proprement dit.
Voici un exemple qui peut sembler anodin. J'enseigne un cours d'entrepreneuriat social et d'investissement d'impact, une sous-catégorie de la finance sociale, aux étudiants en génie de l'Université de Toronto. On pourrait croire qu'il est étrange de rassembler des étudiants en entrepreneuriat social et en génie pour aborder la finance sociale, mais il s'agit d'une excellente occasion de présenter le concept de la finance sociale à différentes personnes provenant de différents milieux.
J'offre aussi des conseils à un groupe nommé ABC Life Literacy. Je pense même que Gilian Mason, une représentante de cet organisme, témoignera devant le comité plus tard cette semaine. Au sein de son organisme, Gilian s'intéresse à la finance sociale, non seulement comme bénéficiaire potentielle d'un investissement social, mais aussi pour avoir la possibilité d'aider d'autres personnes à prendre part à la finance sociale.
Les incubateurs d'entreprises, les cabinets d'experts-conseils et d'avocats, les initiatives de surveillance et d'évaluation, les agences du gouvernement, voilà des exemples d'entités qui peuvent contribuer au développement de l'écosystème de la finance sociale au Canada. La finance sociale représente par conséquent un regroupement de différentes formes d'activités économiques.
Troisièmement, on peut voir la finance sociale comme un instrument qui peut aider à abattre les cloisons traditionnelles qui séparent les secteurs économiques.
Un dénommé Antony Bugg-Levine, le PDG de Nonprofit Finance Fund, un conférencier renommé et un chef de file en matière de finance sociale, évoque souvent la bifurcation de notre monde dans lequel on investit d'un côté seulement pour faire de l'argent ou à des fins de gain personnel, et de l'autre côté on résout des problèmes sociaux au moyen d'oeuvres de bienfaisance ou d'organismes oeuvrant pour le bien public.
La finance sociale fait tomber ces barrières. Grâce à la finance sociale, les acteurs du secteur privé ayant de bonnes intentions et motivations peuvent investir et conjuguer le bien privé et le gain personnel. Dans un tel modèle, le gouvernement est amené à jouer un rôle différent. Au moyen d'outils de finance sociale, le gouvernement peut créer des incitatifs destinés aux acteurs du privé et établir des critères pour financer le bien public.
Mon entreprise, Purpose Capital, a été fondée dans cette optique. Mes partenaires et moi-même avons lancé notre entreprise dans le but de mobiliser toutes les formes de capital — financier, physique, humain et social — pour accélérer le progrès social. Nous voulons faire le pont entre les entreprises et les organismes, qui souhaitent créer un monde meilleur, et les investisseurs qui souhaitent entraîner des retombées financières et sociales concrètes.
Nous avons différentes expériences de la finance sociale. Nous nous spécialisons notamment dans le service-conseil auprès de détenteurs d'actifs pour l'élaboration de stratégies en finance sociale.
Prenez l'exemple de nos travaux auprès de la Fondation Inspirit. La mission de la fondation consiste à valoriser le pluralisme auprès de jeunes Canadiens provenant de différents milieux spirituels, religieux, ou encore laïques. L'organisme remplit sa mission grâce à un programme national novateur et un engagement grâce à un placement axé sur la mission.
Purpose Capital collabore avec la Fondation Inspirit depuis janvier 2014. Nous veillons à la définition, à la mise en oeuvre et au suivi de leur programme de placement, qui consacre 5 % de leurs fonds de dotation à la mission.
Nous sommes heureux de collaborer avec Inspirit qui définit et élargit son engagement à l'égard de l'investissement d'impact. Nous croyons que les investisseurs comme la Fondation Inspirit constituent l'exemple parfait de participants en finance sociale. La fondation possède les actifs nécessaires pour investir et le souhait manifeste d'intégrer les retombées sociales à ses stratégies d'investissement. Ce type d'entreprise constitue plutôt l'exception et non la norme quand il est question d'investissements d'impact ou de finance sociale.
D'autres investisseurs ont besoin d'organismes comme le nôtre, qui jouent un rôle plus actif pour ce qui est de faire tomber les obstacles perçus ou réels à l'investissement.
Notre organisme s'occupe aussi de susciter des possibilités d'investissements en finance sociale. Nous travaillons avec les détenteurs d'actifs non seulement dans le but de les conseiller, mais aussi pour structurer les occasions.
Laissez-moi vous donner un exemple de notre travail dans ce cas-là. Le projet dont il est question en est encore à l'étape embryonnaire, mais la créativité qu'il implique est une source de fierté pour nous et illustre bien la perspective dont j'ai parlé plus tôt. Il s'agit de ce qu'on appelle le fonds des communautés résilientes. C'est une initiative qui vise à repenser la façon dont le logement abordable est financé et construit. Au lieu de se concentrer sur ce qu'on pourrait appeler les partenaires habituels en matière de développement de logement abordable soit le gouvernement et les agences à but non lucratif, le FCR mise sur des investisseurs en immobilier motivés par les profits pour financer le caractère abordable du logement. Les investisseurs achètent des propriétés à l'aide d'une hypothèque obtenue par le truchement du FCR et louent ces propriétés à une personne en besoin de logement abordable.
Notre produit hypothécaire est lié à un fonds de dotation qui permet de réduire l'écart et de rendre le logement abordable pour le locataire. Le locataire paie selon ses moyens, et l'investisseur reçoit le taux du marché en retour.
De simples citoyens investissent dans la finance sociale, ce qui allège le fardeau pour les gouvernements et les organismes à but non lucratif qui en retour peuvent investir dans d'autres formes de logements et de programmes.
Maintenant que le comité comprend mieux de quoi il s'agit, je vais vous donner des pistes de participation du gouvernement fédéral à la finance sociale.
D'abord, je crois que le gouvernement devrait se considérer comme un catalyseur de la finance sociale. Autrement dit, le gouvernement pourrait trouver des moyens de favoriser un écosystème de finance sociale. Le gouvernement n'a pas à offrir de fonds. Il a plutôt un rôle plus important à jouer comme catalyseur. Un incitatif précis est le temps. L'expression qui veut que le temps soit de l'argent s'applique à la finance sociale tout comme à la finance traditionnelle.
Notre travail en matière de logement abordable et d'immobilier en est un exemple. Un processus d'approbation plus rapide pour les projets d'immobilier qui ont des répercussions sociales pourrait changer considérablement les données économiques d'un projet. D'un point de vue gouvernemental, les incitatifs peuvent être offerts de façon facile ou difficile. Je commence toujours par la première façon. Dans ce cas-ci, il s'agirait d'accorder la priorité aux changements mineurs aux politiques du gouvernement qui n'exigent pas de changements à la réglementation ou de nouvelles mesures législatives.
Le gouvernement peut ensuite jouer un rôle de catalyseur d'investissement. Le comité pourrait envisager un capital catalyseur. Une telle structure s'adresse à diverses catégories d'investisseurs, dont ceux qui s'intéressent à l'aspect social et d'autres, à l'aspect financier, du même investissement. Certains acceptent d'absorber un niveau convenu de perte, d'autres réduisent le risque associé à l'occasion d'investissement dans son ensemble. Grâce à la réduction du risque, un groupe d'investisseurs reçoit un retour qui correspond davantage à ses attentes en matière de risque et de rendement, soit normalement le taux du marché.
Puisqu'on parle de catalyseur, je vais vous offrir un dernier exemple, soit celui de Big Society Capital, dont on vous a déjà peut-être parlé.
Big Society Capital est une institution financière à vocation sociale au Royaume-Uni. Big Society Capital investit dans l'écosystème financier social au Royaume-Uni, qui en soit est une chose fantastique. Ce qui est le plus impressionnant, c'est la façon dont l'organisme a obtenu du capital. Le capital initial du fonds Big Society Capital provenait de comptes bancaires inactifs au Royaume-Uni. Les comptes bancaires inactifs étaient détenus par des gens qui ont cessé d'y accéder, parce qu'ils sont décédés, par exemple. Après une certaine période d'attente, les banques transfèrent les fonds de ces comptes à une série d'intermédiaires, et ces fonds finissent par être envoyés à Big Society Capital.
Pourquoi ce que je vous raconte est-il pertinent? Au Canada, les comptes bancaires inactifs représentaient environ 532 millions de dollars en décembre 2013. La Banque du Canada retient ces fonds pour une période de 40 ans avant de les transférer au receveur général du Canada. Je crois que ce serait extraordinaire que le gouvernement fédéral puisse reprendre le modèle et créer une forme de Big Society Capital au Canada pour démontrer son engagement à la croissance de la finance sociale.
Voilà qui met fin à mes remarques. Je vous remercie.