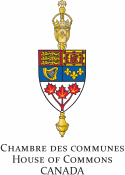:
Madame la présidente et honorables membres du comité, je vous remercie d'avoir invité la Commission canadienne des droits de la personne à s'adresser à vous sur le territoire traditionnel du peuple algonquin.
J'aborderai trois points importants.
Premièrement, il faut mettre en place un régime équitable, disponible et facile d'accès pour veiller au partage des biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves, car il s'agit d'un enjeu de droits de la personne à régler de toute urgence.
Deuxièmement, de nombreuses Premières Nations n'ont pas les ressources nécessaires pour mettre en place un régime efficace de partage des biens immobiliers matrimoniaux.
Troisièmement, le fait que la compétence de la commission soit contestée par certains pourrait nuire à sa capacité à traiter les plaintes qui concerneraient le régime de partage des biens immobiliers matrimoniaux dans les collectivités des Premières Nations.
[Traduction]
Les normes en matière de droits de la personne, tant internationales que nationales, exigent un traitement égal des femmes devant la loi. Ces mêmes normes préconisent aussi que les femmes et les enfants soient protégés contre la violence. Quand survient un divorce ou une séparation, les femmes qui vivent dans une réserve sont plus à risque d’être désavantagées. L’absence de régimes équitables de partage des biens immobiliers matrimoniaux les désavantage encore plus. J’en arrive à mon deuxième point.
Il semble que le projet de loi vise à fournir un mécanisme de partage des biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves en attendant que les Premières Nations créent leur propre régime. On prévoit que cette mesure sera temporaire, mais de nombreuses Premières Nations n’ont même pas les ressources financières et humaines nécessaires pour mettre en place un mécanisme efficace de règlement des différends. Cette question fait partie d’un enjeu plus vaste.
Des Premières Nations sont aussi limitées quant aux ressources dont elles auraient besoin pour concrétiser, dans les réserves, d’autres mesures liées aux biens immobiliers matrimoniaux comme le logement, les centres d’hébergement d’urgence, le counselling et les services d’aide juridique. C’est en menant des activités nécessitant la collaboration d’organisations des Premières Nations que la commission a pris conscience de cette réalité.
En collaboration avec plusieurs intervenants des Premières Nations, la commission a créé des outils pour accroître la capacité des Premières Nations à résoudre des différends liés aux droits de la personne dès qu’ils surviennent, chaque fois que c’est possible. Dans un grand nombre de collectivités, on nous a dit que la mise en oeuvre d’un tel régime ne serait pas possible avec les ressources qui sont actuellement à leur disposition. J’en arrive ainsi à mon troisième point.
Le fait que la compétence de la commission soit contestée par certains pourrait nuire à sa capacité à traiter des plaintes qui concerneraient un régime de partage des biens immobiliers matrimoniaux dans les collectivités des Premières Nations. En vertu de son mandat d’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne, la commission reçoit des plaintes de discrimination liées à des emplois et des services fournis par des organisations sous réglementation fédérale. Les gouvernements des Premières Nations en font partie.
En 2008, le Parlement a modifié la Loi canadienne sur les droits de la personne de manière à y inclure la Loi sur les Indiens du Canada. Cette modification a eu pour effet de permettre aux personnes vivant dans une réserve de porter plainte contre le gouvernement fédéral et leur propre gouvernement lorsqu’elles estiment subir de la discrimination. Même si le mandat de la commission est clair, sa compétence est remise en question.
En vertu de l’article 5 de la loi, la plupart des activités gouvernementales sont considérées comme étant un service. Cependant, la commission a reçu un grand nombre de plaintes contre le gouvernement fédéral sur des enjeux liés aux Autochtones qui ont été contestées par certaines personnes, dont le procureur général. La contestation porte notamment sur ce qui concerne un « service ». Si les contestataires obtiennent gain de cause, la Loi canadienne sur les droits de la personne pourrait ne plus s’appliquer à l’ensemble du financement alloué par le gouvernement du Canada pour les services.
Le projet de loi ne précise pas clairement que le régime de partage des biens immobiliers matrimoniaux serait considéré comme un service en vertu de la Loi.
Je terminerai en ajoutant que le comité a entendu ou entendra plusieurs témoins qui seront directement touchés par le projet de loi. À mon avis, les commentaires de ces personnes ont une importance capitale.
Je vous invite à répondre aux trois questions suivantes durant vos délibérations: premièrement, le projet de loi assure-t-il aux femmes un accès équitable à la justice? Deuxièmement, le projet de loi permet-il aux femmes de faire valoir leurs droits en toute sécurité? Troisièmement, les Premières Nations ont-elles la capacité nécessaire pour créer et mettre en place leur propre régime de partage des biens immobiliers matrimoniaux? Si elles ne l’ont pas, que peut-on faire pour régler ce problème?
Je vous remercie de votre attention. Je serai heureux de répondre à vos questions.
:
Oui, et merci d’avoir posé la question.
Vous vous souvenez peut-être que nous avons discuté de la période de transition lors du projet d’abrogation de l’article 67, et que celle-ci avait été portée à trois ans d’un commun accord. Selon notre expérience... en trois ans, nous avions bâti un modèle après les amendements constitutionnels qui s’étaient produits aussi. À l’époque — et j’établirais une analogie avec ce projet de loi —, on savait bien qu’au moment de l’adoption de la Loi canadienne sur les droits de la personne en 1977, la réserve inscrite à l’article 67 se voulait une mesure temporaire, laquelle bien sûr a duré 31 ans avant d’être finalement abrogée. Nous faisions remarquer qu’une période de transition d’un an ne suffirait pas aux gouvernements des Premières Nations qui n’avaient jamais été assujettis à la Loi canadienne sur les droits de la personne, alors que le gouvernement fédéral et les employeurs sous réglementation fédérale avaient eu 30 ans pour apprendre à fonctionner en vertu de la loi.
Nous avons accueilli favorablement et avons publiquement appuyé ce délai de trois ans sur lequel on s’est finalement entendu. Je peux dire que, selon notre expérience, même ces trois années ne sont pas nécessairement suffisantes, mais heureusement qu’on a accordé trois ans, parce que nous avons continué de travailler avec les gouvernements des Premières Nations à plus d’un chapitre, en particulier pour non seulement sensibiliser mais aussi outiller quant aux mécanismes extrajudiciaires de règlement des différends. Un certain nombre de collectivités en ont, beaucoup n’en ont pas, et un grand nombre nous demandent des conseils sur la façon d’en élaborer. Ce travail se poursuit, même si nous le faisons maintenant depuis juin 2008. Bien sûr, nous approchons du cinquième anniversaire de ce changement.
Donc, bien qu’une période suffisante soit appréciée, même pour la mobilisation de la collectivité, pour que les Premières Nations voient si elles souhaitent élaborer leurs propres lois, leurs propres règles visant les biens immobiliers matrimoniaux, même sans parler d’un mécanisme extrajudiciaire, une année pourrait ne pas suffire pour faire participer la collectivité.
:
Merci beaucoup et merci aux témoins.
Je crois que la dernière observation est très importante. Dans les villes et plus encore dans les communautés rurales, où tout le monde sait où vous habitez, à moins d’avoir une protection en permanence, un bout de papier ne sert pas à grand-chose. Les femmes doivent prendre leurs propres décisions en fonction de leur sécurité et de leur perception du risque de représailles.
Comme vous le savez, notre camp pense que Wendy Grant-John a été très explicite en affirmant que la législation ne donnera rien à elle seule, et qu’il faut prendre des dispositions face aux enjeux non législatifs majeurs que vous avez soulignés.
Je pense que notre camp doit dire, pour mémoire, que notre réponse à vos trois questions sera non, non et non. À moins qu’il n’y ait un vrai engagement, nous ne pouvons pas laisser croire au gouvernement qu’il pourra faire passer cette loi — qui prévoit les ordonnances de protection d’urgence, mais ne prend aucun engagement concret. Il y a peu de chance que cela aboutisse, que cela soit pour l’eau ou pour les biens immobiliers matrimoniaux.
Je suppose que le gouvernement va tenter de faire adopter ce texte de toute façon. Nous devons savoir comment vous pouvez nous aider à l’améliorer. Il me semble que l’un des enjeux est la possibilité pour les Premières Nations d’accroître leur capacité. Comme vous l’avez dit, dans l’abrogation de l’article 67 se trouvait une période de transition de trois ans pour permettre aux gens d’accroître leur capacité. D’après ce que nous avons entendu, il est clair que 12 mois n’y suffiront pas.
Il y aussi un centre d’excellence qui ne sera pas encore opérationnel quand ce projet de loi sera adopté. Pensez-vous que 12 mois suffisent pour créer des capacités dans suffisamment de communautés pour que tout ceci fonctionne au moins un peu, ou diriez-vous qu’il faudrait 36 mois, comme c’était le cas avant l’abrogation de l’article 67?
:
Encore une fois, forts de notre expérience, nous nous sommes réjouis de cette période de 36 mois. Nous avons trouvé que c’était une aide importante pour travailler avec les gens et les gouvernements des Premières Nations, pour fournir les informations, etc.
Pour ce qui est de fournir de la capacité, la capacité c’est bien sûr un vaste fourre-tout, si vous me passez l’expression, pour beaucoup de choses, alors pour le problème des ressources humaines et financières, non. Mais pour ce qui est de développer la capacité, encore une fois je reviendrai sur les commentaires que j’ai faits à propos de la mise en place d’une solution de rechange au règlement des conflits. Grâce au travail que nous avons fait avec les réserves, et à ce qu’elles ont réalisé par elles-mêmes, nous leur avons fourni aide et conseils à la demande, nous avons développé une série d’outils en collaboration avec des Premières Nations, en prenant en compte leurs contributions. Grâce à tout cela, beaucoup d’entre elles sont sur la bonne voie.
Il me semble que, si une Première Nation se trouve devant l’éventualité que le régime devienne provincial ou territorial au bout d’un an, et qu’elle choisisse de ne pas l’accepter — qu’elle préfère l’administrer elle-même — elle pourrait, soit se prévaloir des outils que l’APN a développés comme modèle de législation, soit opter pour un mécanisme alternatif de règlement des différends permettant de solutionner certains problèmes.
Comme je l’ai déjà dit, comme nous travaillons avec les communautés de Premières Nations, nous savons d’expérience que beaucoup d’entre elles veulent prendre tout à leur charge. Un an n’y suffira pas avec les limites et les restrictions auxquelles font face les communautés de Premières Nations aujourd’hui au Canada. Une plus longue période serait-elle souhaitable? Oui, mais je pense que les Premières Nations ont fait preuve de leur résilience par le passé, et je crois qu’elles travailleront aussi dur que possible.
C’est donc un vrai problème. Il me semble que dans certains cas, s’agissant de violences familiales, les conjoints abusifs perpétuent des violences parce qu’ils pensent pouvoir s’en tirer. Si quelqu’un pense qu’il va perdre complètement l’accès aux biens matrimoniaux ou au domicile dans lequel il vit et qu’il partage avec son épouse ou sa conjointe, si ce risque existe, pensez-vous que cela peut suffire à changer cette personne, à la faire réfléchir, cesser les abus, traiter l’autre d’une façon plus respectable?
Il y a bien des générations, les femmes se battaient pour obtenir le droit de vote. Si l’on se tourne vers le passé — avant notre époque bien entendu — les femmes n’étaient pas toujours égales aux hommes dans les foyers. Mais les temps ont changé.
Je dois vous dire cependant que j’ai récemment discuté avec mon mari de cette question, de la nécessité qu’il y a de mettre en place ce projet de loi . Il n’arrivait pas à croire, qu’à notre époque, au Canada, dans un pays comme le nôtre, il y a des femmes qui n’ont pas l’égalité du droit d’accès aux biens matrimoniaux et sont forcées de quitter leur domicile. Il n’arrivait pas à le croire.
Je vous retourne la question, car si le projet de loi ne résout pas tous les problèmes dans les réserves, il améliorera certainement les choses malgré tout. N’êtes-vous pas d’accord?
:
Bien sûr. Je vais essayer d’apporter quelques éléments de réponse.
Il faudrait tout d’abord se référer, ce que je n’ai pas encore fait, à l’affaire d’aide à l’enfance qui passe en ce moment devant le tribunal et qui est passée devant la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale. Elle est maintenant entendue sur le fond. Nous avons reçu une plainte, nous l’avons renvoyée au tribunal et nous participons à une allégation ou une assertion de l’APN et de la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations disant que le financement des services de l’aide à l’enfance dans les réserves est discriminatoire, car il est inférieur au financement de l’aide à l’enfance hors réserves. Évidemment beaucoup de problèmes d’aide à l’enfance résultent des séparations de couples et ainsi de suite, voilà un premier élément.
Alors que nous parlions de l’abrogation de l’article 67, les communautés de Premières Nations ainsi que les dirigeants nous demandaient: « Comment allons-nous aborder les ordonnances de réparations alors que nous n’avons pas de logements appropriés, comment pouvez-vous dire que nous avons des pratiques discriminatoires parce que nous ne fournissons pas de logements tandis qu’il n’y a pas de logements appropriés? »
Nous sommes donc face à un certain nombre de problèmes très sérieux. Certains d’entre eux seront détaillés dans un rapport sur l’égalité des droits des Autochtones au Canada, que nous publierons dans les six prochaines semaines environ. Nous avons examiné sept indicateurs de bien-être. Nous faisons une série sur les quatre groupes désignés. Nous en avons déjà publié un sur les personnes handicapées, et maintenant nous travaillons sur les Autochtones, cela vient renforcer beaucoup de données connues.
Mais la situation est telle qu’il y a une multitude de problèmes. S’il existait une solution simple, on l’aurait déjà trouvée depuis longtemps, je pense.
:
Merci beaucoup, madame la présidente.
Merci d’être venus aujourd’hui.
Mon intervention sera très rapide parce que je n’ai que deux minutes, comme vous le savez.
Je veux déposer un document que nous avons ici et dans lequel nous avons demandé au gouvernement du Canada de nous fournir des informations sur le financement accordé.
Je ne vais pas m’arrêter sur le logement et sur plusieurs enjeux relatifs à la santé ainsi que sur les milliards et milliards de dollars qu’on affecte et qu’on dépense chaque année sur ces questions. Je vais expliquer rapidement qu’en matière de justice, enjeu qu’on a soulevé ici je crois, en 2011-2012, le gouvernement a investi 12,5 millions de dollars, ce qui porte l’investissement fédéral à près de 100 millions de dollars depuis 2007.
Je pourrais poursuivre en parlant du Programme d’assistance parajudiciaire aux Autochtones — soit plus de 200 conseillers parajudiciaires et 5,5 millions de dollars par année, etc. — mais je vais déposer ces documents qui présentent en détail les millions et les millions de dollars qu’on dépense en programmes et services. Nous pourrions encore discuter pendant un millénaire pour déterminer si c’est suffisant, comment offrir les services et par quelles voies.
Bien entendu, nous sommes tout à fait d’accord que les Premières Nations devraient instaurer leurs propres systèmes dans les réserves. Mais comme je n’ai pas beaucoup de temps, je veux souligner ce que vous avez mentionné à la première page de votre allocution, c’est-à-dire le besoin urgent d’établir des systèmes équitables et accessibles pour régler la propriété matrimoniale des biens immobiliers dans les réserves; vous ajoutez que ce besoin urgent repose sur la question du droit de la personne.
Comme vous le savez, on dénonce depuis 25 ans cette lacune dans la loi. Ce projet de loi est en cours d’élaboration et le gouvernement tourne autour du pot depuis plus de quatre ou cinq ans.
:
J’espérais que vous donneriez la parole à l’ancienne chef avant moi, par respect pour le rang qu’elle occupe.
Tout d’abord, permettez-moi de dire miigwetch au comité de m’avoir invitée ici et merci au Conseil tribal du Sud-Est de m’avoir amenée ici.
Je m’appelle Joan Jack et j’ai le privilège de servir mon peuple dans le cadre de mon poste de chef et de membre du Conseil de la Première Nation de Berens River. Au Conseil, je m’occupe du portefeuille de la santé, du bien-être social et des services aux enfants et à leurs familles. J’ai quitté Berens River hier dans une légère tempête de neige et j’ai fait tout le reste du voyage dans un avion 206.
En ce qui concerne ma vie personnelle, je suis mère de six enfants, ou peut-être sept ou même plus si l’on compte tous les enfants que mon mari et moi avons élevés ces 20 dernières années. J’ai subi de la violence familiale quand j’étais dans la vingtaine — d’un autre mari. Parfois on est obligé de s’en aller. Je suis aussi avocate et membre du barreau du Manitoba.
Mais je suis principalement ici à titre de femme indigène pour affirmer nos droits de femmes indigènes dans un contexte indigène. Avant de poursuivre, je tiens à m’excuser du fond du coeur, je vais sûrement offenser quelqu’un sans vraiment le vouloir, et si tel est le cas je vous invite à venir vous réconcilier avec moi plus tard.
Je ne sais pas combien d’entre vous savent qu’aujourd’hui nous fêtons la Journée du bien-être, et il est certain qu’à Berens River, plusieurs femmes vont se faire maltraiter ce soir. Mais ces femmes ne vont probablement pas s’en aller parce que les raisons pour lesquelles nous sommes violentées et nous tolérons cette violence ne sont pas simples, et que de s’en aller et diviser la propriété quand on vit dans une réserve isolée, ce n’est pas toujours la meilleure solution.
Quand j’ai reçu votre invitation très récemment, je me suis mise à télécharger des documents pour les examiner. Puis je me suis aperçue que j’étais en train d’abattre toute une forêt en faisant ça, alors je me suis arrêtée. Au lieu de cela, comme nous faisons dans notre culture, je suis allée regarder ce que d’autres dirigeantes de Premières Nations disent. Le 9 mars 2007, Wendy Grant-John, que j’admire profondément, a déposé un rapport à l’Association des femmes autochtones du Canada et j’ai trouvé que Wendy a dit ce qui suit:
La principale option législative que la représentante ministérielle recommande est un modèle de compétence parallèle par lequel on reconnaîtrait immédiatement la compétence des Premières Nations sur les biens immobiliers matrimoniaux ainsi que sur la résolution des conflits qui aurait préséance sur tous les autres conflits à résoudre conformément à une loi fédérale ou provinciale.
Wendy ajoute que:
La viabilité et l’efficacité de tout cadre législatif dépendront également de l’octroi des ressources financières nécessaires pour appliquer des mesures non législatives telles que […] des programmes de prévention de la violence familiale.
En lisant cela, j’étais tout à fait d’accord. Pourquoi ces dispositions ne s’allient-elles pas à l’article 35 comme compétences parallèles? Est-ce impossible à mettre en vigueur? J’en doute.
Mais je ne vais pas m’engager dans une gymnastique légale intellectuelle, même si je suis tentée de le faire, parce que, chez nous, c’est la Journée du bien-être et que nos gens souffrent. Mon peuple souffre et nos familles souffrent. Nous souffrons parce que nous résistons à la colonisation et à l’assimilation en continuant à vivre dans des conditions terribles, parce que nous aimons notre terre et nous aimons Berens River. La plus grande partie de notre peuple vit dans des réserves, et un plus grand nombre de nos gens reviendraient chez nous si on leur offrait de bonnes conditions de vie.
Alors nous vivons dans des logements inadéquats, sans eau, sans égouts, sans routes, et la liste s’allonge. Évidemment, il faut que nous cessions de tolérer l’alcool et les drogues. Mais ce qui m’attriste le plus, c’est que la majorité des Canadiens ne comprennent pas pourquoi nous ne déménageons tout simplement pas dans une grande ville pour y prendre un emploi. Nous avons déménagé dans de grandes villes, et face au racisme ainsi qu’à notre manque de compétences et d’instruction, nous nous tournons vers le crime pour gagner notre pain et nous avons créé des gangs pour gérer nos activités économiques.
Au lieu de coopérer avec nous en nous octroyant par voie légale une compétence parallèle à celle de l’article 35, le gouvernement fédéral a coupé le financement des programmes de lutte contre la violence familiale, coupé le financement des programmes langagiers, coupé le financement des programmes de santé, coupé le financement des programmes de guérison. Personne ne s’inquiète du nombre de décès que nous voyons chez nous.... et nous en avons, des décès. De toute ma vie, je n’ai pas assisté à autant de funérailles que depuis que je suis retournée vivre dans ma réserve. Tous les moyens qui nous permettraient de guérir et de nous remettre de la colonisation — la guérison et l’éducation — ont été remplacés par une série de mesures législatives. Je ne sais pas du tout qui pourra comprendre et appliquer ces solutions dans les réserves. Quel ministère fédéral administrera ces lois? Quel tribunal administrera ces lois? Le tribunal qui vient par avion à Berens River? Où la Première Nation de Berens River trouvera-t-elle l’argent nécessaire pour rédiger et appliquer ses propres lois? Si cette loi découle du paragraphe 91(24), et c’est le cas, alors elle relève du ministre des Affaires indiennes — désolée, personne chez nous ne connaît le nouveau nom du ministère.
Les chefs et conseillers que nous sommes formulons nos lois en vertu des dispositions de la Loi sur les Indiens et nous les administrons sous l'égide du ministre des Affaires autochtones, ce qui fait de nous des municipalités de Premières Nations. Tout comme le droit municipal relève des lois provinciales, nos lois sont assujetties à la compétence fédérale. Je ne crois pas que c'est ce que Wendy ait voulu dire par compétence concurrente.
Cette loi est un autre pas délibéré vers la création de gouvernements municipaux assujettis aux pouvoirs fédéraux. Ce n'est pas la solution que préconisait Wendy.
Aujourd'hui, je dirais que seuls 10 p. 100 — et même si vous n'entendez rien d'autre, je tiens à ce que entendiez ceci, car je sais que la chose vous importe. Si vous êtes assises là, c'est que vous n'y êtes pas indifférentes. Or, selon mes calculs — et ils sont généreux — il n'y a que 10 p. 100 des gouvernements des Premières Nations qui aient réussi à reprendre assez de force pour se remettre du génocide culturel qu'ont occasionné les internats et les externats, c'est-à-dire la politique d'assimilation conçue pour tuer l'Indien chez l'enfant.
Je crois personnellement que les gouvernements des Premières Nations non soumis à des traités — et je répète que ce n'est que mon point de vue à moi — voient les solutions municipales comme des solutions intérimaires pour éviter de priver leurs peuples en empêchant le transfert de plus de fonds aux gouvernements provinciaux. Permettez-moi de vous dire en toute franchise que ces gouvernements sont tous situés à proximité de centres urbains où ils possèdent des biens de valeur. Le reste d'entre nous, les 90 p. 100 qui résidons loin d'un centre urbain, nous logeons dans de vieilles maisons surpeuplées et moisies, ce qui explique en grande partie la violence familiale et des résultats scolaires médiocres.
Comprenez-moi bien: rien ne saurait justifier la violence familiale. Mais si les gouvernements fédéral et provinciaux voulaient venir en aide aux femmes et aux enfants des Premières Nations dans les réserves, ils travailleraient de concert avec nous pour nous fournir davantage de logements — un point c'est tout.
Commençons simplement par des maisons faites de matériaux à l'épreuve des moisissures et voyons l'effet que cela peut avoir sur la violence familiale. Oui, c'est un fait que de nombreuses femmes des Premières Nations subissent des mauvais traitements simplement parce qu'elles ne veulent pas quitter la maison — c'est vrai. Elles n'ont pas où aller, et le mari ne veut pas quitter la maison non plus pour ne pas se retrouver dans la rue.
Pourtant, je sais que les femmes des Premières Nations qui aiment leur mari ou leur compagnon et tiennent simplement à ce que la violence s'arrête sont beaucoup, beaucoup plus nombreuses. Elles ne veulent pas partir. Elles veulent guérir. Elles veulent guérir en compagnie de leur époux et de leurs enfants, comme une famille.
Si l'on veut légiférer au titre du paragraphe 91(24) et non pas de l'article 35, c'est à mon avis pour des motifs d'argent et de politique d'assimilation, politique qui se poursuit. C'est l'équivalent d'un développement économique fondé sur un racisme sanctionné par la loi.
Les gouvernements fédéral et provinciaux n'ont de cesse que de nous dire « Vous devez faire les choses comme moi. Vous devez créer une loi comme la mienne. Vous devez être comme moi ». Eh bien, tout comme une épinette ne peut être un pin, je ne suis pas vous.
Pendant ce temps, le gouvernement fédéral affirme « nous ferons en sorte que nos provinces s'occupent de vos femmes et de vos enfants dans leurs maisons surpeuplées et moisies sans eau courante ni canalisations, et nous les aiderons s'ils veulent partir ».
Après ma première élection de chef et de conseillère de la Première Nation Berens River, j'ai pris place au tribunal de Berens River pour observer nos gens, mes gens, se promener dans le système judiciaire, soit en moyenne un entretien de cinq minutes avec leur avocat de l'aide juridique, mois après mois, renvoi après renvoi. Tantôt ils contrevenaient à la loi, tantôt ils étaient envoyés en prison; une fois libérés, l'avion atterrissait à peine qu'ils faisaient l'objet d'un nouveau renvoi. Un mois, j'ai vu une jeune maman apporter son nouveau-né au tribunal pour montrer le bébé au papa qui portait des menottes, car le bébé était manifestement né dans l'intervalle entre deux séjours en prison. C'est triste. Les gens deviennent sobres et regrettent ce qu'ils ont fait. Ils ne veulent pas rompre.
Si cette loi est adoptée et s'il y a des femmes dans les réserves qui veulent avoir accès à la justice, comment seront-elles censées l'obtenir? Pour le moment, les règles régissant le regroupement familial dans le cadre du bien-être social les oblige à demander de l'aide, mais elles doivent se déplacer à Winnipeg pour obtenir un avocat.
Je suis consciente du temps qu'il me reste, madame la présidente.
:
Eh bien, je me contenterai de lire les deux dernières pages et ce sera fini.
À mon sens, il est absolument impossible de qualifier de justice, voire d'accès à la justice, ce qui est en train de se passer dans les tribunaux au Canada, qu'il s'agisse de tribunaux ruraux, isolés ou de cours de circuit qui visitent les collectivités par avion. Nos jeunes hommes, et même certains des moins jeunes, se déclarent coupables pour en finir au plus vite, vont en prison, apprennent à devenir de meilleurs criminels, et retournent ensuite chez eux avec un nouvel ensemble de compétences.
Je tiens à rappeler que des gens sont punis parce qu'ils ont une maladie, et je crois que c'est une chose à laquelle vous devriez songer et prendre à coeur, du moins je le souhaite. Vous savez, nous ne punissons pas les personnes diabétiques parce qu'elles mangent des beignes. Je sais que je suis en train de banaliser la chose, mais c'est exactement cela. Mes gens souffrent d'alcoolisme et nous sommes criminalisés, nos familles sont brisées et nous sommes punis. Ce n'est pas la solution.
Il semble que mes commentaires vont être distribués, alors si vous avez des questions à me poser sur la partie qui reste, vous pouvez me les poser.
Merci madame la présidente.
:
Merci tout le monde. Je remercie le comité de m'avoir accueillie et je vous remercie de vos travaux sur une question aussi grave et importante.
Je vous demande d'être patiente avec moi. Je vais vous donner un peu de contexte sur les Tsawwassen, car je crois que c'est bon pour illustrer mon point de vue.
J'ai été chef pendant 13 ans et j'ai siégé au conseil pendant six ans à la Première Nation Tsawwassen. J'ai négocié et mis en oeuvre notre traité, qui est entré en vigueur il y a quatre ans. Il s'agit d'un accord moderne de revendications territoriales et d'autonomie gouvernementale. Nous avons réussi à nous débarrasser de la Loi sur les Indiens dans notre collectivité. Nous l'avons remplacée par nos propres lois et institutions, tel que prévu dans notre constitution. Notre collectivité a rédigé sa constitution au niveau populaire, et s'il a fallu 16 ans pour négocier et appliquer ce texte, nous avons profité de ce temps pour décider d'un commun accord de la vision que nous voulions adopter pour notre avenir et la manière de la transformer en réalité.
J'ai pris la consultation et la participation communautaire très au sérieux et j'en veux pour preuve le taux de participation à la ratification de notre traité. Environ 95 p. 100 de nos membres ont voté et parmi eux, 70 p. 100 ont approuvé le traité et les nouvelles structures de gouvernement, qui comprennent une législature, un conseil exécutif, un conseil judiciaire et un conseil consultatif. Nous avons également établi une société de développement économique et un poste de procureur provincial pour s'occuper de l'application des lois Tsawwassen dans le système judiciaire provincial.
Mon optique est celle de quelqu'un qui a fait l'expérience directe de la Loi sur les Indiens, qui a essayé de l'améliorer par le biais de la Loi sur la gestion des terres des Premières nations ou d'autres initiatives sectorielles, et qui a cherché à faire adopter l'autonomie gouvernementale, qui se fonde sur la politique du droit inhérent. Tout cela me permet d'avoir un regard unique.
Dans le traité Tsawwassen, notre modèle de gouvernance reflète notre convention à l'égard de l'intégration aux lois provinciales et fédérales. Cela veut dire que les Tsawwassen, la Colombie-Britannique et le Canada peuvent adopter des lois et le traité établit laquelle de ces lois a préséance en cas de divergence. Avec ce modèle concurrent, les lacunes sont désormais impossibles et si nous n'avons pas de loi sur tel ou tel aspect, c'est la loi fédérale ou provinciale pertinente qui est appliquée.
En ce qui a trait aux biens matrimoniaux, notre traité prévoit que nous ayons une présence dans toute instance judiciaire qui s'occupe des terres des Tsawwassen à l'issue de la rupture d'un mariage. Le tribunal fera entrer en ligne de compte toutes les preuves et témoignages en fonction de notre loi, qui pourrait restreindre l'aliénation de nos terres aux membres Tsawwassen en plus d'autres questions que la loi nous oblige à envisager.
En l'absence d'une loi matrimoniale précise, c'est la loi provinciale qui s'applique aux Tsawwassen. Je crois que l'élément vraiment important du modèle des lois concurrentes c'est que, contrairement à ce que l'on pourrait croire, il n'enfreint pas notre droit inhérent à l'autonomie gouvernementale. En revanche, il habilite une nation à choisir si elle veut s'en tenir à la loi provinciale existante ou exercer son pouvoir de légiférer. Ce choix n'est pas fait au moyen d'un instrument de délégation; il est fait en vertu d'un accord conclu entre deux gouvernements.
Cette mise en contexte est importante, mais les principaux aspects que je désire soulever s'inscrivent dans une optique pragmatique et terre à terre. Bien entendu que nous voulons l'égalité pour nos femmes, mais nous ne la voulons pas simplement comme un principe légal ou théorique. Nous voulons une égalité réelle que nous puissions vraiment appliquer. La loi ne le fera pas d'elle-même. D'après mon expérience, il faut vraiment insister au niveau de la mise en oeuvre.
Quant à la question de la consultation, il est manifeste que ce gouvernement a une approche différente à l'égard de la consultation qui ne correspond pas aux attentes des Premières Nations. Il appartient entièrement au gouvernement du Canada de gérer ses propres risques sur le plan juridique. Une approche de haut en bas pour régler une question aussi complexe est à déconseiller, à mon avis. C'est malheureux que l'on place tellement l'accent sur le processus que le produit qu'il s'agit d'obtenir finit par perdre de l'importance, voire sa légitimité. Le manque de collaboration, sans parler d'une consultation adéquate, telle que définie par les tribunaux, élimine de nombreuses occasions d'arriver vraiment à résoudre certaines des inquiétudes les plus fondamentales et légitimes qui sous-tendent la mise en oeuvre de ce projet de loi.
Premièrement, nous nous occupons de questions de compétences précises en l'absence d'un contexte plus vaste. Les conseils des Premières Nations sont débordés par les séquelles de la colonisation et de la Loi sur les Indiens. S'en prendre à ce seul aspect sans considérer les défis systématiques plus vastes que les Premières Nations doivent relever est une chose frustrante pour beaucoup, il me semble.
J'estime qu'il faut concilier de nombreuses questions touchant la compétence à l'appui de l'élaboration d'une loi matrimoniale. Continuer d'imposer certaines choses aux Premières Nations, à l'encontre de leurs valeurs ancestrales, y compris le concept de terres communales et d'intérêts en commun, la réalité courante de la Loi sur les Indiens et les valeurs du régime judiciaire provincial, c'est vouloir enfoncer une cheville carrée dans un trou rond.
Il y a non seulement un fossé sur le plan des compétences, mais une contradiction fondamentale entre la Loi sur les Indiens visant les Premières Nations ancestrales et les régimes fédéral et provinciaux. Dans le cas des Tsawwassen, nous mettons à l'essai l'intégration au régime provincial, mais c'est uniquement parce que c'est notre choix. Aussi, la formule a été facilitée par le truchement d'arrangements tripartites complexes qui ont été négociés pour tenter de veiller à ce que les droits et les intérêts qui nous sont propres en tant que Premières Nations soient respectés et adaptés dans ces systèmes provinciaux.
Notre approche est extrêmement controversée parmi d'autres Premières Nations. Je ne saurais assez insister sur le fait qu'il nous fallait choisir ce modèle nous-mêmes. Il n'aurait jamais fonctionné si on nous l'avait imposé. Dans notre cas, notre autonomie gouvernementale nous a donné le régime juridique et politique nécessaire pour formuler la loi matrimoniale.
Nous avons 23 lois pour remplacer la Loi sur les Indiens. Nous contrôlons qui peut être propriétaire de terres Tsawwassen. Nous contrôlons qui peut être membre des Tsawwassen et quels sont leurs droits par opposition aux non-membres. Pour cela, il faut une capacité considérable, tant sur le plan de notre régime juridique qu'au niveau de nos pratiques de consultation et de participation au sein de nos collectivités. Nous avons une présence dans les instances judiciaires en raison de notre compétence communautaire. Il nous faut participer à ces processus, et notre traité reconnaît ce fait.
Je ne veux pas décourager le comité vis-à-vis de la raison d'être de ce projet de loi, mais je tiens à souligner l'importance, à mon avis, de toute la gamme de modèles de gouvernance des Premières Nations qui a besoin d'être résolue pour que tel ou tel projet de loi puisse fonctionner. Si nous voulons que ce soit plus qu'une simple aspiration, je crois que nous devons songer à la réforme de la Loi sur les Indiens ou à sa substitution stratégique en partenariat avec des Premières Nations qui ont peu de temps pour répondre aux priorités fédérales qui leur sont imposées.
Il y a sans doute des Premières Nations qui refusent d'évoluer au-delà du système de la Loi sur les Indiens, et il faudra peut-être quelque chose de plus normatif pour celles qui font abstraction des demandes d'égalité et de responsabilité formulées par leurs citoyens — la Loi sur les Indiens est un bon bouclier pour elles et pour cette inertie — mais je ne crois pas que l'on ait vraiment essayé une approche coopérative, et c'est une formidable occasion que l'on a manquée.
Je n'ai rien dit de ce qu'il faut aux collectivités pour relever le défi d'effectuer des réformes internes. Le travail que cela exige est considérable, mais il est transformationnel. C'est en fait sur cela que nous devrions nous concentrer, donner aux Premières Nations les outils pour résoudre leurs propres problèmes et reconnaître leur compétence inhérente, au lieu de définir l'étendue et en déléguer la responsabilité. De nombreuses Premières Nations sont prêtes à le faire et elles ont beaucoup d'idées sur la manière d'y arriver.
L'approche de haut en bas suivie pour ce projet de loi et d'autres de ce genre est contraire à donner l'occasion d'une véritable transformation, que pratiquement tout le monde reconnaît et est prêt à admettre comme nécessaire pour les Premières Nations, surtout pour les progressistes qui désirent suivre cette voie. Le Canada devrait à tout le moins appuyer cette volonté et travailler en fonction de celle-ci.
Faut-il l'égalité pour les femmes? Oui. Je suis persuadée que ce comité a entendu d'innombrables histoires d'horreur sur la mesure dans laquelle certaines femmes et enfants des Premières Nations sont vulnérables à cause de cette question. J'apprécie la volonté d'aider certains des membres les plus vulnérables de notre société. Je suis encouragée par le fait que le gouvernement du Canada souhaite agir pour régler certaines de ces questions. Je pense uniquement qu'il y a un meilleur moyen de s'attaquer à ces enjeux incroyablement complexes qui poursuivent les Premières Nations depuis tant de générations.
Je vous remercie d'avoir écouté mon point de vue ainsi que de vos délibérations.
Hay ch qa.
Avant toutes choses, je voudrais dire à Joan Jack que je perçois bien dans ses propos toute sa souffrance et toute sa douleur. Je me rends bien compte qu’en dépit de votre formation et du fait que vous avez probablement témoigné dans beaucoup d’autres circonstances, cela demande un gros effort sur le plan émotif. C’est pourquoi je vous exprime notre gratitude.
Je suis à l’écoute de la profonde frustration que vous exprimez, et de l’effort que vous faites pour nous décrire les choses telles que vous les avez vécues. Quant à moi, j’essaie de vous donner la meilleure écoute possible et je vous sais gré du récit que vous nous faites de la situation.
Cela vaut également pour vous, madame Baird.
J’aimerais parler de la décomposition des familles.
Même si ce projet de loi n’est pas une panacée et s’il ne va pas résoudre les problèmes qui remontent à bien des années, nous pensons honnêtement qu’il contribuera à atténuer certains aspects de la violence familiale. Je ne dis pas que cela va tout régler pour tout le monde, et le problème de la décomposition des familles existe vraiment… on voit des femmes forcées par les conseils de bande de quitter la réserve parce qu’il y a violence au sein de la famille. Ce sont donc les femmes que l’on chasse, et qui doivent partir à la ville pour chercher quelqu’un chez qui loger, ou encore trouver refuge dans un foyer, et leurs vies sont complètement bouleversées. Cependant nous avons entendu maintes et maintes fois les témoins nous dire, tout au long du processus de consultation qui nous a amenés dans 103 localités avec un budget de 8 millions de dollars consacrés à la consultation, que c’était la meilleure solution au problème de logement dont vous parlez. On nous dit: donnez-nous un logement, car il est vrai que cela permettrait au moins d’héberger les femmes et les enfants concernés. Certes, cela ne remédie pas à l’éclatement de la famille, parce que si c’est l’homme qui est responsable des mauvais traitements, il devra quitter le foyer familial.
Pensez-vous donc qu’il serait préférable que ce soit les femmes et les enfants qui quittent la maison et qui quittent la réserve?
Je voudrais m’associer à ce que mes collègues ont dit précédemment. Nous sommes vraiment émus de votre témoignage et nous espérons très fort que vous aboutirez, et je m’adresse à vous en particulier, madame Baird, car vous avez réussi à négocier un traité après plus de 16 ans d’efforts acharnés.
Nous avons entendu le témoignage d’un grand nombre de personnes, et il y a parfois de quoi être atterré. Ainsi, un groupe de femmes nous a raconté hier avoir lutté pendant 12 ans — et dépensé beaucoup d’argent — pour se faire entendre par la justice, et en fin de compte on leur a dit que du fait qu’elles habitaient dans une réserve, elles étaient dans un vide juridique.
Vous avez déclaré aujourd’hui que tout le monde aimerait bien pouvoir rester dans sa maison, avec ses enfants et au sein de sa communauté. Alors j’imagine que l’on peut toujours passer en revue les consultations que nous avons menées de façon intensive, le fait que nous avons dépensé 8 millions de dollars pour tenir 103 réunions, mettre en exergue les milliards de dollars dépensés au titre de la santé, de la justice et de toutes sortes de programmes et de services, en ajoutant que cela ne suffira jamais. Cela, nous ne le savons que trop.
Mais au-delà de tout cela, je crois que ce projet de loi vise avant tout à combler par voie législative le déficit juridictionnel qui existe depuis 25 ans… Tout au long de ces années, lorsqu’une femme habitant dans une réserve subissait des sévices chez elle, elle ne pouvait même pas y rester avec ses propres enfants et elle était forcée de quitter sa communauté, avec comme conséquence la kyrielle de problèmes que vous avez évoqués. Nombre d’entre nous ont travaillé du côté est de la ville, dans des agglomérations, dans des foyers, etc.
Nous savons bien qu’aucun texte de loi n’est parfait — cela a été illustré par des témoignages — et nous savons aussi que les ordonnances de protection sauvent la vie à des femmes et à des enfants. Nous savons également que cette loi n’impose pas un régime, mais qu’elle se contente d’indiquer un objectif en encourageant les Premières Nations à élaborer leur propre législation dans un certain délai; et si elles ne le font pas, cette loi restera en vigueur jusqu’à son remplacement par une loi autochtone.
Je m’adresse à présent à madame le chef Baird. Pendant 16 ans, vous avez négocié un traité en vertu duquel vous disposez à présent de la compétence commune. Cette compétence commune comprend les droits de propriété matrimoniale, étant donné que vous avez sans doute accepté la loi provinciale sur la famille.
J’aimerais savoir pourquoi c’était là quelque chose d’important pour vous.