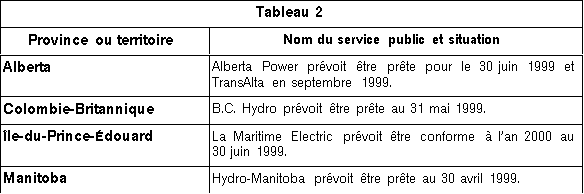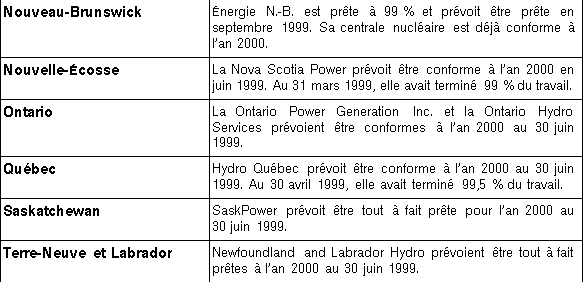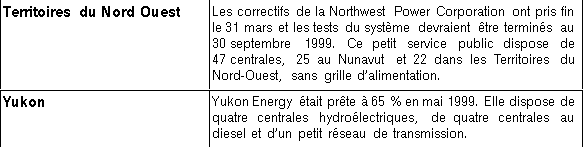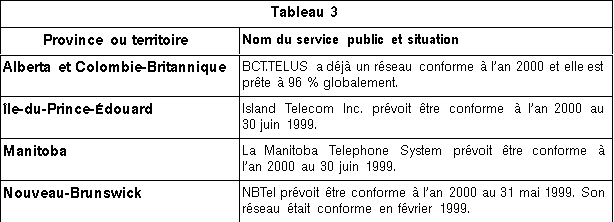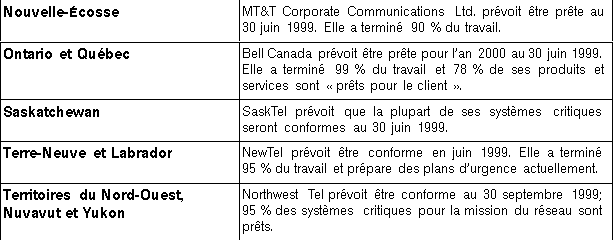INDY Rapport du Comité
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
- MUNICIPALITÉS
- PROVINCES ET TERRITOIRES
- a. Introduction
- b. Gouvernements des provinces et des territoires
- c. Électricité
- d. Télécommunications
- e. Pétrole et gaz naturel
- f. Santé
- ADMINISTRATION FÉDÉRALE
ADMINISTRATION ET SERVICES PUBLICS
Dans ses rapports précédents, le Comité a souligné l'importance pour le Canada de garantir le maintien ininterrompu des opérations clés du gouvernement et des compagnies de services publics à l'arrivée du nouveau millénaire. Ces secteurs fournissent des services essentiels aux Canadiens et à notre industrie de même que les compétences nécessaires pour relever le défi de l'an 2000. Le Comité a eu la chance d'examiner la préparation à l'an 2000 avec des représentants des municipalités canadiennes, des provinces et des territoires, certains services publics, tels des services de télécommunications et d'électricité ainsi qu'avec des représentants du gouvernement fédéral. Dans l'ensemble, tous les paliers de gouvernement semblent s'attaquer au problème de l'an 2000 de façon résolue et consciencieuse. Par ailleurs, les grandes entreprises de services publics prévoient être prêtes à temps. Le Comité a remarqué que bien que le secteur de la santé dans l'ensemble prévoit être prêt à temps, de nombreux éléments des réseaux de la santé ne prévoient être prêts qu'à la fin de l'année.
Les municipalités fournissent de nombreux services de base et constituent le premier palier d'intervention, en cas d'urgence. La Fédération canadienne des municipalités (FCM), qui représente environ 630 municipalités des provinces et territoires, a présenté une mise à jour sur ce que font les municipalités pour régler le problème de l'an 2000. La FCM a convenu avec Statistique Canada que les services essentiels - police, sécurité-incendie, ambulances, aqueducs et égouts - seraient prêts pour octobre 1999 dans les municipalités de plus de 25 000 habitants, représentant 62 % de la population canadienne. La situation est semblable dans les petites et moyennes municipalités (5 000 à 25 000 habitants), qui comptent 21 % de la population et prévoient être prêtes avant la fin de l'année. L'Association canadienne des eaux potables et usées confirme que les Canadiens ne devraient craindre aucune pénurie d'eau potable ni interruption de services d'égout. Dans les petites localités de 1 000 à 5 000 habitants, on estime cependant que 21 % des services d'incendie disposant de systèmes critiques n'auraient pas encore pris de mesures pour garantir que ces systèmes fonctionnent au changement de date.
La FCM a fait une enquête auprès de 990 municipalités comptant 90 % de la population canadienne. En voici les résultats préliminaires :
- des plans d'action pour l'an 2000 sont signalés dans 83 % des municipalités répondantes, parmi lesquelles 94 % ont indiqué qu'elles seraient prêtes au 31 décembre 1999;
- 81 des 990 municipalités craignent que leurs partenaires clés pour les services 911 ne soient pas prêts à temps; et
- environ 80 % des répondants prévoient tester les systèmes critiques pour la mission et ont préparé ou sont à préparer des plans d'urgence.
La FCM signale également avoir fait un inventaire plus à jour de la préparation à l'an 2000 de 4 200 municipalités incorporées du Canada; les résultats seront dévoilés en juin. Elle note que l'enquête a contribué à sensibiliser davantage les petites localités au problème. Le Comité a appris que moins de 10 % de la population canadienne vit dans les municipalités qui ne prévoient pas être prêtes. La FCM s'inquiète un peu des petites localités et concentrera ses efforts sur elles. Selon les résultats préliminaires, les plus petites municipalités pourraient s'en tirer indemnes. Parmi les 3 000 (sur 4 200) municipalités incorporées qui comptent moins de 500 habitants, beaucoup ne fournissent que des services restreints.
Le Canada est un des pays les plus urbanisés du monde. Notre population est surtout concentrée dans les grandes villes. Nous nous inquiétons des plus petites municipalités...
Laissez-moi vous donner certaines réponses susceptibles de vous rassurer. Certaines municipalités ont répondu « sans objet » sur notre questionnaire. Au début nous étions étonnés, mais nous avons fini par conclure qu'elles avaient raison.
Leurs services sont tellement modestes qu'il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Sur 4 200 municipalités au Canada, 3 000 comptent moins de 500 personnes. On a donc affaire à des petits villages qui ne font peut-être guère plus que d'entretenir une route. Vraisemblablement, il n'y a pas de réseaux d'aqueduc.
James Knight, Fédération canadienne des municipalités
Le Comité est encouragé par le témoignage et les résultats de l'enquête de Statistique Canada et il pense avec optimisme que les services municipaux essentiels devraient continuer de façon ininterrompue au changement de date. Le Comité exhorte la FCM de continuer de s'attaquer, lors de sa prochaine conférence, aux grands problèmes de l'an 2000, surtout en ce qui concerne les petites municipalités.
Le Comité a tenu 13 tables rondes provinciales et territoriales pour examiner l'état de préparation des gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi que de certaines grandes compagnies de services publics. Comme le Comité s'inquiétait des services de santé, ce secteur a été plus particulièrement considéré dans le champ d'action provincial et territorial. Le Comité a également reçu des mises à jour écrites sur la préparation des compagnies de production et de distribution du pétrole et du gaz. Dans l'ensemble, le Comité est réconforté par l'information émanant des tables rondes.
Cependant, il note que la gravité du problème de l'an 2000 varie selon les provinces, les territoires, les compagnies de services publics et les réseaux de santé en fonction de l'importance de la population. Les provinces populeuses disposent d'infrastructures complexes et considérables dans le domaine de la santé tandis que les territoires fournissent des services plus élémentaires concentrés à un ou deux endroits. Des distinctions semblables existent pour les autres services provinciaux et territoriaux. Ces écarts dans la complexité et les correctifs requis compliquent la comparaison entre les provinces et les territoires.
b. Gouvernements des provinces et des territoires
Les gouvernements provinciaux et territoriaux offrent une vaste gamme de produits et services aux Canadiens et sont responsables de la préparation de mesures en cas d'urgences reliées au problème de l'an 2000. Au cours des 13 tables rondes provinciales et territoriales, le Comité a eu la chance de rencontrer des représentants de 10 des provinces et territoires. Deux des trois autres gouvernements ont envoyé un mémoire. Les provinces et les territoires que le Comité a entendus travaillent avec diligence à relever le défi de l'an 2000. La méthode varie selon la province ou le territoire, mais les résultats montrent que tous prennent ce problème très au sérieux et s'attendent à être conformes à l'an 2000, au moins pour les systèmes critiques pour la mission avant la fin de 1999. En outre, ils travaillent à des plans et des mesures d'urgence.
Le tableau 1 donne l'état de préparation des systèmes critiques pour la mission des provinces et des territoires, par ordre alphabétique. Notons qu'ils n'utilisent pas tous la même méthode pour évaluer leur progrès; par conséquent, les comparaisons directes ne sont pas toujours possibles. L'information fournie se fonde sur des témoignages et des mémoires.
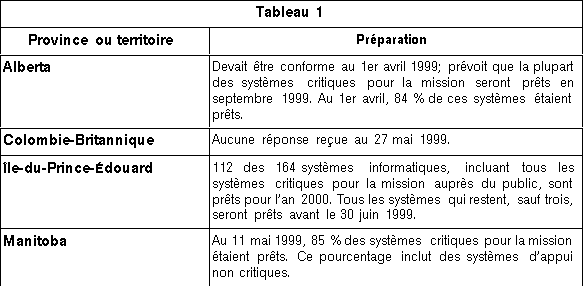
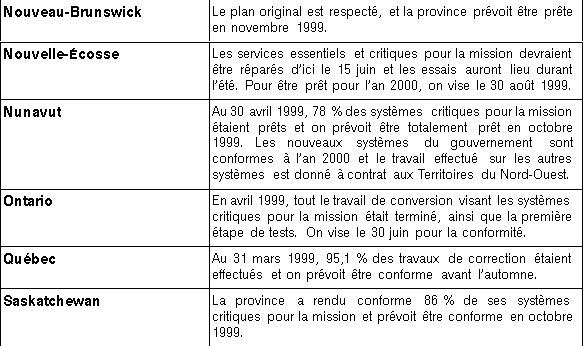
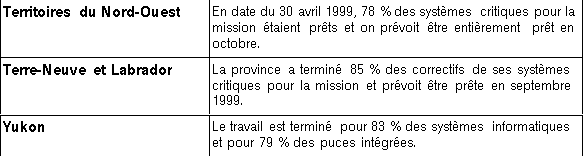
Même si le Comité a appris que les systèmes critiques
pour la mission des provinces et des territoires seront prêts pour
l'an 2000, les retards observés sont inquiétants. L'automne
dernier, l'Alberta était en tête des préparatifs, et
pourtant elle n'a pas pu respecter son échéance originale
du 1er avril 1999. Les retards concernent surtout les logiciels que les
fournisseurs n'ont pas encore livrés. Si d'autres provinces ou territoires
dont les plans prévoient la conformité vers la fin de l'année
connaissent des problèmes semblables, ils pourraient avoir de la
difficulté à rencontrer leurs dates d'échéance.
Le Comité a été rassuré par les progrès et le travail réalisés par toutes les compagnies d'électricité qui sont venues témoigner. La plupart ont tenu des audits externes et toutes travaillent de concert avec les organismes de mesures d'urgence de leur province ou territoire. Le Comité pense que les Canadiens ne verront aucune différence dans la distribution d'électricité au passage à l'an 2000.
Le tableau 2 montre l'État de préparation des systèmes critiques pour la mission des grands services publics d'électricité dans chaque province et territoire, par ordre alphabétique.
Le Comité est également rassuré par les progrès et l'état général de préparation des principaux services publics de télécommunications. À peu près tous ont tenu des audits externes, et tous collaborent activement avec les organismes de préparation des mesures d'urgence de leur province ou territoire. Se fondant sur les témoignages, le Comité est convaincu que les services de télécommunications fonctionneront de façon ininterrompue au changement de date.
Le tableau 3 montre l'état général de préparation des systèmes critiques pour la mission des principaux services publics de télécommunications des provinces et territoires, par ordre alphabétique; certains services publics desservent plus d'une province ou territoire.
Le comité a reçu des mises à jour des associations qui représentent les producteurs et les distributeurs de pétrole et de gaz naturel. Il a noté avec satisfaction que cet important secteur devrait être prêt à temps mais il est un peu préoccupé du fait que la date d'achèvement de la préparation des systèmes critiques pour la mission a été retardée de plusieurs mois dans certains cas.
Les membres de l'Association canadienne du gaz (ACG) prévoient terminer les correctifs aux systèmes critiques pour la mission d'ici septembre 1999. Le travail se poursuivra au-delà de cette date sur les plans de reprise des activités et les systèmes qui ne sont pas critiques. L'enquête indique que la correction des systèmes critiques pour la mission était terminée au 31 mars 1999 dans 75 % des cas (moyenne pondérée). Les plans d'urgence seront prêts cet été et testés avant le 31 décembre 1999.
L'Association canadienne des producteurs de pétrole (ACPP) a déclaré que Ressources naturelles Canada (RNCan) fait enquête aux trois mois sur l'industrie pétrolière et gazière afin de connaître son état de préparation. L'enquête initiale, en janvier 1999, a indiqué que l'industrie d'amont faisait des progrès considérables. Même si les résultats ne sont pas strictement comparables à ceux de l'enquête initiale de l'ACPP en 1998, elles fournissent une analyse sélective du progrès réalisé par le secteur amont de l'industrie. Voici les grands résultats de l'enquête pour les membres des sections 1 et 2 de l'Association :
- selon les prévisions, 76 % (volume produit) des systèmes critiques pour la mission seront testés et conformes au 30 juin; 90 % au 30 septembre et 100 % avant le changement de date;
- selon les prévisions, 80 % (volume produit) des plans de continuité d'affaires seront achevés au 30 juin; 98 % au 30 septembre et 100 % avant la fin de l'année;
- l'évaluation du risque, les correctifs et les autres éléments de préparation devraient être terminés au 30 juin 1999; et
- les tests et l'optimisation des plans d'urgence des membres et de l'industrie auront lieu entre le 1er juillet et le 31 décembre 1999, et on prévoit que 75 % des intervenants auront fait les tests et révisé leurs plans d'ici le 30 septembre 1999.
Dans l'ensemble, le Comité a été encouragé par le travail réalisé par le secteur de la santé dans chaque province et territoire. Il est presque impossible de comparer directement la préparation des divers secteurs du réseau de la santé, à cause des différences de taille et de complexité et du grand nombre de districts hospitaliers et d'organismes dans chaque province et territoire. Le tableau 4 présente la situation d'ensemble, pour les systèmes critiques pour la mission des divers secteurs des réseaux de la santé des provinces et des territoires, par ordre alphabétique.
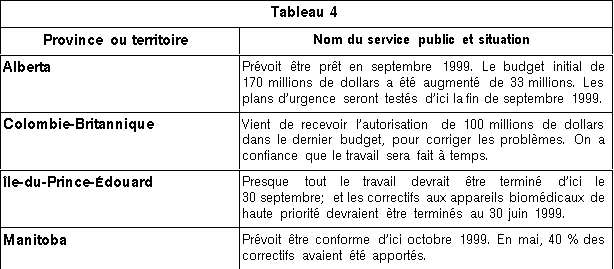
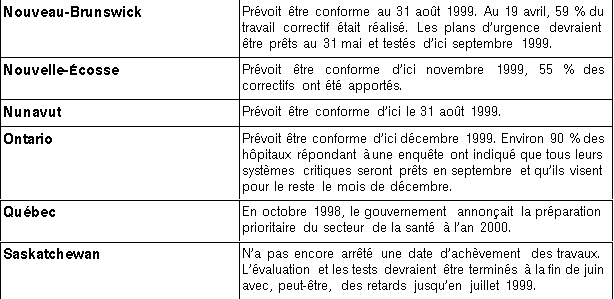
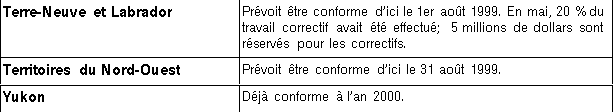
Ce tableau confirme les résultats de l'enquête de Statistique
Canada, qui révélait que seulement 42 % des hôpitaux
et des maisons de santé auront leurs systèmes critiques conformes
en août et 84 % en octobre. Le Comité a fait remarquer que
l'Alberta, chef de file dans ce domaine et disposant de plans détaillés
l'été dernier, ne sera prêt qu'en septembre 1999. Des
témoins ont expliqué certaines difficultés rencontrées
par le secteur de la santé.
J'aimerais donner quelques raisons importantes pour lesquelles cette question est si compliquée pour les soins de santé en Ontario et dans le reste du Canada.
En Ontario en particulier, c'est parce qu'il y a 180 organismes indépendants. Lorsque je vous fournis des résultats d'enquête, ils ne proviennent pas d'un seul organisme, ayant autorité sur le quoi et le comment, et sur la façon de faire rapport. Voilà une chose qu'il faut garder à l'esprit.
Je l'ai dit et je le répète, la question de l'an 2000 en est une de gestion de la chaîne d'approvisionnement pour le réseau de la santé. Nous disposons de très peu de systèmes informatiques que nous avons développés nous-mêmes et que nous pouvons donc contrôler. Dans le cas des systèmes informatiques que les hôpitaux ont choisi en remplacement des vieux systèmes présentant des problèmes pour l'an 2000, il n'y a pas beaucoup de fournisseurs. Nous dépendons de la façon dont ils affectent leurs ressources et de l'ordre dans lequel ils s'occupent des hôpitaux.
En outre, les hôpitaux et les organismes de santé, surtout les hôpitaux, fonctionnent 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de temps mort. Il est donc difficile de tester les systèmes et de retirer l'équipement du service assez longtemps. En réalité, nous devons contourner nos opérations courantes, ce qui nous ralentit.
Sharon Baker, Ontario Hospital Association
Le Comité a appris que même si les petits hôpitaux commencent plus tard, ils peuvent profiter du travail correctif réalisé par les autres et finir plus vite. Il semble que les correctifs ne prennent pas beaucoup de temps dans les hôpitaux mais que l'inventaire et les tests en prennent plus. On a également dit au Comité que la plupart des hôpitaux ne sont guère automatisés et que les plans de secours ou de redressement peuvent régler bon nombre de problèmes de l'an 2000. Étant donné la diversité des dates d'achèvement dans le secteur de la santé, particulièrement pour les systèmes plus importants et plus complexes des grandes provinces, le Comité appuie la recommandation de l'Association canadienne des soins de santé (ACS), elle-même appuyée par bon nombre de représentants de la santé des provinces, voulant que les membres du secteur fournissent rapidement aux autres intervenants de l'information sur la préparation à l'an 2000. Le Comité recommande :
Recommandation 1
Que les établissements et organismes de santé fournissent des renseignements sur leur préparation à l'an 2000 aux gouvernements des provinces ou des territoires en temps opportun pour que ceux-ci puissent surveiller les plans provinciaux d'intervention d'urgence, et communiquer cette information à Santé Canada et au Groupe national de planification d'urgence.
Le mémoire de l'ACS soulève la question de la continuité de la chaîne d'approvisionnement dans le secteur de la santé. En février 1999, on a établi un groupe de travail national sur l'an 2000 dans le secteur de la santé, afin d'évaluer le problème de l'an 2000 et son effet sur les chaînes d'approvisionnement qu'utilisent de nombreux organismes au Canada et ailleurs dans le domaine de la santé. Le fabricant qui fait affaire avec un organisme de la santé peut avoir acheté du matériel et des services de deux, cinq ou vingt fournisseurs et ces derniers peuvent avoir à leur tour acheté de plusieurs fournisseurs. Le problème de l'an 2000 risque de toucher à peu près n'importe quel fournisseur dans le monde. Le Groupe de travail a indiqué que les organismes de santé du monde entier doivent considérer leurs chaînes d'approvisionnement dans la perspective de la préparation à l'an 2000 et de la planification d'urgence. Il a constaté que la stratégie la plus courante en matière de planification d'urgence consiste à stocker le matériel requis.
Santé Canada a parrainé la réunion du 22 avril, qui était présidée par le président du CYNCH; la réunion avait pour objet de constituer un forum de partage de l'information sur certains problèmes, incluant la chaîne d'approvisionnement.
On s'inquiète que certains établissements de santé stockent du matériel de façon préventive ou comme forme de planification d'urgence... Tous les intervenants du milieu craignent que si le stockage se généralise, il y ait problème. On cherche donc à partager l'information et décourager cette pratique, parce que tout indique que les compagnies pharmaceutiques et les fournisseurs de médicaments et de matériel médical sont prêts pour l'an 2000 et qu'il n'y aura pas de pénurie. Nous cherchons donc une stratégie de communication dans le réseau de la santé et dans le public pour décourager cette pratique.
Marie Williams, Santé Canada
Des témoins ont évoqué cette situation et noté les problèmes qui pourraient en découler si on ne suit pas une approche cohérente. La Health Association of B.C. dit décourager le stockage, qui pourrait faire augmenter les prix et créer des pénuries artificielles. D'autres groupes sont à examiner des solutions de remplacement au stockage des fournitures médicales. On craint surtout que les décisions de certaines provinces aient des répercussions sur la disponibilité des fournitures requises par des institutions de santé d'autres provinces ou territoires.
La chaîne d'approvisionnement dessert tout le pays. Les fournisseurs desservent plusieurs provinces, diverses installations; elles sont évidemment toutes indépendantes. Qu'arrive-t-il si une province décide d'augmenter ses stocks de façon déraisonnable au-delà de la capacité des fournisseurs? Qu'arrive-t-il dans les autres provinces? Personne d'entre nous ne peut résoudre ce problème tout seul parce que la réponse est hors d'une province donnée. Le seul intervenant pouvant réunir tous les acheteurs potentiels d'un produit est le gouvernement fédéral.
Aucune province, aucune région n'a le pouvoir de faire cela par elle-même mais nous pouvons subir les répercussions des mesures prises dans l'institution voisine ou la province voisine. Je ne sais pas très bien comment le gouvernement fédéral pourrait jouer ce rôle mais il est clair que ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire par nous-mêmes.
Reg Toews, administrateur, Regional Health Authorities of Manitoba
Comme c'est le cas dans la plupart des autres provinces et des grandes institutions de santé, nos plus importants fournisseurs sont essentiellement américains. Ce qui arrivera chez-nous dépendra en grande partie de la demande aux États-Unis. Par conséquent, je réponds à votre question en disant que chaque province dépend avant tout du fait que leurs fournisseurs sont essentiellement américains.
Colin McMichael, sous-ministre adjoint et directeur du projet L'An 2000, gouvernement du Manitoba
De nombreux groupes de santé provinciaux appuient l'AHC qui recommande une politique nationale sur cette question. Par conséquent, le Comité recommande :
Recommandation 2
Que les ministres de la Santé du gouvernement fédéral, des provinces et des territoires déterminent s'il convient de stocker des produits de santé et que, le cas échéant, ils formulent de toute urgence une politique sur un système de distribution rationnelle, ici et à l'étranger.
Le Comité estime que les gouvernements doivent continuer d'examiner de près la préparation du secteur de la santé à l'an 2000.
Le gouvernement fédéral fournit une vaste gamme de services aux Canadiens et aux entreprises canadiennes. La population compte sur le gouvernement fédéral pour des fonctions essentielles comme l'aide en cas d'urgence, la défense nationale et l'application des lois fédérales. En plus de faire en sorte que les Canadiens continuent de recevoir ces services sans interruption, le gouvernement fédéral a entrepris plusieurs autres activités reliées à l'an 2000, comme l'aide à la préparation des entreprises, l'information du public sur la question, la création d'un organisme national de planification pour coordonner les mesures d'urgence nationales touchant l'an 2000, et l'évaluation des menaces concernant l'an 2000.
Le Comité a appris qu'en date du 30 avril 1999, les 48 fonctions critiques pour la mission du gouvernement fédéral étaient globalement prêtes à 93 % et que le coût des correctifs était passé à 2 milliards de dollars. Les plans d'urgence pour les fonctions critiques pour la mission sont prêts depuis le 31 décembre 1998; on s'attend à ce que les ministères aient terminé les essais en milieu réel au 30 juin 1999.
Le Comité a également appris que de nombreux services clés sur lesquels la population compte sont prêts pour le changement de date dont les Pensions de vieillesse, le Régime des pensions du Canada, l'Assurance-emploi, le Bureau des passeports et le Tribunal d'appel de la Cour canadienne de l'impôt. Le gouvernement fédéral continue de collaborer étroitement avec les autres gouvernements pour relever le défi de l'an 2000, et des réunions fédérales-provinciales-territoriales ont lieu régulièrement. En outre, le gouvernement a rencontré l'Association des banquiers canadiens, l'Association canadienne de l'électricité, les industries pétrolières et gazières, la Fédération canadienne des municipalités ainsi que les gouvernements américain et mexicain et collabore avec eux.
Le gouvernement fédéral fournit aux Canadiens et aux entreprises canadiennes de l'information sur le problème de l'an 2000 et les solutions à lui apporter. Il a établi un service de renseignements sur Internet, par téléphone et par courrier, et six ministères ont participé à deux émissions aux heures de grande écoute sur le canal Discovery; en outre, on a donné plus de 50 entrevues et participé à 100 conférences. En février, le gouvernement a envoyé 11 millions de brochures sur l'an 2000 à tous les ménages canadiens et il envisage d'envoyer un document de suivi cet automne. Il tient à jour un site Web sur le problème de l'an 2000 qui renseigne sur le niveau de préparation du gouvernement fédéral et établit des liens vers d'autres pays et organismes partout dans le monde. Pour les Canadiens sans accès Internet, le gouvernement a établi une ligne téléphonique 1-800.
Pendant les prochains mois, le gouvernement fédéral poursuivra ses efforts au-delà des solutions correctives de ses propres systèmes. Il se concentrera également sur le contrôle des interdépendances et les interfaces entre ses partenaires clés et les ministères.
On a dit au Comité que des représentants du gouvernement fédéral, et des gouvernements des provinces et des territoires se sont réunis pour discuter des lois relatives à l'an 2000. On a jugé que ni une loi « de Bon Samaritain » ni un plafond sur les poursuites relatives à l'an 2000 n'étaient justifiés.
Le gouvernement fédéral, les gouvernements des provinces et des territoires se sont réunis à plusieurs occasions pour discuter des solutions législatives possibles. Aucun gouvernement n'appuie cette démarche. Elle est perçue comme inutile pour promouvoir l'échange d'information et on craint que les victimes des pannes liées à l'an 2000 perdent des possibilités de recours.
Certains gouvernements s'opposent à ce que le gouvernement fédéral légifère dans ce domaine en utilisant ses pouvoirs d'urgence.
J. Edward Thompson, Industrie Canada
Le représentant du gouvernement a noté que la crainte de poursuites n'était pas la principale motivation du secteur privé à se conformer aux exigences de l'an 2000.
La grande peur du milieu des affaires, c'est celle de la survie, celle de protéger sa réputation, la bonne volonté, la confiance des actionnaires et les lignes de crédit. Les poursuites sont considérées comme secondaires par rapport au spectre de la faillite et de la perte de la clientèle.
J. Edward Thompson, Industrie Canada
Le Comité s'est également fait confirmer que les Canadiens ne sont pas aussi prompts à poursuivre devant les tribunaux que les Américains. En outre, on estime qu'il n'y a vraisemblablement aucune urgence, en particulier parce que les grands services publics seront prêts; par conséquent, aucune loi n'est prévue.