|
CHAPITRE 15 :
POLITIQUE ET DROIT DE LA CONCURRENCE
[Les] lois nationales sur la concurrence, si elles sont bien appliquées,
complètent [...la] libéralisation du commerce en empêchant
que des comportements anticoncurrentiels privés diminuent les avantages
des accords. L'intégration de la politique de concurrence au sein
de ces instances garantira aux exportateurs et investisseurs canadiens
qui font des affaires à l'étranger de pouvoir compter sur
une politique de concurrence objective et prévisible qui les protégera
des pratiques anticoncurrentielles sur le marché local. [Patricia
Smith, 31:1600]
Convergence entre la politique commerciale et la politique de la concurrence
La politique et le droit de la concurrence (antitrust) ne sont apparus
que récemment dans les négociations commerciales, alors que
des progrès importants ont été accomplis à
l'échelon multilatéral dans les dossiers plus traditionnels.
Il se pourrait en effet que le temps soit venu d'élargir le dossier
du commerce et d'envisager une gamme plus large de comportements ayant
un rapport avec la disputabilité des marchés. En effet, les
efforts de libéralisation avanceraient sans doute plus vite si l'on
prenait en compte la possibilité que, lorsque tombent les obstacles
au commerce, les sociétés nationales bien implantées
les remplacent par des obstacles à l'accès au marché.
Si la politique commerciale règle la conduite des gouvernements,
la politique de concurrence régit les personnes physiques et morales
relevant de la compétence de ces pouvoirs publics en interdisant
certaines conduites considérées comme anticoncurrentielles
ou susceptibles de l'être. En conséquence, une instance interne
chargée de la concurrence pourrait prendre des mesures préventives
visant à instaurer les conditions préalables à l'exercice
de la concurrence, ou à les maintenir lorsqu'elles sont menacées,
ce qui, estime-t-on, assurera un plus grand bien-être aux consommateurs
et à la société. Ainsi, la politique de concurrence
et la politique commerciale ont un objectif commun, celui de rendre les
marchés « disputables », selon la terminologie utilisée
par les autorités chargées de la concurrence pour désigner
l'accès au marché (voir l'encadré 15.1).
L'idée selon laquelle le libre-échange suffira à
lui seul à créer des marchés efficients dans les économies
de petite taille de cet hémisphère soulève quelques
préoccupations pour le Bureau. À mon avis, la politique de
libre-échange ne devrait pas être considérée
comme un substitut à une politique de la concurrence. Par exemple,
une politique de libre-échange ne pourrait pas à elle seule
permettre de régler les cas où des entreprises très
puissantes sur un marché donné exercent des activités
anticoncurrentielles comme la collusion. [Patricia Smith, 31:1600]
Bien entendu, les responsables du commerce pourraient s'intéresser
au droit et à la politique de la concurrence pour d'autres raisons.
Citons le rare cas où un gouvernement voudrait, par principe ou
par une application sélective, diverger de l'objectif initial de
la politique de concurrence et utiliser celle-ci comme substitut de la
politique commerciale ou de la politique industrielle et, ce faisant, annuler
une partie des importantes richesses déjà acquises au moyen
de la libéralisation du commerce et de l'investissement. Par exemple,
une autorité indépendante chargée de la concurrence
pourrait intenter des poursuites contre une entreprise étrangère,
en alléguant disons la fixation de prix abusifs, pour le simple
motif de harceler et d'ériger un obstacle bureaucratique contre
l'accès au marché. Que ce soit par principe ou par application
sélective, la politique de concurrence pourrait, dans certaines
circonstances, remplacer les politiques commerciales restrictives qui sont
interdites dans le cadre d'un régime commercial libéral.
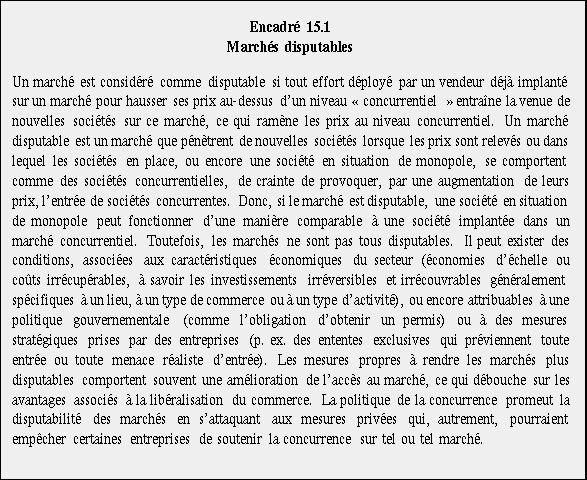
Il existe au moins deux autres raisons pour internationaliser la politique
de la concurrence. Premièrement, ce type de politique peut être
utilisé comme protection exceptionnelle contre la fixation de prix
inéquitables, comme le dumping qui, par définition, pourrait
être assimilé à une fixation de prix abusifs ou à
une discrimination par les prix, selon le cas. Un certain nombre d'éléments
relatifs à l'efficacité des mesures antitrust comme substitut
aux mesures antidumping méritent réflexion, à savoir
les mécanismes de détermination du préjudice et de
l'intention de la partie qui agit ainsi. Essentiellement toutefois, il
s'agit là des deux faces (administratives) d'une même pièce,
et ce sont en fait les objectifs des décideurs qui sont déterminants.
Enfin, dans le contexte actuel de la mondialisation, les conduites anticoncurrentielles
ont de plus en plus d'effets multiples sur les marchés, lesquels
méritent qu'on s'y attaque par une meilleure coordination et une
meilleure coopération entre autorités responsables de la
concurrence. Certes, une politique de concurrence plus efficace est utile
en elle-même, mais il faudrait que le bien-être du consommateur
et de la société en demeure l'objectif ultime.
Préoccupations entourant la politique de la concurrence et le commerce
Bien évidemment, il existe de nombreuses raisons légitimes
pour intégrer une politique de concurrence dans le programme d'action
en matière de commerce, mais les explications présentées
plus haut s'appliquent-elles au marché d'aujourd'hui ou sont-elles
simplement hypothétiques? Considérons la politique de concurrence
comme une politique commerciale de remplacement conçue pour contourner
des engagements commerciaux existants. Des représentants du Bureau
de la concurrence ont dit au Comité qu'ils n'ont pas été
témoins ni informés par d'autres entités chargées
de la politique de la concurrence, dans un passé récent,
du moindre cas d'utilisation dans les Amériques, par les instances
chargées de la politique de la concurrence, des règles relatives
aux fusions ou à la concurrence comme moyen stratégique de
restreindre le commerce. Le Comité accepte ce témoignage
et, en conséquence, conclut que les raisons stratégiques
d'inclure la politique de la concurrence dans les négociations commerciales
ne méritent pas qu'on s'y arrête pour l'instant, et il entend
plutôt s'attacher aux cas de conduite anticoncurrentielle sur plusieurs
marchés pour le guider dans ses délibérations.
Deux affaires récentes illustrent les problèmes liés
à l'établissement d'une limite : la fusion de Boeing Co.
avec McDonnell Douglas Corp., et le cas Kodak-Fuji. La Commission européenne
a menacé de bloquer la fusion des avionneries pour le motif que
les sociétés avaient conclu des ententes exclusives d'approvisionnement
avec certaines grandes lignes aériennes, ce qui risquait de porter
préjudice aux fabricants européens d'un avion concurrent,
l'Airbus. Les États-Unis, ne sachant pas si les poursuites avaient
été intentées pour faciliter la concurrence ou pour
mettre les fabricants de l'Airbus en meilleure position par rapport à
la nouvelle avionnerie américaine, ont menacé d'exercer des
représailles si la fusion était empêchée. Au
Japon, certaines pratiques privées anticoncurrentielles entravant
l'accès sur le marché ont été alléguées
par Kodak dans une pétition en vertu de l'article 301, qui a été
suivie de la présentation d'un mémoire à l'Organisation
mondiale du commerce (OMC) à propos de la tentative de Kodak de
vendre des pellicules sur le marché japonais. Le problème
tenait aux mesures d'une société japonaise verticalement
intégrée qui restreignaient la capacité de Kodak de
vendre des pellicules photographiques au Japon. Au bout du compte, l'OMC
s'est prononcée en faveur du Japon, mais c'est avant tout parce
que les questions de concurrence ne font pas partie de l'Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et qu'aucune obligation
commerciale n'avait donc été violée. Néanmoins,
cette affaire a mis en lumière l'incapacité de l'OMC d'obtenir
les renseignements nécessaires pour résoudre le différend.
Les affaires prouvent certainement qu'il existe des problèmes
de compétence et justifient en partie le plaidoyer du commissaire
du Bureau de la concurrence :
[L]e commerce ignore de plus en plus les frontières et il en
est de même des pratiques anticoncurrentielles. Nous devons donc
veiller au maintien d'une bonne coopération entre les pouvoirs de
réglementation de la concurrence. Cela est nécessaire au
bon fonctionnement du système et est essentiel pour éviter
les conflits de compétences, car il est important de ne pas se gêner
les uns les autres lorsqu'il faut enquêter sur ces complots criminels.
[Konrad von Finckenstein, 113:1120]
Au-delà de ces différends et de ces guerres de compétence,
les autorités chargées de la politique de la concurrence
ont aussi un rôle revendicateur à jouer :
Par exemple, avec la réduction de la protection à la frontière,
qu'il s'agisse de barrières tarifaires ou non tarifaires, on craint
de plus en plus que l'abolition des monopoles d'État ne laisse un
vide que pourront rapidement combler des monopoles privés. Une politique
et un droit de la concurrence sains et vigoureusement appliqués
seront une protection contre ce phénomène. À cet égard,
le rôle de défense des autorités chargées de
la politique de la concurrence revêt une grande importance et elles
doivent faire en sorte de s'engager dès le début dans la
réforme de la réglementation. [Patricia Smith, 31:1600]
De l'avis du Comité, c'est là un argument qui s'applique
particulièrement bien aux Amériques.
La politique de la concurrence et la ZLEA
En prévision d'un éventuel accord sur une Zone de libre-échange
des Amériques (ZLEA), il serait bon au départ de recenser
les pays des Amériques qui possèdent un droit de la concurrence
et ceux qui n'en possèdent pas. Le Comité croit savoir que
12 des 34 pays qui envisagent d'adhérer à une ZLEA possèdent
déjà une loi écrite sur la concurrence, tandis que
8 autres songent à en adopter une1.
Le Comité est également conscient que des engagements relatifs
à la politique de concurrence sont inclus dans l'Accord de libre-échange
nord-américain (ALENA), l'Accord de libre-échange entre le
Canada et le Chili et dans le traité du Groupe des Trois entre le
Mexique, la Colombie et le Venezuela. La décision 285 du Groupe
andin et le protocole du MERCOSUR pour la défense de la concurrence
portent aussi sur la concurrence, mais sont toujours en attente d'une ratification.
Ces lois ont des objectifs et une portée variables d'un pays
à l'autre. En général, dans les Amériques,
elles visent : la promotion et la défense de la concurrence; la
promotion de l'efficience économique et du bien-être des consommateurs;
la liberté d'initiative; l'ouverture des marchés assortie
d'une participation juste et égale des petites et moyennes entreprises;
la déconcentration du pouvoir économique et la prévention
des monopoles et des abus d'une position dominante. Le champ d'application
de ces lois est vaste, mais des exceptions y sont faites pour les monopoles
d'État, les secteurs réservés des intérêts
stratégiques ou de sécurité nationale et les droits
de propriété intellectuelle. Les comportements généralement
visés par ce genre de lois sont énumérés dans
l'encadré 15.2.
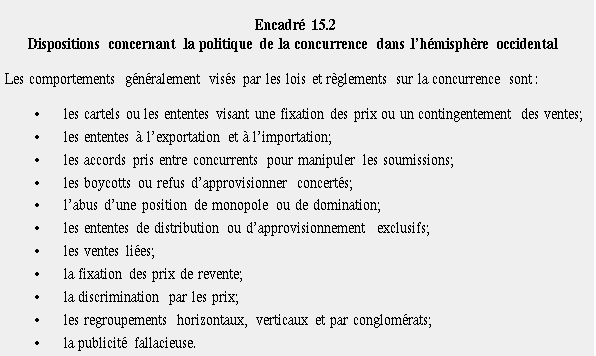
Le Bureau de la concurrence a fait les commentaires suivants sur l'état
général de la politique de concurrence et de son application
dans les Amériques :
Des 12 pays de l'hémisphère qui ont une loi sur la concurrence
en vigueur, plusieurs n'ont élaboré que récemment
leur régime juridique en la matière. De surcroît, le
niveau de l'application varie d'un pays à l'autre; même parmi
ces derniers pays le niveau de la mise en application varie. [...] L'assistance
technique aux pays qui ont un régime de concurrence inexistant ou
relativement peu développé sera un élément
essentiel pour la conclusion d'un accord-cadre sur la politique de la concurrence
au sein de la ZLEA. Les pays qui fourniront l'assistance technique devront
comprendre la nécessité d'adopter une stratégie graduelle
qui commencera par l'établissement d'un consensus intellectuel,
politique et social sur la valeur d'une politique de concurrence et qui
aboutira à l'adoption d'une bonne loi et la mise en application
efficace de cette loi. [Patricia Smith, 31:1555]
Le Comité est toutefois d'avis que les microéconomies
du CARICOM constituent un cas particulier, car ils se buteront sans doute
à un sérieux manque de moyens lorsqu'il s'agira d'élaborer
et d'appliquer un droit national en matière de concurrence. De fait,
à moins d'une aide concrète susceptible d'améliorer
le rapport coûts-avantages de l'instauration d'un cadre formel en
matière de concurrence, ces pays feront peut-être mieux de
compter sur le seul régime gratuit qui soit à leur disposition,
à savoir le libre-échange.
Il faut entreprendre d'autres analyses conceptuelles afin d'étudier
les options pratiques pour les économies de très petite taille,
comme celles des membres du CARICOM et des pays d'Amérique centrale
dans les cas où le poids financier de la mise sur pied d'un organisme
national pose un problème important. Toutefois, pour les économies
de petite taille qui ont des positions et des objectifs compatibles en
ce qui concerne le droit et la politique de la concurrence, l'adoption
de règles - si possible fondées sur des dispositions types
- et la création d'institutions régionales ou infrarégionales
pourraient constituer une solution pratique. Cette méthode permettrait
d'affecter les ressources de manière plus efficace et raisonnable.
[Patricia Smith, 31:1600]
Le Comité a entendu divers avis sur la façon dont la politique
de concurrence doit être envisagée à l'échelon
multilatéral et au sein d'une ZLEA.
Sur un plan conceptuel, [...] nous avons besoin d'un accord fondé
sur les mêmes principes que l'Accord sur les aspects des droits de
la propriété intellectuelle qui touchent au commerce ou ADPIC.
Nous avons donc besoin d'un accord sur les aspects des pratiques anticoncurrentielles
qui touchent au commerce, ce qui donnerait le sigle de TRAMS. [...] Que
contiendrait un accord TRAMS? À notre avis il devrait en premier
contenir une obligation d'adopter une loi ferme sur la concurrence ayant
un champ d'application approprié et assurant l'indépendance
des enquêtes et des prises de décisions. Les principales dispositions
devraient traiter des aspects suivants : les cartels et les complots criminels,
l'examen des fusionnements, l'abus de position dominante, le rôle
de défense des droits de l'organisme de promotion de la concurrence,
afin de veiller à ce que la concurrence soit prise en considération
à toutes les instances nationales, la protection des renseignements
confidentiels, sans laquelle il est impossible de faire fonctionner un
régime de concurrence et, enfin, l'accès à des moyens
de dissuasion efficaces, d'ordre monétaire ou pénal. Il faut
également un engagement envers des principes de transparence, de
traitement national, de non-discrimination et d'équité procédurale.
Il est impossible autrement d'exploiter un régime de concurrence.
Si le régime ne respecte pas le traitement national et la transparence,
il ne sert vraiment à rien. [Konrad von Finckenstein, 113:1120]
et
[La] politique et le droit de la concurrence représentent un
secteur extrêmement complexe, comme nous le savons tous. L'Alliance
estime qu'il ne faut plus essayer de s'entendre sur le fond des règles
sur la concurrence et les recours dans ce domaine, mais essayer plutôt
d'élaborer une série de principes et de directives clairs
qui permettront d'appliquer ces règles de façon transparente
et équitable. [Pamela Fehr, 112:925]
Ces arguments, le Comité en est bien conscient, ne signifient
pas que les témoins sont en faveur d'une harmonisation de la politique
de concurrence dans l'ensemble des Amériques. À l'étape
où nous en sommes, le Comité est d'accord pour reconnaître
qu'il n'est pas nécessaire que tous les intervenants aient les mêmes
règles. Il vaudrait mieux attendre à plus tard pour le faire,
si on le juge à propos.
Le Comité revient maintenant au problème de l'opportunité
de remplacer la politique antidumping par une politique sur la concurrence,
et plus précisément par des dispositions sur la fixation
abusive des prix. À ce propos, le Comité a entendu une large
gamme d'opinions. Voici un commentaire favorable typique :
[L]es règles antidumping et les dispositions des législations
nationales sur la concurrence relatives aux pratiques de prix déraisonnablement
bas poursuivent un objectif commun, soit le maintien de conditions de concurrence
loyale. Aussi peut-on s'interroger sur la logique et la pertinence sur
le plan de la politique publique de maintenir deux régimes juridiques
distincts, l'un s'appliquant aux producteurs étrangers et centré
sur l'administration des droits antidumping, l'autre qui police les opérateurs
oeuvrant sur le marché interne et qui vise à contrer les
politiques de fixation abusive des prix. Une telle dualité de régime
m'apparaît artificielle; il m'apparaît difficile de cerner
sa rationalité. Je pense donc que [...] le Canada devrait s'efforcer
de promouvoir la convergence du régime antidumping, d'une part,
et des règles sur la concurrence concernant les pratiques de prix
déraisonnablement bas, d'autre part. [Vilaysoun Loungnarath, [10:1430]
Et voici maintenant un exemple caractéristique de commentaire
défavorable :
[L]a pratique commerciale injuste qu'est le dumping est celle où
des exportateurs étrangers vendent à des prix plus faibles
que les prix au Canada, ce qui nuit aux producteurs canadiens. Une différenciation
des prix non abusifs par un exportateur étranger qui n'a pas de
pouvoir commercial sur le marché d'importation, en l'occurrence
le Canada, ne peut pas être contrée par les lois traditionnelles
sur la concurrence. [...] Cependant, le fait est que les lois sur la concurrence
stipulent normalement qu'il y a abus si l'on peut constater et interdire
la différenciation des prix et les prix abusifs. Il faut que celui
qui fixe ces prix veuille nuire à son concurrent et ait le pouvoir
commercial de le faire parce qu'il essaie effectivement d'abaisser ses
prix et de chasser son concurrent pour pouvoir ensuite jouir des avantages
du monopole qu'il aura établi. [...] Si j'abandonnais les mécanismes
antidumping pour adopter les règles normales relatives aux prix
abusifs dans les lois sur la concurrence, j'abandonnerais à toutes
fins utiles mon droit de prendre des mesures antidumping. [É]changer
des mesures antidumping pour des lois sur la concurrence ne serait pas
vraiment un échange, mais une capitulation pure et simple. [Michael
Flavell, 99:225]
Le Comité croit comprendre que les dispositions contre les prix
abusifs et contre le dumping trouvent leur origine dans des nécessités
et des intentions différentes. Les premières ont été
conçues pour protéger les intérêts des consommateurs
afin de préserver le processus concurrentiel à long terme.
Quant aux dernières, elles ont pour objectif de protéger
les producteurs nationaux contre un rival étranger précis,
dont la situation particulière lui permet d'établir une différence
entre les marchés. Cette situation particulière consiste
souvent en un marché intérieur protégé.
En ce qui concerne les dispositions antidumping, donc, les intérêts
des consommateurs sont subordonnés à ceux des producteurs
nationaux. Dans cette perspective, le Comité est d'avis que la politique
de concurrence et les autorités chargées de l'appliquer ne
devraient jamais être forcées de subordonner les intérêts
des consommateurs à ceux des producteurs. Toutefois, faute d'une
disparition définitive de la capacité d'exercer une discrimination
entre les marchés étrangers et les marchés intérieurs,
il existe effectivement des circonstances dans lesquelles les intérêts
des producteurs nationaux doivent prévaloir sur ceux des consommateurs,
mais ce ne sont pas tous les cas. À condition que les pouvoirs administratifs
exercent une discrétion appropriée dans l'application des
dispositions antidumping, le Comité est d'avis qu'il n'existe aucune
raison valable, ni non plus de désir de la part de la classe politique,
de confondre les règles antidumping et les règles antitrust.
Les politiques relatives à la concurrence et les politiques antidumping
doivent donc, pour l'instant, demeurer séparées.
D'autre part, la relation entre la politique de la concurrence et le
règlement des différends constitue un autre sujet de controverse
possible. Les comités spéciaux constitués pour examiner
la façon d'intégrer la politique de la concurrence dans le
régime commercial ont déjà conclu que la capacité
d'un gouvernement étranger de contester les décisions des
autorités compétentes en matière de concurrence d'un
autre pays constituerait un empiétement excessif sur la souveraineté
nationale. Les experts du commerce et de la politique de concurrence ont
plutôt axé leurs efforts sur la mise en place d'un mécanisme
de révision des politiques de concurrence et d'un conseil chargé
de surveiller la façon dont les autorités compétentes
respectent leurs obligations en matière d'équité et
de transparence des procédures.
Il faudrait que les négociations portent sur la question de savoir
s'il est possible d'utiliser des procédures de règlement
des différends pour déterminer si les pays membres respectent
leurs obligations d'application et de maintien de leurs lois sur la concurrence,
conformément à un accord-cadre sur la concurrence. [...]
Nous estimons qu'un accord sur la concurrence, intégré à
l'accord sur la ZLEA, serait plus efficace si l'on créait un mécanisme
d'examen des politiques en matière de concurrence sur le modèle
du mécanisme d'examen des politiques commerciales de l'OMC. Un conseil
serait chargé de dresser régulièrement un rapport
sur les dispositions de fond du droit de la concurrence d'un pays et sur
les actes de l'organisme chargé de l'application des lois. Tant
le mécanisme d'examen des politiques de concurrence que le conseil
feraient la promotion de la transparence et constitueraient les antécédents
de l'autorité responsable en matière d'équité
procédurale. Nous croyons que ceci constituerait une solution de
remplacement acceptable pour traiter des questions de conformité.
[Patricia Smith, 31:1555]
D'après ce que comprend le Comité, le mécanisme
d'examen de la politique de la concurrence dans l'accord sur la ZLEA, d'une
part, et le comité consultatif sur la politique de concurrence dans
la ZLEA, d'autre part, ne seraient pas habilités à étudier
ou à commenter les décisions individuelles prises par les
autorités en matière de concurrence. Ils pourraient toutefois
faire la lumière sur la politique de concurrence et le régime
d'application de différents pays de l'hémisphère et
formuler des recommandations en vue de moderniser ces pratiques. Ainsi,
en l'absence de recours pour faire examiner les cas a posteriori, une information
préalable serait diffusée en guise de mise en garde auprès
des éventuels négociants et investisseurs étrangers
de l'hémisphère, au profit desquels cette méthode
servirait à préciser et à rendre plus prévisibles
certains aspects de la concurrence. Un mécanisme d'examen par les
pairs devrait également créer la possibilité d'infléchir,
au besoin, les réformes visant ces politiques, sans porter atteinte
à la souveraineté nationale.
Compte tenu de ces facteurs, le Comité recommande donc :
28. Que le gouvernement du Canada : a) favorise la mise en place
de politiques et de régimes juridiques en matière de concurrence,
ainsi que d'efficaces dispositions d'application de ces lois, dans les
pays des Amériques qui n'en possèdent pas encore; b) s'oppose
aux pays d'une Zone de libre-échange des Amériques qui voudraient
fusionner leur législation antidumping avec les dispositions contre
les prix d'éviction de la politique et de la législation
sur la concurrence; c) examine l'opportunité d'établir un
processus d'examen des politiques de la concurrence qui prévoirait,
au minimum, une surveillance et la présentation régulière
de rapports sur la politique de concurrence du pays membre et sur la façon
dont son autorité en matière de concurrence respecte les
règles concernant l'équité et la transparence procédurale;
et d) prévoie un examen périodique en vue de l'élargissement
du renforcement de la politique de concurrence.
1 Les
12 pays qui possèdent des lois en matière de concurrence
sont les suivants : Argentine (1919), Brésil (1962), Canada (1889),
Colombie (1959), Costa Rica (1994), Chili (1959), États-Unis (1890),
Jamaïque (1993), Mexique (1934), Panama (1996), Pérou (1991)
et Venezuela (1991). Quant aux huit pays qui sont en train de débattre,
de concevoir ou de rédiger des lois sur la concurrence, ce sont
la Bolivie, l'Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua,
la République dominicaine, le Salvador et Trinité-et-Tobago.