FINA Rapport du Comité
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
CHAPITRE 3 :
UNE MEILLEURE PRODUCTIVITÉ POUR UN MEILLEUR NIVEAU DE VIE
L'an dernier, la productivité a constitué l'un des thèmes majeurs du rapport du Comité des finances sur les consultations prébudgétaires. La question a ensuite fait l'objet d'une étude plus détaillée et plus exhaustive au printemps. Lors des consultations prébudgétaires de cette année, les Canadiens étaient d'avis que le gouvernement avait encore beaucoup à faire pour améliorer leur niveau de vie.
J'ai toujours maintenu que le développement économique a évidemment pour objet d'élever le niveau de vie de tous les Canadiens. Pour ce faire, la croissance est essentielle et, partant, l'innovation. Il est très important d'avoir ces éléments de croissance qui permettent non seulement à la société canadienne mais à toute société humaine d'atteindre un niveau de vie supérieur. Voilà ce qui devrait être la pierre angulaire1.
Nous croyons également très important d'accroître la productivité au Canada. La productivité correspond à la capacité de travailler efficacement. Selon la Chambre de commerce du Canada, nous sommes le pays du G-7 qui a enregistré le plus faible taux de croissance de la productivité au cours des 25 dernières années. L'OCDE a signalé que le PIB per capita du Canada allait tomber de 10 % au-dessus de la moyenne de l'OCDE à 15 % au-dessous d'ici 20 ans2.
Avec une forte expansion de la production et la croissance de l'emploi, notre économie se porte bien; on pourrait cependant prendre de nombreuses mesures pour continuer d'améliorer la productivité ainsi que le niveau général de la richesse et de la prospérité. De nombreux témoins nous ont exprimé leur avis quant à la meilleure façon de stimuler la productivité. Ce chapitre rend compte de leurs points de vue et indique la direction que, selon le Comité, le gouvernement devrait suivre pour atteindre cet objectif.
Premièrement, il importe d'expliquer ce que nous entendons par productivité. La productivité n'est pas une notion que nous préconisons pour elle-même. Ce n'est pas non plus une notion dont nous faisons la promotion au lieu d'autres objectifs. C'est plutôt un élément que nous favorisons en vue de réaliser la vaste panoplie des objectifs économiques et sociaux auxquels aspirent les Canadiens. La productivité constitue le principal moyen permettant de hausser notre niveau de vie.
Qu'est-ce que la productivité et quel est son rapport avec le niveau de vie?
Bien qu'il soit de bon ton d'utiliser le mot productivité dans les médias et dans le débat sur la chose publique, il est évident que de nombreux Canadiens ne connaissent pas encore sa signification précise ni ne savent comment elle peut influer sur leur niveau de vie.
Marc a parlé de la productivité, comment mieux la comprendre, la mesurer et l'améliorer. C'est un secteur pour lequel nous aimerions que l'on consacre plus de ressources s'il y en avait.
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
La productivité n'est pas le niveau de vie. Celui-ci décrit le bien-être économique des Canadiens. Normalement, on le mesure au moyen du PIB par habitant, qui indique simplement la quantité de biens et services pouvant être consommés pour satisfaire à nos besoins. Les Canadiens pourraient vouloir consommer ces biens et services chacun de leur côté, chaque ménage décidant alors de ses propres priorités. Nous pourrions aussi préférer consommer certains biens et services en commun, ceux-ci étant alors fournis de manière plus appropriée et efficiente. Si nous comparons le PIB par habitant à un gâteau, notre niveau de vie correspond à la taille de ce gâteau, mais pas nécessairement à ses ingrédients. Notre niveau de vie, c'est-à-dire la taille du gâteau, dépend de la quantité et de la qualité des facteurs que nous utilisons dans le processus de production et de l'efficacité avec laquelle nous les utilisons.
Par contraste avec le niveau de vie, la productivité est le moyen grâce auquel on peut accroître la taille du gâteau au fil du temps. En termes simples, la productivité de notre économie est sa capacité d'augmenter la production par facteur de production. Elle mesure donc l'efficience avec laquelle nous utilisons les facteurs de production dans le processus de production.
En termes simples, la productivité est la valeur de ce qui est produit, divisée par le coût de production. Il y a deux façons d'améliorer la productivité : réduire les coûts de production ou augmenter la valeur des biens et des services que nous produisons, ou encore faire l'un et l'autre. Mais pour être plus productifs tout en créant de nouveaux emplois de qualité pour les Canadiens, c'est sur l'accroissement de la valeur de ce que nous produisons qu'il faut mettre l'accent. Pour cela, il faut créer de nouveaux biens et services qui peuvent percer le marché mondial. Il s'agit là du genre d'innovation auquel le CRSNG participe le plus3.
À n'importe quelle époque, notre niveau de vie découle de la croissance économique antérieure; il est tributaire d'une utilisation plus efficace de la main-d'9uvre et du capital ainsi que des techniques que nous employons pour transformer les facteurs de production en biens et services. Notre niveau de vie d'aujourd'hui est le résultat cumulatif de nombreuses décisions et circonstances sur une longue période. Ainsi, lorsque nous parlons d'une amélioration de productivité, nous évoquons en réalité l'avenir.
Essentiellement, la productivité consiste à créer le plus de valeur avec le moins d'intrants. [ . . . ] Pour attirer des capitaux d'investissement et maintenir des emplois bien rémunérés, une entreprise doit soutenir et hausser sa productivité au moins autant que ne le font ses compétiteurs. C'est le principe même de la compétition. Aujourd'hui, cela exige une innovation continue. Si les Canadiens produisent une valeur supérieure grâce à leur travail, alors leurs niveaux de rémunération - élevés par rapport aux normes mondiales - seront maintenus et améliorés. Sinon, dans une économie ouverte à la concurrence mondiale, le niveau de vie des Canadiens diminuera nécessairement.
Association canadienne des producteurs d'acier
Même les plans gouvernementaux les mieux conçus ne peuvent avoir qu'une faible incidence sur le taux de croissance annuel de la productivité. Néanmoins, si l'on parvient à susciter une croissance faible mais constante de la productivité, l'impact peut être énorme dans l'avenir. Par exemple, il est bien connu que le taux de croissance économique a marqué un recul important dans les années 80 et 90 par rapport à celui des années 60 et du début des années 704. S'il était demeuré le même, notre niveau de vie serait beaucoup plus élevé qu'il ne l'est aujourd'hui. De fait, si le rythme de la croissance économique s'était maintenu, bon nombre de nos problèmes économiques et sociaux n'existeraient pas. Par ailleurs, une croissance économique plus rapide permet de régler de nombreuses difficultés liées aux changements démographiques, notamment le vieillissement de la population.
L'Assemblée des Premières Nations l'a bien exprimé dans son mémoire lorsqu'elle a fait observer que « la période d'excédents qui s'annonce n'est donc qu'une occasion parmi tant d'autres que le Canada doit saisir pour prendre des mesures en vue d'améliorer la productivité avant de subir les pressions des coûts associés à une société vieillissante ».
Il est facile de ne pas croire qu'on peut augmenter la croissance de, mettons, 0,5 point de pourcentage par année, mais peut-être convient-il de citer à cet égard le cas de l'Irlande. De 1994 à 1998, la production réelle y a progressé de 50 %, l'inflation se situant dans la même fourchette qu'au Canada. Le taux de chômage a diminué de près de moitié, et le gouvernement s'attend maintenant à un excédent d'environ 3 % du PIB en 1999. Un tel taux de croissance est sans précédent parmi les pays industrialisés, et on prévoit qu'il se maintiendra à moyen terme5.
Au cours du présent cycle de consultations prébudgétaires et lors de notre enquête antérieure, l'objet de notre recherche était de recenser les options qui s'offrent au gouvernement pour accélérer la croissance de la productivité et, partant, favoriser une croissance économique plus rapide et un niveau de vie plus élevé pour tous les Canadiens.
Ce que nous avons appris sur la productivité et la croissance économique
On peut répartir ainsi les facteurs qui stimulent la croissance de la productivité : l'investissement et la formation de capital, l'éducation et le capital humain, le progrès technologique, la concurrence et le commerce international ainsi que la fiscalité.
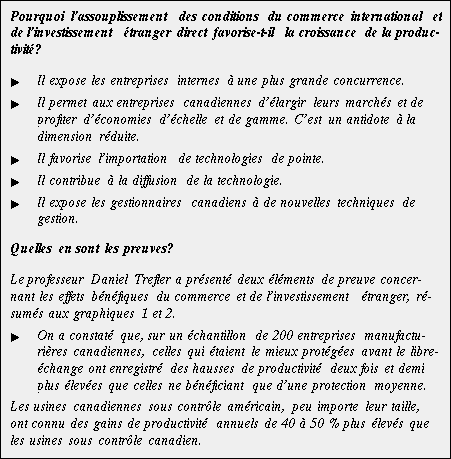
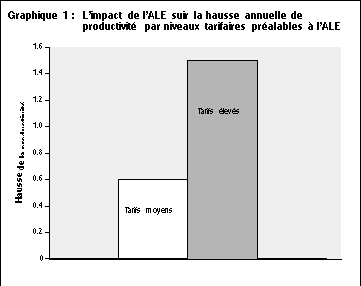
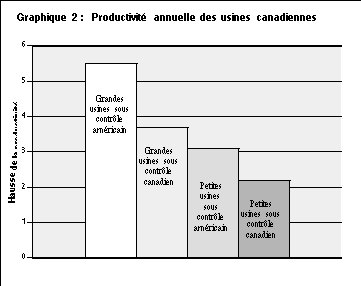
En ce qui concerne l'investissement et la formation de capital, l'une des conclusions non controversées des experts est le fait que les économies qui épargnent et investissent davantage ont tendance à générer de meilleurs taux de croissance. Plus les travailleurs ont de biens d'investissement à leur disposition et plus ceux-ci sont à jour, plus la productivité du travail sera élevée. Malheureusement, notre taux d'accumulation du capital est allé en diminuant. Dans les années 70, l'investissement net dépassait 10 % du PIB; il a atteint un sommet de près de 15 % en 1974. Au cours de la présente décennie, il s'est situé aux environs de 5 à 6 % du PIB. La même histoire se répète en ce qui touche le stock de capital. Dans les années 60, l'investissement net représentait environ 5 % du stock de capital en moyenne. À l'heure actuelle, il correspond à environ la moitié de ce taux.
Le secteur public peut jouer un rôle important pour rehausser la formation de capital. De fait, les infrastructures publiques soutiennent l'activité privée en la rendant plus efficace. Elles sont constituées d'équipements de transport comme les routes et les ponts, de systèmes de télécommunications, de réseaux d'adduction d'eau et d'égouts ainsi que de services d'éducation et de santé6. La présence gouvernementale dans bon nombre de ces domaines peut aussi procurer des avantages environnementaux marqués. Ainsi, le gouvernement fédéral participe à un projet pilote de collecte sélective conçu pour diminuer les rejets d'ordures ménagères, réduisant de ce fait les émissions de gaz à effet de serre7.
Toutefois, les dépenses gouvernementales au chapitre des infrastructures ont subi une importante régression au cours des trois dernières décennies. Dans les années 60, les gouvernements canadiens consacraient globalement environ 5 % du PIB à l'investissement fixe brut réel. À l'heure actuelle, toutes proportions gardées, ils dépensent environ la moitié de cette somme. Cela peut dépendre en partie du fait que, dans les années 60, nous avions beaucoup ajouté à notre stock d'infrastructures. Néanmoins, la compression des dépenses publiques suggère que le stock existant n'est pas adéquatement entretenu.
[Au Canada,] on trouve deux fois plus de personnes qui n'ont pas terminé leurs études secondaires qu'aux États-Unis. L'investissement en éducation est donc un élément essentiel du programme d'amélioration de la productivité
John D'Orsay
Notre infrastructure continue de se détériorer et le coût des réparations et de l'entretien, à augmenter. Nous sommes d'avis que l'insuffisance de l'investissement dans notre infrastructure cause quelques-uns des problèmes que nous connaissons aujourd'hui, dont les retards et les bouchons de circulation, la pollution atmosphérique, les accidents de circulation et la contamination de l'eau potable. Tout cela ajoute considérablement aux coûts des soins de santé et se répercute négativement sur notre productivité économique générale8.
En ce qui concerne l'éducation, il est largement admis que le capital humain joue un rôle de plus en plus vital dans la croissance de la productivité. Pour tirer parti des techniques les plus modernes et les plus productives, il faut des travailleurs hautement qualifiés. Les économies où les travailleurs sont peu qualifiés sont reléguées aux techniques plus anciennes et moins productives..
La productivité accrue du secteur de la fabrication au Canada, due au changement technologique, exigera un accès facile à du personnel hautement qualifié9.
Toutefois, un niveau élevé de compétences est fonction de la capacité d'apprendre. Et l'on est en train de se rendre compte que la capacité d'apprendre est déterminée très tôt dans la vie des enfants. Si elle est inhibée à cette époque, il devient très difficile d'inverser les effets. C'est là un exemple parfait de la nature à long terme de la productivité et des facteurs qui la conditionnent. C'est également un exemple parfait de la manière dont le capital social, ou les programmes sociaux, peuvent effectivement contribuer à la productivité. Si l'on sait s'y prendre, une intervention tôt dans l'enfance constitue un investissement au même titre que l'acquisition de nouveau capital physique, l'obtention d'un diplôme universitaire ou des activités de R-D.
Un investissement dans les premières années, de la part de tous les secteurs de la société, est aussi important que notre investissement dans le domaine de l'éducation si l'on veut que l'Ontario ait une population hautement compétente et bien instruite, ce qu'exigent une économie forte et une démocratie florissante.
[ . . . ] Si nous agissons dès maintenant, nous solidifions pour nos enfants et notre société les assises de l'avenir. C'est une mesure nécessaire non seulement pour maintenir un niveau de vie raisonnable mais aussi pour servir l'intérêt de nos enfants10.
En matière d'éducation permanente, de nombreux témoins ont dit qu'il y aurait lieu d'augmenter de beaucoup les fonds affectés à la formation. Actuellement, nombre de programmes facilitent la formation des travailleurs sans emploi ou déplacés. Toutefois, notre économie évoluant rapidement, il importe que les travailleurs recourent à l'éducation permanente afin d'améliorer leur employabilité et de conserver leur emploi. Chacun doit pour cela acquérir la formation qui lui convient le plus, compte tenu de ses intérêts et de ses besoins. Le gouvernement fédéral a déjà pris des mesures pour faciliter l'inscription à l'éducation permanente en permettant d'y consacrer des sommes retirées des REER.
Le progrès technologique, entraîné par des changements dans les biens et services que nous produisons et dans la façon dont nous les produisons, est le moteur de la productivité et de la croissance économique à long terme. Pour qu'il ait lieu, il importe qu'une économie et une société soient ouvertes aux nouveaux défis ainsi qu'aux nouvelles idées et possibilités. L'innovation fructueuse est tributaire non seulement d'une main-d'9uvre hautement qualifiée et souple, mais également d'un secteur privé où s'expriment une gestion créative et un leadership éclairé.
Toutefois, le Canada n'arrive pas à suivre ses concurrents dans la transition vers une économie du savoir fondée sur l'innovation. À presque tous les égards, les résultats du Canada en matière d'innovation sont moindres que ceux de ses principaux concurrents, en particulier les États-Unis. Selon les statistiques fournies par l'Association des industries aérospatiales du Canada :
- Le pourcentage du PIB consacré à la recherche et au développement au Canada est le plus faible des pays du G7, à l'exception de l'Italie.
- Les dépenses du Canada consacrées à la recherche et au développement sont, à 1,8 % du PIB, 30 % moins élevées que celles des États-Unis (2,7 %).
- Les fonds consacrés à la R-D par les universités canadiennes se situent, si on les compare au PIB, à l'avant-dernier rang des pays du G7.
- Les entreprises américaines investissent environ deux fois plus que les entreprises canadiennes dans la R-D.
- La densité technologique totale est moins élevée dans presque toutes les industries canadiennes qu'elle ne l'est dans les industries américaines.
- L'adoption de technologies existantes par les entreprises canadiennes est beaucoup plus faible que par les entreprises américaines11.
On a dit au Comité qu'il existait également un déficit d'innovation entre les divers participants au système d'innovation. Le graphique 3, fourni par le Conseil national de recherches, illustre cet écart sur le plan de l'innovation, qui a constitué un facteur dans notre piètre productivité. Selon toute évidence, nous devons en faire beaucoup plus, en particulier dans le domaine de la recherche fondamentale, si nous voulons améliorer notre position concurrentielle au sein de la nouvelle économie mondiale.
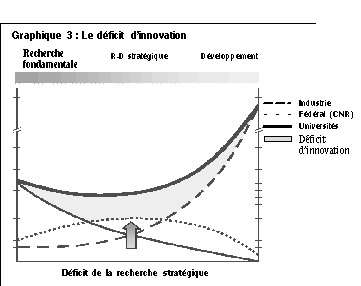
Le Canada réussit mieux pour ce qui regarde l'investissement dans la technologie de pointe. Selon une étude récente, les dépenses consacrées par le secteur privé aux ordinateurs et au matériel de télécommunications ont augmenté au rythme de 19 % par année depuis le début des années 90, un rythme plus rapide que les 16 % enregistrés à ce chapitre aux États-Unis. L'étude montre également que la production du secteur canadien de haute technologie a augmenté de plus de 10 % par année depuis 1995, un taux de 3,5 % plus élevé que celui de la croissance du PIB12.
De fait, les ordinateurs et les technologies des télécommunications font subir une transformation rapide à pratiquement tous les secteurs de l'économie (médecine, finances, éducation, etc.), tout en contribuant au processus de la mondialisation. Compte tenu de l'importance grandissante d'Internet, il est probable que la nature et la structure des entreprises seront totalement différentes dans l'avenir. Les rapports entre employeurs et employés seront également très différents de ceux d'aujourd'hui, et en particulier de ceux d'hier.
Cela aura d'énormes répercussions sur la façon dont les gouvernements peuvent, et devraient, réglementer les activités et les relations économiques. Par exemple, à quoi sert d'empêcher une banque de vendre directement de l'assurance dans une succursale si un consommateur peut, grâce à un hyperlien dans Internet, en acheter sans aucune difficulté auprès de la filiale de cette banque? À quoi sert d'empêcher des institutions canadiennes de fournir tel ou tel ensemble de services alors que les consommateurs canadiens peuvent facilement l'acheter en visitant un site Web approprié, du pays ou de l'étranger?
En outre, au fur et à mesure que le commerce électronique facilite pour les fournisseurs de produits la différenciation des fonctions, par exemple distinguer entre la fourniture de renseignements sur un produit et la livraison comme telle du produit, à quoi sert d'imposer certains types de restrictions à la propriété pour certaines institutions financières, ou de limiter leur pouvoir commercial?
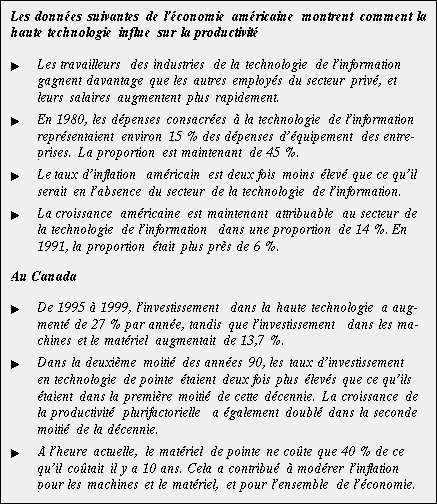
Enfin, à quoi sert d'assujettir des fournisseurs conventionnels
de services de télécommunications, de radiodiffusion ou de
télédiffusion à des restrictions touchant le contenu
canadien, alors que ces fournisseurs sont en train d'être supplantés
par une plateforme Internet d'envergure mondiale ne faisant l'objet d'aucune
réglementation?
Lorsqu'il a comparu devant le Comité l'an dernier, le gouverneur de la Banque du Canada, Gordon Thiessen, a soutenu que la souplesse et l'ouverture constituaient des ingrédients importants d'une économie efficiente et productive. À cause des changements technologiques et de la mondialisation accrue, cette souplesse revêt encore plus d'importance que par le passé.
Notre chapitre sur la nouvelle économie tient compte de ce facteur. Nous faisons observer que la technologie évolue rapidement et que la durée de vie des nouvelles technologies est en fait très courte. Il devient donc pratiquement impossible de réglementer l'économie de la même façon que nous l'avons fait par le passé, principalement parce que les autorités de réglementation ne peuvent suivre le rythme des avancées technologiques et, partant, des tendances économiques.
Un facteur, celui de la concurrence, se rattache à la souplesse et au progrès technologique. C'est le processus de la concurrence qui incite les entreprises canadiennes à offrir les meilleurs produits au meilleur prix. Pour y parvenir, elles doivent être aussi efficientes et concurrentielles que les autres fournisseurs. Le commerce international et l'ouverture des frontières revêtent donc une importance extrême pour faire en sorte que des économies de taille relativement réduite, comme celle du Canada, puissent jouir des avantages d'une vaste concurrence et permettre en même temps à leurs entreprises d'accéder aux marchés mondiaux. Dans le contexte de la mondialisation, les entreprises canadiennes peuvent acquérir une taille imposante en tirant parti des économies d'échelle et de gamme, ce même si elles sont basées dans un marché relativement restreint.
Toutefois, pour une réelle compétition, les règles du jeu doivent être équitables, et cela ne semble pas être le cas, par exemple, dans l'industrie de la construction navale où plusieurs pays mais non le Canada aident les constructeurs (par des subventions directes, des avantages fiscaux, des prélèvements et des restrictions, etc.). Le Comité a appris que l'industrie canadienne de la construction navale était défavorisée par rapport à celle de ses compétiteurs étrangers et que cette réalité a contribué à un déclin constant durant les années 90. Nous reconnaissons le rôle important que joue cette industrie dans les diverses régions du pays ainsi que dans le système mondial du commerce et du transport. C'est pourquoi nous exhortons le gouvernement fédéral à examiner, en collaboration avec les provinces, la situation de la construction navale au Canada et les moyens pour elle de relever les défis sur la scène internationale.
Malheureusement, dans ce secteur, ce n'est pas suffisant de concurrencer sur le plan de la qualité du travail et de la main-d'9uvre et des autres coûts de production. Les fortes subventions étrangères - de 2 % à plus de 30 % - ont véritablement empêché les constructeurs de navire canadiens de pénétrer sur la plupart des marchés étrangers. Les efforts internationaux répétés pour mettre ce secteur au pas en éliminant les entraves au commerce et les mesures protectionnistes sont restés vains. Ainsi, les tentatives de l'OCDE pour uniformiser les règles du jeu dans l'industrie de la construction et de la réparation de navire, y compris l'élimination des subventions directes, n'ont pu engendrer de ratification.
Fédération des travailleurs de construction navale/TCA-Canada
Les Canadiens n'ont pas obtenu beaucoup de succès pour ce qui concerne l'intégration totale de leurs marchés internes. Bien que le gouvernement fédéral et les provinces aient pris des mesures pour instaurer le libre-échange à l'intérieur des frontières, ce processus demeure incomplet.
C'est cette concurrence qui oblige les entreprises à s'adapter aux nouvelles circonstances et aux nouvelles possibilités. Il n'y a qu'à observer la culture en évolution des entreprises de télécommunications, qui ont cessé d'évoluer dans un marché protégé et monopolistique et qui font maintenant face à une forte concurrence.
Quant au lien entre la fiscalité et la productivité, la meilleure façon de l'expliquer consiste à examiner comment la fiscalité influe sur les motivations des particuliers et des entreprises, et quelle action elle exerce sur leurs décisions. Il n'y a pas que le niveau d'imposition qui compte, mais également la composition des impôts et la façon dont ils sont appliqués à l'économie. Notre chapitre sur la réforme et l'allégement de la fiscalité présente différentes options visant à soutenir la croissance économique.
Les auteurs d'une étude récente sur le lien entre la fiscalité et la croissance économique sont arrivés précisément à ces conclusions13. Différentes techniques sont utilisées dans les documents économiques pour cerner cette relation, à la fois dans le contexte américain et sur le plan international. Un examen de ces documents a fait ressortir que des taux d'imposition élevés sont associés à de faibles taux de croissance. En outre, on a conclu que la composition des impôts peut avoir une forte incidence sur la croissance économique, l'impôt sur le revenu ayant les plus fortes répercussions négatives, par exemple, tandis que des taxes à la consommation réparties sur une large base ont les répercussions négatives les plus faibles.
À court terme, les conséquences semblent mineures, mais elles deviennent très substantielles à long terme. Encore une fois, c'est une chose que nous n'avons cessé de souligner dans le contexte de la productivité et de la croissance économique. Dans l'étude en question, on fait observer ce qui suit :
Une réforme fiscale majeure réduisant tous les taux marginaux de 5 points de pourcentage, et les taux d'imposition moyens de 2,5 points de pourcentage, devrait faire augmenter les taux de croissance à long terme de 0,2 à 0,3 points de pourcentage.
L'étude poursuit, dans le contexte de l'économie américaine :
Même ces effets de croissance modestes peuvent avoir d'importantes répercussions à long terme sur les niveaux de vie. Par exemple, supposons que, depuis 1960, une structure d'imposition inefficace retarde la croissance de 0,2 % par année. Après une accumulation de 36 ans, le taux de croissance plus faible aboutit à un PIB inférieur de 7,5 % en 1996, ou une réduction nette de la production de plus de 500 milliards de dollars par année14.
Enfin, cette étude nous paraît digne de mention pour une autre raison : elle corrobore dans une large mesure les conclusions et recommandations du comité Mintz sur l'imposition des entreprises. En particulier, on a constaté que l'allocation intersectorielle des capitaux constituait un facteur important de la croissance économique. Lorsque les impôts ont un effet de distorsion sur cette allocation, comme cela a lieu au Canada, la croissance économique en souffre. C'est précisément là que veut en venir le comité Mintz lorsqu'il recommande que le régime d'imposition des entreprises soit plus neutre. La leçon qu'il faut en tirer est que l'investissement revêt de l'importance, certes, mais qu'il doit également être affecté aux initiatives les plus profitables.
Le taux d'imposition élevé au Canada a contribué à rogner régulièrement les revenus des contribuables, à abaisser les taux d'épargne des Canadiens et à faire gonfler les ratios dette à revenu. Les impôts élevés sont à l'origine de l'exode des cerveaux vers les États-Unis et ils empêchent d'attirer et de retenir les professionnels qualifiés. De plus, les impôts élevés ont pour effet de diminuer la productivité et la croissance du PIB du fait qu'ils constituent une désincitation au travail et un frein à la prise de risques et aux investissements. (Association des industries aérospatiales du Canada)
En ce qui concerne la fiscalité des entreprises, on a fait valoir ce qui suit :
Une réduction de l'impôt des sociétés notamment des petites et moyennes entreprises dégagerait d'importants capitaux qui pourraient être réinvestis de façon stratégique. Les investissements effectués dans des domaines comme la technologie de l'information permettraient à un plus grand nombre d'entreprises canadiennes, petites et moyennes, de tirer parti des possibilités qu'offre l'économie nouvelle dont le commerce électronique et autres technologie en émergence. Cette mesure permettrait également d'attirer de nouveaux investissements dans cette industrie et autres, et de favoriser ainsi la concurrence à l'échelle nationale et internationale. (Association des industries de l'automobile du Canada)
Ce qui est déjà accompli
Ces dernières années, le gouvernement fédéral a pris différentes initiatives qui ont orienté l'économie canadienne dans la bonne direction et sont de nature à la rendre plus productive.
L'amélioration la plus importante a été l'instauration de conditions saines et stables sur les plans budgétaire et monétaire. En éliminant le déficit, en réduisant le ratio de la dette au PIB et en réalisant la stabilité des prix, on a rétabli la confiance dans l'économie canadienne et fait chuter les taux d'intérêt à des niveaux qui ne s'étaient pas vus depuis très longtemps.
Nous [CATA Alliance] aimerions féliciter le gouvernement pour ses engagements dans la R-D. La Fondation canadienne pour l'innovation, les Instituts canadiens de recherche en santé, l'augmentation des budgets des conseils subventionnaires qui ont tout dernièrement annoncé qu'ils financeront 2 000 chaires de recherches universitaires sont des mesures importantes qui viennent soutenir la recherche scientifique au Canada. C'est le genre de programmes qui stimulent la nouvelle économie et renforcent la position du Canada sur la scène internationale.
CATA Alliance
L'ouverture de l'économie grâce à l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis (ALE) et à l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) a étendu les marchés des entreprises canadiennes et rehaussé la concurrence dans les marchés internes. La déréglementation de certains marchés a également joué un rôle pour ce qui est d'accentuer la concurrence et les occasions d'affaires. Le secteur financier en offre un parfait exemple, mais c'est également le cas d'autres secteurs, comme celui des télécommunications.
Par ailleurs, on a révisé le filet de sécurité sociale afin de le rendre plus sécuritaire et d'améliorer le fonctionnement des marchés du travail. À cet égard, les réformes de l'assurance-emploi (AE) ont été les plus marquantes, mais il ne faut pas oublier celles des politiques d'investissement et des primes versées au RPC/RRQ pour rendre plus viable le système de sécurité du revenu de retraite.
Le gouvernement a aussi réalisé un certain nombre d'investissements au titre d'une économie productive. Il a amélioré l'accès à l'enseignement postsecondaire et à l'éducation permanente grâce à la création de la Fondation canadienne des bourses d'études du millénaire et de la Subvention canadienne pour l'épargne-études ainsi qu'à différentes mesures fiscales comme un soutien fiscal accru touchant les frais de scolarité et de subsistance. Du côté de la R-D, il a augmenté le financement des organismes subventionnaires et établi la Fondation canadienne pour l'innovation ainsi que les Instituts canadiens de recherche en santé. L'annonce faite dans le discours du Trône de créer de 1 200 à 2 000 chaires pour la recherche dans les universités constitue une autre initiative valable.
Il y a eu également d'importantes réformes du secteur des services financiers, et d'autres restent du domaine des possibilités. Qui plus est, le gouvernement se retire de secteurs qui conviennent mieux au secteur privé. Il a déjà mené à terme la privatisation et la commercialisation de plusieurs activités.
Enfin, le gouvernement a entamé le processus de réduction des impôts; au départ les mesures sont limitées aux plus démunis, mais à terme tous les Canadiens en profiteront.
Ce qui reste à accomplir
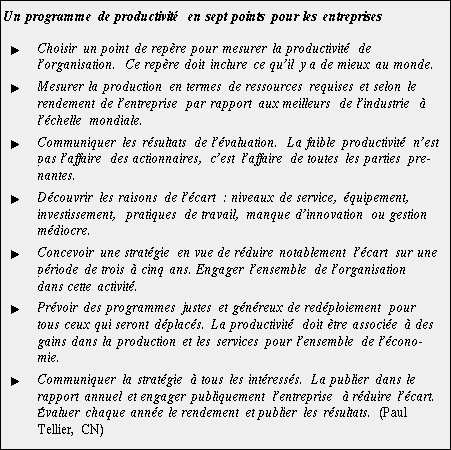
D'après une étude économique récente de l'OCDE,
il reste plusieurs secteurs où le gouvernement doit revoir ses politiques
afin d'améliorer le niveau de vie des Canadiens à moyen et
à long terme. Les interventions souhaitées sont les suivantes
:
La nouvelle économie est axée sur le savoir. Cela fait de l'éducation un facteur encore plus important dans le succès que peuvent espérer remporter tant les citoyens canadiens que l'économie canadienne. Le gouvernement devrait concentrer son intervention sur l'éducation et, en particulier, le perfectionnement continu, en augmentant ses investissements sociaux. Des programmes comme Rescol et Accès communautaire, qui offrent à tous les Canadiens l'accès à un réseau mondial de connaissances, constituent de bons modèles.
CATA Alliance
- Réduire le fardeau fiscal moyen des particuliers et des sociétés, et réduire les taux d'imposition marginaux.
- Restructurer la fiscalité des entreprises afin de la rendre neutre et compétitive à l'échelle internationale.
- S'efforcer continuellement d'améliorer les compétences de la main-d'9uvre et des personnes qui ont peu d'antécédents professionnels.
- Stimuler continuellement la mobilité des ressources productives et des biens et services d'une province à l'autre.
- Maintenir un accès ample et sûr aux marchés mondiaux.
- Créer un cadre d'action tenant compte de l'évolution de la concurrence dans divers secteurs en réponse à la mondialisation et aux mutations rapides de l'information et des télécommunications15.
Dans son rapport intitulé Stimuler la productivité pour relever le niveau de vie des Canadiens, le Comité examinait les différents aspects statistiques et conceptuels de cette question. On y fait observer que la croissance de la productivité a considérablement ralenti après le milieu des années 70 et que le Canada n'a pas été capable de combler l'écart avec les États-Unis à ce chapitre. Nous n'allons pas reprendre ici cette discussion. Nous cherchons à identifier les facteurs qui importent pour relever la productivité et son taux de croissance et, partant, améliorer le niveau de vie des Canadiens. Dans le rapport mentionné plus haut, nous établissions un guide pour rehausser la productivité. Nous y énoncions une série de principes tout en définissant un rôle approprié pour le gouvernement. Au cours des dernières audiences, notre but était de raffiner ce guide, d'ajouter des exemples concrets et de préciser de quelle façon une telle politique pourrait être mise en 9uvre. Voici les principaux points abordés dans notre guide pour rehausser la productivité :
L'amélioration des éléments fondamentaux : Il est question ici du vaste contexte économique au sein duquel fonctionne l'économie. Le Comité soutient la politique de la Banque du Canada visant la stabilité des prix. En outre, le rapport de la dette au PIB devrait être réduit, et notre recommandation d'utiliser la réserve pour éventualités exclusivement pour la réduction de la dette lorsqu'elle n'est pas nécessaire par ailleurs est conforme à cette conviction. De même, nous appuyons la poursuite de l'examen des programmes afin de concentrer l'attention du gouvernement sur les secteurs où il a un rôle efficace à jouer.
La politique fiscale : conformément à ce qui est dit plus haut, le Comité est d'avis qu'il faudrait augmenter l'exemption personnelle de base, réduire les taux marginaux d'imposition, éliminer la surtaxe de 5 %, rendre plus neutre et compétitif à l'échelle internationale le régime d'impôt sur les sociétés et imposer les gains en capital à un plus faible taux qu'à l'heure actuelle. Le régime fiscal influe sur l'activité économique non seulement parce qu'il consacre à certaines fins des revenus en provenance du secteur privé, mais également parce qu'il agit sur la motivation des particuliers et des entreprises.
L'aide à l'enseignement et au perfectionnement : Le Comité continue à soutenir les mesures antérieures qui élargissent l'accès à l'enseignement postsecondaire, établissent une aide fiscale aux études supérieures et encouragent l'épargne-études. En réduisant les taux marginaux et moyens d'imposition, les particuliers seront financièrement plus motivés à acquérir des compétences leur donnant accès à des emplois mieux rémunérés.
Pendant plus de deux décennies, le gouvernement fédéral a permis aux contribuables d'investir dans un régime enregistré d'épargne-études (REEE) en vue de financer les études futures des bénéficiaires, habituellement les enfants des contribuables en question. Contrairement à ce qui se passe pour les REER, les contribuables n'ont pas droit à une déduction pour ces investissements. Toutefois, le revenu du régime n'est pas imposé avant d'être retiré; c'est alors le bénéficiaire qui est imposé, normalement à un taux faible ou nul.
Dans la Mise à jour économique et financière, on fait observer que les Canadiens ont réagi avec enthousiasme au programme des REEE depuis l'introduction de la Subvention canadienne pour l'épargne-études dans le budget de 1998. En moins de deux ans, les économies des REEE ont doublé, passant à 5 milliards de dollars, alors que 25 ans avaient été nécessaires pour accumuler les premiers 2,5 milliards de dollars. La Subvention canadienne pour l'épargne-études est une subvention fédérale équivalent à 20 % des contributions, jusqu'à concurrence de 400 $ par bénéficiaire par année, et elle est le résultat direct du rapport prébudgétaire de 1997 de notre comité. Nous sommes heureux d'en constater le succès. Le Comité y voit un exemple des appuis constructifs que le gouvernement fédéral peut fournir à l'éducation, au développement des compétences et à la promotion d'une économie productive pour les temps nouveaux.
L'aide à la R-D : La technologie est l'élément clé d'une meilleure productivité à long terme. Le Comité continue donc de soutenir les mesures qui encouragent la création et l'utilisation des nouvelles technologies. L'aide fiscale à la recherche et au développement, les programmes de diffusion de la technologie, l'aide aux infrastructures de recherche et le financement adéquat des organismes subventionnaires constituent des initiatives importantes prises par le gouvernement pour promouvoir la R-D. Nous constatons également que la recherche est une entreprise risquée et que le régime fiscal a un impact véritable sur la mise en branle et le financement d'activités risquées par les particuliers et les entreprises. Notre recommandation touchant l'imposition des gains en capital et la réduction de l'impôt général des sociétés soutient ce point de vue.
La réforme sociale et du marché du travail : Une économie fonctionne de façon optimale lorsque les particuliers jouissent d'une sécurité fondamentale grâce à un solide filet de sécurité sociale, tout en bénéficiant des débouchés offerts par un marché du travail souple et efficient. Le gouvernement a déjà réformé le régime d'assurance-emploi, contribué à amoindrir le piège de l'aide sociale et renforcé le filet de sécurité sociale. En outre, notre recommandation de modérer le taux de réduction des prestations en ce qui concerne la Prestation fiscale canadienne pour enfants favorisera une plus grande participation au marché du travail.
La politique commerciale et de l'investissement : Bien qu'il n'en soit pas directement question ici, le Comité continue à appuyer une plus grande libéralisation du commerce et de l'investissement. Grâce à l'expansion des marchés et à l'intensification de la concurrence, les entreprises canadiennes peuvent réaliser des économies d'échelle et de longs cycles de production; elles se frottent également à la concurrence des meilleures entreprises du monde. Un accroissement de l'investissement étranger direct, vers l'intérieur et vers l'extérieur, rend possible un transfert plus rapide et plus vaste de la technologie moderne.
Laisser agir les forces du marché : Encore une fois, il ne s'agit pas d'un sujet traité de façon précise dans les consultations prébudgétaires. Néanmoins, nous réitérons la position que nous avons déjà exprimée, c'est-à-dire que le gouvernement devrait réduire les subventions aux entreprises, continuer à privatiser les sociétés commerciales, réduire le fardeau et l'utilisation de la réglementation économique et encourager la concurrence.
![]()
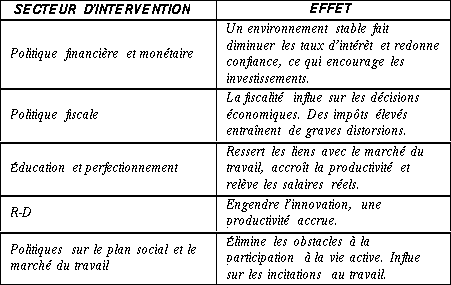
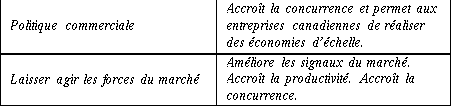
Approche du Comité
Le Comité expose, dans ce rapport, un vaste programme complet de réformes et d'allégements fiscaux. Il le fait en grande partie par conviction qu'un tel programme sera bénéfique pour l'économie canadienne et stimulera encore la productivité pour aboutir, à terme, à une croissance économique encore plus forte. Le Comité n'est pas seul à revendiquer des réductions d'impôt comme moyen de mousser la productivité. Selon le professeur Pierre Fortin, « le Canada pourrait maintenant réduire les impôts de quelque 30 milliards de dollars étalés sur les 10 prochaines années. Il devrait saisir l'occasion pour protéger les incitatifs au travail, promouvoir l'investissement - et non pas la consommation - et renforcer à la fois l'infrastructure technologique et la compétitivité fiscale internationale du pays »16. En outre, un témoin a déclaré ce qui suit :
La fiscalité élevée gêne l'innovation et la productivité et pose de gros problèmes aux entreprises qui cherchent à garder leur personnel et à attirer des gens prêts à travailler au Canada17.
Si le Comité a opté pour la réforme/l'allégement fiscal comme principal moyen de fouetter la productivité, ce n'est pas parce que nous connaissons l'existence de liens bien précis et réels entre la productivité et la fiscalité, mais surtout à cause de ce que nous ignorons.
Les facteurs qui contribuent à hausser la productivité sont complexes et mal connus, mais nous sommes conscients de bien des facteurs importants. Les témoignages entendus au cours de nos consultations sont venus confirmer ce que nous avons entendu dans le passé.
L'investissement est le moteur principal des hausses de productivité. L'infrastructure publique, la machinerie et l'équipement privés, la R-D fondamentale et appliquée, et la formation du capital humain sont tous des éléments qui y contribuent. Et certaines des variables de base qui favorisent ces investissements sont connues. Nous ne saurions, toutefois, évaluer l'importance relative de chaque type d'investissement et personne ne sait exactement quelle est la meilleure façon de stimuler chacun. De nouvelles études, gouvernementales et universitaires, s'imposent dans ce domaine.
Autrement dit, le Comité ne saurait entreprendre la microgestion du processus de productivité. Il est d'ailleurs convaincu qu'aucun palier de gouvernement ou ministère ne saurait le faire efficacement. La meilleure façon de stimuler la productivité est donc de bien saisir les principes fondamentaux de l'économie. Le gouvernement devrait, par conséquent, lancer de vastes initiatives qui vont dans le sens d'une économie saine, prospère et croissante, une économie adaptée au prochain millénaire et aux nouveaux défis et débouchés que la nouvelle ère apportera.
Une hausse de productivité n'est pas une chose que le gouvernement peut imposer. Elle est l'aboutissement de décisions privées prises dans le contexte de marchés économiques assujettis au cadre fiscal, monétaire, réglementaire et juridique créé par le gouvernement.
C'est pourquoi le Comité a concentré son attention avant tout sur la réforme/l'allégement fiscal, domaine où le gouvernement peut jouer un rôle précieux.
Tous les paliers de gouvernement du Canada pratiquent aujourd'hui une politique financière prudente qui vise la stabilisation et le déclin du fardeau de la dette. Les taux d'inflation et d'intérêt sont faibles. Vu la politique adoptée par la Banque du Canada et sa crédibilité sur les marchés financiers, l'inflation devrait rester faible. L'économie canadienne est maintenant, plus que jamais, ouverte au commerce et à l'investissement internationaux. Non seulement les gouvernements canadien, américain et autres acceptent l'ouverture des frontières, mais les tendances des marchés et de la technologie vont dans le sens d'une ouverture encore plus grande. En plein essor, l'Internet est de nature foncièrement planétaire. L'élimination du facteur de la distance dans bien des opérations commerciales, et surtout la diffusion d'information, est sa caractéristique déterminante. Il est difficile d'imaginer, au moment où l'Internet devient la nouvelle place du marché, comment les gouvernements pourraient même tenter de mettre leurs économies à l'abri de ces forces internationales.
D'autre part, l'économie canadienne offre aux entreprises beaucoup plus de souplesse que dans le passé. Le secteur des services financiers en est un exemple. Les télécommunications aussi. Une déréglementation plus poussée demeure néanmoins possible dans ces deux domaines et dans d'autres.
Chacune de ces grandes perceptions de la politique économique est autant de façons de stimuler la productivité. Chacune contribue à créer le contexte dans lequel les marchés fonctionnent, sans chercher à en dicter le mode de fonctionnement et la forme exacte.
C'est précisément le rôle que le Comité entrevoit pour nos initiatives fiscales. De manière générale, nos propositions portent sur de grandes mesures d'allégement fiscal. Nous ne prônons pas le recours aux réductions d'impôt pour pousser les particuliers ou les entreprises à faire des choses précises. Nous ne préconisons pas non plus de préférences fiscales pour les investissements en R-D ou l'achat d'ordinateurs, par exemple, ni de réductions d'impôt pour des secteurs particuliers de l'économie. L'une des choses qui nous laissent perplexes dans notre façon de promouvoir la R-D par de généreuses concessions fiscales (les plus généreuses de tous les pays de l'OCDE18) est la raison pour laquelle cela n'a pas donné lieu, d'une part, à des dépenses accrues en R-D et, d'autre part, à une plus forte hausse de la productivité.
Le Comité a plutôt examiné le régime fiscal en tentant de cerner les éléments qui soit découragent les comportements de nature à stimuler la productivité, soit défavorisent un secteur par rapport à un autre. En s'attaquant à ces pommes de discorde particulières, nous donnons aux ménages et aux entreprises canadiens la possibilité de réagir comme ils le jugent bon.
Nous recommandons, par exemple, d'augmenter le montant du revenu des particuliers exonéré d'impôt. Une telle baisse des taux moyens et marginaux d'impôt des Canadiens à faible revenu qui sont peu qualifiés pourrait les encourager à demeurer actifs.
Le Comité recommande en outre de hausser le seuil d'imposition des tranches moyenne et supérieure de contribuables, et de réduire de trois points de pourcentage, sur une période de cinq ans, le taux marginal d'impôt de la tranche moyenne. Outre le taux marginal d'impôt, ces mesures réduiraient aussi les taux moyens d'imposition. En plus de la formation du capital humain, elles encourageraient les salariés secondaires d'une famille à travailler. Ces personnes, qui acquièrent de nouvelles qualifications et améliorent leurs perspectives de revenu et d'emploi, conserveront une part plus grande de ce qu'ils gagnent.
Le Comité recommande d'augmenter la stimulation fiscale de l'épargne et de réduire le taux réel d'impôt sur les gains en capital. En encourageant l'épargne, cela réduira la dépendance du pays envers les capitaux étrangers. Nous recommandons des mesures de portée très générale qui ne déterminent pas où et comment les particuliers ou les entreprises doivent épargner ou investir. Une telle réduction de l'impôt sur les gains en capital pourrait toutefois avoir une forte incidence sur le financement des PME et des nouvelles entreprises de haute technologie. Ce genre d'entreprises se finance habituellement sur place.
Le Comité recommande enfin de réduire le taux réglementaire d'impôt sur les sociétés, ce qui contribuerait à égaliser les taux réels d'impôt d'un secteur économique à l'autre. Ce faisant, le milieu canadien des affaires, devenu plus compétitif, augmentera le rythme de ses investissements. En plus d'accroître et de moderniser les capitaux d'investissement, ces deux répercussions tendront à hausser la productivité et le salaire réel des travailleurs canadiens.
Les impôts élevés freinent-ils la croissance?
Le Comité a plaidé jusqu'ici en faveur de réductions d'impôt pour des raisons pratiques. Ce n'est pas sa seule raison d'appuyer les réformes/allégements fiscaux. Certains signes indiquent qu'une forte imposition a une incidence négative directe sur la hausse de productivité et la croissance économique. Cette conclusion est d'ordre non pas idéologique mais économique. Le chancelier de l'Échiquier travailliste, Gordon Brown, l'affirmait cette année dans son exposé budgétaire au Parlement britannique :
Plus notre pays devient entreprenant et plus nous créons de richesses, plus notre niveau de services publics et notre niveau de vie peuvent augmenter, pas juste pour les privilégiés, mais pour tous. [ . . . ] Puisque notre régime fiscal a trop longtemps sous-estimé l'entrepreneuriat et l'investissement, nous prenons des mesures pour réduire les impôts sur les sociétés19.
Le lien entre le régime fiscal et la croissance économique est parfois ambigu ou controversé, mais l'OCDE entrevoit clairement plusieurs façons dont la politique fiscale peut promouvoir la croissance économique. La première consiste à réduire les impôts dans les domaines où l'effet de distorsion est particulièrement prononcé. C'est ce que confiait au Comité l'an dernier le professeur Jonathan Kesselman, en plaidant en faveur d'une réforme fiscale. Selon lui, il n'y a pas que le niveau d'imposition qui importe, mais aussi la composition du fardeau fiscal. Il signalait que malgré des fardeaux fiscaux plus lourds divers pays européens ont réussi à atteindre des plus hauts niveaux de productivité et de croissance que nous20.
Il faisait valoir en particulier que le régime fiscal du Canada est trop axé sur le revenu, et surtout le revenu du capital, et pas assez sur la consommation ou le revenu du travail, en ajoutant qu'il fait trop peu de cas de l'impôt salarial. Il se peut aussi que la structure de cet impôt soit inefficace, d'où une incidence négative sur le comportement des particuliers. Lorsque les prestations personnelles de sécurité sociale sont liées aux contributions de chacun, par exemple, les ménages y voient, non pas un impôt, mais un paiement ou une prime d'assurance, bien qu'obligatoire. Au Canada, chacun perçoit les contributions aux programmes de sécurité sociale comme le RPC/RPQ ou l'assurance-emploi comme des impôts. Les contributions au REER ne sont cependant pas perçues comme des impôts. Pourquoi? Parce que ce sont manifestement des économies dont le rendement dépend directement du niveau de nos versements. Les cotisations au RPC/RPQ ou à l'assurance-emploi ne sont pas perçues dans la même optique.
L'OCDE a examiné les taux d'impôt et la croissance économique pendant la période de 1980 à 1994. Bien que d'autres facteurs influent évidemment sur les divergences de taux de croissance entre les pays, la fiscalité présente une corrélation négative très claire. Tout porte à croire qu'une hausse d'impôt de 10 points de pourcentage réduit la croissance économique d'un demi-point par an. Cela peut paraître peu, mais à la longue les résultats peuvent être frappants. Au bout de 10 ans, la différence entre un taux de croissance annuel de 3,0 % et de 3,5 % est de 7 %. Au bout de deux décennies, elle s'approche de 19 %. Une politique économique qui nous appauvrit de 19 % ou même juste de 7 %, est une politique vraiment coûteuse.
L'OCDE recommandait en outre que les régimes fiscaux tiennent compte de l'intégration croissante des marchés de capitaux. Les capitaux deviennent de plus en plus mobiles.
Les impôts ne sont cependant pas seuls en cause
Bien que nos efforts pour stimuler la productivité soient centrés sur les mesures fiscales, le gouvernement peut aussi intervenir dans toute une gamme de domaines. D'autres mesures peuvent et doivent aussi s'ajouter aux réformes fiscales.
Rôle du secteur public
Tout en reconnaissant, dans ce rapport, que la hausse de productivité résultera en grande partie de mesures prises par le secteur privé, nous reconnaissons que le gouvernement a un rôle important à jouer, directement et indirectement. Comme l'indiquait notre rapport intitulé Stimuler la productivité pour relever le niveau de vie des Canadiens, les investissements en capital de tous genres sont vitaux pour hausser la productivité :
Le capital peut être décomposé en trois éléments distincts, soit le capital matériel, le capital humain et le capital social. Ils sont liés dans une certaine mesure, mais ont néanmoins chacun un rôle distinct à jouer. Le capital matériel, qui comprend les machines l'équipement et l'infrastructure publique, a été traditionnellement la plus importante source de gains de productivité car le rendement du travail augmente en même temps que le ratio capital-travail. L'infrastructure publique par exemple les routes, les égouts, les systèmes d'approvisionnement en eau permet à l'économie de marché de fonctionner de façon efficace. Il est donc clair que le capital matériel provient à la fois du secteur privé et du secteur public, et le gouvernement a un rôle important à jouer dans les deux puisqu'il finance, et fournit souvent directement l'infrastructure publique. L'environnement macroéconomique et le régime fiscal influent sur l'investissement dans le capital privé. Le gouvernement doit donc faire en sorte que le niveau d'imposition et la composition des taxes ne nuisent pas à l'accumulation du capital privé.
Le gouvernement fédéral doit être prêt à permettre la poursuite de cette relance en réinvestissant les excédents budgétaires dans l'économie, notamment en investissant dans un nouveau programme national d'infrastructure pour améliorer les infrastructures publiques qui se délabrent, par exemple nos routes et nos installations de traitement des eaux, et lutter contre des problèmes comme le réchauffement planétaire ou d'autres problèmes environnementaux.
Newfoundland and Labrador Federation of Labour
Le Canada dépense un peu moins de 20 milliards de dollars par an en infrastructures publiques, dont la part fédérale est légèrement inférieure à 3 milliards. Le niveau de ces dépenses stagne depuis 10 ans et se situe, en pourcentage du PIB, à environ la moitié de ce qu'il était dans les années 60. La détérioration de notre système de transport témoigne du fait que l'infrastructure n'a plus, dans l'ordre de priorité des dépenses publiques, l'importance qu'elle avait :
Notre large coalition, qui représente collectivement tous les secteurs de l'économie, s'inquiète fortement de la dégradation du réseau routier national du Canada et des effets pernicieux qui en résultent sur la croissance économique, la création d'emplois et la productivité dans notre pays. Les conséquences, qu'elles soient relevées dans la pratique ou qu'elles ressortent des études, sont claires : l'investissement au Canada dans un réseau routier national procurera aux gouvernements un rendement positif sur leur investissement, épargnera des vies, améliorera la productivité et contribuera à la croissance économique21.
Notre productivité s'en ressent. Il est aussi important, toutefois, de bâtir l'infrastructure là où elle rapportera le plus.
Dans une proposition budgétaire intitulée « Vers une meilleure qualité de vie », la Fédération canadienne des municipalités (FCM) expose les besoins d'infrastructure environnementale, de transport et sociale qu'elle anticipe pour la prochaine décennie. Elle ébauche aussi un programme de financement pour les trois paliers de gouvernement et le secteur privé. Selon ses prévisions, les investissements requis seraient de :
- 16,5 milliards de dollars pour l'épuration d'eau et 36,8 milliards pour le traitement des eaux usées;
- 9 milliards de dollars pour les routes municipales;
- 8 milliards de dollars pour le transport en commun; et
- 21 milliards de dollars pour le logement social.
La FCM propose que le gouvernement fédéral contribue 20 % de l'ensemble des investissements publics, et les provinces 36 %. Le reste viendrait des administrations municipales. Tout comme le programme d'infrastructure antérieur, il s'agirait d'un programme tripartite qui laisserait cependant aux municipalités le soin de déterminer les investissements prioritaires. Le gouvernement fédéral a bien proposé dans le dernier discours du Trône un nouveau programme d'infrastructure, mais en fixant à 2001 la date de démarrage.
Le gouvernement fédéral peut aussi faire en sorte que sa politique fiscale soutienne l'investissement dans les infrastructures. L'Association canadienne du transport urbain et d'autres témoins l'ont encouragé à considérer les laissez-passer fournis par les employeurs aux fins du transport en commun comme un avantage non imposable en reconnaissance des effets bénéfiques de l'utilisation accrue du transport en commun sur les régions urbaines.
Le BAC croit que les gouvernements du Canada devraient investir de 100 à 150 millions de dollars par an dans un Fonds de protection contre les catastrophes naturelles, dont de 33 à 50 millions de dollars en argent frais de la part du gouvernement fédéral, assortis d'un montant équivalent en provenance des gouvernements provinciaux et des municipalités... pour financer des investissements qui permettraient de réduire la vulnérabilité des collectivités canadiennes aux pertes occasionnées par des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes et violentes.
Bureau d'assurance
du Canada
Malgré les divergences de systèmes politiques entre le Canada et les États-Unis, les villes canadiennes doivent concurrencer avec les villes américaines comme lieu d'implantation des nouvelles activités économiques. L'infrastructure publique, tant matérielle que sociale, est souvent un facteur vital des choix que font les entreprises.
La région métropolitaine de Toronto compte pour environ le quart de la production nationale et, si on l'étend à la zone située à une heure de route de l'Aéroport international Pearson, cela atteint même pour un tiers de la production nationale. Elle se trouve à une journée de route de la moitié du marché de consommation et des usines de fabrication des États-Unis. Toronto n'est plus juste une ville canadienne, mais vraiment une ville nord-américaine. Sur le plan des infrastructures, toutefois, « Toronto investit environ le cinquième de ce que dépensent ses concurrents »22. Cette différence s'explique en grande partie par le rôle accru du gouvernement américain dans le financement des infrastructures. Le budget de 217 milliards de dollars étalé sur six ans dont dispose la Transportation Equity Act for the 21st Century des États-Unis en est un exemple.
Nous aimerions reconnaître publiquement le discours du Trône et la réponse du premier ministre à ce dernier. Tant le gouverneur général que le premier ministre ont reconnu la nécessité d'un nouveau programme national quinquennal d'infrastructure. Ce faisant, ils ont ainsi reconnu, selon nous, le lien important entre la productivité, la compétitivité, la salubrité et la sécurité des communautés et un environnement durable. Il s'agit là de points saillants de cette position du gouvernement fédéral et nous sommes ravis que l'engagement en ce qui concerne l'infrastructure qui a été pris dans le discours du Trône et les remarques du premier ministre confirment le lien entre les deux.
Association des ingénieurs-conseils du Canada
Le programme d'infrastructure fédéral initial visait deux objectifs : relancer l'économie par la création d'emplois directs et renouveler l'infrastructure publique du Canada. La bonne performance de l'économie rend le premier objectif désuet. Le besoin de renouveler l'infrastructure et d'en bâtir de nouvelles pour la nouvelle économie demeure cependant. Le Comité recommande donc que le gouvernement fédéral lance un nouveau programme d'infrastructure à long terme, en collaboration avec les provinces et les municipalités, pour financer de nouvelles initiatives dans ce domaine. Il faudrait assujettir ce programme et les investissements qu'il englobe à l'examen des programmes et aux critères du Pacte de productivité. Le Comité recommande que le gouvernement fédéral s'engage à y verser au moins 500 millions de dollars par an pendant au moins cinq ans.
Le gouvernement joue aussi un rôle important dans le perfectionnement du capital humain. Nos résultats sur ce plan sont bons au cours des dernières décennies. Le Canada a même rétréci l'écart, sur le plan des inscriptions scolaires, par rapport aux États-Unis depuis la fin des années 70. Mais la nature de la formation professionnelle et de la formation du capital humain évolue. La notion d'acquisition continue du savoir, qui se passe souvent en dehors des établissements publics d'éducation traditionnels, prend de plus en plus d'importance.
La piètre performance du Canada en matière d'innovation, où le Canada peut encore jouer un rôle important, demeure cependant inquiétante. Le Canada ne consacre que 1,8 % de son PIB à la R-D, alors que les États-Unis y injectent 2,7 % de leur PIB et que la moyenne de l'OCDE est de 2,2 %.
Bien que le Canada profite de ce qui se fait à l'étranger, les retombées semblent limitées et lentes à venir lorsqu'il faut importer les connaissances. On estime à 15 ans le temps nécessaire pour que la moitié des retombées de la R-D internationale parvienne à un pays où les travaux n'ont pas été effectués. D'autre part, d'énormes facteurs externes sont associés à la R-D locale. Cela attire des ouvriers très spécialisés, qui peuvent ensuite passer à d'autres entreprises de haute technologie locales. Il n'est pas étonnant que les industries de haute technologie, dont nous sommes de plus en plus redevables pour les hausses de productivité et la croissance économique, se regroupent dans des zones géographiques bien limitées. Les deux zones de concentration des entreprises de haute technologie, la Silicon Valley de Californie et celle du Canada, près d'Ottawa, en sont des exemples parfaits.
Puisque le rendement total de la R-D dépasse de beaucoup ce que l'entreprise qui effectue les travaux peut capter, le rôle positif du gouvernement à cet égard est énorme. Une façon d'y contribuer serait d'établir un régime de propriété intellectuelle propice à ce genre d'investissement. Il faut reconnaître que l'économie de marché ne saurait fonctionner sans protection de la propriété privée, qui prend de plus en plus une forme intangible, comme c'est le cas du fruit des travaux de recherche. Pour tirer avantage de la nouvelle économie, le Canada doit en protéger les apports essentiels. Il doit cependant éviter, ce faisant, de restreindre la diffusion bénéfique des connaissances.
Pour montrer comment nos dépenses en R-D gênent la hausse de productivité, il est bon d'énumérer certains des travaux en cours à l'Institut canadien de recherches avancées. Il est maintenant admis qu'il existe deux formes d'innovations du marché. D'une part, l'innovation des produits qui a trait, comme son nom l'indique, au lancement de nouveaux produits, dont l'ordinateur personnel est un exemple. Par contre, l'innovation des procédés a trait aux changements apportés à la fabrication des produits existants. Si la fiche du Canada semble excellente dans ce dernier domaine, elle est moins bonne dans l'autre. Il est important de signaler que c'est surtout l'innovation des produits qui est à l'origine de la forte hausse de productivité aux États-Unis. Outre notre lenteur à adopter les nouvelles technologies, c'est à notre manque d'investissement en R-D et au fait que nous n'avons pas su mettre à profit les connaissances de notre voisin américain, qu'il faut attribuer directement la performance du Canada23.
L'aide fiscale que le Canada accorde à la R-D est, nous l'avons vu, extrêmement généreuse. Pourquoi ne donne-t-elle pas de résultats? La question laisse nombre d'observateurs perplexes. Ce n'est peut-être pas cette mesure fiscale particulière, mais bien l'ensemble du régime fiscal des sociétés qu'il faut blâmer, ou le financement public de la recherche fondamentale, ou encore le milieu universitaire.
Le crédit d'impôt pour la R-D. Bien qu'il soit accueilli favorablement, il ne se rend pas jusqu'aux petites sociétés, et je vais vous dire pourquoi. Nous avons consulté des comptables. Ce crédit d'impôt n'en vaut pas la peine pour un montant inférieur à 10 000 $, à cause de la paperasse et de tout le reste, car il faut débourser 5 000 $ pour obtenir l'avis nécessaire à l'obtention de ce crédit d'impôt. En deçà d'un certain niveau, il n'en vaut pas la peine. C'est donc un autre problème. Le gouvernement laisse à l'écart 78 % de toutes les entreprises parce qu'elles ont moins de cinq employés, alors que ce programme devrait permettre toutes sortes d'activités intéressantes, mais les entreprises n'ont même pas accès à ce crédit d'impôt.
Fédération canadienne de l'entreprise indépendante
Quoi qu'il en soit, le message de base reste clair. Pour participer pleinement à la nouvelle économie, le Canada doit créer un climat favorable à l'épanouissement de la recherche scientifique. Il faut offrir des débouchés locaux aux experts canadiens. Les entreprises doivent juger le Canada attrayant pour y lancer toutes les activités liées à la nouvelle économie.
Selon des témoins entendus, les récentes initiatives fédérales ont réussi à revigorer le milieu canadien de la recherche. La reprise du financement des organismes subventionnaires, la création des Instituts canadiens de recherche en santé, la création et le financement accru de la Fondation canadienne pour l'innovation et l'annonce, dans le discours du Trône, de la création de 1 200 et, à terme, 2 000 nouvelles chaires de recherche universitaires ont contribué à inspirer un nouveau sentiment de confiance en l'avenir. Un élément manque toutefois.
Comme l'a signalé Robert Prichard, de l'Université de Toronto, chaque fois qu'un chercheur obtient une bourse, il ajoute aux frais d'infrastructure de son établissement, qui doit lui accorder du temps de laboratoire et acheter le matériel et l'équipement requis. À défaut de financement externe de ces coûts indirects, les montants requis sont souvent prélevés sur les budgets de l'enseignement. Un programme d'investissement en infrastructures regrouperait toutes les autres initiatives fédérales, permettant ainsi de commercialiser la recherche et de l'appuyer au niveau tant du 2e ou du 3e cycle que des travaux postdoctoraux.
Le Comité estime qu'il n'y a pas lieu d'encourager la recherche aux dépends de l'enseignement et des autres activités prioritaires des universités. Le gouvernement fédéral doit s'assurer que ses efforts de promotion de la recherche forment un tout cohérent et cadrent avec ses autres initiatives et celles des provinces. Le Comité recommande donc de créer un fonds d'infrastructures de recherche pour financer les dépenses des établissements en matière de recherche qui découlent directement d'autres subventions de recherche fédérales.
L'activité des établissements postsecondaires, voués avant tout à l'enseignement, ne se limite pas à la recherche. Ce sont eux qui aident à créer le capital humain qui rend les Canadiens productifs.
Dans son rapport de l'an dernier sur la productivité, le Comité faisait observer que les études supérieures réduisent les risques de chômage des Canadiens et augmentent le revenu viager. C'est pourquoi le gouvernement attache autant d'importance à la formation du capital humain et à l'accès à l'éducation, et pourquoi il a tenté, dans le passé, à améliorer la situation par des mesures budgétaires.
Le graphique 4, fourni par l'Association des universités et collèges du Canada, montre clairement que l'économie canadienne évolue. Les cols blancs et les spécialistes de la haute technologie remplacent les cols bleus. Le message qui ressort de la dernière décennie est très net : l'école secondaire n'est qu'une étape vers les études supérieures. Comme son titre l'indique, le graphique 5 révèle que l'emploi augmente dans les secteurs où le capital humain prime. L'importance primordiale du capital humain pour l'avenir de notre économie saute aux yeux. Les deux graphiques laissent également entrevoir que le Canada est bien parti pour devenir un pays de la « nouvelle économie ».
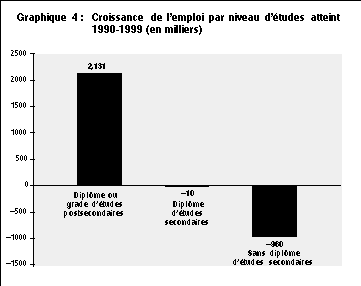
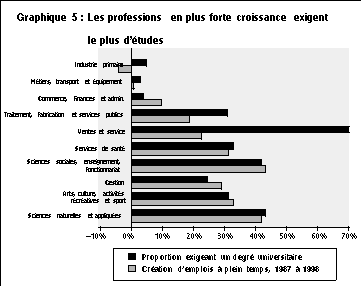
Le processus budgétaire et la productivité
Dans le sens du point de mire de ce rapport, la productivité, le Comité formule aussi des recommandations sur le processus budgétaire. La croissance économique et la productivité sont, nous l'avons vu, des sujets de préoccupation à long terme. Elles exigent un horizon de planification plus long que celui utilisé ces dernières années. C'est le cas en particulier des initiatives stratégiques qui se répercutent à la fois sur le niveau de production et le rythme d'augmentation de la production. Des nouvelles théories de croissance endogène influent maintenant sur les politiques stratégiques destinées à stimuler la croissance économique et la productivité. Cette approche oblige « les décideurs à s'abstraire du court terme pour évaluer les conséquences d'autres initiatives »24. Même des changements infimes peuvent avoir, à terme, une très forte incidence s'ils influent sur le rythme de croissance de l'économie. En réalité, si le gouvernement fédéral n'avait qu'une vue à court terme des orientations à imprimer, il ne se serait jamais lancé dans une politique monétaire de désinflation et n'aurait pas pris les mesures annoncées dans le budget de 1995. Dans les deux cas, les résultats positifs ne se sont manifestés que bien plus tard.
La nécessité d'un horizon de planification plus long vaut particulièrement pour les mesures fiscales étant donné la façon dont elles influent sur l'économie. Les réductions d'impôt ne font pas que laisser plus d'argent aux particuliers et aux sociétés; elles se répercutent aussi sur le rendement tiré des investissements et des efforts des travailleurs. Il est donc important, pour en maximiser l'impact au plus vite, que les particuliers et les entreprises comprennent l'évolution anticipée du régime fiscal et sachent quelle sera la situation fiscale lorsque les investissements et les décisions ouvrières produiront enfin des fruits.
La hausse de productivité est surtout fonction des investissements. Tout investissement est, par nature, une entreprise de longue haleine qui exige des particuliers et des entreprises des décisions dont il faudra attendre les résultats. En présentant un plan quinquennal, le gouvernement réduirait, il nous semble, l'incertitude des investisseurs quant à la situation économique et fiscale qui les attend. Il indiquerait clairement au secteur privé, ce faisant, que les Canadiens peuvent s'attendre à un meilleur rendement après impôt de leur travail, de leurs investissements et des risques qu'ils prennent.
L'exode des cerveaux
Dans son rapport intitulé Stimuler la productivité pour relever le niveau de vie des Canadiens, le Comité s'est penché sur la question de l'exode des cerveaux. Aucun consensus clair ne se dégageait alors sur la gravité du problème, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Les médias continuent toutefois d'en parler, et le phénomène comporte toujours de graves conséquences pour l'économie et la société canadiennes.
Certaines parties au débat sur l'exode des cerveaux laissent entendre que le Canada n'a pas à s'en faire tant que le nombre d'immigrants qualifiés dépasse celui des émigrants. Or, beaucoup des Canadiens qui partent apportent leur emploi avec eux [ . . . ] En tant que pays, nous devons trouver ce qui persuadera les gens possédant des compétences universelles de venir chez nous et d'y rester, et surtout de lancer des entreprises florissantes. Si le Canada se montre plutôt peu enclin à favoriser l'excellence et à embaucher des chefs de file, si nous négligeons d'accroître le nombre d'emplois hautement spécialisés et bien rémunérés, alors qui demain paiera la note des services sociaux élargis?25
Le printemps dernier, le Comité estimait que l'exode des cerveaux pourrait rester sans gravité dans l'ensemble, puisque le pays attire normalement plus de travailleurs instruits qu'il n'en perd par l'émigration. C'est toutefois un problème grave dans certains secteurs de l'économie, et cela pourrait aussi se révéler symptomatique de difficultés plus grandes pour l'économie canadienne. Ce n'est pas que le pays perde beaucoup de travailleurs bien instruits qui importe, mais plutôt qu'il perd ses meilleurs ouvriers et ses plus brillants éléments.
Prenons l'exemple de Nortel, la première société canadienne dont la capitalisation atteint 100 milliards de dollars américains. Des 70 000 employés de cette société canadienne, 22 000 travaillent au Canada, alors que seulement 7 % des 400 cadres qui forment sa haute direction ont leur bureau au Canada. C'est l'exemple parfait d'une entreprise de la nouvelle économie qui s'est réorientée pour tirer avantage des débouchés qu'offre l'Internet. Nortel compte pour le quart de la R-D que le secteur privé réalise au Canada et recrute le quart des diplômés de nos instituts de haute technologie. Elle éprouve toutefois des difficultés à garder au Canada ses employés canadiens les mieux payés. Pour citer son président et chef de direction, John Roth, « Notre équipe de gestion est formée en grande partie de Canadiens en exil, surtout aux États-Unis. Ils se sont eux-mêmes envoyés aux États-Unis »26.
L'exode des cerveaux n'est pas, bien sûr, fonction que du régime fiscal. L'écart salarial entre le Canada et les États-Unis est aussi un facteur. Selon Roger Martin, de la Rotman School of Management, les entreprises canadiennes de haute technologie paient leurs employés sensiblement moins que leurs concurrentes américaines. Le salaire de départ d'un ingénieur est de 49 000 $CAN chez Nortel contre 53 000 $US aux États-Unis.
Pour réussir dans la nouvelle économie, le Canada a besoin de sociétés comme Nortel et de ses cadres supérieurs, comme ceux d'autres entreprises de la nouvelle économie. Il ne serait pas de bon augure pour les hausses de productivité et de niveau de vie espérées s'il n'arrivait pas à les attirer et à les retenir. Pour citer encore une fois M. Roth :
Ce qui est passé inaperçu c'est que le Canada a créé une très forte incitation à partir pour les sociétés canadiennes et ses meilleurs éléments et entrepreneurs du secteur de la haute technologie. [ . . . ] Chez Nortel, ce sont les 400 cadres les plus hauts placés dans la hiérarchie (c.-à-d., la moitié d'un pour cent de l'effectif) qui donnent le ton et ouvrent la voie. Il faut s'inquiéter au sujet du personnel de direction, car c'est lui qui tire l'entreprise en avant. Quand ces gens de talent décident de partir, le Canada perd ses emplois les mieux rémunérés et ses meilleurs éléments, les chefs. [ . . . ] C'est beaucoup perdre27.
Conclusion
Maintenant que le gouvernement fédéral est dans une situation où il continuera vraisemblablement de produire des excédents, de plus en plus grands, à moyen terme, les revendications d'une part du gâteau vont pleuvoir. Une grande variété de nouveaux programmes sont proposés par ceux qui ont tout à y gagner. Si le gouvernement devait succomber à la tentation et se lancer dans de nouveaux programmes coûteux, nous croyons qu'une occasion vitale aura été ratée. Le gouvernement a résisté dans le passé à la tentation d'engager de nouvelles dépenses de programmes, jugeant prioritaire de rétablir la crédibilité et la stabilité financières du pays. Le gouvernement devrait continuer de résister à la tentation de se jeter dans de nouvelles dépenses tant que l'économie n'aura pas aussi été remise sur les rails. La bonne performance des dernières années rapproche de nouveau l'économie de la pleine utilisation de ses moyens de production. À moins de hausser sensiblement la productivité, il ne sera toutefois pas possible d'atteindre des taux de croissance annuelle d'environ 3 % ou plus. Dans ce cas, il ne faudrait pas compter sur le genre d'excédents financiers que l'on prédit maintenant.
Le Comité juge donc le moment venu de promouvoir activement des mesures susceptibles d'accroître l'efficacité de l'économie et sa capacité de production. Des mesures de réforme et/ou d'allégement fiscal feront plus en ce sens que toute autre initiative que pourrait prendre le gouvernement.
Qui plus est, comme nous l'indiquons ailleurs, les gouvernements provinciaux se retrouvent aussi avec des excédents budgétaires croissants. Alors que leur assiette fiscale est pratiquement la même que celle du gouvernement fédéral, ils auront plus de souplesse pour structurer leurs impôts de la manière jugée la plus appropriée. Les mesures fiscales proposées ici n'auront donc pas nécessairement une incidence négative sur leur situation financière à moins que les provinces le souhaitent.
Pour parler simplement, le Comité estime que les provinces auront les ressources voulues pour entreprendre des initiatives qui relèvent de leur compétence. Le gouvernement fédéral devrait donc se garder de lancer de nouvelles initiatives dans des domaines de compétence provinciale.
La communauté internationale a salué l'amélioration, des plus impressionnantes, de la situation financière des gouvernements canadiens en si peu de temps. Alors que l'état de ses finances était désespéré il n'y a pas si longtemps, le Canada assiste à une baisse absolue de sa dette publique et à un déclin encore plus rapide du ratio de la dette au PIB. Les grandes réformes structurelles entreprises commencent maintenant à porter fruit. D'après l'OCDE, « Le Canada semble maintenant recueillir les fruits de ces réformes structurelles : à en juger par les données statistiques révisées, les résultats obtenus par le Canada pour la production totale des facteurs ces deux dernières décennies sont meilleurs qu'on le pensait et certains indices donnent à penser que la croissance de la productivité tendancielle a augmenté dans les années 90. Ces résultats sont encourageants, mais il ne faut pas se dissimuler que le niveau de productivité au Canada reste nettement plus faible qu'aux États-Unis : les autorités canadiennes doivent donc poursuivre leur action dans le domaine structurel pour que le Canada ne se laisse pas distancer par son voisin du point de vue du niveau de vie. »
Nos recommandations visent précisément à favoriser la croissance.
1 Thomas d'Aquino, Conseil canadien des chefs d'entreprises, compte rendu 28:1155.
2 Martin Lockyer, St. John's Board of Trade, compte rendu 12:1525.
3 Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, mémoire.
4 De 1966 à 1973, la productivité de la main-d'9uvre au Canada a progressé d'environ 3,7 % par année. Après 1973, cette croissance a chuté entre 1 et 1,5 % par année.
5 Gouvernement d'Irlande, Economic Review and Outlook, 1999.
6 De plus en plus, le secteur privé pourvoit à l'infrastructure des télécommunications. Dans certains pays, il est aussi un important fournisseur de services d'éducation et de santé.
7 Le processus SUBBOR (programme de recyclage au moyen des boîtes bleues) constitue une technique globale de gestion des déchets n'exigeant ni triage préalable, ni enfouissement, ni incinération. Les déchets solides sont transformés grâce à la technologie en produits recyclables (acier, plastique, papier, etc.), tourbe et électricité (méthane). Voir mémoire SUBBOR.
8 Consulting Engineers of British Columbia, lettre au président, 3 septembre 1999.
9 Del Bruce, Association canadienne de l'outillage et de l'usinage.
10 Fraser J. Mustard et Margaret McCain, The Early Years Study, avril 1999, p. 2.
11 Association des industries aérospatiales du Canada, mémoire,
12 Aron Gampel, « Les investissements en technologie de pointe sont en forte croissance », Commentaire économique de la Banque Scotia, 28 octobre 1999.
13 Eric Engen et Jonathan Skinner, « Taxation and Economic Growth », National Tax Journal, vol. 49, no 4, 1996.
14 Ibid., p. 636.
15 Études économiques de l'OCDE : Canada, 1999, Thème spécial - Réforme structurelle, p. 93.
16 Pierre Fortin, (1999), p. 67.
17 Richard Patton, Association canadienne des fabricants de produits chimiques, compte rendu 3:1555.
18 Au Canada, le niveau réel de subventions à caractère fiscal de la R-D est environ 2,5 fois plus élevé qu'en Australie et aux États-Unis, et environ trois fois plus généreux qu'en France.
19 Cité dans Business Council of British Columbia, mémoire.
20 Jonathan Kesselman, « Tax Cuts for Growth and Fairness », Options politiques, décembre 1998.
21 John D. Redfern, Coalition pour le renouvellement des infrastructures du Canada, compte rendu 3:1610.
22 Urban strategies Inc., Reinvesting in Toronto: What the Competition is Doing, mars 1999, p. 7.
23 Daniel Trefler, « Does Canada Need a Productivity Budget? » Options politiques, juillet-août 1999.
24 Peter Howitt, "Endogenous Growth Theory: Taming the Winds of Change, or Tweaking Neoclassical Economics?" dans Thomas J. Courchene, dir., Stabilization, Growth and Distribution: to Linkages in the Knowledge Era, The Bell Canada Papers on Economic and Public Policy, 1994.
25 Thomas d'Aquino, CCCE, compte rendu 28:0950
26 « Q&A with John Roth », Ottawa Citizen, le 13 novembre 1999.
27 Ibid.