FINA Rapport du Comité
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
CHAPITRE 4 :
L'INFRASTRUCTURE SOCIALE DU CANADA
L'infrastructure sociale et l'excédent budgétaire
L'infrastructure sociale est une notion plutôt vaste qui regroupe toute une gamme de services, de politiques et de programmes publics - dans le domaine de l'éducation, de la santé, du logement, de l'aide et du bien-être social, de l'appui aux familles et aux enfants dans le besoin, par exemple - conçus pour conserver ou améliorer le niveau et la qualité de vie de la population d'un pays. Lors du dernier discours du Trône, le gouvernement fédéral a fait part de son intention de renforcer l'infrastructure sociale du Canada, en déclarant qu'il consacrerait la moitié de l'excédent budgétaire à des investissements répondant aux besoins sociaux et économiques du Canada.
Notre gouvernement s'est engagé au début de ce mandat à consacrer la moitié de tout excédent à réduire l'impôt et la dette et l'autre moitié à des investissements de nature économique et sociale qui rehausseront notre qualité de vie à long terme.
L'honorable Jean Chrétien, réponse au discours du Trône
Cependant, jamais au cours des audiences du Comité il n'y a eu unanimité chez les témoins quant à la proportion du surplus budgétaire qui doit être affectée aux programmes sociaux. D'une part, certains témoins ont suggéré que le gouvernement fasse preuve de prudence et évite d'investir dans de nouvelles initiatives sociales, sauf en remaniant les priorités existantes en matière de dépenses. Ainsi, la Chambre de commerce de Toronto explique dans son mémoire :
Il n'a pas été facile d'éliminer le déficit - certains Canadiens n'ont pas très bien accueilli les compressions de dépenses de programmes. Mais il serait prématuré de renoncer aujourd'hui à cette politique et de revenir en arrière à une situation qui était désastreuse. Nous ne saurions trop insister sur la nécessité de maintenir le statu quo en matière de dépenses de programmes [ . . . ] Le moment n'est pas venu d'engager de nouvelles dépenses - le surplus doit être remis entre les mains des Canadiens au moyen d'allégements fiscaux.
De la même façon, William Robson de l'Institut C.D. Howe a déclaré :
La façon la plus sûre de prolonger les récentes victoires budgétaires est de diminuer la dette : des surplus de 6 ou 7 milliards de dollars réduiront de quelque 2 milliards de dollars les paiements en intérêts d'Ottawa sur cinq ans. Si, au lieu de cela, nous dépensons l'excédent, les prochains budgets seront moins encourageants que prévus1.
Le Fonds monétaire international (FMI) a fait écho à ce point de vue quand il a déclaré, concernant la situation financière du Canada :
Le personnel du FMI estime que la réduction de la dette et la réforme de l'impôt sur le revenu doivent être considérées en priorité au moment de l'affectation des éventuels surplus budgétaires. Bien que des dépenses supplémentaires modérées dans les domaines de l'éducation et de la santé puissent être utiles, il reste que la réduction de la dette et la réforme fiscale sont plus susceptibles de produire des retombées économiques notables à long terme2.
D'autres témoins cependant recommandent que les excédents budgétaires soient investis dans les programmes sociaux et de la santé, avant toute réduction de l'impôt sur le revenu. À leur avis, les mesures d'allégement fiscal ne doivent pas compromettre les investissements sociaux :
Si les programmes sociaux sont sous-financés, une large part du potentiel humain sera sous-développée et gaspillée [ . . . ] Le Canada a peu de chance de conserver une main-d'9uvre de première qualité et un niveau de vie exemplaire s'il ne consacre pas suffisamment de ressources au développement social et économique de sa population. (Association nationale de la femme et du droit, mémoire de l'an dernier)
D'autres encore préconisent de légères augmentations pour les programmes existants ou de modestes nouveaux investissements dans l'infrastructure sociale du Canada. :
[L]e gouvernement [ . . . ] s'en remet à sa politique de répartir tout surplus budgétaire d'une façon « équilibrée » : 50 % sur les réductions d'impôt et la diminution de la dette et 50 % sur les programmes sociaux. Nous devons reconnaître et développer les relations entre les choix qu'offre cette approche « équilibrée ». Par exemple, l'opposition entre les réductions d'impôt et les dépenses en santé constitue une fausse dichotomie sur le plan de la productivité. En effet, ces deux choix mènent tous deux à une plus grande productivité. Il en va de même pour les dépenses en soins de santé par rapport aux investissements dans le « programme pour les enfants » : ces deux avenues peuvent mener à une amélioration de l'état de santé des enfants.
Association canadienne des soins de santé
Nous croyons que le niveau actuel de la dette exclut aujourd'hui toute augmentation notable des dépenses. Dès que le rapport dette-PIB aura amorcé une nette tendance à la baisse, amenée par un plan détaillé de réduction notable de l'endettement national, le gouvernement pourra, selon nous, dépenser davantage dans les secteurs essentiels, notamment les soins de santé et l'éducation. En attendant, nous reconnaissons sa volonté de satisfaire aux besoins des Canadiens en augmentant, modérément toutefois, les dépenses des programmes prioritaires. Nous souscrivons donc au prochain budget dans lequel est prévue une modeste augmentation de 1,5 milliard de dollars pour les programmes d'investissements sociaux qui, au dire du gouvernement, se traduiront par des avantages à long terme, et pour les Canadiens et pour l'économie dans son ensemble. (Institut canadien des comptables agréés, mémoire)
D'après le Comité, une solide infrastructure sociale est tributaire d'une économie vigoureuse. Sans une économie forte et les recettes fiscales qui en découlent, le gouvernement ne sera plus à même de soutenir les programmes sociaux nécessaires. Par conséquent, les initiatives visant à accroître la compétitivité du Canada dans la nouvelle économie mondiale axée sur les connaissances favoriseront le maintien de notre infrastructure sociale. Nous devons également ajouter que trop souvent, ces initiatives sont perçues comme étant en concurrence avec les programmes sociaux en vue de fonds publics limités. Or, c'est un point de vue qui témoigne d'imprévoyance et pourrait à long terme menacer la viabilité même de l'infrastructure des programmes sociaux au Canada.
En outre, bien qu'il existe diverses façons d'aider les Canadiens à réussir dans la nouvelle économie mondiale, l'approche adoptée par le gouvernement doit reposer sur l'amélioration de la productivité. À notre avis, la principale façon d'y parvenir consiste à investir dans les gens, à les aider à approfondir leurs connaissances, leurs compétences et leur créativité afin de transformer leurs idées en nouveaux produits et processus et de créer un environnement économique qui les encouragera dans cette voie. Nous serons à même de soutenir une infrastructure sociale abordable si nous ciblons les secteurs où nous pouvons avoir la plus grande influence.
L'itinérance et le logement à prix abordable
Dans toutes les villes où nous sommes allés, nous avons entendu dire que l'itinérance est un problème croissant au Canada qui fait du tort non seulement à l'individu mais aussi à l'ensemble de la société canadienne.
C'est peut-être plus évident dans les grands centres urbains, mais la question de l'itinérance devient rapidement un sujet de préoccupation pour tous les Canadiens parce qu'elle influe sur notre qualité de vie. (Chambre de commerce de Toronto)
Dans tous les grands centres urbains du Canada, les sans-abri sont de plus en plus visibles et désespérés. Les clients des refuges d'urgence augmentent dans de nombreuses collectivités et, de plus en plus, ce sont des familles avec des enfants, des adolescents et des femmes seules qui sont les nouveaux sans-logis.
Association canadienne d'habitation et de rénovation urbaine
On nous a aussi dit que l'itinérance est un problème qui touche un secteur de plus en plus vaste de la population, y compris les jeunes et les familles avec des enfants. Il y aurait quelque 200 000 sans-abri au Canada, soit 1 Canadien sur 153. Or, les sans-logis sont plus susceptibles de contracter la tuberculose, une infection à VIH ou l'hépatite, de souffrir de dépression, du syndrome de stress post-traumatique ou de famine, ou même de mourir.
Les preuves que la crise de la clochardise à Toronto, en Ontario et dans tout le Canada a pris l'ampleur d'une catastrophe ont commencé s'accumuler à la fin de 1995 et au début de 1996. En voici quelques-unes : le surpeuplement marqué de notre système de refuges de jour et de nuit, un taux d'infection par la tuberculose de 38 % parmi les sans-abri, des blocs de décès par hypothermie, une augmentation de la morbidité, dont la malnutrition, la propagation des maladies infectieuses et la hausse du nombre de décès chez les sans-abri. (Toronto Disaster Relief Committee, mémoire)
D'après le maire de la ville de Markham, en Ontario, M. Donald Cousens, plus de 300 000 ménages locataires dans sa province sont sur le point de se retrouver sans logement, tandis que 100 000 autres attendent des unités de logement social. Or, à l'heure actuelle, le parc immobilier abordable ne suffit pas à la demande3.
Cependant, le logement abordable n'est qu'une partie de la solution. En fait, de nombreux témoins ont affirmé qu'il ne suffit pas de répondre aux besoins immédiats d'abri pour régler le problème de l'itinérance. On nous a exhortés à prendre des mesures mettant à contribution les systèmes éducatifs, judiciaires et médicaux et pouvant freiner l'accroissement de l'itinérance. De plus, les témoins ont souligné que l'itinérance ne relève pas d'un seul palier de gouvernement, mais bien de tous les niveaux, soit local, provincial ou territorial et fédéral.
Nous félicitons le gouvernement fédéral d'avoir nommé Claudette Bradshaw comme ministre responsable de l'itinérance, d'avoir créé un secrétariat de l'itinérance et, par le biais de la SCHL, de poursuivre la recherche et de parrainer des tribunes sur la question.
Association canadienne d'habitation et de rénovation urbaine
Le Comité fait siennes ces préoccupations. L'itinérance est un problème complexe qui touche non seulement le logement, mais aussi des facteurs sociaux, sanitaires et économiques. Nous jugeons important de comprendre les raisons et les circonstances qui mènent à l'itinérance afin de déterminer quels programmes et services sont les plus susceptibles de prévenir et d'atténuer ce problème au Canada.
Le 23 mars 1999, le gouvernement fédéral a chargé Claudette Bradshaw, ministre du Travail, de coordonner les activités fédérales visant les sans-logis au Canada. Mme Bradshaw présentera sous peu au Cabinet ses recommandations sur une réponse fédérale à l'égard de la question de l'itinérance. En outre, lors du dernier discours du Trône, le gouvernement fédéral a signalé son intention de travailler en partenariat afin d'aider les collectivités à s'attaquer aux causes profondes de l'itinérance et à répondre aux besoins de leurs membres en matière de refuge et de soutien.
Le Comité appuie sans réserve ce que fait la ministre du Travail pour régler la question de l'itinérance. Nous attendons son rapport et incitons le gouvernement fédéral à examiner ses conclusions et recommandations et à y donner suite le plus rapidement possible. En outre, nous souscrivons à tout investissement social effectué afin de mieux comprendre et d'atténuer les causes de l'itinérance au Canada. Nous croyons que tous les ordres de gouvernement - fédéral, provincial-territorial et municipal - doivent collaborer pour résoudre ce problème. Le Comité sait que des ressources supplémentaires seront sans doute nécessaires, mais il ne peut formuler de recommandations précises tant que le rapport n'aura pas été rendu public et examiné.
De même, en ce qui concerne la question plus vaste du logement à prix abordable, le Comité partage le point de vue des témoins selon lesquels tous les Canadiens devraient pouvoir se loger adéquatement et à prix abordable d'un océan à l'autre. Encore une fois, nous estimons que cette question relève de tous les ordres de gouvernement, ainsi que des organismes locaux.
Soins de santé
De nombreux témoins considèrent que le système de soins de santé du Canada est un atout important dans la nouvelle économie en évolution et veulent qu'il soit prioritaire dans les prochains budgets. En effet, selon eux, notre système de soins de santé contribue à la croissance économique puisqu'il réduit le coût des avantages sociaux, donne accès à une main-d'9uvre saine et mobile et favorise des recherches en santé de haute qualité. Par exemple, l'Association des hôpitaux de l'Ontario a déclaré ceci :
L'accès universel à d'excellents soins de santé dans tout le Canada n'assure pas seulement que les travailleurs sont en bonne santé et productifs, car il favorise également la mobilité de la main-d'9uvre en permettant aux Canadiens de s'adapter aux besoins constamment en évolution des entreprises et de profiter des occasions de faire des affaires.
[L]es investissements dans le système des soins de santé du Canada amélioreront la qualité de vie, l'état de santé et la sécurité du public, maintiendront notre avantage concurrentiel et favoriseront la création d'emplois et les nouveaux investissements.
Notre système de soins de santé est une raison majeure pour laquelle le Canada continue à occuper le premier rang dans l'Indice du développement humain des Nations Unies; c'est aussi pour cette raison que plusieurs études relatives aux possibilités de faire des affaires indiquent régulièrement que, pour les entreprises, le système de soins de santé du Canada constitue un avantage concurrentiel par rapport à notre partenaire commercial le plus important, les États-Unis. (Association des hôpitaux de l'Ontario)
L'accès à des services et des soins de santé de qualité est un facteur qui contribue énormément à l'aptitude du Canada à demeurer compétitif dans un environnement économique global de plus en plus complexe.
Medical Society of Prince Edward Island
De nombreux témoins ont bien accueilli le budget fédéral de 1999, souvent baptisé le « budget de la santé », y voyant un pas important dans la bonne direction. Par exemple, certains nous ont déclaré :
Le budget de 1999 a eu la sagesse de réinjecter des fonds dans des secteurs de soins de santé qui avaient été gravement dégarnis et de fournir des fonds dans des secteurs clés, y compris la recherche et l'information sur la santé, les services de santé pour les Premières nations et les Inuit et les programmes de prévention. (Association des infirmières et infirmiers du Canada, mémoire)
Le gouvernement fédéral a réinvesti dans les soins de santé et nous l'encourageons à poursuivre dans cette voie afin de favoriser une société saine, productive et prospère pour l'avenir. (HEAL)
Même si les témoins sont heureux des investissements fédéraux supplémentaires en santé, certains estiment qu'il en faut encore davantage pour résoudre les problèmes qu'éprouve actuellement le système de santé. Ils recommandent également d'indexer les transferts fédéraux afin d'assurer une croissance continuelle des paiements :
La recommandation 6 traite de la nécessité d'une pleine indexation afin que la contribution fédérale continue d'augmenter et qu'on puisse répondre aux besoins futurs des Canadiens en matière de santé. La formule d'indexation tient compte du fait que les besoins en santé ne sont pas toujours synchronisés avec la croissance économique. En périodes de difficultés économiques (chômage, stress, discorde au sein de la famille et de la société, etc.), le système de santé subit souvent des pressions plus intenses. Si on n'intervient pas, la valeur actuelle des fonds fédéraux continuera à péricliter avec le temps, compte tenu des besoins de plus en plus grands d'une population vieillissante et croissante, de l'inflation, du chômage et d'autres difficultés économiques. (HEAL)
Je dois admettre que cet avis de ma part repose sur des valeurs personnelles. Je pense qu'il serait absurde de rejeter le genre de société que nos parents et grands-parents ont mis des décennies à construire, qui offre un niveau de services publics un peu (mais pas énormément) plus élevé au Canada qu'aux États-Unis - et qui nous situe au premier rang de l'indicateur du développement humain des Nations Unies. J'ajouterai que ma priorité absolue en ce qui concerne la croissance des dépenses de programmes serait que le gouvernement remette au secteur de la santé les fonds qu'il lui a retirés en réduisant les transferts aux provinces au cours de la dernière décennie.
Pierre Fortin
D'autres témoins estiment qu'il y a encore beaucoup à faire si on veut établir un système de soins de santé solide et durable pour l'avenir. À leur avis, le statu quo est inacceptable : il convient de mieux intégrer les soins de santé afin d'en améliorer l'efficacité et de promouvoir l'obligation de rendre compte. Ils estiment cependant que la hausse du financement des soins de santé ne constitue pas la solution :
. . . la réponse ne consiste pas à injecter plus d'argent dans le système de soins de santé. Il ressort de comparaisons à l'échelle internationale que l'appui financier total au système de santé canadien, en tant que pourcentage du produit national brut, est parmi les plus élevés du monde. Nous avons appelé l'attention sur la nécessité de commencer à mettre en place un système intégré de prestation des soins plutôt que de perpétuer l'actuel système inefficace et non rentable des fournisseurs/parties prenantes. Nous visons la meilleure qualité de soins au meilleur coût - un objectif que partagent, à notre avis, tous les ordres de gouvernement4
Les témoins ont bien insisté sur le fait que pour rendre le régime de soins de santé plus efficace et plus adapté aux besoins des consommateurs, il faut accélérer l'intégration des services de soins de santé - les soins primaires, les soins actifs, les soins de longue durée et les soins à domicile. Ils expliquent qu'une plus grande coordination et rationalisation des services réduiront les coûts et amélioreront la prestation de soins aux patients. Ainsi, le porte-parole de l'Association des soins de santé du Nouveau-Brunswick a déclaré :
L'ACS et ses organismes membres sont conscients que les difficultés que connaît notre régime de soins de santé ne seront pas résolues uniquement par des sommes d'argent.
Association canadienne des soins de santé
Cela ne signifie pas pour autant que le statu quo soit la seule solution d'avenir pour les soins de santé. En effet depuis longtemps, notre association fait la promotion de changements dans la prestation de soins de santé qui serait moins axée sur les services hospitaliers coûteux et davantage sur les ressources communautaires, y compris la médecine préventive, l'éducation et les services de santé communautaire, les soins à domicile et une meilleure prise en charge des états chroniques. Au Nouveau-Brunswick, cette réorientation des priorités a reçu l'appui du nouveau gouvernement provincial et le travail visant à changer les soins de santé pour l'avenir est commencé.
À long terme, ces changements nous permettront d'avoir un système de santé moins coûteux et amélioré. Deux choses sont nécessaires à ce genre de transition : la stabilité financière pour le réseau, dès maintenant, pour créer un climat propice à la planification et à l'innovation, et le financement des mesures nécessaires pour effectuer la transition.
Le Comité s'est également fait dire que quelque 60 % des actes médicaux n'ont jamais été soumis à un examen fondé sur l'expérience clinique et l'analyse des résultats et de l'efficacité du diagnostic médical et du traitement. On a calculé qu'en vérifiant l'efficacité des divers aspects du système de soins de santé une économie de plusieurs milliards de dollars pourrait être réalisée5. D'après une étude mixte menée en 1995 par l'Université d'Ottawa et l'Université Queen's, il est possible de réaliser des économies dans le système de santé sans compromettre les résultats :
D'importantes économies sont réalisables si on opte pour des modes de prestation moins coûteux. Un bon nombre de provinces ont déjà entamé le processus, mais des recherches indiquent qu'il est possible d'accomplir beaucoup plus. ( . . . ) Nous avons calculé qu'on pourrait réduire les coûts de quelque 7 milliards de dollars, ce qui équivaut à environ 15 % des dépenses publiques pour la santé dans notre pays. Deux grandes possibilités se présentent : une utilisation plus appropriée des installations et services ( . . . ) et l'adoption par les provinces des pratiques exemplaires d'autres juridictions ( . . . )6
Pour toutes ces raisons, de nombreux témoins recommandent que le gouvernement fédéral mette l'accent sur le rendement du système de soins de santé fondé sur l'expérience clinique :
La nouvelle orientation de la politique fédérale en matière de santé donne aussi un élan nouveau pour exercer un contrôle sur les coûts de soins de santé, réduire ces mêmes coûts et assurer une meilleure répartition des fonds disponibles. Il ne s'agit pas que de la recherche fondamentale sur la prévention, les causes, le diagnostic et le traitement de pathologies particulières, mais aussi de la recherche concernant le système même de soins de santé et visant à nous assurer de la meilleure utilisation qui soit des fonds consacrés à la santé. (Conseil pour la recherche en santé au Canada)
Des témoins ont aussi parlé de la nécessité de responsabiliser notre système de soins de santé :
Le régime doit davantage rendre compte aux gouvernements, et ceux-ci sont responsables devant le public de leurs actes en matière de soins de santé. (HEAL)
Cependant, pour être efficaces, les mécanismes de responsabilité doivent s'appuyer sur des données fiables :
C'est pourquoi les systèmes d'information sur la santé sont des composantes essentielles assurant des mécanismes de responsabilité efficaces. Les systèmes d'information aux niveaux local, régional, provincial, territorial et national doivent englober le vaste continuum des soins à l'intérieur du régime de soins de santé. Les indicateurs du régime doivent aussi refléter objectivement les systèmes, les processus et les résultats. Nous devons adopter une vision à long terme afin de nous assurer que nous ne serons pas limités aux ensembles de données existants pour mesurer et comprendre le rendement du régime de soins de santé. (Association canadienne des soins de santé)
Le Comité estime, comme de nombreux témoins, que notre système de soins de santé public constitue un avantage concurrentiel par rapport à nos partenaires commerciaux. Le système de soins de santé du Canada constitue manifestement un atout, favorisant une main-d'9uvre saine, productive et mobile en vue de la nouvelle économie. Nous devons par conséquent le protéger et le soutenir. À cet égard, le Comité juge que le budget fédéral de 1999, qui prévoit des investissements supplémentaires dans les soins de santé au cours des cinq prochaines années par le biais du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux, constitue un pas important vers la stabilisation du régime de soins de santé du Canada et le rétablissement de la confiance de la population canadienne.
Un versement unique par le gouvernement fédéral est nécessaire pour établir un système national global d'information offrant un accès facile à une variété de données en matière de santé y compris celles concernant les patients et les services de santé. Un tel système pourrait aboutir au développement de moyens indispensables pour évaluer les normes de rendement, des leçons concernant les meilleures pratiques et des fiches de rendement à l'intention du public.
Association de santé de la Colombie-Britannique
Nous estimons également qu'il faut encourager les efforts visant à rendre le système plus efficace et responsable. Or, le gouvernement fédéral a aussi pris des mesures importantes à cet égard dans le dernier budget7. En premier lieu, il a prévu quelque 328 millions de dollars sur quatre ans pour améliorer la qualité et la disponibilité d'information sur la santé et pour élargir les systèmes d'information sur la santé partout au pays. Ce financement aidera à informer les patients, les fournisseurs de soins de santé et les gouvernements, et l'information recueillie servira à faire savoir aux Canadiens dans quelle mesure le système de soins de santé répond à leurs besoins, ce qui favorisera une plus grande responsabilité devant le public. Le financement servira également à investir dans les technologies modernes de l'information comme la « télésanté ». En deuxième lieu, le gouvernement fédéral a affecté550 millions de dollars sur une période de trois ans à la recherche et à l'innovation en santé afin d'améliorer le diagnostic et le traitement des maladies, de promouvoir les meilleures pratiques en prestation de soins de santé et de favoriser la santé et le bien-être des Canadiens.
Il est essentiel d'investir dans les initiatives qui visent à maintenir et à accroître notre avantage concurrentiel dans le domaine des soins de santé. Nous pensons, comme de nombreux témoins, que nous y parviendrons par la mise en 9uvre des nouvelles technologies d'information, la collecte de nouveaux types de données sur la santé et les soins de santé et l'évaluation de l'efficacité des méthodes de diagnostic, de traitement et de prestation de soins de santé. Par conséquent, nous exhortons le gouvernement fédéral à continuer d'appuyer financièrement les systèmes d'information sur la santé et les initiatives innovatrices annoncées dans le budget de février 1999.
Un certain nombre de témoins ont dit au Comité que le tabagisme grève lourdement notre système de soins de santé public et coûte cher à notre économie. Il est la principale cause évitable de morbidité et de mortalité précoces au Canada. Selon les estimations les plus récentes, on peut lui imputer plus de 45 000 décès par année. Il coûte de 3 à 3,5 milliards de dollars par année à notre système de soins de santé et 8 milliards de dollars de plus en perte de productivité et de revenu familial (surtout attribuable à l'absentéisme). Les témoins se sont réjouis de la décision récente de hausser la taxe d'accise sur le tabac et de rendre permanente la surtaxe actuelle de 40% sur les profits des fabricants de produits du tabac, mais ont déploré qu'une petite partie seulement des recettes fiscales provenant des taxes sur le tabac soit affectée à des stratégies de lutte au tabagisme. Certains ont recommandé de créer un fonds ou une fondation pour sensibiliser les enfants et les adolescents aux dangers du tabac et de financer cet organisme au moyen de taxes sur le tabac.
Par ailleurs, beaucoup de témoins ont parlé du fléau économique et social que constitue la toxicomanie. En 1993, selon une étude récente du Centre canadien de lutte contre les toxicomanies, l'alcool et les drogues illicites ont coûté, estime-t-on, 1,3 milliard et 88 millions de dollars respectivement en frais directs de soins de santé. La perte de productivité imputable à l'alcoolisme s'est élevée à 4,1 milliards de dollars alors que les stupéfiants ont coûté estimativement 823 millions de dollars à ce chapitre.
Nous prenons acte du lourd fardeau que la consommation d'intoxiquants fait peser sur l'économie et le système de soins de santé. Comme nos témoins, nous applaudissons à la hausse récente des taxes sur le tabac. Nous avons l'intime conviction que le gouvernement fédéral doit maintenir l'ensemble de ses mesures visant à réduire la consommation des produits du tabac et plus particulièrement celles qui visent spécifiquement à prévenir le tabagisme chez les jeunes. Il faut de plus encourager toute mesure visant à réduire et à prévenir la consommation d'intoxicants.
Les personnes handicapées
Le Comité a entendu de nombreux représentants des personnes handicapés, et tous ont dit devoir affronter des obstacles qui les empêchent de contribuer pleinement à la société et à l'économie. Premièrement, les personnes ayant une déficience doivent souvent assumer des dépenses supplémentaires du fait de cette déficience (appareils spécialisés, équipement adaptatif, médicaments, etc.). Deuxièmement, elles ont un taux plus faible de participation à la main-d'9uvre et ce faible taux ne tient pas au fait qu'elles ne veulent pas travailler ou n'en sont pas capables. Il s'ensuit que les personnes handicapées ont tendance à être plus pauvres que les autres Canadiens.
. . . les coûts supplémentaires liés aux besoins des personnes handicapées nuisent souvent à leur capacité d'occuper un emploi, de participer à la vie de leur collectivité et du pays et de se dégager des programmes de soutien du revenu. (Independent Living Resource Centre, St. John's, Terre-Neuve et Labrador)
On nous a signalé que les personnes handicapées voulaient de meilleures possibilités de participer pleinement à notre économie et à notre société. Un taux de participation plus élevé à la main-d'oeuvre leur procurerait une plus grande indépendance, ce qui entraînerait des réductions à long terme des dépenses d'aide sociale.
Les Canadiens ayant une déficience veulent être des citoyens égaux de ce pays, et ils veulent l'égalité d'accès à la société canadienne. Ils veulent et doivent contribuer économiquement, politiquement, socialement et culturellement à la société canadienne. ( . . . ) En les tenant à l'écart du cours normal de la vie économique et politique, nous gaspillons une énorme partie des fonds des contribuables (Association canadienne des centres de vie autonome)
Nous vous mettons au défi de mettre à contribution la capacité d'action de tous les citoyens et d'en faire une partie intégrante de la croissance économique et sociale de notre pays. Nous vous mettons au défi de tirer parti de nos compétences et capacités au bénéfice de la croissance économique et de la société canadienne. (Independent Living Resource Centre, St. John's, Terre-Neuve et Labrador)
Le gouvernement fédéral est résolu à aider les personnes handicapées à participer aussi pleinement que possible à la société canadienne. Dans le budget de 1996, il doublait l'aide fiscale aux personnes qui fournissent des soins à domicile à des membres de la famille ayant une déficience. Dans le budget de 1997, il haussait le montant de l'aide fiscale accordée au titre des coûts liés à une déficience, notamment par les mesures suivantes :
- l'élimination de la limite de 5 000 $ sur la déduction pour frais des préposés aux soins aux personnes handicapées faisant partie de la population active et ayant besoin de ces services pour gagner leur revenu;
- l'élargissement de la liste des dépenses admissibles relativement au crédit d'impôt pour frais médicaux.
Des témoins ont recommandé d'étendre les mesures fiscales existantes qui prennent en compte les coûts additionnels liés aux déficiences.
Les annonces faites dans le budget de 1997 représentaient des mesures constructives et importantes pour l'amélioration de la situation des personnes handicapées . . . nous exhortons le Comité à appuyer des révisions majeures de la législation de l'impôt sur le revenu afin de prendre en compte plus équitablement les coûts extraordinaires de la situation des personnes handicapées. (Société canadienne de la sclérose en plaques)
Le budget de 1997 a également créé le Fonds d'intégration, une initiative de trois ans visant à susciter des projets novateurs pour aider les personnes handicapées à se préparer à un emploi, à le trouver et à le conserver. En ce qui concerne ce programme, on a mentionné au Comité :
Le Fonds d'intégration a permis d'appuyer certaines pratiques excellentes, et il a aidé des gens à trouver et à créer de l'emploi . . . il a joué un rôle déterminant pour ce qui est de résoudre des problèmes d'emploi sur une base individuelle. (Independent Living Resource Centre, St. John's, Terre-Neuve et Labrador)
Le Comité croit qu'une croissance économique soutenue constitue le meilleur moyen d'améliorer le niveau de vie des Canadiens, y compris ceux qui ont une déficience. Toutefois, nous reconnaissons les besoins des personnes handicapées et les difficultés auxquelles elles doivent faire face quotidiennement. Nous pensons qu'au moment d'entreprendre une réforme de la fiscalité, on devrait accorder une attention particulière à la situation des personnes handicapées en vue d'instaurer une plus grande équité horizontale.
En outre, nous estimons qu'il importe d'élargir les débouchés des personnes handicapées qui veulent entrer dans la population active et intégrer plus pleinement la vie économique de la société canadienne. Nous comprenons qu'il s'agit là de la raison d'être du Fonds d'intégration, et nous y souscrivons entièrement.
Investir dans l'enfance
Nous avons entendu un large éventail de témoins : particuliers, professionnels, organismes non gouvernementaux, groupes communautaires aussi bien que représentants de syndicats et d'entreprises, mais pratiquement tous ont dit que les enfants doivent constituer un important point de mire du prochain budget fédéral. On nous a dit que nous pouvions faire plus pour les enfants au Canada et que nous devrions édifier une société qui offre plus de possibilités pour que chaque enfant réalise son plein potentiel. Ces témoins ont exigé une approche améliorée à l'échelle du pays à l'égard de la santé et du bien-être des enfants.
De nombreux témoins attribuent une grande priorité aux enfants mais aucun consensus ne s'est dégagé quant aux meilleurs types de programmes pour répondre à leurs besoins. Certains estiment que la meilleure façon d'aider les enfants est de veiller à ce que les familles disposent de ressources financières suffisantes tandis que d'autres voudraient des programmes réalisés par des tiers spécialisés à l'intention des familles et des enfants.
La Fédération sait bien que l'on se dispute des fonds publics limités et reconnaît qu'il faut un engagement exhaustif et viable à long terme afin d'obtenir des résultats. Nous ne nous attendons pas à ce que tout soit réalisé dans l'espace d'un ou deux budgets. Le gouvernement fédéral peut cependant s'engager à faire des enfants et des jeunes une priorité nationale pour ce qui de l'affectation des ressources budgétaires. Il peut agir comme catalyseur afin d'énergiser les Canadiens pour le prochain millénaire.
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants
On nous a dit que les dépenses publiques visant les enfants (et leurs parents ou leurs familles) doivent être considérées comme un investissement à long terme. Le fait d'investir dans les enfants peut non seulement améliorer leur qualité de vie et leur bien-être dès maintenant, mais aussi entraîner d'intéressantes « retombées » à l'âge adulte. En outre, l'investissement public dans les enfants est avantageux non seulement pour l'individu mais aussi pour l'ensemble de la société.
Des témoins ont déclaré qu'il nous faut investir dans l'enfance et voir nos enfants comme une ressource naturelle qui représente l'avenir de notre pays. Dans la même veine, de nombreux témoins ont dit voir les enfants comme étant des créateurs de richesses futures. En fait, ils constituent notre capital humain. Leur productivitéfuture - et par conséquent celle du pays - dépend d'un investissement notable aujourd'hui.
Pour créer une économie vigoureuse et une société humaine et en santé, il nous faut investir dans l'enfance et la jeunesse du pays.
Alliance nationale pour les enfants
Les enfants du Canada constituent notre ressource la plus précieuse. Investir dans l'enfance constitue l'investissement d'infrastructure le plus avisé que nous puissions faire. Le fait de les préparer à une vie active de citoyen et de les aider à réaliser leur plein potentiel afin qu'ils deviennent des membres productifs de la société est avantageux pour tous les Canadiens. La viabilité future de notre régime public de soins de santé, des régimes de pension et d'avantages sociaux de même que la possibilité de réduire les impôts et la dette dépendent de nos enfants. Plus ils connaîtront de succès et plus ils seront à même de contribuer à la société; nos programmes et services sociaux réputés seront ainsi plus susceptibles de continuer d'exister et d'être accessibles pour tous les Canadiens. (Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants)
Les enfants du Canada constituent notre ressource la plus précieuse. Investir dans l'enfance est l'investissement d'infrastructure le plus avisé que nous puissions faire.
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants
En investissant dès aujourd'hui dans nos enfants, nous leur fournissons la possibilité de développer pleinement leurs capacités physiques, intellectuelles et sociales. Selon des témoins, les enfants ont de meilleures chances d'être des parents, des travailleurs et des citoyens modèles et enthousiastes si nous investissons maintenant comme il se doit.
De l'avis du Comité, investir dans l'enfance constitue non seulement une politique sociale salutaire, mais aussi une politique économique judicieuse. Si nous appuyons une économie axée sur le savoir, il nous incombe de fournir une infrastructure qui aidera les enfants et les jeunes à en devenir des participants. À la veille du prochain millénaire, nous souhaitons que les enfants deviennent des jeunes gens indépendants, avertis, polyvalents et créatifs, en d'autres mots, capables de relever les nombreux défis et de profiter des occasions que présentera le XXIe siècle.
Toute l'information recueillie relativement au développement et au perfectionnement cognitifs et, par la suite, au succès scolaire, met en lumière le fait que les jeunes enfants doivent être le principal point de mire de notre investissement social. La place qu'occupera le Canada dans la nouvelle économie et une productivité accrue dépendent directement des investissements que nous consentirons pour le bien-être de nos enfants.
Saskatchewan School Trustees Association
[L]es sociétés prospères s'occupent de leurs ressources humaines, et à cet égard, s'il y a un domaine où le soutien peut être le plus fructueux, c'est celui de l'enfance et de la famille. (Martha Friendly, Childcare Resource and Research Unit, Université de Toronto)
Développement du jeune enfant
Le développement de l'enfant compte quatre grandes étapes : de la période prénatale à 18 mois (le f9tus et le nourrisson); de 18 mois à 5 ans (le préscolaire); de 6 à 12 ans (correspondant à l'école primaire); de 13 à 18 ans (l'adolescence). Chaque étape offre une période particulièrement propice pendant laquelle il est davantage possible d'influer sur le développement de l'enfant et de l'aider à surmonter des désavantages antérieurs. Il y a aussi des facteurs qui jouent un rôle essentiel et façonnent le développement de l'enfant, notamment le patrimoine biologique, la famille, la garderie et l'école, le contexte physique et communautaire et la société. Ces facteurs ont diverses influences selon les différentes étapes du développement de l'enfant. Par exemple, à partir de la période prénatale à 18 mois, c'est la famille immédiate qui influe le plus sur l'enfant. À mesure que celui-ci grandit, il multiplie ses interactions avec la collectivité, à l'extérieur de la famille immédiate, par le biais de la garderie et de l'école, des loisirs et des soutiens dans le quartier, et ces rapports prennent de plus en plus de place dans la vie quotidienne de l'enfant8.
Cependant, selon une étude effectuée récemment par un groupe de 10 personnes coprésidé par Dr J. Fraser Mustard et l'honorable Margaret Norrie McCain, les toutes premières années du développement de l'enfant - soit de la conception à l'âge de 6 ans - représentent une période particulièrement importante pour l'établissement des compétences et des habiletés d'adaptation qui influeront sur les aptitudes à l'apprentissage, le comportement et la santé de l'enfant tout au long de sa vie. À de nombreuses reprises, des témoins ont mentionné les nouvelles données scientifiques qui montrent que le vécu de l'enfance a une très grande incidence sur le bien-être plus tard dans la vie9.
Comme le montre le tableau ci-après, le cerveau est apte à absorber certains types d'information selon les étapes de la petite enfance : avant la conception, pendant la grossesse, à la naissance, à l'âge du nourrisson et de la petite enfance. C'est pendant la phase prénatale et du nourrisson (de la conception à 18 mois) que se fait le modelage de base du cerveau de l'enfant. Des facteurs antérieurs à la naissance, comme le style de vie de la mère (p. ex. la nutrition et la consommation d'alcool et de tabac), influent sur le développement de l'enfant. Après la naissance, la relation du bébé avec les personnes qui en ont la charge influence grandement le développement des réseaux de cellules du cerveau. Ces réseaux peuvent avoir une incidence sur le développement immédiat et futur de l'enfant sur le plan intellectuel, émotionnel et du comportemental10.
La maturation psychique comprend donc plusieurs périodes critiques, au cours desquelles le jeune enfant doit recevoir des stimulus favorisant la création des circuits neuronaux du système nerveux. À l'âge de 6 ans, un grand nombre de ces périodes critiques sont déjà franchies ou s'achèvent. Elles visent les aspects suivants : la vision binoculaire, la maîtrise des émotions, les façons habituelles de réagir à des stimuli, l'acquisition du langage et l'apprentissage de l'écriture, des symboles et de la notion de quantité relative.
Mustard et McCain, L'Étude sur la petite enfance
TABLEAU 1
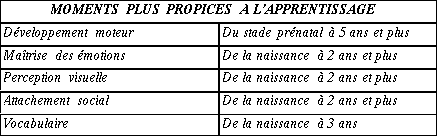
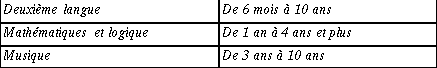
Source : Conseil national du bien-être social, Parents en
santé, bébé en santé, été 1997,
p. 26.
L'acquisition du langage est un exemple éloquent de la capacité d'apprendre du nourrisson. Les circuits cérébraux qui représentent les sons qui donneront des mots se forment pendant la première année de la vie; pendant les mois qui suivront, le langage se développera rapidement chez l'enfant. Plus l'enfant entend de mots avant l'âge de 2 ans, plus son vocabulaire s'accroîtra11.
Les données scientifiques indiquent que les connexions cérébrales de l'enfant s'effectuent normalement seulement si celui-ci est soumis à des stimulus externes adéquats. Pour s'épanouir pleinement, les enfants ont besoin de stimulations visuelles, tactiles, auditives et autres. Si ces stimulus cruciaux font défaut pendant les périodes critiques du développement neuronal, il se peut que l'enfant en souffre sur le plan cognitif ou du comportement plus tard au courant de sa vie :
[Les six premières années de la vie constituent] une étape décisive dans le développement du cerveau, un moment où la structure (la « malléabilité ») du cerveau de l'enfant subit l'influence du monde qui l'entoure. [ . . . ] La qualité de l'attention que reçoit l'enfant au cours de ses premières années d'existence façonne l'émergence de la pensée, l'apprentissage et les capacités futures. Un environnement physique, affectif et social malsain durant la petite enfance peut avoir des répercussions permanentes. En fait, l'enfant choyé a un cerveau dont l'aspect physique diffère de celui de l'enfant qui a connu des conditions moins favorables durant sa petite enfance12.
Il existe des preuves inquiétantes voulant que les enfants dépourvus de l'alimentation et de la stimulation nécessaires à leur développement durant les premiers mois et les premières années de leur vie aient souvent beaucoup de mal à surmonter des obstacles quand ils sont plus âgés. Une fois achevées les périodes critiques de développement cérébral, l'enfant peut compenser certaines lacunes, à moins qu'il ait été victime de négligence extrême. Il lui sera néanmoins difficile de réaliser tout son potentiel.
Mustard et McCain, L'Étude de la petite enfance
Des études récentes confirment combien il est important pour le bébé et le jeune enfant de jouir d'un attachement sécurisant à un parent ou à un gardien aimant pour se développer le mieux possible sur les plans affectif et social :
Un attachement sécurisant constitue un solide fondement sur lequel bâtir l'aptitude de l'enfant à développer la confiance en soi, l'estime de soi, l'autocontrôle, le calme intérieur et des relations positives avec autrui. Il influe sur le développement linguistique et intellectuel et donne à l'enfant l'assurance nécessaire pour bien explorer le monde. Il est également prouvé qu'un attachement sécurisant stimule la création de modèles de réseau dans le cerveau qui peuvent réduire l'anxiété et permettre au cerveau d'accepter de nouveaux stimulus13.
Il est vrai que la recherche scientifique ajoute du poids aux arguments en faveur d'investissements substantiels dans les premières années de la vie des enfants, mais le message n'est pas nouveau. La plupart des Canadiens, notamment les parents, savent déjà par instinct que de procurer aux jeunes enfants un milieu stimulant, aimant, positif et sûr fait une énorme différence sur leur avenir. Les enfants dont on s'occupe bien aujourd'hui ont plus de chance de devenir des adultes bien portants, responsables, productifs et bienveillants, capables d'apporter leur contribution à l'économie et à la société du Canada. Une intervention dans la petite enfance constitue un investissement qui aura comme retombée une réduction des dépenses au cours des années subséquentes.
Malgré tout, les gouvernements et les collectivités ont tendance à investir davantage plus tard au cours de la vie, laissant passer la période la plus critique pour promouvoir la compétence et le potentiel humains.
Nous avons appris que l'objectif le plus bénéfique de nos démarches a été l'intervention précoce. La création d'un environnement sain et stimulant sur le plan social et intellectuel pour les enfants, avant qu'ils atteignent l'âge obligatoire de scolarité, a le plus grand effet sur leur succès scolaire futur. Il n'est pas surprenant que, vu la nécessité de veiller à ce que les jeunes Canadiens puissent participer à une économie fondée sur le savoir, la plupart des gens considèrent le plan d'intervention précoce comme un investissement.
Saskatchewan School Trustees Association
Même avec les nouvelles connaissances dont nous disposons sur l'importance de l'étape formative, les Canadiens et les Canadiennes continuent de consacrer le plus gros de leur énergie à régler les problèmes après coup. Bien sûr, nous ne pouvons pas ne pas tenir compte de l'importance des services destinés à répondre aux besoins des enfants plus âgés. Cependant, lorsque cela est possible, nous devons favoriser le bien-être durable de l'enfant dès le début de sa vie14.
Les nouvelles preuves scientifiques laissent présager une infrastructure sociale renouvelée, engagée à l'égard des premières années de vie des enfants. Plutôt que d'attendre pour régler les problèmes après le fait, le Comité estime que nous devrions essayer de les empêcher de se produire : nous devrions adopter en la matière une approche prospective. Prévenir les problèmes constituerait une évolution marquée dans l'infrastructure sociale canadienne. La prévention engendrera pour la société dans son ensemble des économies substantielles sous la forme de dépenses de santé moins élevées, d'une réduction du décrochage scolaire, d'une main-d'9uvre plus productive et d'une diminution de la délinquance et de la criminalité. De ce point de vue, cela ressemble à un investissement qui coûte peu aujourd'hui mais qui, plus tard, rapporte beaucoup.
Les programmes d'éducation de qualité pour la petite enfance ont des effets positifs sur les enfants concernés et aussi sur la société canadienne. Dans le cas des enfants, ces effets sont très évidents. Les enfants qui grandissent dans un milieu affectueux et stimulant, que ce soit à la maison ou dans un service de garde, sont plus heureux et se portent mieux à l'âge adulte. Certaines études [ . . . ] ont clairement démontré les avantages que présentent, sur le plan économique et humain, les programmes d'éducation de qualité. Les enfants qui ont pris part à l'étude et bénéficié de tels programmes ont, à l'âge adulte, éprouvé moins de problèmes de santé, eu moins de démêlés avec la justice et connu plus de succès sur le plan financier. Autrement dit, ces personnes ont une meilleure qualité de vie du fait de leur participation aux programmes. Les conséquences sur le plan économique ont elles aussi été quantifiées : chaque dollar consacré aux programmes préscolaires de qualité permet plus tard aux services de santé, de justice et autres services sociaux d'en économiser sept. (Association des commissaires d'écoles du Manitoba)
Le gouvernement fédéral a reconnu les avantages sociaux et économiques à long terme des initiatives de développement dans la petite enfance, comme on le constate dans le discours du Trône :
À cause de l'évolution de l'économie mondiale, pour jouir d'une qualité de vie élevée, tous les pays devront compter plus que jamais sur une population adaptable, déterminée et prête à poursuivre son apprentissage pendant toute sa vie. C'est dès la tendre enfance que de telles qualités s'acquièrent. Aucun engagement que nous prenons aujourd'hui ne sera donc plus important pour la prospérité et le bien-être à long terme de la société canadienne que celui d'investir nos efforts en faveur des très jeunes enfants. Ce sont les parents et les familles qui ont la responsabilité première de prendre soin de leurs enfants. La société toute entière doit cependant 9uvrer de concert pour que nos enfants acquièrent les compétences nécessaires à leur réussite.
Le gouvernement fédéral a donc annoncé qu'il prendra sept mesures pour répondre aux besoins précis des enfants et de leur famille. Le tableau qui suit résume ces mesures :
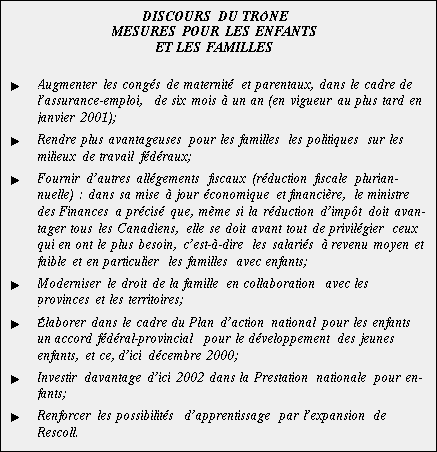
Toutefois, les fonds publics investis dans les enfants ne suffisent pas.
Les gouvernements ne peuvent agir seuls :
Il est vrai qu'il faut un village tout entier pour élever un enfant en santé. L'action communautaire est un complément important de l'action gouvernementale; les quartiers doivent être sûrs et soutenir le développement sain de l'enfant. Le secteur privé doit également participer, puisque la dynamique du temps et du revenu a d'importantes répercussions sur l'aptitude à être un parent. Lorsque les gouvernements, les entreprises, les collectivités, les familles et les jeunes collaborent, les enfants et les jeunes ont toutes les chances de devenir des adultes sains et productifs15.
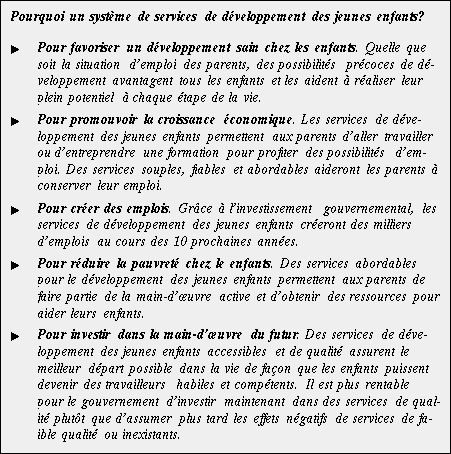
Source : Ontario Coalition for Better Child Care Network, mémoire
La pauvreté chez les enfants
Le Canada jouit, à l'échelle du monde, d'une enviable réputation comme pays où il fait bon vivre, mais il semble que son succès ne rejaillisse pas également sur tous. Notre économie, qui se caractérisait autrefois par des emplois permanents à plein temps, connaît maintenant des changements d'emplois plus fréquents, une augmentation de la demande de recyclage ainsi que davantage de travail contractuel, à temps partiel et autonome. Les changements survenus dans la structure familiale ont entraîné l'augmentation des familles monoparentales et, en dépit de la croissance économique, la proportion des familles avec enfants vivant de faibles revenus s'est élevée au cours de la dernière décennie. Par ailleurs, les enfants inuit et des Premières nations, où qu'ils habitent au Canada, risquent plus que les autres enfants canadiens de vivre dans la pauvreté.
Peu de témoins ont contesté que de vivre dans la pauvreté avait des conséquences directes et dévastatrices. La recherche a montré que la pauvreté multiplie les défis et les facteurs de stress que connaissent toutes les familles, ce qui a de fortes répercussions sur les enfants. Selon une étude réalisée par l'économiste Dave Ross à l'aide de 31 indicateurs différents sur le plan social, du développement et de la santé, à mesure que diminue le revenu familial augmente la probabilité pour les enfants d'éprouver des problèmes. Les taux de mauvaise santé, d'hyperactivité et de développement linguistique tardif sont beaucoup plus élevés chez les enfants de familles à faible revenu que chez ceux de familles à revenu moyen ou supérieur. Par conséquent, la pauvreté accroît les risques en matière de santé. Elle peut réduire la capacité des familles et des collectivités de pendre soin des enfants. Elle peut affaiblir les résultats scolaires. Bref, la pauvreté peut avoir un effet négatif sur le développement des enfants.
La réalité économique et financière des Premières nations est tout à fait différente de celle du reste du Canada. Le niveau moyen de chômage des Premières nations se situe autour de 50 %. Le revenu moyen n'est que de 60 % de la moyenne nationale. Alors que les Nations Unies ont déclaré que le Canada avait le plus haut niveau de vie au monde, si l'on mesure de la même façon celui des Premières nations, elles arrivent au 63e rang.
Assemblée des Premières nations
Toutefois, cette même étude laisse entendre que les enfants pauvres ne sont pas toujours désavantagés et que, parallèlement, les enfants désavantagés ne sont pas toujours pauvres. En fait, dans tous les groupes socioéconomiques, il existe des enfants qui ne réussissent pas bien, et de cette constatation en découlent plusieurs autres :
Depuis une dizaine d'années, nous avons aussi appris qu'un nombre croissant de familles canadiennes vivent en deçà du seuil de pauvreté. Les raisons en sont diverses et complexes mais, comme ces familles sont incapables de tirer tout l'avantage possible de l'économie canadienne, de nombreux enfants vivent dans des environnements qui ne sont pas sains, ni stimulants sur le plan social ou intellectuel. Malheureusement, une proportion importante des habitants de certaines communautés vivent dans la misère, sont sous-alimentés et n'ont aucun espoir. L'inadaptation sociale à la maternelle, la délinquance juvénile et l'abandon scolaire à l'adolescence pour vivre dans la rue sont les symptômes de communautés et d'une nation où rien ne va plus.
Saskatchewan School Trustees Association
- Il n'existe pas de ligne de démarcation nette (niveau de revenu) au-dessus de laquelle tous les enfants fonctionnent bien.
- Le revenu ne constitue pas le seul facteur qui influence le sain développement de l'enfant. D'autres facteurs comme le fait d'être de bons parents et l'accès à des programmes de développement précoce affectent aussi le développement de l'enfant.
- Des éléments comme une bonne approche parentale, des quartiers chaleureux et l'accès à des programmes de développement précoce peuvent contrebalancer les effets négatifs de la pauvreté sur les enfants.
- Étant donné la taille de la classe moyenne au Canada, le nombre d'enfants qui ne réussissent pas aussi bien qu'ils le pourraient est plus élevé au sein de la classe moyenne.
- Les programmes et les politiques visant le développement positif de l'enfant et qui aident les gens à être de bons parents doivent s'adresser à tous les secteurs de la société et à toutes les catégories de revenu16.
Dans l'ensemble, bon nombre de témoins étaient d'avis qu'il fallait privilégier simultanément le soutien du revenu et les services intégrés pour les enfants et les familles. Les facteurs tels qu'une bonne approche parentale, des services de garde de qualité, les soutiens sociaux et sanitaires et d'autres influences communautaires offrent une protection qui contrebalance ou réduit les désavantages, y compris ceux qu'on associe à un faible revenu. Certains nous ont dit que, pour être efficace à long terme, le soutien du revenu doit être combiné à des mesures qui répondent à d'autres besoins des familles à faible revenu comme les services de garde, les prestations de maladie et les services sociaux.
Dans cette perspective, les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux ont déjà pris des mesures significatives pour ce qui est du soutien du revenu et des interventions dans la petite enfance, notamment par l'intermédiaire de la Prestation nationale pour enfants et du Plan d'action national pour les enfants.
La prestation nationale pour enfants (PNE)
Le Comité estime que, pour améliorer le bien-être économique des familles et réduire la pauvreté chez les enfants, rien ne vaut une économie solide, génératrice de possibilités pour tous. L'emploi soutenu garantit un revenu familial sûr. De nombreuses familles, toutefois, continuent d'avoir besoin d'un soutien financier additionnel pour élever leurs enfants, même en période d'abondance économique. C'est pourquoi le Comité est en faveur de la Prestation nationale pour enfants et recommande qu'elle continue de jouer un rôle important dans l'aide aux familles à faible revenu avec enfants.
La PNE, mise en 9uvre le 1er juillet 1998, est une approche fédérale, provinciale et territoriale (excluant le Québec) conçue pour aider à prévenir et à réduire la pauvreté infantile, renforcer les liens avec le marché du travail et éliminer les chevauchements et le double emploi au gouvernement. Elle combine les investissements fédéraux dans les prestations pour enfants destinées aux familles à faible revenu et les investissements provinciaux et territoriaux dans les services et prestations à ces mêmes familles. En vertu de la PNE, les parents assistés sociaux sont appuyés alors qu'ils s'orientent vers des emplois améliorant l'accès à des avantages et services essentiels pour leurs enfants, tandis que les parents déjà dans des emplois à faible revenu obtiennent un soutien des plus nécessaires pour rester au travail.
Au moyen de la PNE, le gouvernement fédéral a augmenté le soutien du revenu qu'il fournit aux familles à faible revenu avec enfants. Les provinces et les territoires ont rajusté le soutien qu'ils procurent aux familles avec enfants sous la forme d'aide sociale, et tous ont investi dans des avantages et services nouveaux et améliorés pour les familles à faible revenu avec enfants. Cet appui prend surtout la forme de suppléments au revenu gagné, de services de garde, de services à la petite enfance et aux enfants à risque et de prestations de maladie supplémentaires. Étant donné que la prestation de base pour enfants ne se rattache pas au système d'aide sociale, les parents peuvent trouver plus facile de se procurer un emploi et de le conserver.
À titre de contribution initiale à la PNE, le gouvernement
fédéral a engagé
850 millions de dollars par année afin d'augmenter les prestations
pour enfants à l'égard des familles à faible revenu
avec enfants. En 1998-1999, cet investissement additionnel a permis une
augmentation des prestations pour environ 1,4 million de familles canadiennes
et 2,5 millions d'enfants. Pour arriver à ce résultat, le
gouvernement a fusionné deux programmes existants, soit la Prestation
fiscale pour enfants et le Supplément au revenu gagné, en
une Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE). La nouvelle prestation
comporte deux éléments, la prestation de base, versée
mensuellement à 80 % de toutes les familles canadiennes avec enfants,
et le supplément de la Prestation nationale pour enfants (SPNE),
versé aux familles à faible revenu avec enfants. Le montant
de la PFCE payable à chaque famille est déterminé
au moyen du régime d'imposition, en fonction du revenu familial
de l'année précédente, et est automatiquement rajusté
en juillet de chaque année.
Dans le budget fédéral de 1999, on a annoncé la structure et le niveau de prestation de la PNE puis, en juillet 1999, le financement de cette dernière a été augmenté de 425 millions de dollars, un montant égal devant s'ajouter en juillet 2000. Le niveau maximal du SPNE s'est accru de 350 $ par enfant (de 180 $ en juillet 1999 et de 170 $ en juillet 2000). Par conséquent, les montants maximaux annuels de PFCE sont passés à 1 805 $ pour le premier enfant et à1 605 $ pour chacun des enfants suivants. Pour leur contribution à la PNE, les provinces et territoires participants réinvestiront les économies réalisées au chapitre de l'aide sociale de façon à répondre aux priorités et aux besoins locaux. En 1999-2000, ils devraient dépenser plus de 400 millions de dollars pour l'amélioration des actuels services et programmes destinés aux familles à faible revenu et à leurs enfants. Dans le dernier discours du Trône, le gouvernement a indiqué son intention d'effectuer un troisième investissement d'importance dans la PNE en 2001. Le Comité appuie fortement cette majoration.
Le Comité est convaincu que les recommandations qu'il a formulées dans le chapitre précédent concernant les allégements fiscaux et la Prestation fiscale canadienne pour enfants (diminuant le taux de réduction de la prestation) aideront les familles à revenu moyen et faible.
La PNE peut, avec les allégements fiscaux, faire une différence marquée dans la vie des enfants et des familles, mais ce n'est pas suffisant en soi. Lors de leur conférence de 1997, le premier ministre du Canada, les ministres provinciaux et les dirigeants territoriaux ont réitéré leur engagement à l'égard d'une nouvelle approche coopérative, destinée à répondre aux besoins des enfants au moyen d'un Plan d'action national pour les enfants.
Le Plan d'action national pour les enfants
Au cours des cinq dernières années, la plupart des provinces ont entrepris d'élaborer des approches plus globales pour aider les enfants et les familles. Le gouvernement fédéral s'est lui aussi impliqué dans un certain nombre de projets. Le Plan d'action national pour les enfants pourrait harmoniser tout ce travail et inspirer de nouvelles solutions.
Dans le discours du Trône de 1997, le gouvernement fédéral annonçait un Plan d'action national pour les enfants qui intégrerait les politiques et programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux axés sur le bien-être des enfants canadiens. En mai 1999, les autorités fédérales, provinciales et territoriales (à l'exception du Québec) publiaient un document de travail intitulé Plan d'action national pour les enfants : Élaboration d'une vision commune. Durant tout l'été, les Canadiens ont été invités à réagir à ce rapport et à donner leur opinion sur la meilleure façon de combler les besoins des enfants.
Le document sur la vision commune précise quatre objectifs mesurables : il faut des enfants en santé, sur les plans physique et affectif; à qui on assure sécurité et protection; qui réussissent leur apprentissage; capables d'engagement social et responsables. Il met également en lumière six domaines interdépendants où les efforts peuvent avoir des effets positifs sur les enfants :
- Appuyer le rôle des parents et renforcer la famille.
- Favoriser davantage le développement dans la petite enfance.
- Améliorer la sécurité économique des familles.
- Offrir des expériences d'apprentissage précoces et continues.
- Promouvoir l'épanouissement de l'adolescent.
- Créer des collectivités favorables, sûres et exemptes de violence.
Le Plan d'action ne propose pas avec précision une politique ou un ensemble de politiques. Le rôle du gouvernement fédéral et celui des provinces et des territoires n'est pas encore délimité. Toutefois, d'après bon nombre de témoins, le Plan d'action peut fournir au gouvernement fédéral les outils nécessaires pour collaborer avec d'autres ordres administratifs et les diverses collectivités d'un bout à l'autre du pays afin de tenter de régler les problèmes ayant trait au bien-être des enfants.
Nous espérons que notre gouvernement saisira cette occasion et prendra les mesures nécessaires pour renforcer la structure sociale de nos communautés. (Nova Scotia School Boards Association, lettre)
À l'occasion de leur conférence annuelle, le 11 août 1999, les premiers ministres provinciaux et les dirigeants territoriaux ont précisé que les questions touchant les enfants étaient prioritaires et ils nous ont rappelé qu'ils s'étaient employés à régler les questions clés qui sont de leur ressort. Pour ce qui est d'une nouvelle initiative fédérale concernant les enfants, ils ont dit s'attendre à ce que le gouvernement central respecte ses engagements découlant de l'Entente-cadre sur l'union sociale. Ils prévoient donc que le gouvernement fédéral entamera dès le départ une véritable collaboration avec les provinces et les territoires au sujet de tout programme qu'il pourrait vouloir créer concernant les enfants, de façon à ne pas dédoubler les travaux en cours dans les provinces et les territoires17.
Partout au Canada, les gouvernements financent ou fournissent une vaste gamme de soutiens sous forme de lois, de politiques et de programmes visant à garantir que les enfants ont la meilleure chance possible de bien commencer leur vie. Outre les services universels en matière de santé et d'éducation, diverses initiatives viennent appuyer différents aspects de la vie des enfants. Parmi les exemples de ces appuis, mentionnons des programmes relatifs au revenu pour les familles avec enfants, des prestations d'assurance-maladie complémentaires, un soutien pour le développement des jeunes enfants comprenant des programmes prénataux, des visites à domicile des enfants et des nouvelles mères, des programmes et activités préscolaires, des services de garde, etc., la protection des enfants, des services de loisirs et, enfin, des services à l'égard des jeunes contrevenants. Plusieurs organisations non gouvernementales, des groupes communautaires ainsi que le secteur privé participent également à la prestation de programmes et d'appuis destinés aux enfants18.
Le gouvernement fédéral s'occupe déjà depuis un certain nombre d'années de programmes et d'initiatives visant le développement des jeunes enfants, par exemple :
- Programme d'action communautaire pour les enfants : Ce programme, annoncé en mai 1992, consent des fonds à des groupes communautaires pour les aider à établir et à fournir des services concernant les besoins de développement des enfants à risque âgés de 0 à 6 ans. Les services combinent des activités d'éducation et d'intervention, l'accent étant mis sur la prévention. Comme exemples de services, mentionnons : les centres de ressources pour les parents et les familles, les centres de développement de l'enfance, l'éducation parentale et la stimulation des bébés. Les groupes cibles sont les enfants vivant dans des familles à faible revenu, les enfants vivant avec des parents adolescents, les enfants souffrant de retard de développement, de problèmes sociaux et affectifs ou de troubles du comportement, les enfants victimes de sévisses et de négligence, les personnes qui ont ou pourraient avoir de jeunes enfants à risque. Le Programme est géré conjointement par le gouvernement fédéral et par les provinces ou les territoires. Si l'objectif global est le même partout au pays, les priorités d'action sont déterminées par les provinces et les territoires et, de ce fait, diffèrent d'une compétence à l'autre en fonction de la situation locale.
- Le Programme canadien de nutrition prénatale : Ce programme, annoncé en juillet 1994 et réalisé par l'entremise du Programme d'action communautaire pour les enfants, est lui aussi géré conjointement par le gouvernement fédéral et par les provinces ou les territoires. Il a pour objet de fournir des suppléments alimentaires, des conseils sur la nutrition, un soutien, de l'éducation, des services de renvoi et de counselling sur des questions de mode de vie à des femmes enceintes susceptibles d'avoir des enfants maladifs. Le programme cible les adolescentes enceintes, celles qui risquent de le devenir, les femmes enceintes qui abusent de l'alcool ou consomment d'autres substances, les femmes enceintes vivant dans la violence, les Autochtones et les Inuit à l'extérieur des réserves, les réfugiés, les femmes enceintes vivant isolément ou n'ayant pas accès aux services.
- Programme d'aide préscolaire aux Autochtones : Ce programme a été institué en 1995 pour faciliter le développement des enfants indiens, métis et inuit vivant dans les centres urbains et les grandes collectivités nordiques, et pour les préparer à l'école. En octobre 1998, on annonçait l'expansion, aux communautés des Premières nations, du Programme d'aide préscolaire aux Autochtones. L'initiative dans les réserves est conçue pour préparer les enfants des Premières nations à leurs années scolaires en répondant à leurs besoins affectifs, sociaux, sanitaires, nutritionnels et psychologiques. Le programme a pour but d'encourager l'élaboration de projets portant sur les éléments suivants : langue et culture, éducation, promotion de la santé, nutrition, soutien social et participation des parents. Il encourage, dans les communautés des Premières nations, l'élaboration de projets dirigés à l'échelle locale qui s'efforcent d'inculquer un sentiment de fierté et le désir d'apprendre, de fournir des compétences parentales, de promouvoir le développement affectif et social, de renforcer la confiance et d'améliorer les relations familiales. Il aide également les parents à accroître leurs compétences qui contribuent au bon développement de leur enfant.
Dans l'ensemble, les gouvernements du Canada investissent déjà un montant considérable dans de nombreux programmes concernant les soins aux enfants et l'éducation préscolaire. Si beaucoup de ces programmes et services sont excellents, on nous a dit que leur élaboration s'était souvent faite d'une façon improvisée. Dans bien des cas, il n'y a guère de coordination et d'intégration des programmes et des services, et aucun ne constitue à lui seul une réponse complète en matière de développement de la petite enfance. Les problèmes des enfants et des familles sont parfois complexes et exigent par conséquent des solutions plus exhaustives19.
Le Comité estime que, même si de nouvelles ressources s'imposent peut-être dans certains cas, nous devrions d'abord essayer de faire fond sur ce qui existe déjà au pays. Cet effort peut s'effectuer dans le cadre du Plan d'action national pour les enfants, dans lequel les gouvernements proposent d'examiner les façons de renforcer le travail déjà en cours et de partager l'information sur les méthodes efficaces. Voilà qui se rapproche beaucoup de l'orientation que nous avons prise l'an dernier dans le dossier des soins de santé : déterminer les meilleures pratiques, trouver les causes profondes des problèmes sociaux, évaluer les programmes et mécanismes actuels, etc.
Le Plan d'action national pour les enfants propose également de mesurer le bien-être des enfants et de suivre les progrès des diverses initiatives, ce qui nous révélera la meilleure façon d'aider les enfants à accomplir leur plein potentiel. Puisque le gouvernement fédéral et les provinces offrent déjà une vaste gamme de programmes et de services destinés aux familles et aux enfants, il est logique de partager l'information sur ce qui fonctionne et de pousser plus avant les expériences réussies des gouvernements et de la collectivité.
Comme le développement des jeunes enfants comprend plusieurs étapes préconception, période prénatale, petite enfance et années préscolaires les témoins ont recommandé de fournir des programmes différents aux différentes étapes (certains programmes pouvant se chevaucher). Le tableau suivant résume les initiatives axées sur le développement des jeunes enfants, dont les témoins ont parlé lors des audiences :
Nous serons responsables pour autant que nous associions les mesures visant l'atteinte des résultats auprès des enfants et des jeunes à des changements de politique. L'information et la recherche permettront de vérifier si la situation des enfants et des jeunes au Canada s'améliore ou si, au contraire, elle se détériore. Il est donc essentiel que le Canada mette sur pied :
- un programme national de recherche;
- un mécanisme national de compte rendu et de surveillance relativement au bien-être des enfants.
Alliance nationale pour les enfants
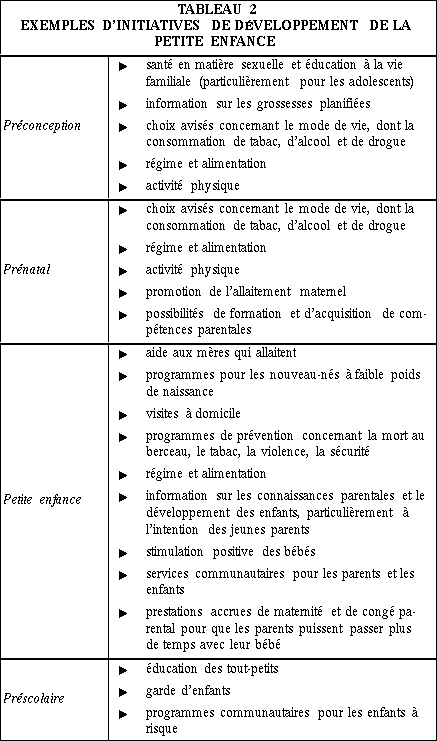
D'après ce que les témoins ont dit au Comité, la prolongation
du congé parental apportera de grands bienfaits aux familles, notamment
à celles qui ont un enfant handicapé. Certains ont recommandé
de majorer la déduction des frais de garde pour les familles ayant
un enfant handicapé en augmentant la déduction et en portant
l'âge limite à 18 ans. D'autres ont recommandé de hausser
la prestation nationale pour enfants à 4 200 $ par famille et de
la rendre disponible aux familles à revenu moyen et modeste.
En réponse au discours du Trône, le premier ministre a mis ses homologues provinciaux et territoriaux au défi de conclure, d'ici décembre 2000, une entente harmonisée avec l'Entente-cadre sur l'union sociale de façon à renforcer les soutiens communautaires au développement de la petite enfance. Le Comité croit que nous devons tirer parti du Plan d'action national pour les enfants et recommande par conséquent que le gouvernement fédéral s'emploie à mettre au point et à appliquer le Plan d'action national pour les enfants.
Il est temps de dire que la pauvreté ne devrait pas être une condition préalable au soutien du gouvernement fédéral à l'égard des enfants.
Marc van Audenrode
1 William B.P. Robson, « The $22.5 billion Question: Will Exposure Make Future Federal Surpluses Evaporate? », document de fond de l'Institut C.D. Howe, 27 octobre 1999, p. 2.
2 Fonds monétaire international, Statement of the IMF Mission, 2000 Article IV Consultation with Canada, 16 novembre 1999 (tiré du site Web du FMI : http://www.imf.org).
3 Mémoire, p. 3.
4 Employer Committee on Health Care - Ontario, mémoire.
5 Conseil pour la recherche en santé au Canada, mémoire, p. 5.
6 Douglas E. Angus et coll., Sustainable Health Care for Canada, projets économiques, Université Queen's et Université d'Ottawa, p. 115.
7 Ministre des Finances, Le plan budgétaire de 1999, 16 février 1999, p. 87-88, 102-111.
8 Conseil fédéral-provincial-territorial des ministres sur la refonte des politiques sociales, Plan d'action national pour les enfants : la mesure du bien-être des enfants et l'évolution des progrès, document de discussion supplémentaire, 1999, p. 3.
9 Groupe de référence coprésidé par l'honorable Margaret McCain et Dr J. Fraser Mustard, L'Étude sur la petite enfance : Rapport final, avril 1999.
10 Comité consultatif fédéral-provincial-territorial sur la santé de la population, Pour un avenir en santé : Deuxième rapport sur la santé de la population canadienne, septembre 1999, p. 75.
11 Conseil national du bien-être social, Parents en santé, bébé en santé, été 1997, p. 26.
12 Conseil fédéral-provincial-territorial des ministres sur la refonte des politiques sociales, Plan d'action national pour les enfants : Élaboration d'une vision commune, p. 2.
13 Comité consultatif fédéral-provincial-territorial sur la santé de la population, Pour un avenir en santé : Deuxième rapport sur la santé de la population canadienne, septembre 1999, p. 79.
14 Conseil fédéral-provincial-territorial des ministres sur la refonte des politiques sociales, Plan d'action national pour les enfants : Élaboration d'une vision commune, p. 2.
15 Comité consultatif fédéral-provincial-territorial sur la santé de la population, Pour un avenir en santé : Deuxième rapport sur la santé de la population canadienne, septembre 1999, p. 90.
16 Les résultats de cette étude sont résumés dans Comité : consultatif fédéral-provincial-territorial sur la santé de la population, Pour un avenir en santé : Deuxième rapport sur la santé de la population canadienne, septembre 1999, p. 85.
17 Conférence annuelle des premiers ministres provinciaux, communiqué, 10 août 1999.
18 Plan d'action national pour les enfants : La mesure du bien-être des enfants et l'évolution des progrès.
19 Gouvernement de la Saskatchewan, Saskatchewan's Action Plan for Children, avril 1999.