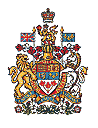:
Bonjour et bienvenue à la 46
e séance du Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie, qui se tient aujourd'hui, le 25 novembre 2009. Conformément à l'article 108(2) du Règlement, nous étudions le rendement récent des petites et moyennes entreprises au Canada.
Nous accueillons aujourd'hui six témoins représentant quatre organismes: M. Rémillard, directeur exécutif de l'Association canadienne du capital de risque et d'investissement, MM. Campbell et Wrobel, de l'Association des banquiers canadiens, M. Hayes, de GrowthWorks Atlantic Ltd., et enfin, MM. Halde et Nycz, de la Banque de développement du Canada.
Nous sommes ravis de vous voir tous ici.
Nous commencerons par les exposés des diverses organisations, d'une durée d'environ cinq à sept minutes chaque. Pour débuter, nous entendrons l'Association canadienne du capital de risque et d'investissement.
:
Je vous remercie beaucoup, monsieur le président.
Bonjour, mesdames et messieurs.
[Français]
C'est un grand plaisir que d'être ici avec vous aujourd'hui. C'est la première fois, de mémoire, que l'on est invités par le comité. On est très conscients de votre attention à notre égard.
[Traduction]
Je m'en tiendrai aujourd'hui à trois grands sujets: une introduction à l'industrie du capital de risque, un exposé sur les défis que doit relever l'industrie, particulièrement en ce qui concerne les petites entreprises, et quelques solutions qui nous sont apparues.
Nous sommes la seule association nationale de capital de risque au Canada. Fondée en 1974 avec six fonds, notre association gère 130 fonds totalisant des capitaux de 75 milliards de dollars. C'est une croissance considérable sur une période de 35 ans.
Les fonds de capital de risque investissent presque exclusivement — à plus de 90 p. 100 — dans des entreprises de haute technologie. Le capital de risque constitue la source principale de financement des secteurs canadiens de haute technologie, qui englobent notamment RIM, Intel, Google et Microsoft. Nous investissons principalement dans les technologies de l'information et des communications, les sciences de la vie et, de plus en plus, la technologie propre.
Selon une recherche que nous avons commandée avec Industrie Canada, la BDC et quatre gouvernements provinciaux, les entreprises financées à l'aide de capital de risque tendent à exporter, à créer des emplois et à réaliser de la R-D bien plus que la compagnie canadienne moyenne.
Le capital de risque traverse actuellement une formidable tempête, qui frappe sur plusieurs fronts. Force nous est de constater que les investissements sont en chute libre, tout comme le financement. Il n'y a aucun retrait, aucun appel public à l'épargne initial, et les fusions et acquisitions sont au plus bas. Par exemple, au troisième trimestre de 2009, l'industrie a récolté 1 million de dollars en Ontario, un montant qui permet de financer la moitié d'une entreprise pendant un an.
Conséquence de la crise à laquelle notre industrie est confrontée, on investit de moins en moins dans les PME canadiennes, particulièrement dans les secteurs de haute technologie. Les entreprises canadiennes recueillent à peine le tiers environ du financement que récoltent leurs voisines du Sud, aux États-Unis. Nous laissons ainsi échapper l'occasion de commercialiser toute la R-D dans laquelle le Canada investit et ne créons pas les emplois que nous pourrions et devrions créer.
Nous avons toutefois quelques solutions, que je vais vous exposer.
Tout d'abord, le gouvernement pourrait constituer un fonds de fonds substantiel afin de recapitaliser l'industrie, comme on le fait notamment en Ontario, au Québec et principalement en Alberta.
Ensuite, il faudrait inciter les grandes entreprises internationales qui obtiennent des contrats du gouvernement à investir dans les fonds de capital de risque, en partie pour honorer leurs engagements de compensation.
De plus, les investisseurs individuels devraient être davantage encouragés à investir dans les catégories des actifs de capital de risque. Il faudrait majorer les crédits d'impôt à la RS-DE. Une certaine disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu empêche les capitaux étrangers d'entrer au pays. Il s'agit de l'article 116, une tache au dossier d'investissement du Canada qui nuit à sa capacité d'attirer le capital de risque étranger. Ce type d'investissement est donc en baisse au pays.
Enfin, le comité pourrait demander aux ministère des Finances et de l'Industrie ce qu'il est advenu de la recommandation 37 du groupe d'experts Wilson. M. Wilson a dirigé un groupe d'étude sur la compétitivité, qui a remis son rapport en juin 2008. La recommandation 37 disait en essence que les ministres des Finances et de l'Industrie devraient préparer et publier un document sur les options en matière de capital de risque privé aux fins d'examen.
Nous sommes à la mi-novembre, et ce document se fait encore attendre. Il faudrait peut-être envisager la mise sur pied d'un groupe d'experts sur la commercialisation. Nous laissons échapper une occasion en or.
Je vous remercie de m'avoir écouté.
:
Bon après-midi. Je m'appelle Terry Campbell et je suis vice-président, Politiques, à l'ABC. Je suis accompagné aujourd'hui de mon collègue Marion Wrobel, directeur, Évolution des marchés et de la réglementation.
Nous remercions le président et les membres du comité de nous donner l'occasion de nous exprimer.
[Traduction]
Vous savez certainement que l'Association des banquiers canadiens représente 50 banques membres, soit des banques canadiennes ainsi que des filiales et des succursales de banques étrangères exerçant des activités au Canada, et leurs 263 000 employés. Les Canadiens sont fiers de leur banques, et avec raison. Les banques au Canada ont maintenu leur vigueur et leur stabilité alors que de nombreuses banques à travers la monde ont dû recourir aux fonds des contribuables pour subsister, et d'autres ont simplement cessé d'exister.
Bien gérées, bien réglementées et bien capitalisées, nos banques n'ont pas été un fardeau pour les contribuables. Bien au contraire, elles continuent, durant cette période économique difficile, à accorder du crédit aux consommateurs et aux entreprises, y compris les petites entreprises. Il s'agit d'un avantage pour le Canada, qui entame sa reprise économique.
Sur la période d'un an qui s'est terminée le 30 juin 2009, les crédits accordés par les banques aux petites et moyennes entreprises, soit les fonds disponibles, ont augmenté de 1,2 p. 100, alors que les montants de crédits utilisés par les PME sont légèrement en baisse. Ainsi, les PME veillent à ce que le crédit leur soit disponible, mais ne l'utilisent qu'en cas de besoin.
La vaste majorité des clients d'affaires des banques sont de petites entreprises, et les banques ont continué de s'efforcer de répondre à leurs besoins. Une enquête réalisée auprès des PME l'été dernier a montré que 89 p. 100 des répondants pensent avoir une bonne relation de crédit avec leur banque, alors que seulement 4 p. 100 ont déclaré avoir une mauvaise relation. En outre, 90. p. 100 des répondants qui ont fait des démarches auprès de leur banque pensent que celle-ci est disposée à les aider à traverser la période de repli économique et plus de la moitié pensent qu'elle était absolument disposée à le faire. Seulement 5 p. 100 des clients des banques considéraient que l'accès au crédit constituait leur plus défi économique.
Bien que l'offre de crédit aux entreprises solvables demeure un point important, toutes les PME ne cherchent pas du financement en ce moment. En fait, l'enquête a révélé que 68 p. 100 des propriétaires disent qu'il est peu probable pour leur entreprise de demander du crédit additionnel dans les six prochains mois. Cela est probablement attribuable à la décision de retarder les projets d'investissement et d'expansion en raison de la récession.
Un point qui passe souvent inaperçu est le fait que les banques représentent environ le quart du marché du financement commercial au Canada. Il y a un an, au moment où les marchés financiers mondiaux étaient très fragiles, les banques canadiennes ont augmenté le niveau de crédit accordé aux entreprises afin de combler les lacunes créées par le réduction du crédit ou la disparition des autres prêteurs.
Malgré le fait qu'elles aient pallié certains manques sur le marché financier, les banques n'ont pu répondre à l'ensemble de la demande, et c'est là que le gouvernement est intervenu. Le gouvernement fédéral a reconnu cette réalité dans le budget de 2009 en introduisant le Programme de crédit aux entreprises, le PCE, qui procure au moins 5 milliards de dollars de prêts additionnels aux entreprises dotées de modèles opérationnels viables, par l'entremise d'Exportation et développement Canada et de la Banque de développement du Canada et en collaboration avec des prêteurs du secteur privé. Les banques collaborent activement à ce programme afin de trouver des solutions de crédit pour les entreprises solvables.
À la fin août 2009, le PCE avait accordé environ 2,7 milliards de dollars en financement à près de 6 000 entreprises, Une forte majorité de ces entreprises — 98 p. 100 d'entre elles, en fait — étaient des petites entreprises avec un chiffre d'affaires inférieur à 25 millions de dollars.
Il importe de faire remarquer que les PME cherchent auprès des banques une variété de solutions d'affaires, outre le financement. En effet, les banques s'efforcent continuellement d'offrir à leurs presque deux millions de PME clientes des conseils et des solutions novatrices en matière de services de dépôt, de gestion de la trésorerie, d'opérations de change et de planification de la relève. En fait, si on en revient à notre enquête, 92 p. 100 des répondants ont indiqué que le contact personnel avec leur banquier est le facteur le plus important dans la relation avec leur banque.
En conclusion, rappelons que les banques du Canada jouent un rôle essentiel dans les activités des petites et moyennes entreprises et sont fières de cette relation positive qui dure depuis bien longtemps. Nos banques demeurent ouvertes aux entreprises et engagées à fournir aux PME du crédit ainsi qu'une myriade d'autres solutions d'affaires. Les banques accueillent favorablement l'occasion de collaborer avec le gouvernement et les parlementaires afin de veiller au succès des entreprises canadiennes et de jouer un rôle clé dans la reprise économique du Canada.
Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de témoigner, monsieur le président.
Je serai heureux de répondre à vos questions.
:
Merci, monsieur le président.
Je suis heureux d'avoir l'occasion de vous parler d'un sujet aussi important.
Mon collègue, Richard Rémillard, de l'Association canadienne de capital de risque, a fait un excellent survol de l'état de l'industrie du capital de risque au Canada et a formulé quelques recommandations afin de corriger la situation. Pour ma part, je vous donnerai le point de vue d'un gestionnaire de capital de risque actif qui est confronté quotidiennement à ces défis, puisque nous travaillons avec nos sociétés de portefeuille actuelles pour les aider à croître et à prospérer dans le difficile climat économique. Sachez également que j'ai exploité à titre de propriétaire ma propre entreprise, qui recevait elle-même du capital de risque.
Je dirai tout d'abord quelques mots sur GrowthWorks. Outre le Québec et le Fonds de solidarité, nous sommes le plus important gestionnaire de capital de risque de détail, avec des actifs totalisant 750 millions de dollars. Nous sommes présents partout au pays, comptant des bureaux à Vancouver, Saskatoon, Winnipeg, Ottawa, Toronto, Fredericton, Halifax et St. John's. Nous avons investi les divers fonds que nous gérons dans environ 300 sociétés de portefeuille. Ces dernières années, nous avons acquis par fusion ou reprise les fonds suivants: le Fonds de relance économique, Capital Alliance, le Fonds de croissance canadien de la science et de la technologie, First Ontario Fund, le Fonds d'investissement des travailleurs et travailleuses, l'Ensis Fund et le Fonds de Découvertes Médicales Canadiennes, notre plus récente acquisition.
À GrowthFWorks, je suis principalement responsable de la gestion du GrowthWorks Atlantic Venture Fund, exclusivement axé sur les possibilités d'investissement dans le Canada atlantique. Cependant, mes observations et mon expérience de gestionnaire de fonds dans cette région s'apparente énormément à celles de mes collègues qui travaillent dans nos autres bureaux du Canada.
Avant d'aller plus loin, je devrais définir le terme « capital de risque de détail », aussi appelé fonds d'investissement de travailleurs. Contrairement aux fonds institutionnels, qui tirent leur capital de régimes de retraite, de sociétés ou de fonds de dotation, nous obtenons tout notre capital d'investisseurs indépendants, encouragés à investir par les crédits fiscaux fédéraux et provinciaux. Depuis le lancement de programme, dans les années 1980, plus d'un million de Canadiens ont investi au-delà de 12 milliards de dollars dans cette catégorie particulière d'actifs.
J'irai droit au but et dirai que notre principal problème au pays est actuellement le manque de capital pour investir dans les sociétés de portefeuille existantes et dans de nouvelles entreprises qui s'adressent à nous pour obtenir des investissements. Ce problème est suivi de près par le manque de partenaires consortiaux avec qui investir quand nous cherchons activement à effectuer des investissements. Par partenaire consortiaux, j'entends les autres gestionnaires de capital de risque qui nous aident à assurer la diligence raisonnable, partage les risques et contribuent aux fonds que nous pouvons investir. Le nombre de ces partenaires a chuté de manière spectaculaire ces dernières années, et ce, pour la même raison, soit le manque de capital à investir.
Ces problèmes ont de très graves conséquences sur les entreprises naissantes que nous appuyons déjà et les nouvelles sociétés qui cherchent du soutien. Le pire qui puisse arriver à un fonds de capital de risque, c'est de manquer de capital. Il est généralement convenu que quand nous investissons dans une nouvelle entreprise, la ronde initiale est exactement cela: la première d'une longue série d'étapes que parcourra l'entreprise sur la route de la réussite. Il est presque toujours certain que d'autres investissements suivront. Si nous ne pouvons continuer de les appuyer avec de nouveaux capitaux, deux issues sont évidentes: le fonds de capital de risque lui-même perdra de sa valeur ou s'affaiblira, ce qui entraînera une diminution notable du rendement pour les actionnaires, et, plus important encore, l'entreprise où l'on a investi manquera de capitaux à un moment crucial de son développement et cessera ses activités ou ira aux États-Unis pour tenter d'y trouver du capital. Voilà des situations que personne ne souhaite dans le secteur.
Existe-t-il une solution simple à ce problème? Eh bien, Richard a noté un certain nombre d'initiatives qui pourraient certainement permettre de relever les défis actuels. Afin de simplifier les choses, je m'intéresserai particulièrement à celle que le gouvernement fédéral devrait selon moi considérer, puisqu'elle concerne les fonds de capital de risque de détail.
Quand le programme de crédits fiscaux pour les investisseurs a été lancé au début des années 1980, le crédit fédéral était de 20 p. 100, auquel s'ajoutait le crédit provincial de 20 p. 100. La contribution annuelle se limitait à environ 5 000 $, soit le même niveau que les régimes d'épargne-retraite à l'époque. Le programme est devenu fort populaire dans les années 1990 et a permis de récolter des sommes considérables. Les deux ordres de gouvernement ont donc réduit leurs crédits fiscaux, qui s'établissent maintenant à 15 p. 100. La contribution annuelle n'a pas augmenté et est demeurée à 5 000 $, même si celle des REER est maintenant de plus de 20 000 $.
Les temps ont bien changé. Comme Richard l'a indiqué, il reste bien peu de joueurs dans le secteur, et rares sont ceux qui cherchent activement à trouver de nouveaux capitaux. Pour ceux qui poursuivent le combat, comme GrowthWorks, les sommes que l'industrie réussit à amasser sont dérisoires par rapport à celles que l'on réunissait dans les années 1990, exception faite du Québec. Je crois que nous récoltions à l'époque un milliard de dollars annuellement, alors que c'est environ 100 millions de dollars actuellement.
Pouvons-nous renverser cette tendance dans le secteur du capital de risque de détail et nous assurer de réunir des niveaux importants de nouveaux capitaux pour les entreprises qui voient le jour dans les domaines de la technologie propre, de la technologie de l'information, des sciences de la vie et de la fabrication de pointe et non dans des industries en perte de vitesse? Nous croyons que oui. Et la manière la plus simple d'y arriver, c'est de moderniser le programme existant en revenant au crédit fiscal fédéral de 20 p. 100, comme l'ont fait un certain nombre de provinces dans leurs budgets récents, et en portant à 20 000 dollars la limite de contribution annuelle pour qu'elle corresponde à celle des REER.
Si ces deux mesures étaient mises en place pour la saison 2010 de cotisation aux REER, nous sommes persuadés que l'industrie pourrait immédiatement amasser plus de capital, des fonds dont bénéficieraient rapidement les nouvelles entreprises, puisque l'infrastructure nécessaire est déjà là.
Merci.
Je me ferai un plaisir d'expliquer davantage ces aspects au cours de la séance de questions et réponses.
Au nom de mes collègues de la BDC, je vous remercie de m'avoir invité à me joindre à vous aujourd'hui.
[Français]
Nous sommes évidemment heureux de contribuer à vos délibérations.
Je vais vous faire part des observations de BDC quant aux défis auxquels font face les propriétaires de petites et moyennes entreprises. Par la suite, je partagerai avec vous ce que nous constatons dans notre portefeuille pancanadien, ce que les entrepreneurs nous disent. Afin de m'en tenir à l'économie traditionnelle, je n'aborderai pas expressément la situation des entreprises axées sur la technologie qui bénéficient de nos investissements en capital de risque, mais je serai néanmoins heureux de répondre à vos questions à ce sujet.
[Traduction]
De façon générale, les propriétaires de petite entreprise du Canada ont montré beaucoup de résilience au cours des derniers mois, mais ils ne sont pas encore au bout de leurs peines. Ils sont toujours soumis à des pressions, et les 12 prochains mois seront cruciaux.
Le portefeuille de la BDC représente plus de 13 milliards de dollars sous forme de financement, de capital de risque et de services de consultation qui bénéficient à plus de 28 000 clients. Nous nous efforçons de nouer avec nos clients des relations à long terme propices à leur réussite. Nous avons des clients dans la plupart des secteurs de l'économie et dans toutes les régions du pays. Nous croyons pour cette raison que notre portefeuille reflète, d'une façon générale, le marché global du financement des petites et moyennes entreprises, aussi appelées PME.
Notre portefeuille a changé depuis le début de la crise du crédit et de la récession parce que, comme il convient à notre rôle en tant que banque de développement du Canada, nous avons accru nos activités de prêt, les portant à des niveaux records. Au cours des six premiers mois de l'exercice en cours, les prêts ont grimpé de 54 p. 100. Une part importante des nouvelles activités de prêt résulte de notre participation au Programme de crédit aux entreprises du gouvernement fédéral, aussi appelé PCE, dont M. Campbell a parlé.
Dans le cadre de ce programme, la BDC travaille avec EDC et les institutions financières du secteur privé afin d'améliorer l'accès au crédit. Entre février et octobre, nous avons accordé 1,9 milliard de dollars de financement à des entreprises au titre du PCE. Je profite de cette occasion pour souligner que cette hausse des activités de prêt est le fruit d'une excellente collaboration entre les institutions financières et la BDC.
Nous acceptons depuis toujours plus de risques que les banques du secteur privé, et c'est notre rôle. Mais durant la dernière année, nous avons augmenté notre soutien aux entrepreneurs ayant des projets à haut risque. Notre volume de transactions à risque élevé a grimpé de 60 p. 100 par rapport à l'an dernier.
Lorsque nous examinons notre portefeuille pour trouver des indices montrant comment se portent nos clients, nous voyons des signes tangibles des pressions continues auxquelles j'ai fait allusion plus tôt. Par exemple, le taux de délinquance — c'est-à-dire le pourcentage de clients dont les remboursements accusent un retard de plus d'un mois — a atteint un nouveau sommet. Et le pourcentage de clients dont le compte a été déclassé à la catégorie des « prêts en difficulté », ce qui survient généralement après trois paiements consécutifs en souffrance, a atteint son point culminant cette année en octobre.
Il existe aussi d'autres indices, plus subtils, des pressions qui pèsent sur les entreprises. La proportion de prêts consentis à de nouveaux clients est plus élevée que l'habitude. Nous attribuons cela à la difficulté qu'ils ont à obtenir du crédit ailleurs. Lorsqu'ils sont à la recherche de crédit, beaucoup d'entrepreneurs comparent les offres. Cela signifie qu'un pourcentage relativement stable de clients potentiels — des entrepreneurs à qui nous avons fait une offre de prêt — se désistent et annulent leur demande, généralement parce qu'ils ont trouvé ailleurs une solution moins coûteuse. Ce taux d'annulation est présentement plus bas qu'il ne l'a jamais été. Cela nous indique que les entrepreneurs ont besoin de la collaboration étroite dans laquelle la BDC et les institutions financières du secteur privé se sont engagées en ces mois difficiles.
Voyons maintenant ce que nos clients nous disent. Leur rétroaction provient de deux sources: les conversations qu'ils ont régulièrement avec nos employés d'un bout à l'autre du pays, et nos sondages périodiques. Nos clients nous indiquent que leurs principaux défis sont la santé générale de l'économie et leur position concurrentielle sur le marché.
Signe d'optimisme important, trois clients sur quatre ont des projets d'investissement qu'ils envisagent de mettre à exécution. Ce n'est pas peu dire: 74 p. 100 de nos clients prévoient effectuer des investissements en capital au cours des 18 prochains mois. Ceci est très encourageant pour l'avenir.
En résumé, les messages que nous recevons de nos clients sont mitigés. Du côté négatif, nos taux de délinquance dénotent des signes de pression persistants. Nous voyons également des indices montrant que beaucoup d'entreprises doivent multiplier les démarches pour trouver le crédit dont elles ont besoin. Du côté positif, les entrepreneurs montrent de plus en plus d'optimisme et de fermes intentions d'investir dans leurs entreprises au cours des mois à venir.
Nous sommes relativement confiants quant à la rapidité de la reprise, mais croyons aussi que nous arrivons à un carrefour crucial. Un plus grand nombre d'entrepreneurs doivent convertir leur optimisme et leurs bonnes intentions en actions concrètes. C'est ce dont le Canada a besoin en ce moment pour accélérer la relance. Peu importe où nous en sommes dans le cycle économique, la prospérité future du Canada dépend, dans une large mesure, d'entrepreneurs qui n'ont pas peur de prendre des risques et de retrousser leurs manches. Nous avons besoin d'eux pour créer davantage d'entreprises capables de s'adapter et de se mesurer à la concurrence mondiale.
Sachez enfin que la BDC est là pour aider ces entrepreneurs, toujours en collaboration avec les autres institutions financières. Comme vous avez pu le voir dans l'étude de Statistique Canada que mon collègue Jérôme Nycz vous a transmise cet été, les résultats sont éloquents: les clients de la BDC ont surclassé les entreprises non clientes en ce qui concerne la croissance des revenus et de l'emploi et le taux de survie. Et les clients qui ont utilisé à la fois notre financement et nos services de consultation ont obtenu des résultats encore plus probants.
Nous sommes fiers d'apporter une aide concrète aux PME.
Si vous avez des questions, nous y répondrons avec plaisir. Merci.
Je vous remercie tous de comparaître aujourd'hui et d'avoir fait un exposé. Nous vous sommes gré de nous accorder du temps et de venir nous informer. Merci encore.
La question que nous examinons, l'accès au capital, est très importante, et nous avons l'impression qu'elle constitue un problème pour les entreprises canadiennes. Et je crois, comme chacun d'entre vous l'a indiqué, que ce problème persiste. Il ne va pas disparaître comme par magie du jour au lendemain.
J'aimerais commencer par poser quelques questions sur le capital de risque, si vous le voulez bien.
Messieurs Rémillard et Hayes, je vous remercie d'avoir été franc en nous faisant part de certains des problèmes qu'il faudrait selon vous résoudre au pays pour assurer la vitalité du marché du capital de risque. Comme j'ai déjà travaillé dans le secteur de la haute technologie, le financement et les difficultés et défis qu'il présente ne me sont pas inconnus.
Deux problèmes se posent à cet égard. Il faut d'abord voir comment nous pouvons nous assurer que le Canada a un environnement qui attire le capital de risque. Je crois, monsieur Hayes, que vous nous avez donné quelques pistes de solution pour attirer davantage d'argent par l'entremise d'un fonds d'investissement de travailleurs. Comment pouvons-nous attirer et développer du capital de risque plus effectif, pas seulement aujourd'hui, dans l'avenir également?
Nous nous penchons sur certains des défis qui se présentent à l'heure actuelle. Je sais que vous avez parlé du groupe d'experts de M. Wilson et du fait que nous devrions constituer un groupe d'étude sur la commercialisation et examiner des options sur le plan du capital de risque. Pourriez-vous nous dire ce que nous devrions faire, à votre avis, pour encourager le renforcement du marché du capital de risque? M. Hayes nous a donné quelques indications de ce qu'il faut faire immédiatement concernant le fonds d'investissement de travailleurs.
Ensuite, pourriez-vous nous parler de la question de l'investissement providentiel? Je sais que votre spécialité est le capital de risque, mais je crois que les investisseurs providentiels sont les premiers à prendre des risques, et c'est là un point faible au Canada.
Je m'adresse à vous, puis je poserai quelques questions aux banques.
:
Je vous remercie beaucoup, madame Coady.
Je suppose que de notre point de vue, on ne peut régler tous les problèmes d'ici demain d'un simple coup de baguette magique. Il faut absolument adopter une approche exhaustive qui couvre en même temps, presque simultanément, tout un éventail d'aspects ou de problèmes. Mais la racine du mal, le coeur même du problème, c'est que l'industrie du capital de risque a besoin de plus d'argent pour pouvoir le recycler, gérer activement des sociétés — une activité à valeur ajoutée — et réaliser ensuite des retraits vraiment valables.
À court terme, certains aspects de la situation échappent peut-être au contrôle de bien des intervenants. C'est que les marchés du capital de risque, dans leur état actuel, sont particulièrement friands des premiers appels publics à l'épargne de sociétés technologiques. Or, il n'y en a eu aucun jusqu'en octobre de cette année et un seul en 2008. Il faut qu'il y ait certains retraits dans l'industrie pour qu'elle puisse afficher un certain rendement d'investissement afin d'attirer des fonds dans ses coffres.
Pour ce qui est des investisseurs providentiels, je crois qu'ils jouent un rôle important et précieux dans ce que nous avons tendance à appeler l'écosystème du financement de risque entrepreneurial. Bon nombre d'investisseurs providentiels ont des relations officielles, parfois officieuses, avec des fonds de capital de risque, surtout si ces derniers s'intéressent particulièrement aux entreprises qui en sont à leurs premiers pas. Par exemple, certains génies qui ont développé une idée peuvent manquer de fonds et être de piètres gestionnaires. Bien souvent, après s'être adressés à leurs proches, ils rencontreront un investisseur providentiel. Nous travaillons en étroite collaboration avec ces derniers dans ce que nous considérons comme une relation symbiotique. Même s'il existe toujours des exceptions à la règle, ces investisseurs tendent à investir des sommes plutôt modestes aux étapes préliminaires de développement.
:
Il ne me reste qu'une minute. Je veux donc poser deux brèves questions, dont une à M. Hayes.
Je peux comprendre que vous deviez attirer plus d'argent dans votre fonds d'investissement de travailleurs. Je sais qu'un problème se pose. On est confronté à des défis, particulièrement à l'échelle régionale, et je le sais, car je viens du Canada atlantique. Vous nous avez donné quelques bonnes idées, je suppose, pour nous permettre d'aider les fonds d'investissement de travailleurs.
Ce qui me préoccupe, bien sûr, c'est que lorsque nous avons étudié la situation — et je suis originaire de St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador, où vous avez un bureau, selon ce que vous nous avez dit —, nous avons constaté que la communauté locale ne s'implique pas beaucoup. Comment pouvons-nous nous assurer que le capital de risque est investi dans toutes les régions du pays? La situation est particulièrement difficile à cet égard dans le Canada atlantique.
Monsieur Campbell, pourriez-vous, je vous prie, nous parler de la Loi sur les prêts aux petites entreprises. très brièvement, car mon temps est presque écoulé.
Merci.
:
Sachez tout d'abord que notre société a réalisé une analyse que nous avons incluse dans un rapport que j'ai fait parvenir au greffier. Cette étude devrait bientôt vous être remise.
Les gouvernements et le secteur privé dépensent des sommes colossales — près de 30 milliards de dollars annuellement en recherche-développement —, mais il semble que par la suite, il y ait de graves lacunes lorsque vient le temps de commercialiser tous ces travaux.
Voilà qui n'aide pas le fonds d'investissement de travailleurs. Ce que je veux dire, c'est que le fonds de capital de risque de détail n'est qu'un mécanisme. Nous tentons d'améliorer et d'accroître l'offre en capital de risque. Selon nous, c'est une manière très rapide d'y parvenir.
Ce problème ne se limite pas au Canada atlantique. Selon les statistiques de Richard, les chiffres ont été désastreux au troisième trimestre de 2009, et ce, dans l'ensemble du pays, et pas seulement dans la région de l'Atlantique.
:
Je suis d'accord avec tout ce que Thomas vient de dire. Mais je vais examiner la situation sous un angle légèrement différent: la perspective macroéconomique.
Lorsque nous sommes entrés en récession, nous étions d'avis que bon nombre de petites et moyennes entreprises sur le marché — et nous ne parlons pas ici de nouvelles entreprises ou de clients à la recherche de capital de risque — se trouvent dans une bien meilleure situation qu'au cours des récessions précédentes. Leurs bilans et leurs niveaux d'endettement sont en meilleur état, et elles sont plus disciplinées sur les plans du financement et de la gestion de la trésorerie.
Par conséquent — et je ne nie pas l'existence de problèmes à certains égards —, de nombreuses entreprises ont supporté relativement bien les pressions de la récession. Elles ont su relever les défis qui se présentaient pour les transformer en occasions et ont fait preuve d'une discipline de fer pour gérer les coûts et trouver des moyens de renforcer leur efficacité — car elles éprouvent des difficultés avec certains clients qui leur font faux bond — afin de percer de nouveaux marchés.
Tout n'est pas noir à l'horizon. Les petites entreprises font preuve de vitalité au coeur de cette récession. En fait, les statistiques indiquent que de nouvelles petites entreprises voient le jour.
Mais pour le 20 p. 100 du marché qui exporte, le gros défi sera de voir ce qui se passera aux États-Unis. Ce marché se rétablira-t-il? Les consommateurs américains se remettront-ils à dépenser? Les entreprises canadiennes qui dépendent du marché national ont, d'une certaine manière, été moins malmenées. Je crois donc que bien des choses dépendent de ce qui se passera chez nos voisins du Sud.
:
Vous parlez d'entreprises qui s'en sont le mieux sorties, qui sont le mieux organisées, qui ont un bon niveau de production ou de resserrement. Parlez-vous des grandes ou des petites entreprises?
En 2007, le prix du dollar connaissait une hausse fulgurante, tout comme le prix du pétrole. Cela a eu pour conséquence que toutes les entreprises ont eu recours au juste-à-temps. À un certain moment, il n'y a plus de place à l'amélioration et on ne peut plus sabrer dans les coûts. Les entreprises que vous citez ne devraient pas être de nouvelles entreprises, mais plutôt des entreprises bien établies.
Qu'arrive-t-il aux nouvelles entreprises qui ne peuvent pas faire de resserrement? Ces gens ont-ils fait faillite ou ont-ils essayé de trouver d'autres crédits? Quand M. Hayes parle de nouveaux crédits — au Québec, on parle du Fonds de solidarité FTQ —, serait-il probant de dire que le plafond de 5 000 $ devrait être haussé et que l'on devrait remettre à 20 p. 100 ce qui touche aux deux ordres de gouvernement afin d'injecter directement du capital de risque dans les entreprises?
J'aimerais connaître votre opinion sur ces deux questions.
:
Il y a beaucoup de questions, et je crois que mon collègue M. Halde voudra probablement répondre à certaines d'entre elles.
Je crois que l'on peut difficilement généraliser en ce qui concerne les petites et les grandes entreprises. J'ai trouvé fort instructifs les témoignages que Manufacturiers et exportateurs du Canada et la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante ont fait lundi. Leurs points de vue sont diamétralement opposés, ce qui me semble logique. Je crois que ce qui compte, ce n'est pas tant la taille des entreprises, même si ce facteur a effectivement une certaine incidence, que le fait qu'elles sont vulnérables à la fluctuation du dollar ou plus tributaires du marché national.
Comme vous le savez probablement, la question du dollar est une arme à double tranchant. D'un côté, le dollar s'apprécie depuis plusieurs années maintenant. Les entreprises se sont adaptées de leur mieux à la force du dollar, ce qui les a aidées à mieux accuser le coup quand la récession a frappé. Par contre, la situation est évidemment bien plus facile aux côtés des importations de machinerie, de la productivité et de l'investissement en capital aux fins de renforcement de l'efficacité.
Ce n'est donc pas tant la taille de l'entreprise qui compte que la place qu'elle occupe dans l'économie.
Jean-René?
:
Merci, monsieur le président et merci aux témoins d'être ici aujourd'hui.
La réunion est intéressante parce que toutes vos organisations semblent très similaires — de par leur nom et leurs activités — mais j'ai l'impression que votre clientèle est très différente, à bien des égards.
Quelqu'un en a parlé. Divers commentateurs dans le monde ont parlé, de fait, de la vigueur relative du Canada comparativement au reste du globe. À propos de la fin de ce ralentissement économique d'envergure mondiale, je sais que l'OCDE a récemment dit dans le cadre du Forum économique mondial que le Canada serait l'un des deux pays industrialisés à sortir de la crise en position plus compétitive que quand il y est entré. Je pense que l'autre pays, c'est l'Australie. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu ce que nous faisons comme il faut? Je ne fais pas cela pour forcer les témoins à jeter des fleurs au gouvernement, bien que cela fait parfois du bien.
Quelle leçon pouvons-nous tirer de ce que nous faisons correctement? Un témoins a parlé, par exemple, du programme de la recherche scientifique et du développement expérimental. Nous avons apporté à ce programme des changements plutôt positifs, je pense, mais on nous en a demandé d'en faire peut-être plus. Des témoins, dans le cadre de diverses études que nous avons effectuées, nous ont parlé de ce qui pourrait être fait pour améliorer le programme de RS et DE.
Que faisons-nous de bien, et quelle leçon pouvons-nous en tirer pour être encore plus solides?
:
Je dirais la même chose que M. Halde. Nous pensons que le Programme de crédit aux entreprises est un bon programme. Nous cherchions, nos deux organisations, un moyen de mieux collaborer avant que la récession ne frappe, et je pense que le Programme de crédit aux entreprises a certainement amplifié et approfondi ces rapports.
Ce que je dirais aussi — et je ne m'exprime maintenant que pour les banques — comme je l'ai dit dans mes observations, c'est que notre industrie est entrée dans la récession bien gérée, bien capitalisée, mais aussi bien réglementée. Je pense que notre perception, particulièrement dans les secteurs axés sur la stabilité du système, la garantie de liquidités dans le système, c'est que le gouvernement a à la fois ciblé et restreint ses activités comme il le devait, je suppose que c'est le terme exact, dans le sens où on axe des mesures sur un point précis, comme un rayon laser, là où le marché présente des problèmes. Pas les banques; les banques étaient solvables. Parfois, le marché ne fonctionnait pas très bien. Si on jette un regard sur le monde entier, il y a eu une assez belle cohésion entre les autorités du globe. Mais si on regarde ce qui se passe aux États-Unis et au Royaume-Uni, où il y a eu un problème très grave avec les banques, le degré d'intervention, l'énormité de l'intervention, c'est tout autre chose que notre situation. Donc, le gouvernement, je pense, a très bien su cibler son intervention, et je pense que c'est ce genre de démarche très équilibrée, désormais, qui sera la bonne.
:
Je vous remercie beaucoup pour cette question.
Je suis heureux que vous ayez parlé du rapport du Forum économique mondial. Celui qui a été diffusé plus tôt cette année, je pense que c'était à la fin de septembre, situait le Canada en 9e place au titre de la compétitivité à l'échelle mondiale, et ce n'est pas si mal sur 140 ou 150 pays. Au plan du capital de risque, par contre, nous n'étions plus en 9e, mais en 18e place. L'exposé ou le texte dans ce rapport, que vous pouvez vérifier, qualifie ce fait de désavantage concurrentiel pour le Canada.
Ce n'est pas une question de gouvernements qui font les choses de travers ou comme il faut. Je pense que le clou, vraiment, c'est qu'il faut faire plus de ce qu'il faut. Je me fais l'écho de mon ami Tom, ici. L'investissement de la BDC dans le capital de risque a augmenté, c'est très positif, et la situation que nous affrontons est suffisamment difficile pour que je sois à cette table, à vous dire que ce qu'il nous faut, c'est que le gouvernement fasse plus.
J'ai une dernière observation à faire. Que fait le gouvernement comme il faut? L'un des éléments absolument fondamentaux du succès du capital de risque, c'est une base de haute technologie que l'on peut exploiter, dans les universités, d'autres établissements d'enseignement postsecondaire, les hôpitaux de recherche — à vous de choisir. Selon la manière dont on fait le calcul, nous dépensons 9 ou 10 milliards de dollars par année. Le problème, c'est la constipation. Tout est là, et rien ne parvient jusqu'aux compagnies. C'est ça, le problème.
:
Je dirais que ce que l'on peut expliquer de deux manières est ce que fait le gouvernement, peut-être. Premièrement, le gouvernement investit, concrètement. Ce n'est pas prêter de l'argent aux sociétés de capital risque, c'est investir dans les sociétés de capital risque. En tant qu'investisseur, il peut légitimement s'attendre à un rendement de son investissement. C'est ce à quoi s'attendent le gouvernement de l'Ontario, et ceux du Québec et de l'Alberta qui ont récemment créé de plus petites entités.
Deuxièmement, de quoi est-ce qu'il retourne vraiment? La réponse, c'est que si nous nous préoccupons des emplois de demain, des emplois dans les secteurs en croissance, des emplois à valeur ajoutée, nous devons financer nos industries de haute technologie. Si vous supprimez le capital de risque, il n'y a pas de financement. C'est aussi simple que cela.
Pour revenir à ce que disait Siobhan tout à l'heure, l'industrie, au 3e trimestre de 2009, n'a récolté que 65 millions de dollars dans tout le Canada. C'était un million en Ontario, 32 millions en Colombie-Britannique et 32 millions de dollars au Québec. Cela ne suffit pas pour financer un grand nombre de compagnies. Actuellement, aujourd'hui, comparativement à il y a cinq ans, nous finançons moins de 40 p. 100 des compagnies que nous financions alors, parce que l'argent n'est plus là.
:
La situation, dans le secteur automobile, comme vous et tout le monde autour de cette table le savez, a simplement été une séquence extraordinaire, quasi cataclysmique, d'événements survenus au cours des 12 ou 18 années et mois.
Plus précisément, en ce qui concerne les concessionnaires, j'aurais deux ou trois choses à expliquer, ici, en contexte. Pour ce qui est de financer les clients particuliers, le gros du marché du financement était détenu par les compagnies financières captives des concessionnaires. Ce sont elles, les compagnies qui ont été durement touchées par la crise financière. Elles dépendaient de la titrisation dans le marché du papier commercial, qui s'est tout simplement écroulé. Alors une grande partie du problème pour les concessionnaires, tout à fait à part des problèmes qu'ils ont eus avec leurs sociétés mères et leurs fournisseurs, c'est que les principaux bâilleurs de fonds étaient en crise.
Les banques n'avaient qu'une toute petite part de ce marché. Comme vous le savez, les banques ne peuvent pas assumer le financement de baux financiers. Nous pouvons octroyer des prêts. Je pense que comparativement à la même période l'année dernière, nos prêts aux concessionnaires et par leur intermédiaire sont en hausse.
Notre devise, c'est que nous prêtons aux gens qui sont en mesure de rembourser leur emprunt. Nous aimerions pouvoir saisir une plus grande part du marché. Néanmoins il y a eu de grandes perturbations, que n'ont pas provoquées les banques mais d'autres fournisseurs de financement qui, très franchement, se sont fait tirer le tapis de sous les pieds par le marché.
:
Je vous remercie de poser cette question.
Je pense que plusieurs choses sont survenues. Tout d'abord, il y a eu des fusions, tant dans le secteur de la vente au détail que dans d'autres secteurs. Deuxièmement, certains joueurs ont carrément retiré leurs billes du jeu, et des joueurs qui étaient auparavant actifs ne sont plus de la partie.
Troisièmement, ce qui catalyse une grande part de l'activité, c'est l'impossibilité pour les agents de financement de trouver des capitaux. Si on prend un fonds de capital-risque typique qui est en train de constituer un fonds de 100 millions de dollars avec les régimes de pensions, des investisseurs institutionnels, il peut aller frapper à cinq ou six portes au Canada. Si tout le monde dit non, il n'a nulle part où s'adresser à part en-dehors de nos frontières, et c'est un processus qui peut prendre bien plus d'un an. Aussi, il faut avoir un bureau et une infrastructure, tout pour pouvoir mener des affaires tout en continuant d'amasser des capitaux.
Alors je connais plusieurs agents de financement qui ont simplement abandonné la partie. Ils ne peuvent trouver de capitaux et retirent leurs billes du marché. Ils gèrent leur portefeuille à la baisse, et quand ils font des bénéfices, ils réduisent leurs activités.
Mes homologues des États-Unis prédisent une contraction de l'ordre de 25 à 30 p. 100 dans le monde du capital-risque américain. Ils sont aux prises avec certains des mêmes problèmes que nous. Ces problèmes ne sont pas aussi aigus et ne se sont pas manifestés aussi tôt, mais c'est ce qui se prépare pour eux.
:
Puis-je ajouter quelque chose ? Je suis tout à fait d'accord avec la description qu'a donnée Richard de la situation de l'industrie. Nous avons eu une longue suite de piètres résultats des compagnies, d'où de piètres résultats pour les fonds de financement et d'où la réduction de la capacité d'amasser de nouveaux fonds. C'est là que nous entrons dans un cercle des plus vicieux.
Il y a une chose qui arrive et qui me semble bonne, probablement la seule lueur positive à l'horizon, très franchement, c'est que les fonds de financement seront désormais beaucoup plus importants. Le capital de risque est encore une industrie relativement jeune au Canada, comparativement aux États-Unis. S'il y a une chose que nous avons apprise avec tout cela, c'est que ce n'était pas une bonne idée que de créer tout un tas de petits fonds de financement, parce qu'alors on n'a pas le poids financier nécessaire pour investir de très gros montants dans une compagnie et on n'a pas les moyens de s'adjoindre la bonne expertise, alors on répartit beaucoup d'argent en tout plein de petits montants.
Je pense que ce que tout le monde dit aujourd'hui, c'est que oui, amassons plus d'argent, mais faisons-le dans des fonds de financement beaucoup plus importants et beaucoup plus capables. Je pense que ce sera avantageux pour l'industrie.
:
Merci, monsieur le président.
Je ne veux pas être le nuage qui assombrit tout, mais si je n'avais pas vécu cette dernière année et j'arrivais à cette réunion, je ne penserais pas que nous avons été en récession. Je penserais que le crédit est à la disposition d'à peu près quiconque le demande. J'aurais bien voulu que certains d'entre vous aient eu l'occasion de passer un moment à mon bureau de circonscription et de recevoir le nombre d'appels que j'ai reçus. Je peux vous jurer que l'intégralité de ces 5 p. 100 de clients des banques trouvaient que l'accès au crédit était leur plus gros problème. On aurait dit que tous, les 5 p. 100, ont appelé mon bureau.
Monsieur Campbell, je ne peux pas résister à l'envie de vous poser la question suivante. Vous dites que plus de 90 p. 100 des répondants qui se sont adressés à leur banque pensaient que leur banque était disposée à les aider à traverser cette période, et plus de 50 p. 100 pensaient que leur banque était absolument disposée à le faire. J'aimerais bien savoir à combien de personnes vous avez posé ces questions, quand vous parlez de 90 p. 100 des répondants.
Mais plus important encore, j'aimerais que vous conciliez cette affirmation avec ce que dit le rapport du BDC à la page 3, c'est-à-dire:
La proportion de prêts consentis à de nouveaux clients est plus élevée que d'habitude. Nous attribuons cela à la difficulté qu'ils ont à obtenir du crédit ailleurs.
Il y a quelque chose dans votre rapport qui contredit tout simplement mon expérience. Bon nombre de mes électeurs suppliaient pour avoir du crédit, et bon nombre se sont fait dire de ne pas même se donner la peine d'en demander parce qu'ils ne l'obtiendraient pas. De fait, on a même voulu augmenter le taux d'intérêt de certains de 1 p. 100, en pleine récession. Il me faut une réponse à cela.
Cette question en comporte en fait trois ou quatre.
Tout d'abord, notre sondage, en passant, a été mené par PricewaterhouseCoopers et par Grant Thornton. Ils ont fait des sondages auprès des PME du Canada et ont obtenu généralement le même résultat, c'est-à-dire que généralement parlant, environ 90 p. 100 des petites entreprises du pays ont déclaré que les questions de financement — l'accès au crédit — ne constituaient pas des contraintes, ne restreignaient pas leur capacité de réaliser leur plan d'affaires.
Pour ce qui est de notre propre sondage, il a été mené par Strategic Counsel, et il est statistiquement valable. C'était un sondage des PME. L'échantillon était de 200 petites entreprises, et il avait la précision habituelle, soit 19 fois sur 20, et tout le reste. Mais d'autres études ont donné les mêmes résultats.
Pour ce qui est de ce que vous avez entendu de vos électeurs à Guelph — où je vis, en passant — ce que nous constatons, c'est que si on regarde l'intégralité du marché financier, les banques n'en constituent qu'environ un quart. Nous entendons toujours « je ne peux obtenir de crédit ici ». Quand nous poussons un peu plus loin, nous constatons qu'il y a un éventail de fournisseurs qui, dans la dernière année, ont soit quitté le marché ou ont réduit considérablement leurs activités de financement. Une compagnie américaine très connue déclare dans son site Web qu'elle ne fait désormais plus d'affaires au Canada.
Il y a deux exemples d'entités étrangères qui font ce qu'on pourrait appeler des prêts opportunistes: elles sont arrivées sur le marché canadien quand le climat y était favorable, et quand les problèmes se sont manifestés dans leur propre pays, elles ont littéralement abandonné leurs clients.
Tout revient en fait à ce que les banques soient ouvertes pour les affaires et pour prêter à des clients solvables, et à ce qu'elles continuent de soutenir leurs clients. Mais la question, ici, c'est qu'on a une situation où, si on a un bon client et celui-ci éprouve des difficultés, nos banques disent deux choses. Elles disent par pitié, venez nous parler. Le pire que puisse faire une entreprise, c'est de garder le silence et tenir la banque dans l'ignorance de la situation. Nous poussons nos clients à venir nous parler. Si vous avez un problème, voyons ce que nous pouvons y faire. Il y a tout un tas d'outils dans la trousse, ici, pour restructurer la dette et restructurer les paiements. Ce que la banque cherchera à déterminer, c'est si votre bilan affiche une certaine vigueur, une certaine résilience, si vous connaissez la nature de vos problèmes et si vous avez un plan pour les régler. La banque veut vous aider. Cela vous semblera une banalité, mais nous réussissons quand nos clients réussissent. Personne ne veut dire « adieu, voici la porte ».
Cela étant dit, bien sûr, nous sommes en récession. Les problèmes sont réels. Il y a des compagnies dont le modèle d'entreprise, très franchement, a échoué et ne fonctionnera pas. Elles ont des dettes par dessus la tête. Si un client se noie dans ses dettes, le fait de lui en donner plus reviendrait à lui jeter une ancre plutôt qu'une veste de sauvetage. Il y en a, de ces tristes situations, c'est certain. La question qui se pose, c'est est-ce que nous pouvons aider cette compagnie à se rendre jusqu'au prochain jalon de son évolution?
Je ne dis pas, monsieur, que tout client est solvable. Ce que je dis, c'est que si un client a des problèmes, il devrait en parler à sa banque.
:
Merci, monsieur le président.
Je remercie les témoins d'être ici.
Pour mettre les choses au clair, monsieur Campbell, vous avez fait allusion à ces autres prêteurs dans l'industrie automobile. On entendait dire à une certaine époque qu'il suffisait de pouvoir se tenir debout et respirer pour obtenir des prêts de certaines de ces institutions. Cela a donc été de la bonne administration. C'est une bonne administration qui vous a mis dans la position où vous êtes aujourd'hui, et je vous en félicite.
On ne dit pas assez dans ce pays que nous avons des institutions qui, tout d'abord, n'oublient pas que l'argent qu'elles manipulent est l'argent des clients. Je m'attends, si j'épargne de l'argent, à pouvoir aller n'importe quand à votre banque et sortir mon argent. Je ne veux pas entendre parler des trop grands risques que vous avez pris. Alors je vous applaudis pour ce que vous avez fait.
:
Je pense qu'il y a peut-être deux questions en une.
Tout d'abord, au sujet de l'histoire, la comparaison avec cette récession, où nous sommes dans la récession, et si nous en sortons. Pour paraphraser ce que j'ai dit tout à l'heure — et je laisserai ensuite la parole à M. Halde, parce que je suis sûr qu'il aura quelque chose à dire aussi — à bien des égards, en ce qui concerne cette récession, on a beau dire « cette fois-ci, ce sera différent »... et bien, ce ne sera pas différent, cette fois. Il y a des cycles économiques.
La chose sur laquelle j'insisterais, c'est que bien que nous constatons que les fabricants éprouvent des difficultés — mais pas de manière généralisée, parce qu'il y a des points forts différents — notre industrie, en entrant dans cette récession, était plus forte qu'au début de récessions antérieures, et elle était certainement plus diversifiée. Mais il y a eu aussi une plus grande discipline des PME dès le départ aux plans de la santé fiscale, la santé financière, la santé du bilan. Alors à ce stade de la récession, nous ne voyons pas de quantités énormes de faillites. Comparativement aux récessions antérieures, il y a eu remarquablement peu de faillites. Et c'est étonnant. Le nombre de nouvelles PME est en hausse, en fait. Maintenant, on peut prétendre que c'est parce que des chômeurs deviennent des travailleurs indépendants, mais nous constatons néanmoins une hausse de leur nombre.
Quant à savoir la suite des événements, je pense qu'elle dépend en grande partie de deux choses. Elle dépend beaucoup de la résistance continue des ménages canadiens. Les bilans des ménages canadiens sont nettement meilleurs que ceux des ménages américains. Nous pouvons continuer de dépenser. Notre taux de chômage, bien qu'il soit toujours plus élevé qu'aucun de nous ne le souhaiterait, est nettement meilleur qu'aux États-Unis. Alors je pense que l'élément de la demande intérieure maintiendra à flot les petites entreprises, qui sont centrées sur l'économie nationale. Le problème, c'est ce qui va se passer aux États-Unis.
Vous avez parlé — et je vous remercie infiniment pour vos observations — de la prudence des prêts au Canada. Les États-Unis paient encore le prix de leur imprudence au plan des prêts, et le renouvellement des prêts hypothécaires à taux variable sur ce marché l'année prochaine aura pour effet de faire perdurer la crise. Alors c'est là que je peux voir les problèmes persister.
Jean-René?
:
Permettez-moi d'aborder la question sous un angle légèrement différent. Je pense que les PME, pendant cette récession, ont fait preuve d'une résistance formidable. Je dois vous dire que nos pertes sont inférieures à ce que nous avions anticipé, et c'est tout un avantage. Je suis d'accord avec M. Campbell. Je pense que les organisations se sont concentrées plus rapidement sur les rentrées de fonds, elles ont tiré des leçons, et elles étaient en meilleure position financière quand la situation s'est détériorée.
Je pense que nous sommes en meilleure position, probablement, que ce à quoi nous nous attendions tous, franchement, il y a 15 mois. Nous ne sommes pas encore sortis du bois, comme je l'ai dit, parce qu'il y a toujours une espèce de période de latence, et il y a encore des compagnies qui ne tiennent qu'à un fil, et pour ce qui est de savoir si elles s'en sortiront, seul le temps nous le dira.
J'aimerais peut-être ajouter quelques commentaires, au sujet de la BDC. Je ne veux pas faire de publicité, mais c'est pour essayer d'expliquer la différence entre les institutions financières plus traditionnelles et nous. Nous avons un plus grand appétit pour le risque. Même si nous recherchons aussi des entreprises solvables, nous ne tirons pas un trait exactement au même point que les autres institutions. L'une des choses que nous essayons de faire, pour aider les entrepreneurs à traverser des périodes difficiles... nous avons permis à bien des entrepreneurs de reporter leur paiement de capital pendant un certain temps — nous avons offert cette possibilité à 7 000 de nos 29 000 clients; ne payez que les intérêts, pas le capital, nous le reporterons, recommencez à le payer dans six mois. Cette mesure a énormément aidé à préserver le fonds de roulement de ces entreprises.
L'autre chose que nous faisons, c'est qu'il y a bien des gens qui, quand ils veulent acheter de l'actif à long terme, éprouvent de la difficulté à obtenir un prêt à long terme pour cet achat, et ce qui arrive, c'est qu'ils empiètent sur leur capital de roulement s'ils ne trouvent pas le juste équilibre entre l'actif à long terme et la créance à long terme. Alors nous nous concentrons vraiment sur l'offre de prêts à long terme à ces entrepreneurs.
Je vous remercie.
:
Je ne savais pas que je me retrouverais dans mon domaine 24 heures après avoir été assermenté député.
Je veux saluer M. Halde, en particulier, puisque nous avons effectué des transactions ensemble, dans une vie précédente. Au fait, celle à laquelle je pense avait été profitable. J'ai été investisseur à la Caisse de dépôt et placement ainsi qu'à la Société Générale de financement, puis directeur financier, notamment pour une entreprise qui disposait de beaucoup de liquidités pour la croissance et pour d'autres qui étaient particulièrement mal équipées pour faire face à la tempête.
Monsieur Campbell, nous allons faire en sorte que vous ne demandiez pas de remboursement de capital. En effet, vous ne voulez pas vous retrouver avec les clés de l'entreprise. C'est clair. Les coûts, les frais, les clauses restrictives, tout ça s'empile sur les épaules de l'entrepreneur. On lui dit de ne plus faire ceci ou cela. Pour ce qui est de votre mode de rendement, la marge des taux d'intérêt n'est plus très élevée. Or n'a-t-on pas imposé des frais à outrance pendant cette crise? Ce mouvement de balancier n'est-il pas allé un peu trop loin? Le travail de l'entrepreneur, c'est sa survie. En définitive, M. Halde disait que 75 p. 100 des gens voulaient réinvestir. Heureusement, puisque ce sont des entrepreneurs. Ils voient la vie en rose, mais ils doivent travailler beaucoup.
On dit que l'entrepreneur ne peut rien entreprendre sans d'abord demander la permission. Je vous écoute et je me dis que c'est presque de l'acharnement. Dans une situation comme celle qu'a connue l'économie canadienne, on serre peut-être un peu trop la vis. Elle finit par casser. N'y a-t-il pas moyen d'adopter une approche plus entrepreneuriale, en ce qui a trait aux banquiers?
Par la suite, j'aimerais revenir sur la question du capital de démarrage.
:
Je regrette, mais je vais devoir m'exprimer en anglais.
[Traduction]
Il y a plusieurs éléments — les coûts, les clauses restrictives et l'esprit d'entreprise. Pour ce qui est des coûts, il est vraiment important de prendre du recul et de mettre tout cela en contexte. Peut-être mon collègue, Marion Wrobel, pourra-t-il en parler aussi.
Si vous remontez pas plus tard que, disons, août 2007, le taux préférentiel était à 6,25 p. 100. Il est actuellement à 2,25 p. 100. Maintenant, prenez le taux préférentiel et il est rajusté à la hausse ou à la baisse. Si vous avez un prêt hypothécaire résidentiel, c'est la meilleure situation qui soit. Mais même avec les ajustements, les taux d'intérêt réels pour les entreprises et les consommateurs sont plus bas qu'ils ont été depuis de nombreuses années. La Banque du Canada, par exemple, fait régulièrement un sondage de ce qu'elle appelle les taux d'intérêt réels des entreprises. C'est un taux pondéré, mais il donne une idée d'où en sont les choses. Dans son dernier rapport d'octobre, le taux d'intérêt réel des entreprises au Canada se situait à environ 3,33 p. 100.
Quand vous regardez la question des coûts, le prix des prêts, il faut tenir compte de deux choses. Comme vous le savez, l'une est le coût du financement pour les banques. Comme vous l'avez dit, comparativement à l'année dernière, quand les coûts ont été pris de folie, la situation est revenue à la normale, mais elle n'est pas encore à ce qu'on pourrait appeler la norme historique. Nous finançons bien de nos activités, nous essayons de l'égaler, comme vous le savez, nous essayons de le financer au moyen du marché des titres, et c'est variable. Cela n'a pas été pris en compte.
L'autre chose qu'il faut prendre en compte, comme toujours, mais surtout en période de récession, c'est l'élément du risque. Quand des pertes sont enregistrées sur les prêts ailleurs dans notre industrie, où les prêts ne sont pas remboursés, elles ont des répercussions sur les prix pour tout le monde.
Alors c'est ce que nous coûte le financement, c'est le risque des clients particuliers, et c'est le contexte opérationnel, pour ce qui est des pertes sur les prêts.
Marion, avez-vous autre chose?
:
Merci, monsieur le président.
Messieurs, je vous remercie de vous être joints à nous cet après-midi.
J'aimerais seulement revenir sur divers commentaires qui ont été faits. Nous essayons, je suppose, d'évaluer la disponibilité du capital pour les petites entreprises. Nous apprécions beaucoup vos témoignages cet après-midi.
Monsieur Campbell, dans vos observations, vous disiez que ce qui a fait la différence entre ce ralentissement et d'autres, c'est la vigueur financière généralisée des petites entreprises. J'aimerais bien que vous en disiez un peu plus long là-dessus. En fait, j'avais prévu de poser la question même avant que vous en parliez.
Quand vous parlez de vigueur générale d'une entreprise, est-ce que vous parlez de ses réserves de liquidités générales en regard de son ratio de dette? Quel facteur entre réellement en compte dans votre évaluation de la vigueur générale d'une compagnie? Peut-être pourriez-vous l'expliquer. Je ne sais pas si vous autres, messieurs, avez des commentaires à faire là-dessus, mais cette question m'intéresse.
:
Vous me permettrez d'ajouter mon grain de sel et de revenir sur les propos de Jean-René au sujet de la propriété intellectuelle. Les universités pourraient envisager de libérer leurs professeurs titularisés et de les réintégrer ultérieurement. Certains clients m'ont signalé au fil des ans qu'il était vraiment difficile d'obtenir la collaboration d'un professeur universitaire qui a songé à un produit tout à fait révolutionnaire, car en cas d'échec, ce qui se produit dans bien souvent, le professeur ne peut pas revenir à l'enseignement universitaire. C'est extrêmement difficile. La propriété intellectuelle est donc un aspect.
Ensuite, lorsque je pense à notre ami de la semaine dernière et je me dis qu'il serait peut-être intéressant d'envisager d'accroître le nombre d'entrepreneurs en série canadiens. Lorsque vous examinez une partie de la recherche que nous avons effectuée de concert avec Industrie Canada et la BDC, vous constatez qu'il y a eu un effet boule de neige. On ne se contente pas de créer une entreprise, on en crée 10 ou 30. C'est ce qu'il faut viser, accroître le nombre d'entrepreneurs en série canadiens.
Enfin, j'estime que le gouvernement devrait examiner tout ce qu'il fait. Il devrait se pencher notamment sur son programme compensatoire relatifs aux grands contrats, du moins afin d'envisager d'accorder davantage de capital de risque. Les marchés publics... Le gouvernement achète beaucoup. À quel escient le fait-il?
En terminant, je voudrais signaler que je me suis rendu en Israël il y a deux ans dans le cadre d'une petite mission commerciale. Les moyens que les Israéliens prennent pour réunir du capital de risque sont très impressionnants. Alors que leur marché du capital-risque était inexistant il y a 14 ans, il rivalise maintenant celui du Canada.
:
Merci, monsieur le président.
Je veux faire écho aux propos de mes collègues et remercier les témoins de leur présence. Je sais que certains d'entre vous ont franchi de longues distances pour comparaître, et nous vous en sommes très reconnaissants.
Monsieur Halde, vous avez évoqué deux phénomènes dans votre déclaration: la hausse du taux de délinquance parallèlement à l'augmentation du nombre de vos clients qui cherchent à investir dans des technologies nouvelles. Ces deux phénomènes viennent simplement renforcer ma conviction qu'il se produit toujours un processus d'élimination en période de récession.
La situation est difficile pour certains, nous le reconnaissons, mais elle offre des occasions dont il faut tirer profit. J'en conclus qu'il importe surtout alors de s'assurer que les entreprises les plus florissantes ne manquent pas de capitaux. C'est alors vraiment le temps d'aider les entreprises prometteuses pour que leur viabilité ne soit pas mise en péril par manque de fonds.
Mes questions s'adressent à vous, monsieur Hayes et monsieur Rémillard.
Dans le rapport du comité sur les consultations prébudgétaires, le Parti libéral recommande certes d'augmenter le maximum admissible au crédit d'impôt pour capital de risque ainsi que le montant de ce crédit d'impôt. Ces recommandations sont, à mon sens, un pas dans la bonne direction. Cependant, on nous signale que l'exode de certaines de ces entreprises vers les États-Unis demeure un problème préoccupant.
Monsieur Hayes, vous avez parlé de l'écart toujours présent entre la recherche-développement et l'étape suivante, la commercialisation. C'est ce qui explique une partie de cette exode vers les États-Unis.
Outre ces recommandations sur le crédit d'impôt pour capital de risque, quelles autres mesures le gouvernement pourrait-il prendre selon vous pour que cet écart se rétrécisse et que nous rattrapions notre retard par rapport aux États-Unis?
Je sais que certaines réponses ont été apportées, mais je vous demanderais de nous en faire une synthèse, s'il vous plaît.
:
J'y arrive. Il faut avoir un objectif d'abord, puis une stratégie.
Je vous ai fait part de ma liste de souhaits et de notre liste de souhaits dans ma déclaration préliminaire. Toutefois, un certain nombre d'autres mesures concrètes peuvent être prises.
Vous avez demandé comment on définit le succès. Eh bien, voici un très petit indicateur du succès: la prochaine fois que le ministre des Finances ou le premier ministre se rend en Chine et s'assoit avec le chef du fonds d'investissement souverain chinois d'une valeur de 1 000 milliards de dollars, M. Tom Hayes est assis à côté de lui sur la photo.
C'est ainsi que je définis le succès. Nous serons en mesure d'obtenir plus de capitaux de l'étranger que nous ne le faisons maintenant.
C'est l'élément clé. Et c'est ce que nous allons faire.
:
C'est encore trop tôt, mais nous avons observé l'année dernière que les fonds de capital-risque de détail, à l'exception du Fonds de solidarité du Québec, ne peuvent pas vendre directement aux clients. Il faut travailler par l'entremise de conseillers en placements indépendants. En fait, même si ce n'est pas intentionnel, le compte d'épargne libre d'impôt a, en quelque sorte, livré concurrence à notre capacité de ramasser de l'argent dans les fonds de capital-risque de détail.
Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que de nombreuses mesures ont été prises l'année dernière au niveau des gouvernements provinciaux pour améliorer le fonds de détail et accroître l'offre de capitaux. La Colombie-Britannique a augmenté le montant des cotisations annuelles — que nous appelons le « prix du billet ». La Saskatchewan a fait passer le crédit d'impôt de 15 à 20 p. 100. La Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador et le Nouveau-Brunswick ont fait passer le crédit d'impôt à 20 p. 100. Le Québec, pour un fonds donné, a fait passer le crédit d'impôt à 25 p. 100. Le Manitoba a augmenté le montant des cotisations à 12 000 $. Toutes ces mesures sont utiles, mais sans un financement de contrepartie de la part du gouvernement fédéral pour compléter les initiatives provinciales, celles-ci ne seront pas aussi efficaces.
J'en reviens encore à ce message: il y a deux mesures rapides que vous pourriez prendre pour vraiment influer sur l'offre de capitaux à court et à moyen termes, à savoir faire passer le crédit d'impôt à son taux antérieur, soit à 20 p. 100, et accroître le montant des cotisations permises.
:
Merci beaucoup. Vos témoignages ont été très instructifs. Je vais entrer dans le vif du sujet puisqu'il ne nous reste que cinq minutes et j'ai quatre grandes questions. Alors si vous pouviez être succincts dans vos observations... Je vais poser mes questions d'un seul coup.
Monsieur Campbell, veuillez nous parler de la Loi sur les prêts aux petites entreprises et nous dire si elle a besoin d'améliorations. Selon vous, que faut-il changer dans la loi?
Monsieur Halde, en ce qui concerne le financement subordonné, j'aimerais savoir comment il fonctionne, en tant que combinaison de prêt avec une certaine forme d'option d'action. J'aimerais savoir si ce financement fonctionne. Avez-vous noté une augmentation ou une diminution, sur le plan régional et industriel?
Monsieur Haies, vous avez mentionné être préoccupé par la question de la syndication. Pourriez-vous nous expliquer vos réserves à ce sujet?
Monsieur Rémillard, j'aimerais parler de l'approvisionnement. Nous avons eu une transaction avec Sikorsky dans le cadre, bien entendu, d'un important contrat pour l'achat d'hélicoptères, d'une valeur de 3,5 milliards de dollars. Il y avait un fonds commun de placements de 50 millions de dollars. Cela a-t-il porté fruit? Devrions-nous encourager le gouvernement?
Fait le plus important, j'aimerais porter à l'attention du gouvernement le fait qu'il s'agit d'une question très sérieuse. L'accès au capital continue de poser un très gros problème. Nous avons parlé de la tempête parfaite, et c'en est une.
Monsieur Campbell, veuillez commencer, s'il vous plaît.