FINA Rapport du Comité
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
CHAPITRE 6 :
NOTA BENE
Le Comité porte à l'attention du gouvernement fédéral les questions suivantes.
Recouvrement des coûts
Dans le cadre de l'examen des programmes, le gouvernement fédéral a institué une nouvelle politique de recouvrement des coûts de divers services. Cette décision s'inscrivait dans le contexte des compressions budgétaires que le gouvernement devait appliquer, mais participait aussi d'un souci de rationalisation. Les ministères ont dû rationaliser leurs opérations et éliminer celles qui n'étaient pas nécessaires. Il était en outre entendu que les clients paieraient pour certains des services reçus.
Ce n'est pas la façon normale de procéder d'un gouvernement. En règle générale, le gouvernement perçoit des recettes auprès des Canadiens et leur offre en contrepartie un éventail de services qui ne sont aucunement liés à leur propre contribution aux recettes publiques. Cela tient au fait que les programmes publics sont conçus pour offrir des prestations à l'ensemble de la population.
Dans certains cas cependant, les services publics offrent des prestations à caractère privé et non collectif. Dans ces cas-là, le gouvernement devient un fournisseur comme n'importe quelle autre entreprise. Cependant, contrairement à une entreprise normale, le gouvernement a généralement le monopole des services qu'il offre; et contrairement à ce qui se passe normalement dans les monopoles, il a le pouvoir d'ordonner au consommateur d'acheter un produit particulier. Imaginons un moment une compagnie de téléphone qui pourrait non seulement empêcher les Canadiens d'acheter des services téléphoniques à un autre fournisseur, mais les forcer à acheter une quantité donnée de services. C'est exactement ce que certains groupes d'entreprises reprochent aux ministères et aux organismes de réglementation de faire sous couvert de recouvrement des coûts.
Les petites entreprises et les agriculteurs se plaignent depuis déjà longtemps des effets de la politique de recouvrement des coûts. Ils sont de plus en plus mécontents.
Le montant total des frais d'utilisation imposés au secteur privé a crû de 47 % en seulement 2 ans, de 1994-1995 à 1996-1997. Pour les entreprises du secteur de la fabrication, ils ont augmenté de 50 %. Selon le Business Council on Cost Recovery (BCCR), ces frais sont plus une taxe qu'un prix pour des services et semblent servir à subventionner d'autres activités ou à grossir les recettes publiques. Ils ressemblent davantage à des taxes parce que les ministères ne suivent pas les directives établies initialement dans le Programme de recouvrement des coûts; qu'ils ne fixent pas le montant des frais en fonction de la valeur des services fournis; qu'ils ne cherchent pas à réduire au maximum les coûts de prestation des services et qu'ils ne font rien pour réaménager leurs opérations de manière à offrir de meilleurs services. En fait, dans certains cas comme celui de l'homologation des médicaments d'usage vétérinaire, la qualité du service s'est grandement détériorée et est bien loin des normes promises.
En tant que taxes, ces frais d'utilisation faussent tout autant les décisions économiques que l'impôt sur le revenu des particuliers et l'impôt sur les sociétés. Selon le BCCR, ces frais ont réduit le PIB de jusqu'à 1,4 milliard de dollars, ce qui aurait coûté 23 000 emplois. L'introduction de nouveaux produits au Canada est retardée, ce qui impose des coûts directs aux consommateurs et rend l'économie moins productive.
Le Comité a recommandé précédemment que toutes les mesures gouvernementales soient assujetties aux critères de l'examen des programmes, à un pacte de productivité et à une vérification réglementaire. La manière dont le gouvernement met en 9uvre sa politique de recouvrement des coûts serait un bon candidat pour une telle vérification.
Questions agricoles
Un certain nombre de témoins ont demandé au Comité de se pencher sur la situation des producteurs agricoles, en particulier celle des producteurs de grains et des producteurs d'oléagineux de l'Ouest. On nous a dit que les revenus agricoles dans les provinces de l'Ouest seront inférieurs aux prévisions. En fait, on s'attend que quelque 41 % des agriculteurs des Pairies enregistreront des pertes en 1999 et que 16 % seulement feront un bénéfice. La baisse des revenus agricoles est imputable à la diminution des cours des marchandises causée en partie par le niveau élevé des subventions à la production aux États-Unis et dans l'Union européenne. Des témoins nous ont dit que la réduction des aides agricoles du gouvernement fédéral dépassait grandement ce qu'exigeaient nos engagements commerciaux. Selon eux, cette mentalité de « boy scout » compromet l'avenir des agriculteurs de l'Ouest du pays. Les graphiques 1 et 2, qui reposent sur des données fournies par le ministre de l'Agriculture de la Saskatchewan Dwain Lingenfelter, montrent, d'une part, que les subventions agricoles du Canada dans ces secteurs sont bien inférieures à celles de nos principaux concurrents et, d'autre part, que les producteurs de grains et d'oléagineux reçoivent une aide moindre en moyenne que les autres producteurs agricoles, et de loin inférieure à celle dont bénéficient les autres producteurs, comme les producteurs de lait et les producteurs d'9ufs.
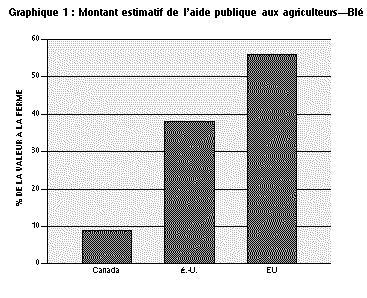

Bien que le gouvernement fédéral ait annoncé récemment de l'aide additionnelle dans ce secteur, les témoins entendus estiment qu'elle est insuffisante. Ils craignent que les agriculteurs de l'Ouest n'arrivent pas à maintenir leurs niveaux de production, leur productivité et, en conséquence, leur compétitivité dans les prochaines années. À leur avis, seul le gouvernement fédéral peut prendre des initiatives en la matière.
[ . . . ] le secteur agricole constitue une des grandes forces de notre économie et de notre société. L'agriculture offre à coup sûr d'énormes possibilités de tirer profit de l'élargissement du marché à l'échelle mondiale. Cependant, ce secteur traverse actuellement une période de grandes difficultés économiques auxquelles seule l'intervention du gouvernement fédéral peut remédier. (Saskatchewan Wheat Pool)
Les témoins ont proposé diverses formes d'aide gouvernementale : aide financière directe et immédiate; financement à long terme suffisant pour établir un filet de sécurité efficace; réduction des tarifs de transport du grain et réduction des frais d'utilisation et des activités de recouvrement des coûts.
Le Comité estime que le secteur agricole revêt une importance cruciale pour le Canada, qu'il doit non seulement survivre, mais aussi croître, et qu'il demeure un élément essentiel de la nouvelle économie.
La meilleure solution consiste manifestement à négocier des réductions des subventions agricoles au niveau international, de permettre au jeu des forces du marché de fixer les prix et de permettre aux producteurs compétitifs de réussir. Les producteurs canadiens sont efficients et peuvent parfaitement soutenir la concurrence des autres agriculteurs sur les marchés mondiaux, mais ils ne peuvent cependant pas soutenir la concurrence des trésors américain et de l'Union européenne. En attendant, le gouvernement fédéral a le devoir de soutenir les agriculteurs qui se retrouvent en mauvaise posture du fait que la communauté internationale n'a pas encore réussi à trouver une solution satisfaisante au problème.
Nous notons que le Comité permanent de l'agriculture de la Chambre des communes est en train d'étudier la question et nous attendons son rapport.
Quoi qu'il en soit, le Comité estime que le gouvernement fédéral doit se rappeler que les autres pays ne suivent pas toujours notre exemple en matière de commerce international, ce qui peut parfois avoir des conséquences sérieuses pour les Canadiens. Dans ces cas-là, le gouvernement a certaines obligations envers les groupes touchés.
Pompiers
Des représentants des pompiers ont fait valoir au Comité que leur profession les exposait plus que les autres travailleurs à un risque élevé de maladie, de décès et de blessure. Au Canada, le règlement de la Loi de l'impôt sur le revenu considère le travail de pompier comme une profession du secteur de la sécurité publique, ce qui fait que les pompiers peuvent prendre leur retraite à 55 ans. Le même règlement cependant précise un taux maximal d'accumulation de prestations de retraite de 2 % pour les années de service ouvrant droit à pension dans le contexte d'un régime de retraite à prestations déterminées. Cela s'applique à toutes les professions, et pas seulement aux pompiers. Cela a pour effet de pénaliser les pompiers puisqu'ils ne peuvent pas cotiser davantage à leur régime de retraite enregistré pour compenser la perte de revenu de retraite. Il a donc été recommandé de porter à 2,33 % le taux d'accumulation des prestations de pension pour les pompiers. On a aussi recommandé une autre solution qui consisterait à rendre les pompiers admissibles à des prestations réduites du RPC à l'âge de 55 ans et à des prestations non réduites dès l'âge de 60 ans.
Essentiellement, le règlement atteste l'existence d'un problème pour les pompiers dans la mesure où ils sont tenus de prendre leur retraite plus tôt que le reste des travailleurs, mais sans offrir de solution par la voie d'un taux d'accumulation accru. Avec les taux actuels, compte tenu du taux de mortalité plus élevé des pompiers par rapport aux autres Canadiens, les pompiers ne peuvent pas se prévaloir d'un régime de pension auquel ils ont cotisé durant toute leur carrière. (International Association of Fire Fighters, division canadienne)
Le Comité reconnaît que les règlements qui découlent de la Loi de l'impôt sur le revenu sont inéquitables pour ce qui est des retraites anticipées et des pensions. Nous croyons également comprendre que, bien que la question ait été soulevée par les pompiers, elle touche tous les Canadiens qui occupent un emploi dans le domaine de la sécurité publique. À notre avis, ces dispositions doivent être revues.
GRC et services de police communautaire
Le Comité a également reçu les doléances de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). La GRC applique les lois fédérales et 9uvre auprès des collectivités pour assurer la sécurité de tous les Canadiens. Elle fournit également des services de police au niveau communautaire aux provinces, aux territoires et aux municipalités (sauf en Ontario et au Québec) en vertu de contrats conclus avec le gouvernement fédéral et portant sur les enquêtes, la détection et la prévention de la criminalité, l'application des lois, le maintien de la paix et de l'ordre et la protection de la vie et des biens.
On nous a dit que les compressions opérées au fil des années ont créé des problèmes dans de nombreuses municipalités à travers le pays. Par exemple, comme le nombre de personnes chargées de patrouiller des secteurs importants a décliné, certaines zones sont laissées sans aucune surveillance. Dans certains cas, il serait impossible pour un agent de la GRC de faire son travail correctement, par exemple si un appel était logé à deux endroits différents en même temps. En raison de la baisse du financement destiné à la GRC, le coût des services policiers s'est déplacé du gouvernement aux particuliers.
Au cours des quelques dernières années, la pénurie de personnel s'est répercutée de façon directe et négative sur les services policiers, d'un point de vue tant qualitatif que quantitatif. Nous estimons donc qu'il y a eu des coûts humains et matériels, ce qui revient à dire que le coût des services policiers est passé du gouvernement fédéral aux citoyens. (Alberta Urban Municipalities Association)
On nous a dit en gros que le gouvernement n'honorait pas les engagements qu'il avait pris en vertu des contrats conclus relativement à des services policiers, tout comme les agents de la GRC ne peuvent fournir des services adéquats à leurs partenaires. Il y a donc tout lieu de s'inquiéter de la sécurité des municipalités qui passent des contrats avec les administrations publiques à cet égard. Les témoins ont donc demandé de rétablir le financement à un niveau suffisant pour que la GRC puisse respecter ses obligations contractuelles. Le Comité estime que le gouvernement devrait honorer l'esprit et la lettre de ce type de contrats.
L'aide étrangère
Les témoins nous ont rappelé une déclaration de principe dans le domaine de la politique étrangère que le Canada avait faite en 1995 à propos de la mondialisation et de la nécessité de venir en aide aux pays les plus pauvres. Cet énoncé confirmait que l'aide au développement pouvait stimuler l'économie mondiale :
. . . la pauvreté dans les pays en développement se répercute de plus en plus sur le bien-être économique, social et politique des pays développés ( . . . ) et peut aboutir à de graves problèmes, comme la dégradation de l'environnement, l'instabilité économique et politique et l'immigration sur grande échelle de populations en quête d'une vie meilleure1.
Le Comité a appris que le budget que consacre le pays à l'aide internationale a fortement décliné ces dernières années, que ce soit en termes réels ou en pourcentage du PIB. Selon l'Institut Nord-Sud,
En 1984, le Canada consacrait 0,49 % de son PIB (soit 2,3 milliards de dollars) à l'Aide publique au développement (APD). En 1997, ce pourcentage était tombé à 0,34 % (soit 2,7 milliards de dollars d'aujourd'hui ou 1, 3 milliard de dollars de 1984). Pour ce qui est de la générosité, le Canada se classe 8e parmi les pays de l'OCDE2.
Il a également appris que la contribution du Canada à l'Aide publique au développement a reculé par suite d'une réaffectation des fonds destinés à l'aide internationale :
Le montant destiné à l'investissement à long terme s'est encore amenuisé, ces fonds ayant été utilisés pour les secours à court terme au Kosovo et dans l'ancienne Yougoslavie (qui est admissible à une aide selon l'OCDE), aux pays d'Amérique centrale touchés par l'ouragan Mitch et à l'Afrique centrale après les guerres. Les rares fonds d'aide prévus ont également servi à financer l'allégement de la dette . . . 3
En règle générale, les témoins ont dit espérer que la tendance à la baisse des fonds destinés à l'aide au développement se renverse, compte tenu des excédents budgétaires que dégage maintenant le gouvernement fédéral. À leur avis, l'aide aux pays les plus pauvres doit constituer une priorité de l'investissement social renouvelé :
Le gouvernement manquerait de vision s'il consacrait l'intégralité du dividende budgétaire aux investissements sociaux nationaux. Appuyer le développement est un geste humanitaire certes, mais cela sert aussi les intérêts de l'État qui le fait. L'essor des économies des pays en développement ouvre des marchés pour les pays industrialisés. Les pressions résultant des mouvements de population et les tensions de nature sociale et environnementale s'atténuent avec l'accroissement de la sécurité4.
Le Comité partage le point de vue des témoins selon lequel l'aide au développement a des répercussions bénéfiques sur l'économie mondiale. Nous estimons également que le Canada devrait se concentrer davantage sur les projets de développement humain ainsi que sur l'allégement de la pauvreté à long terme. Par ailleurs, nous estimons que les fonds devraient servir aux fins auxquelles ils étaient initialement destinés.
Les outils de mécanicien
Une fois de plus, les représentants des apprentis mécaniciens et des techniciens en automobile se sont présentés devant le Comité pour se plaindre de l'absence de dispositions dans la Loi de l'impôt sur le revenu concernant leurs outils. Il faudrait que la Loi contienne des modalités comme celles s'appliquant aux artistes, aux opérateurs de scie à chaîne et aux musiciens. Les apprentis et les techniciens d'automobile doivent dépenser des dizaines de milliers de dollars pour se procurer des outils ou les remplacer annuellement et ne peuvent déduire cette somme de leur revenu imposable. Par ailleurs, il y a une pénurie de techniciens spécialisés, car le nombre de véhicules ne cesse de croître. Le secteur a tenté de remédier à la situation, mais ne peut rien changer au fait qu'une grande portion du revenu des techniciens doit être consacrée à l'achat d'outils. Comme l'a mentionné un de ces représentants au Comité :
La pénurie de main d'9uvre qualifiée provient, comme nous ne cessons de le répéter, du fait qu'il est impossible de déduire de son revenu imposable les sommes consacrées à l'achat de ses outils. En plus, ce qui est encore plus important pour l'avenir de ce secteur, cela constitue une barrière systématique et un facteur qui décourage les jeunes d'entrer dans la profession5.
Les frais professionnels ne peuvent être réclamés que par les travailleurs autonomes en règle générale, sauf dans quelques rares cas, cités plus haut.
Le camionnage
Depuis quelques années, la situation est difficile pour les camionneurs. Les livraisons transfrontalières se multiplient par suite d'une intensification du trafic, elle-même attribuable à l'essor de l'économie et à l'ALENA. Les routiers ont fait remarquer que l'état des autoroutes nationales se détériore et raccourcit la vie utile de leur équipement.
De plus, en raison de la longueur des journées de travail, les frais de restauration se sont accrus et l'abaissement de 80 % à 50 % du pourcentage des frais de repas pouvant être déduits a de lourdes conséquences. Parce qu'ils franchissent souvent la frontière, les routiers ont demandé à ce que le taux de déductibilité de 80 % soit graduellement rétabli pour les repas pris aux États-Unis.
Comme ils l'ont dit au Comité :
On parle de camionneurs qui sont longtemps loin de chez eux et qui doivent s'arrêter à intervalles fixes (fixés par règlement par le gouvernement fédéral). Ils ne peuvent donc vraiment choisir l'endroit de leur arrêt6.
L'apprentissage
L'apprentissage suscite des préoccupations dans le milieu de la métallurgie de précision au Canada. La main d'9uvre est devenue plus onéreuse dans ce secteur en raison de la rareté du personnel qualifié. L'effectif actuel vieillit, ce qui exacerbe le problème. Les techniciens spécialisés voient leur journée de travail s'allonger en raison de cette pénurie. Selon la Canadian Machining Tool Association, la semaine moyenne de travail dans le secteur de la métallurgie de précision est de 56 heures. De plus, cette pénurie risque de donner lieu à une production d'articles et de services non fiables, et le secteur risque de perdre des affaires.
Les techniciens sont donc moins nombreux que par le passé. Comme le déclarait un représentant du secteur :
Il y a un problème d'attitude. Les jeunes, leurs parents et les éducateurs ne voient pas l'apprentissage comme une voie valable. Les métiers sont dévalorisés et les adultes ont tendance à orienter les jeunes vers d'autres carrières. Il ressort de cette attitude qu'il est difficile de recruter des jeunes qui s'intéressent aux programmes d'apprentissage. Dans bien des cas, les candidats que nous recevons n'ont pas le bon profil7.
Les apprentis suivent des programmes formels d'apprentissage, pour lesquels l'effectif est de 500 étudiants par an au maximum, ce qui aggrave la pénurie. Les employeurs paient 90 % des coûts de la formation, dispensée la plupart du temps au sein de petites entreprises.
Le financement des programmes d'apprentissage pose des problèmes. Selon les représentants du secteur :
Le gouvernement fédéral abolira tout financement des programmes d'apprentissage d'ici 1999-2000 et les gouvernements provinciaux sont en train de remanier leurs programmes. Par conséquent, ce sont les apprentis qui devront défrayer le coût de ces réformes et payer leur apprentissage. On peut supposer que le nombre de gens inscrits à ce type de programmes va décliner au lieu de s'accroître.8.
Pour remédier au problème, l'Association propose que soit instauré un crédit fiscal de 75 % dont bénéficierait toute entreprise canadienne inscrite à un programme d'apprentissage agréé par la province. Ce crédit s'appliquerait à tous les frais salariaux liés à la formation approuvée de l'apprenti accrédité.
Le développement économique régional
La mondialisation de l'économie et l'inévitable profonde transition structurelle qui s'ensuit n'offrent pas de réelles possibilités à toutes les personnes et à toutes les régions. Le Cap-Breton est une des régions dont l'économie, axée sur une matière première, est aux prises avec un taux de chômage élevé. L'industrie de la pêche s'est effondrée, avec les conséquences que l'on sait sur des comtés ruraux comme celui de Richmond. Les charbonnages vont licencier un grand nombre de travailleurs l'année prochaine.
Dans les 30 dernières années, le gouvernement fédéral a lancé un certain nombre de mesures conçues pour revitaliser les industries et stimuler le développement régional, mais elles n'ont pas toutes donné les résultats espérés.
Si le déclin continu de l'activité économique impose des coûts économiques et sociaux, il reste que des programmes inopportuns d'aide financière peuvent faire plus de mal que de bien. M. John Whalley, un économiste qui travaille pour la municipalité régionale du Cap-Breton, a cité en exemple le crédit d'impôt à l'investissement au Cap-Breton.
Ce qu'on a constaté avec le crédit d'impôt à l'investissement au Cap-Breton, c'est que ce crédit était accordé tout de suite. Dès que les entreprises investissaient en biens d'équipement, elles obtenaient un crédit. Si ces biens étaient mobiles, les entreprises s'en allaient. La région se retrouvait sans rien. Ce type de mesure n'apportait aucun avantage à long terme9.
Les administrations locales sont déterminées à se tourner vers l'avenir au lieu de s'appesantir sur le passé et à chercher de nouvelles activités tirant parti de leurs avantages inhérents. Elles mettent l'accent sur des mesures conçues pour attirer de nouvelles industries, avec des dépenses d'infrastructure qui amélioreront la qualité de vie de la population locale. Comme l'a dit M. Whalley au Comité :
L'idée c'est que dans notre région comme dans d'autres régions du Canada, on a besoin surtout d'emplois; pas d'investissements dans des immobilisations, pas d'infrastructures, mais d'investissements privés propres à créer de l'emploi10.
D'autres régions du pays se trouvent dans une situation analogue du fait qu'elles sont elles aussi du « mauvais côté de la route du progrès ». De nombreuses initiatives locales ont été lancées, en particulier en Colombie-Britannique.
Il ne fait plus de doute que, pour remédier à la pauvreté endémique, des mesures locales globales de développement peuvent jouer un rôle crucial. Reste à trouver le moyen de déterminer ce qui fonctionne et de l'intégrer à une stratégie plus vaste capable de démultiplier le succès11.
Le but ultime consiste à atteindre un état d'autonomie grâce à une forte participation des institutions et entreprises locales et, par-dessus tout, de la population locale. En conséquence, selon le degré de développement de la communauté en question, on consentirait des investissements de manière à améliorer les infrastructures locales ou à répondre à d'autres besoins en vue d'établir un climat propice à l'économie régionale et à la création d'emplois. Les organisations locales admettent que le plus grand obstacle tient aux gens eux-mêmes. Comme l'a dit le CCEDNet dans sa présentation,
La plupart du temps, les gens voudraient bien faire quelque chose, mais leur intervention est limitée par des facteurs comme le faible niveau de l'activité économique dans la région, le fait que les compétences ne correspondent pas aux besoins du marché du travail, des modes vie qui ne conviennent pas, un manque de compétence ou d'expérience de travail, l'absence de cours de formation ou d'occasions d'apprendre et des restrictions concernant l'acquisition ou la consolidation d'immobilisations ou l'accès au capital12
Le CCEDNet a fait d'autres suggestions et indiqué notamment que :
[ . . . ] l'octroi de crédits permettant de financer des projets locaux de formation et de développement pourrait jouer un rôle utile dans la réduction de la pauvreté des citoyens13.
À la lumière de ces expériences, le Comité admet que la croissance économique forte et soutenue que l'on observe récemment n'a pas profité également à toutes les régions. Certains problèmes de développement régional ne datent pas d'hier. D'autres sont plus récents et sont apparus depuis la restructuration économique qui a suivi la mondialisation de l'économie. Enfin, certaines collectivités ont été touchées encore plus durement par la récente récession qui frappe la Colombie-Britannique tandis que le reste du pays bénéficie d'une conjoncture plus favorable.
Le Comité se rend bien compte aussi que ce ne sont pas les idées ni la bonne volonté qui manquent. Les collectivités concernées ont montré qu'elles étaient prêtes à se tourner vers l'avenir et à réaliser des initiatives mieux adaptées aux besoins de la population locale. On sent que les administrations municipales ont su tirer des leçons des erreurs du passé.
Le gouvernement du Canada pourrait offrir des mesures d'encouragement appropriées qui appuient et viennent compléter les initiatives locales. Il pourrait s'agir de projets exécutés en collaboration avec le ministère du Développement des ressources humaines, comme on l'a fait avec succès dans le passé. Cependant, l'impulsion doit venir d'abord des autorités, entreprises et populations locales, qui sont le mieux placées pour savoir ce dont elles ont besoin pour participer à part entière à celle nouvelle ère.
La défense
L'Examen des programmes a très efficacement réalisé son objectif de restructuration des dépenses de programmes additionnels, mais a touché certains ministères plus que d'autres. Les dépenses pour la défense en constituent un exemple.
Les compressions des dépenses en matière de défense ont entraîné la fermeture de bases militaires et des retards dans la modernisation de l'équipement. Au même moment, le Canada s'est engagé à participer à un nombre croissant de missions internationales, posant un défi pour nos Forces armées.
Comme l'a souligné au Comité un des représentants du Congrès des associations de la Défense :
Les Forces armées du Canada s'effondrent en raison d'un écart entre le nombre croissant d'engagements et la baisse des ressources fournies pour réaliser ces engagements [ . . . ] Aujourd'hui, avec le récent déploiement au Timor-Oriental, près de 4 500 militaires canadiens sont affectés à 22 missions distinctes à l'étranger. Il s'agit du plus important déploiement de troupes outre-mer depuis la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée14.
Par conséquent, les Forces canadiennes éprouvent de plus en plus de difficultés à suivre le rythme des progrès de la technologie militaire. Le Canada étant un fervent partisan des Nations Unies et étant donné notre longue tradition de missions de maintien de la paix, les Forces armées canadiennes se verront sans doute réclamer encore plus leur participation.
Le Comité admet que la défense a subi plus de compressions financières que tout autre programme. Ces compressions nuisent maintenant à nos engagements envers nos alliés et les missions de maintien de la paix des Nations Unies. Le Comité appuie les forces militaires du Canada dans leurs traditions et leur rôle pour la promotion de la paix et de la sécurité. Il convient d'accorder les fonds voulus au soutien de ce rôle. Le Comité demande que le gouvernement du Canada élabore et mette en 9uvre un programme quinquennal de revitalisation et de modernisation des Forces canadiennes qui accorde au ministère de la Défense nationale un budget représentant un pourcentage sensiblement plus élevé du PIB.
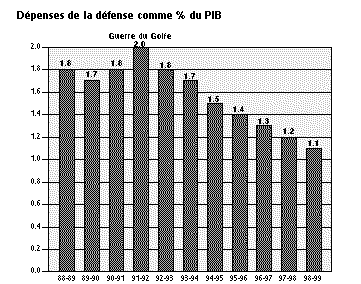
1 Citée dans le mémoire d'Action Canada for Population and Development.
2 Institut Nord-Sud, mémoire.
3 Institut Nord-Sud, mémoire.
4 Action Canada for Population and Development, mémoire.
5 Commentaires de Keith Lancastle, Conseil du Service d'entretien et de réparation automobiles du Canada, mémoire au comité, 25 novembre 1999.
6 David Bradley, président directeur-général, Alliance canadienne du camionnage, 25 novembre 1999, compte rendu n 29, 1245 (version préliminaire).
7 Making a Case for Apprenticeship Training Tax Credits, document de discussion envoyé au Comité par la Canadian Tooling and Machining Association, le 22 septembre 1999.
8 Ibid.
9 Délibérations, réunion 12, Halifax, 1610.
10 Ibid.
11 Canadian CED Network, mémoire soumis au Comité à Vancouver, 23 novembre 1999.
12 Ibid, p. 6.
13 Ibid.
14 Mémoire au Comité, Ottawa, 18 novembre 1998, p. 2.