FINA Rapport du Comité
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
UN NOUVEAU PAYSAGE BUDGÉTAIRE ET ÉCONOMIQUE
Lorsque le Comité a publié son rapport sur les consultations prébudgétaires il y a deux ans, les perspectives économiques du Canada s'étaient déjà considérablement améliorées. Depuis lors, les Canadiens bénéficient d'une meilleure conjoncture, situation conforme à l'amélioration de la situation budgétaire du gouvernement. En septembre 1999, par exemple, le PIB du Canada a enregistré une quatorzième progression mensuelle consécutive, qui s'inscrit dans « . . . la plus longue série ininterrompue de progressions mensuelles depuis plus d'une décennie . . . 1 ». En fait, cette année, la croissance demeure forte et soutenue et semble concerner un vaste éventail de secteurs d'activité. Ces tendances ne sont pas de simples anomalies à court terme. Les organisations et les médias internationaux commencent à décrire le Canada en termes extrêmement flatteurs, ce que l'on n'avait pas vu depuis de nombreuses années.
Cependant, comme le montrent les événements des dernières décennies, il ne faut rien tenir pour acquis. C'est seulement la quatrième année où la croissance économique dépasse la croissance démographique. Le souvenir de la dernière récession et de la reprise anémique du début de la décennie est encore vif dans notre mémoire.
Au demeurant, il est évident que le Canada n'a pas encore réussi à combler l'écart de productivité qui le sépare des États-Unis. Force est de conclure qu'il reste encore des gains de productivité à réaliser. L'économie canadienne n'actualise pas son plein potentiel, et cela risque de limiter notre aptitude à améliorer le niveau de vie des Canadiens dans l'avenir, une fois que nous aurons atteint la crête du cycle économique.
Quoi qu'il en soit, le contexte économique et financier d'aujourd'hui nous donne des raisons d'être optimistes. C'est le moment, donc, d'envisager des mesures qui consolideront les acquis, stimuleront encore davantage notre performance économique, amélioreront nos perspectives d'avenir et contribueront à préserver ce que de nombreux Canadiens considèrent comme le caractère essentiel de notre économie et de notre société.
Monsieur le président, en ces derniers jours du XXIe siècle, le Canada a une occasion unique d'assumer son destin. De faire en sorte que l'assainissement des finances publiques signifie une meilleure qualité de vie pour tous. De donner aux Canadiens ce à quoi ils sont en droit de s'attendre, c'est-à-dire la promesse de revenus plus élevés et d'une plus grande sécurité.
Paul Martin, La mise à jour économique et financière,
2 novembre 1999
Les faits suivants témoignent succinctement de nos récentes réalisations économiques et budgétaires2 :
- La performance économique du Canada a dépassé les attentes depuis le budget de 1999 en raison de l'amélioration de la conjoncture internationale et d'une vive reprise de la demande intérieure.
- La vigueur de la demande intérieure touche de nombreux secteurs.
- En septembre, le taux de chômage était à son niveau le plus bas depuis juin 1990. (En novembre, à 6,9%, le taux de chômage était à son niveau le plus bas depuis août 1981.)
- Les prévisions de croissance pour 1999 ont presque été doublées.
- Les dépenses de programme fédérales représentent 12,4 % du PIB, la proportion la plus faible depuis 1949-50.
- De tous les pays du G7, le Canada est celui où le solde budgétaire pour l'ensemble du secteur public s'est le plus amélioré de 1992 à 1998.
- Le Canada est le pays où les dépenses publiques ont le plus baissé durant la même période.
Les avantages directs de l'assainissement des finances publiques
Au cours de l'automne 1994, les marchés financiers ont connu de fortes turbulences dans le sillage de la dévaluation du peso mexicain. Même si la crise n'était pas grave à l'échelle internationale, elle a néanmoins eu des répercussions impressionnantes au Canada. Il a fallu en effet relever les taux d'intérêt à court terme de 400 points de base, ce qui a non seulement exercé de fortes pressions à la hausse sur le déficit, par le truchement de la progression des coûts du service de la dette, mais aussi contribué à freiner l'expansion.
Monsieur le président, la vigueur de notre performance économique résulte, dans une certaine mesure, de la solidité de notre performance financière. Grâce aux efforts des Canadiens et des Canadiennes, notre pays a amorcé le plus grand redressement financier de son histoire.
Paul Martin, La mise à jour économique et financière,
2 novembre 1999
La crise asiatique, survenue quatre ans plus tard, s'est répercutée de façon beaucoup plus profonde sur les marchés financiers mondiaux. Et pourtant le Canada s'est assez bien tiré d'affaire, à l'exception de la Colombie-Britannique, qui a connu une récession en raison de sa dépendance vis-à-vis des marchés asiatiques et de la chute de la demande de matières premières. Pour le Canada dans son ensemble, l'essoufflement de la croissance économique n'a pas beaucoup ralenti la croissance de la production ni eu d'effet négatif sur la situation du marché du travail. Il ne s'est pas non plus traduit par une détérioration de la situation budgétaire des administrations publiques en général et du gouvernement fédéral en particulier. En fait, à en juger par les dernières statistiques économiques, la crise asiatique n'a eu aucune conséquence négative.
Deux crises distinctes, assez rapprochées dans le temps, ont eu des répercussions bien différentes. Cela reflète les avantages de la santé budgétaire, monétaire et économique du pays et augure bien de l'avenir, puisque nous nous savons désormais capables de résister aux chocs économiques ou financiers qui pourraient se produire.
Ces deux dernières années, la situation budgétaire s'est considérablement améliorée et on est passé de déficits chroniques à des budgets équilibrés et même des excédents.
Conseil du Patronat du Québec
Selon les projections du Fonds monétaire international (FMI) et de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le gouvernement du Canada devrait, pour la troisième année de suite, avoir un budget équilibré. Parmi les pays du G7, seuls les États-Unis en ont fait autant. Toutefois, en pourcentage du PIB, la performance du Canada a surpassé celle des États-Unis au cours des deux derniers exercices.
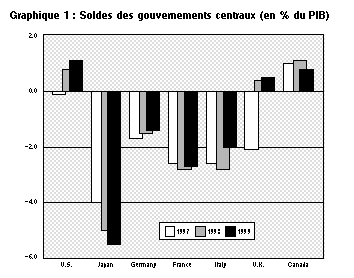
La poursuite d'une réussite sur le plan international
Notre traversée de la crise asiatique aurait pu être beaucoup plus mouvementée. La crise mexicaine de 1994 avait fortement secoué l'économie canadienne. Les autorités de notre pays ont joui d'une marge de man9uvre beaucoup plus grande pour répondre aux chocs économiques et financiers l'an dernier. L'économie a été le plus durement frappée par le recul généralisé des cours des ressources naturelles, dû essentiellement à une surproduction et à la chute de la demande. La dépendance du Canada vis-à-vis des matières premières, bien que moindre qu'avant, a suffi pour que des pressions à la baisse s'exercent sur le dollar canadien. Les turbulences qu'ont connues les marchés financiers en août 1998 à l'occasion de la crise russe (prolongement de la crise asiatique) ont constitué un autre choc que nous avons absorbé de façon satisfaisante.
Monsieur le président, lors de notre rencontre de l'an dernier, l'inquiétude était vive au sujet des bouleversements en Asie, de l'effet de contagion sur l'économie mondiale et des répercussions possibles chez nous.
Paul Martin, La mise à jour économique et financière,
2 novembre 1999
Lorsque la Banque du Canada a haussé les taux d'intérêt de 100 points de base pour répondre aux événements d'août 1998, le dollar canadien subissait déjà des pressions à la baisse sur les marchés des changes, par suite du déclin des cours des matières premières et du fait que les investisseurs cherchaient refuge dans les avoirs libellés en dollars américains. Cette intervention était censée stabiliser quelque peu les marchés des changes. De fait, la Banque du Canada a pu annuler cette hausse de 100 points de base quelques mois plus tard.
La Banque du Canada a été en mesure de maintenir la stabilité monétaire en faisant en sorte que le taux d'inflation demeure dans la partie inférieure de la fourchette cible dont les limites sont de 1 et de 3 %. (Dernièrement, l'inflation s'est accélérée quelque peu, mais l'inflation tendancielle se situe toujours dans la moitié inférieure de la fourchette cible et ne devrait pas menacer l'atteinte des cibles en matière d'inflation.) La réserve fédérale américaine a majoré ses taux d'intérêt de 25 points de base à 2 occasions, pour répondre aux craintes d'une résurgence de l'inflation. La Banque du Canada ne lui a pas emboîté le pas, illustrant encore plus les avantages qu'un assainissement des finances publiques présente pour la politique monétaire canadienne. En novembre toutefois, elle a relevé les taux de 25 points de bas, et la réserve fédérale américaine a aussi augmenté les taux. Le taux d'inflation pour le mois d'octobre est d'ailleurs tombé à 2,3 %, alors qu'en septembre il était de 2,6 %.
La compétitivité des entreprises canadiennes est très favorable et, l'assainissement budgétaire ayant bien progressé, la politique monétaire et la politique budgétaire peuvent maintenant appuyer conjointement l'expansion économique,
Étude économique du Canada, 1998-1999, Organisation pour la coopération et le développement économiques
Ces événements récents montrent bien qu'une discipline budgétaire réelle a pour principal avantage que le pays est capable de s'en tenir à une politique conséquente et prudente, même lorsqu'il fait l'objet de turbulences de nature financière d'origine étrangère. Le Canada est désormais mieux équipé pour choisir sa propre destinée, même si l'interdépendance à l'échelle mondiale ne fait que s'accroître.
Comme l'a déclaré le gouverneur de la Banque du Canada : « . . . le dynamisme de l'activité aux États-Unis et la réaction rapide . . . des principales banques centrales . . . ont atténué l'incidence de la crise asiatique sur l'économie canadienne . . . Si l'importance de ces facteurs favorables est indéniable, il reste que nous nous sommes mieux tirés de cette crise que des précédentes parce que notre économie repose maintenant sur des bases plus solides que par le passé3 ».
Il n'en demeure pas moins que l'on s'inquiète encore des éventuels effets de contagion des crises économiques et financières. Dans l'espoir de contribuer à maintenir la santé et la stabilité de l'économie mondiale, la communauté internationale a créé le Groupe des Vingt (G20) pour promouvoir le dialogue, et étudier et examiner les questions stratégiques entre pays industrialisés, essentiellement des membres du G7 et des économies à marché émergent. Il se trouve également dans cette tribune des représentants de l'Union européenne, de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Ce groupe a pour objectif de promouvoir la stabilité financière dans un monde où d'aucuns estiment que les crises financières sont non seulement plus nombreuses, mais également plus inquiétantes4. Il importe donc de limiter la portée et la gravité de ces crises et d'en circonscrire les effets (contagion). Le premier président du Groupe des Vingt est le ministre canadien des Finances, l'honorable Paul Martin.
La transition vers un siècle nouveau fournit l'occasion de relever les défis de l'avenir tout en s'occupant aussi des priorités du passé.
Fédération canadienne des municipalités.
Le système financier international pourrait connaître de nouvelles crises, les transactions financières se faisant toujours plus nombreuses et plus rapides et les économies à marché émergent gagnant en importance. Ces économies accroissent les risques d'instabilité, parce qu'elles ne sont pas dotées des règlements et des normes appropriés dans le domaine financier et en raison du lourd endettement de certaines d'entre elles.
En raison de son expérience récente et des enseignements qu'il a tirés de ses difficultés financières et budgétaires, le Canada est devenu un modèle en matière de politique économique saine, appuyée par des institutions financières solides et correctement réglementées. Il pourrait conseiller utilement les autres pays qui font face au type de difficultés financières qu'il a connues.
Le gouvernement fédéral a redressé de façon spectaculaire l'équilibre de ses comptes budgétaires et il faut l'en féliciter.
Chambre de commerce du Québec
Les marchés financiers canadiens sont assujettis à des normes en matière de réglementation prudentielle strictes et sont soumis à une discipline de marché rigoureuse, qui assure un fort degré de transparence et de responsabilité. À cela s'ajoute une grande quantité d'informations de qualité accessibles à tous.
Croissance économique soutenue
L'économie canadienne a affiché un taux de croissance annuel de plus de 3 % en 1997, puis de nouveau en 1998. Le Fonds monétaire international a récemment révisé à la hausse ses prévisions concernant l'économie canadienne5, puisqu'il mise sur un taux de croissance de 3,6 % pour cette année, alors qu'il projetait, ne serait-ce qu'en mai dernier, un taux de 2,6 % seulement. Cela cadre avec les prévisions économiques récentes de toutes les institutions financières canadiennes. Toutes ces institutions ont révisé à la hausse leurs prévisions économiques depuis le printemps dernier et s'attendent à une croissance de plus de 3,5 % pour 1999. L'économie canadienne devrait continuer sur sa lancée pendant encore deux ans, amorçant bien le nouveau millénaire. En gros, la croissance de l'économie canadienne devrait suivre de près celle des États-Unis et surpasser nettement celle des autres pays du G7, en 1999 et en l'an 2000.
Les indicateurs macroéconomiques canadiens sont encourageants. La croissance du PIB en termes réels est raisonnablement forte, les revenus des particuliers se mettent enfin à progresser [ . . . ] et les taux d'intérêt (nominaux) demeurent relativement bas.
Jim Stanford, Travailleurs et travailleuses canadien(ne)s de l'automobile
La croissance de l'économie mondiale, devant se chiffrer à 3 % cette année, est manifestement attribuable en partie à la nette amélioration des perspectives économiques des nouveaux pays industriels (NPI), dont les prévisions de croissance pour 1999 ont été révisées, passant de 0,5 % à 5,2 %, ce qui est un taux tout à fait robuste.
Les chiffres de l'emploi sont également prometteurs. Depuis le début de 1998, il s'est créé au Canada 626 500 nouveaux emplois. Le taux de chômage est passé de 9 % en août 1997 à 6,9 % en octobre 1999. Depuis l'an dernier, le secteur privé a créé, en termes nets, près de 350 000 nouveaux emplois.
Une inflation toujours basse
Bien que le dollar canadien ait perdu beaucoup de terrain au cours des 10 dernières années, la Banque du Canada a été à même de maintenir le taux d'inflation dans la fourchette de 1 à 3 % qu'elle vise. De fait, en règle générale, l'inflation s'est plutôt située dans la moitié inférieure de cette fourchette, même si elle a récemment dépassé la barre des 2 p. 100.
À la veille de l'an 2000, les Canadiens peuvent être fiers de leurs réalisations : nous sommes actuellement parmi les économies les plus compétitives du monde et nous avons figuré à plusieurs reprises au premier rang du classement des Nations Unies des pays où il fait bon vivre. Mais la roue continue de tourner et nous devons nous garder de nous reposer sur nos lauriers si nous ne voulons pas compromettre les chances des générations futures de profiter d'une meilleure qualité de vie.
Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario
L'économie atteindra bientôt les limites de son potentiel de production ou en approchera, et les augmentations futures de production seront limitées par la croissance de nos capacités à cet égard. Bien que l'inflation puisse surgir à tout moment du cycle, elle risque surtout de survenir lorsque l'économie se trouve à la limite de son potentiel ou en approche. C'est à ce moment-là que la Banque du Canada doit faire preuve de la plus grande vigilance.
Pour apprécier la crédibilité de la politique monétaire canadienne, dont témoigne le comportement des marchés financiers, il suffit de savoir que le taux d'intérêt des titres canadiens est inférieur à ceux de leurs pendants américains, sur toute la gamme des échéances. Cela signifie que les investisseurs ont tout à fait confiance que la Banque du Canada sera en mesure de maintenir un bas niveau d'inflation.
La confiance des consommateurs
L'indice de la confiance des consommateurs est un indicateur de ce que pensent les consommateurs de la situation économique. À en juger par l'évolution de cette mesure, les Canadiens continuent d'avoir une confiance croissante en l'économie et en l'avenir. Après un long épisode d'incertitude économique, aggravé par les effets des mesures d'austérité budgétaire prises par les administrations publiques, la confiance est remontée au niveau des années les plus prospères de la période allant de 1980 à 1990. Cet indicateur cadre avec la santé de l'économie, caractérisée notamment par la croissance de l'économie et de l'emploi, une faible inflation et des taux d'intérêt bas.
. . . Les cibles en matière d'inflation ont fait la preuve de leur utilité depuis deux ou trois ans en signalant la nécessité d'assouplir un peu la politique monétaire à une époque où beaucoup de gens prônaient un resserrement monétaire pour défendre le taux de change.
David Laidler
Bien que les exportations continuent de contribuer largement à la vitalité de notre économie, le bas niveau des taux d'intérêt et l'amélioration de l'emploi encouragent les ménages canadiens à dépenser davantage. Les dépenses de consommation se sont accrues, par exemple, de plus de 3 % au cours des six premiers mois de 1999. L'investissement résidentiel, qui est un autre indicateur de la confiance des consommateurs, a affiché une forte augmentation au premier semestre de l'année, avec des taux annuels supérieurs à 16 %. D'autres mesures, comme les ventes au détail, révèlent également une nette amélioration cette année. La confiance des consommateurs s'est accrue dans toutes les régions du Canada, sauf en Colombie-Britannique.
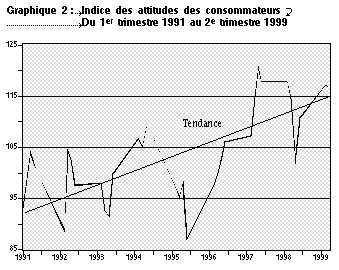
Il y a néanmoins un sujet d'inquiétude, le niveau de l'épargne personnelle des Canadiens. Ce taux est le plus bas enregistré depuis que Statistique Canada a commencé à suivre cette variable, soit depuis 1961. Au cours de quelques mois de cette année, ce taux a même été négatif, ce qui indique que les Canadiens dépensent plus qu'ils ne reçoivent en revenus. Les perspectives d'emploi étant les meilleures enregistrées depuis le début de la décennie, les Canadiens augmentent leur consommation à un rythme supérieur à celui auquel s'accroît leur revenu disponible. Par ailleurs, cette tendance est encouragée par la modicité du loyer de l'argent. Cela tient en partie au stade du cycle conjoncturel où nous nous trouvons et à la très grande confiance des consommateurs. Mais c'est toutefois une évolution inquiétante, car les ménages sont plus vulnérables, en cas d'aléas économiques. Pendant que le taux d'épargne des particuliers déclinait, l'endettement des ménages a continué de grimper. Il se situe à un niveau représentant près de 100 % du PIB, contre moins de 80 % en 1989.
Il importe de signaler qu'il n'existe de règle, dans l'analyse des cycles économiques, quand à la durée maximale des périodes d'expansion économique.
Pierre Fortin
En revanche, le taux d'épargne global, première source d'investissement de capitaux, s'est redressé, reflétant le net revirement de la situation des finances publiques. Fait nouveau, le secteur public ne constitue plus une ponction importante sur les économies des Canadiens.
Les membres du Conseil envisagent l'an 2000 avec optimisme et prévoient une autre année d'augmentation soutenue des ventes, de l'ordre de 4 %.
Conseil canadien du commerce de détail
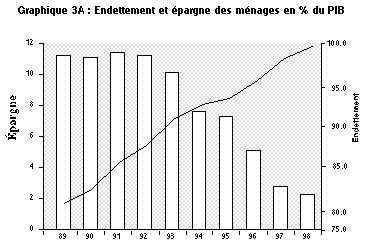
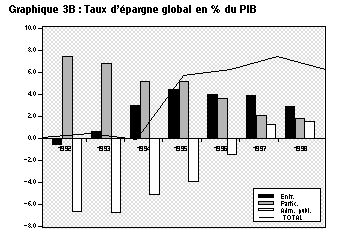
La confiance des entreprises
Les entreprises reprennent confiance, ce qui se traduit par des investissements plus massifs du secteur privé dans les usines, l'équipement et les machines. Au second trimestre de 1999, par exemple, les investissements ont progressé de 25,3 %, les entreprises ayant acheté un grand nombre d'ordinateurs, souvent pour se préparer au passage à l'an 2000. Et, parce que les entreprises canadiennes se sont équipées en matériel informatique, elles sont beaucoup mieux armées pour répondre à la concurrence internationale. De plus, elles sont plus à même de s'adapter à un environnement où l'essor rapide du commerce électronique pose de nouveaux défis.
Les intentions d'investissement des entreprises ont été révisées à la hausse au Canada et sont positives dans toutes les régions du pays.
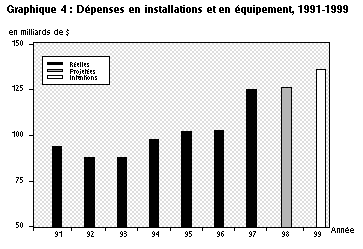
L'endettement
La vitalité de l'économie que nous venons de décrire est liée à l'assainissement des finances publiques, exprimé sous la forme du ratio de la dette publique nette au PIB. Depuis deux ans, la dette publique nette recule en termes nominaux, contribuant ainsi à une chute marquée de ce ratio, lequel est passé de 71,2 % au 31 mars 1996 à 64,4 % au 31 mars 1999. Selon les toutes dernières prévisions du ministère des Finances, les budgets équilibrés prévus pour les cinq prochaines années permettront de faire encore fléchir la dette publique nette, qui ne représentera plus que 49 % du PIB.
Tout plan budgétaire pour les prochaines années doit accorder une grande priorité à un plus gros effort de réduction de la dette.
David Laidler
Le recul de l'endettement, conjugué à la progression du PIB, allège le fardeau que représentent les frais de la dette publique, de sorte que le gouvernement peut focaliser sa politique budgétaire sur les priorités économiques et sociales du pays. Le bas niveau des taux d'intérêt aidant, les frais d'intérêt sur la dette publique sont tombés à 4,6 % du PIB en 1999, contre plus de 6 % au début de la décennie. Le PIB se chiffrant à plus de 900 milliards de dollars en termes nominaux, une variation de 1,4 % est tout à fait significative.
D'après la Mise à jour économique et financière, le service de la dette devrait reculer encore pour se situer à 3,4 % du PIB d'ici 2004-2005, même si la réserve pour éventualités n'est pas utilisée pour réduire l'endettement net. Si elle l'était, comme par le passé, chaque réduction de la dette de 1 milliard de dollars abaisserait de 70 millions de dollars les frais d'intérêt.
Les coûts du service de la dette nuisent à la performance économique du Canada. Il est très important de réduire la dette nationale si, en tant que pays, nous voulons conserver la maîtrise de notre situation financière dans le contexte de la mondialisation de l'économie.
St. John's Board of Trade
On peut également juger de ces tendances en examinant la proportion des recettes de l'État qui passent en service de la dette. En 1998-1999, 26,6 cents par dollar de revenus y étaient consacrés, et cette proportion devrait descendre à 20 cents d'ici 2004-2005. Il n'y a pas si longtemps, le gouvernement fédéral consacrait un tiers de ses revenus au service de sa dette.
La dette nationale coûte cher : taux d'intérêts réels à long terme plus élevés, manque de souplesse budgétaire et affectation au service de la dette de ressources qui seraient plus utiles ailleurs.
Tim O'Neill
Avec un ratio de l'endettement net au PIB de 60,8 %, sur la base des comptes nationaux, le Canada se trouve en deuxième position parmi l'ensemble des pays du G7, après l'Italie, et est bien au-dessus de la moyenne du G7, qui est de 45,8 % pour 1999. Cela souligne l'héritage des déficits accumulés par le passé. Les paiements d'intérêt absorbent toujours une portion excessive de la production nationale et, comme nous le notons plus loin dans le Rapport, le service de la dette est en bonne partie responsable du fait que le fardeau fiscal est relativement plus élevé au Canada qu'aux États-Unis.
Les problèmes du Canada en la matière [sur le plan fiscal] paraissent particulièrement graves quand on fait des comparaisons avec les États-Unis.
David Laidler

La situation des provinces
La situation des provinces du point de vue de l'endettement net et des frais de la dette s'est également nettement améliorée. Sur la base des comptes publics, le ratio de l'endettement net au PIB pour les provinces et les territoires était d'environ 28,3 % en 1998 (moins de la moitié de celui du gouvernement fédéral), et les frais de la dette sont demeurés stables (ils comptaient pour 2,5 % du PIB en 1999) et devraient connaître une légère baisse en l'an 2000. Cette année, la plupart des provinces devraient équilibrer leurs comptes, à l'exception de trois. L'Ontario a choisi de procéder à des allégements fiscaux importants avant d'éliminer son déficit. Cette province devrait équilibrer son budget au cours de l'exercice 2000-2001. La Colombie-Britannique a éprouvé des difficultés d'ordre économique, que nous avons déjà mentionnées, qui l'ont mise à mal du point de vue budgétaire. La Nouvelle-Écosse, quant à elle, a de nouveau accusé un déficit, estimé à 384 millions de dollars, pour 1998-1999, et à 497 millions de dollars, pour 1999-2000. Cette province a également ajusté ses états financiers des deux années précédentes et affiché des déficits. Son gouvernement s'est engagé à équilibrer le budget en l'an 2002-2003.
Il importe de se rappeler que, contrairement au reste du pays, l'économie de la Colombie-Britannique est en récession. [ . . . ] Nous ne cherchons pas à jeter le blâme sur qui que ce soit par cette affirmation. Nous ne revenons pas en arrière pour critiquer tel ou tel gouvernement ou telle ou telle entreprise. Nous cherchons des solutions pour l'avenir.
British Columbia Chamber of Commerce
Emboîtant le pas au gouvernement fédéral, plusieurs provinces ont utilisé des hypothèses économiques prudentes qui semblent donner de bons résultats. Le Québec, par exemple, a dépassé ses cibles budgétaires pour la troisième année de suite, tout comme l'Ontario.
Par ailleurs, de nombreuses provinces ont décidé de procéder à des allégements fiscaux importants ces dernières années, ou envisagent de le faire.
Des pressions provenant des États-Unis
La mondialisation et les ententes de libre-échange ont créé bien des débouchés nouveaux pour les Canadiens, tout en présentant certains défis. La frontière qui sépare le Canada des États-Unis, du moins pour les transactions économiques, perd de sa réalité pour les entreprises canadiennes et les résidents de notre pays.
Dans un numéro récent de Conjonctures, publié par la Banque royale, il est dit que le Canada doit concurrencer les États américains pour attirer des investissements à la fois nationaux et étrangers, ce qui tient du défi6. Si les capitaux deviennent plus mobiles, la fiscalité entre davantage en ligne de compte. Cela est vrai pour les entreprises américaines qui envisagent d'investir au Canada, mais également pour les entreprises canadiennes qui cherchent à investir.
De nos jours, le fardeau fiscal effectif des grandes entreprises du Canada est supérieur à ce qu'il est dans d'autres grands pays, en particulier pour les grandes sociétés du secteur des services. Si l'on n'intervient pas, il y fort à craindre que le régime fiscal des sociétés du Canada, maintenant dépassé, surtout en ce qui concerne les grandes entreprises non manufacturières, suscite un exode des investissements et des sièges sociaux.
Business Council of British Columbia
Au cours des 20 dernières années, l'écart entre les impôts que paient respectivement les Canadiens et les Américains s'est creusé constamment. En 1996, les recettes fiscales représentaient 28,5 p. 100 du PIB aux États-Unis contre 36,8 p. 100 au Canada7.
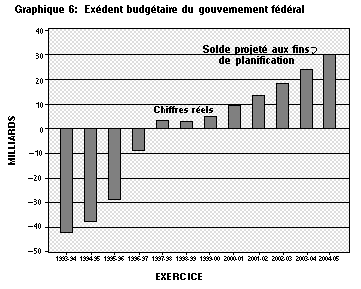
Le graphique 6 illustre l'évolution des finances publiques au Canada. Après avoir accusé un déficit de 42 milliards de dollars en 1993-1994, le gouvernement fédéral compte aujourd'hui dégager un excédent de 30 milliards de dollars en 2004-2005, soit une augmentation de ses recettes de 70 milliards de dollars en à peine plus de 10 ans. Cet optimisme est-il justifié?
La mondialisation présente un potentiel considérable sur le plan de la création d'emplois, de l'augmentation des revenus et de la croissance économique, du développement des ressources humaines, des transferts de technologie et de l'augmentation de la productivité. Elle pourrait permettre de relever le niveau de vie et d'améliorer considérablement la qualité de vie au Canada et dans le monde entier.
Conseil canadien pour la coopération internationale
Tous les indicateurs économiques révèlent une amélioration continue de l'économie à court terme. Par exemple :
- La croissance économique demeure vigoureuse et, en 1999, a été tirée par la demande intérieure.
- Les prix des produits de base se sont fortement redressés en 1999.
- Depuis le début de 1996, l'emploi et le nombre d'heures ouvrées a augmenté d'environ 8 %.
- Le taux de chômage est bien inférieur aux niveaux d'avant la récession.
Même si le redressement des finances publiques fédérales a résulté directement des mesures qu'a prises le gouvernement, et que la situation financière future du pays sera le reflet des politiques poursuivies (examen des programmes et engagements pris envers la réduction de l'endettement), il n'en demeure pas moins que la situation économique du pays joue également un rôle. À cet égard, les prévisions semblent raisonnables.
Je pense que ces projections sont très raisonnables, y compris le fait de prévoir une réserve additionnelle.
Pierre Fortin
Le processus de préparation du budget
La réussite du gouvernement fédéral sur le plan budgétaire provient en grande partie des innovations qu'il a mises en 9uvre dans le domaine il y a quelques années. Le Rapport financier annuel du gouvernement du Canada8 publié récemment, contient une section intitulée « La carte de pointage », dans laquelle les résultats et les prévisions des deux derniers budgets sont comparés. Dans les budgets de 1998 et de 1999, le gouvernement indiquait son intention d'équilibrer le budget pour le dernier exercice. Au lieu de cela, il a dégagé un excédent, la situation économique s'étant révélée meilleure que prévue et les taux d'intérêt, inférieurs aux prévisions. Pour chaque exercice, le Plan de remboursement de la dette visait un objectif financier se fondant sur les éléments suivants :
- des hypothèses de planification économique prudentes soit la moyenne des prévisions économiques du secteur privé disponibles au moment de l'établissement de l'objectif, à laquelle est appliquée une marge de prudence supplémentaire; et
- l'inclusion d'une réserve pour éventualités annuelle, dans le but de couvrir les risques inhérents aux imprévus et les imprécisions inévitables des modèles économiques et financiers servant à traduire les hypothèses économiques en prévisions budgétaires détaillées9.
La réserve pour éventualités, qui sert de coussin en cas d'aléas, s'élève à 3 milliards de dollars. Elle ne doit pas servir à financer les dépenses de programmes. Si elle n'a pas été utilisée à la fin d'un exercice, elle est affectée automatiquement à la réduction de l'endettement.
Maintenant que le gouvernement fédéral a atteint, voire dépassé, les divers objectifs qu'il s'était fixés dans plusieurs budgets consécutifs, il est temps de monter la barre.
Institut des dirigeants financiers du Canada
Les questions stratégiques
Sur cette toile de fond, le Comité a articulé ses conclusions sur les consultations prébudgétaires autour de cinq grands thèmes.
En premier lieu, nous nous sommes préoccupés du processus global de préparation du budget et des paramètres utilisés. Nous sommes conscients que le processus actuel a été utile et a permis au gouvernement d'atteindre ses cibles en matière de déficit, mais il serait peut-être nécessaire d'adopter une nouvelle approche compte tenu des excédents budgétaires qui se sont dégagés et pour promouvoir la croissance économique.
Si, dans l'ensemble, le système des coopératives de crédit prône la prudence en matière de réduction des impôts, nos membres estiment qu'il ne faut pas trop tarder à effectuer certaines réformes.
Centrale des caisses de crédit du Canada
Un tel processus se compose de plusieurs éléments. Il faut d'abord tenir compte de l'horizon temporel; autrement dit, le gouvernement devrait-il conserver un horizon mobile de deux ans ou envisager un horizon de planification à plus long terme, de cinq ans par exemple.
L'autre élément est la nature de la prudence en matière budgétaire. Pour le moment, le gouvernement utilise deux approches différentes, puisqu'il prévoit une réserve pour éventualités, chiffrée en dollars, et applique un facteur de prudence aux hypothèses économiques, lesquelles sont exprimées en points de base. La plupart des Canadiens ne sont pas des économistes de profession et ont de la difficulté à comprendre la notion de prudence appliquée au budget. Par souci de transparence, devrait-on adopter une nouvelle méthode pour empreindre le budget de la prudence économique nécessaire?
Quand on aura réduit la dette et ainsi libéré des sommes actuellement consacrées au paiement des intérêts, on sera en mesure d'offrir des réductions durables de l'impôt sur le revenu des particuliers qui auront des répercussions sensibles sur l'économie nationale.
Metropolitan Halifax Chamber of Commerce
En second lieu, le Comité s'est penché sur la question de la réforme fiscale et des allégements fiscaux. Quelle que soit la priorité accordée à ces questions, la façon dont le gouvernement procédera se répercutera de façon sensible sur l'économie. Si le gouvernement doit s'employer à améliorer la productivité et à soutenir la croissance économique, quels rôles doivent jouer les allégements fiscaux et comment ces derniers doivent-ils être ciblés?
Les baisses d'impôt stimulent fortement la croissance économique. Elles ont également des répercussions directes sur le revenu disponible des ménages canadiens, surtout des familles. C'est là un aspect important dont il faut tenir compte lorsque l'on conçoit une réforme fiscale ou un plan de réduction des impôts.
Si le Comité se soucie à un très haut point de la poursuite de la croissance économique, il s'inquiète également de l'importance de l'infrastructure sociale dans le niveau de vie des Canadiens. L'infrastructure sociale est une composante notable de tout programme de croissance économique. Elle touche directement le bien-être de la population. Nous nous pencherons sur les aspects par lesquels la politique sociale peut contribuer à la santé de la société et de l'économie du pays.
Compte tenu de la rapidité des avancées technologiques et de l'interdépendance croissante des nations, aucun pays ne peut rester statique et jouir d'une économie forte et vibrante. La nouvelle économie ne relève pas de la science-fiction; c'est une réalité. C'est cette nouvelle économie qui a contribué au dynamisme et au faible niveau du chômage et de l'inflation que connaît l'économie américaine.
Les politiques qui convenaient à l'ancienne économie ne conviendront probablement pas à la nouvelle. Il se peut même qu'elles aillent à l'encontre du but recherché. Si nous voulons continuer à améliorer le niveau de vie des Canadiens, il est important et même essentiel que nous puissions exploiter les débouchés et relever les défis que présente cette nouvelle économie.
[ . . . ] beaucoup de Canadiens considèrent que l'une des particularités fondamentales de la société canadienne est qu'elle est plus « douce et modérée» que celle des États-Unis, qu'elle bénéficie d'un régime universel d'assurance-maladie, que les inégalités y sont moins extrêmes et qu'elle soutient les régions et les personnes défavorisées, telles que les sans-abri et les autochtones.
Banque Royale du Canada, Conjonctures
Enfin, le Comité se penchera sur la question de la productivité. C'est un thème que nous avons déjà étudié et qui est le fil conducteur de notre document. La productivité est l'élément qui déterminera notre niveau de vie à l'avenir. Elle établira la mesure dans laquelle nous pourrons profiter des bienfaits de tous les aspects de la société canadienne qui nous sont chers. Dans quelle mesure pouvons-nous avoir une économie vigoureuse et source de prospérité? Quel type de régime de sécurité sociale pouvons-nous nous permettre d'avoir? Comment faire pour assurer un système de soins de santé qui réponde aux besoins d'une population vieillissante?
Notre message au Parlement, au gouvernement et au ministre des Finances sera constitué des réponses que nous trouverons à ces cinq questions. Nous espérons pouvoir contribuer à l'élaboration d'un budget qui aidera grandement l'ensemble des Canadiens.
Le destin du Canada est et sera toujours d'être une société généreuse et bienveillante.
The Economist, 24 juillet 1999, Survey on Canada
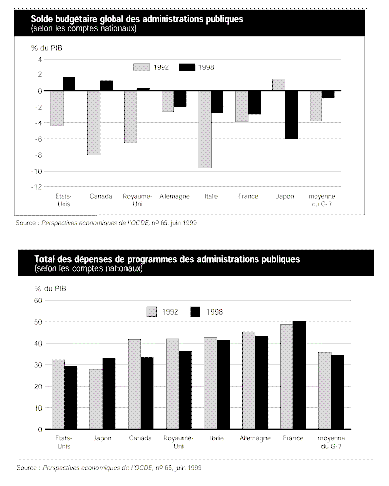
1Statistique Canada, Le Quotidien, 30 novembre 1999.
2 Données tirées de la Mise à jour économique et financière, 2 novembre 1999.
3 L'économie canadienne à l'approche de l'an 2000. Allocution prononcé par Gordon Thiessen, gouverneur de la Banque du Canada, devant la Chambre de commerce de Regina (Saskatchewan), le 23 septembre 1999.
4 Josehp Stiglitz, Must Financial Crises Be This Frequent and This Painful, McKay Lecture, Pittsburg (Pennsylvanie), 23 septembre 1998.
5 Perspectives de l'économie mondiale, septembre 1999.
6 John McCallum, 17 août, 1999, p.
7 Banque Toronto Dominion, Rapport sur les finances publiques au Canada, le 17 août 1999, document s'appuyant sur les données fournies par l'OCDE.
8 Ministère des Finances, 23 septembre 1999.
9 Ibid., p. 22.