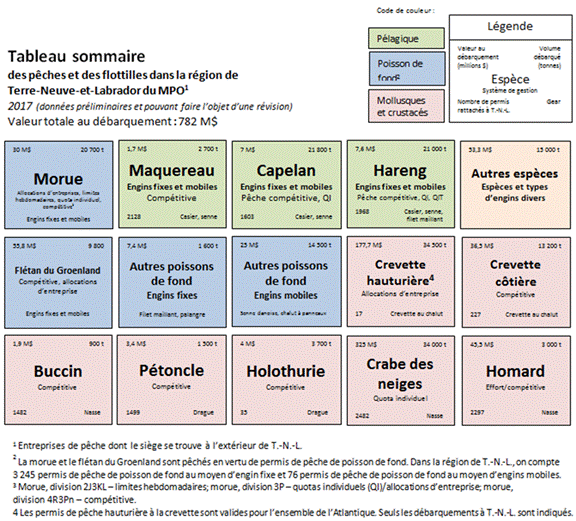FOPO Rapport du Comité
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
INTRODUCTIONLe 26 septembre 2017, le Comité permanent des pêches et des océans de la Chambre des communes (le Comité) a convenu d’entreprendre « une étude examinant la politique de longueur des navires de pêche commerciale tel qu’elle s’applique aux provinces de l’Atlantique[1] ». Il devait étudier les politiques propres à chacun des sujets suivants : les règlements sur le prolongement des bâtiments de pêche commerciale, le transfert de permis de pêche hauturière et extracôtière, la période allouée pour le transfert d’exploitants, la combinaison des quotas et de la capacité des bateaux de pêche commerciale. Du 15 février au 17 avril 2018, le Comité a tenu quatre réunions à Ottawa, et reçu trois mémoires. Parmi les témoins entendus, notons de hauts fonctionnaires de Pêches et Océans Canada (MPO), de Transports Canada et du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST), ainsi que des pêcheurs et des groupes représentant les intérêts de l’industrie de la pêche commerciale marine. Les membres du Comité tiennent à exprimer chaleureusement leur gratitude aux témoins qui sont venus leur faire part de leur expérience et de leur savoir-faire. LE RÉGIME ACTUEL DE DÉLIVRANCE DE PERMIS ET SES OBJECTIFSA. Restrictions relatives à la longueur des bâtimentsLe MPO différencie les flottilles côtières et les flottilles hauturières de pêche commerciale en mer par la longueur hors tout (LHT) des bâtiments utilisés pour la pêche, qui n’est pas la même dans ses différentes régions du Canada atlantique (c.-à-d. le Golfe, les Maritimes, Terre-Neuve-et-Labrador et le Québec)[2]. En général, les bâtiments des flottilles côtières ont une LHT de moins de 65 pi, alors que ceux des flottilles hauturières (et semi-hauturières) ont une LHT de plus de 65 pi[3]. Les exigences en matière de LHT imposées par le MPO font partie des conditions de permis de pêche. En ce qui concerne la région de Terre-Neuve-et-Labrador, les règles relatives au remplacement des bateaux ont été modifiées le 12 avril 2007, ce qui a divisé la flottille côtière en deux sous-flottes : celle de moins de 40 pi (effectivement, 39 pi 11 po) et celle de moins de 65 pi (effectivement, 64 pi 11 po). De plus, les pêcheurs côtiers « peuvent se voir octroyer le droit d’utiliser des bateaux de moins de 27,4 m (90 pi) de LHT dans certaines conditions. »[4] Le paragraphe 2(1) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985[5] (pris en application de la Loi sur les pêches[6]) définit la LHT comme suit : « longueur hors tout : Dans le cas d’un bateau, la distance horizontale entre deux perpendiculaires tirées aux extrémités extérieures de la coque principale du bateau. » [Italique et gras figurant dans l’original]. Cependant, Transports Canada la définit comme étant « la distance entre les points extrêmes avant et arrière du bâtiment[7] ». Transports Canada précise que, pour mesurer la longueur hors tout, il faut inclure le prolongement de la poupe[8] (ou plates-formes) dans le calcul, mais pas l’étrave à bulbe[9]. Ainsi, selon le MPO, la mesure de la LHT (ou longueur) d’un bâtiment ne comprendrait pas le prolongement amovible de la poupe, mais, selon Transports Canada, elle l’inclurait. Pendant la période des pêches concurrentielles, la restriction de la longueur des bâtiments était en partie une façon pour le MPO de limiter l’effort de pêche à des fins de conservation du poisson. Comme il est mentionné dans un document de travail du MPO de 2002 intitulé Règles et procédures relatives au remplacement des bateaux sur la côte de l’Atlantique, « plus le bateau est grand, plus sa capacité de prendre du poisson [et de le ramener vers le rivage] est grande[10] ». Selon le même document de travail, la jauge et le type de bâtiments autorisés dans chaque pêche étaient ceux qui « pourraient soutenir une entreprise viable dans les limites de niveaux d’exploitation soutenable sans pression excessive pour surexploiter les ressources ». Bref, les restrictions relatives à la longueur des bâtiments servaient à réglementer la capacité de pêche. Plus tard, le MPO a présenté un système de gestion par quotas individuels (QI)[11] pour la gestion des prises. Cependant, les limites quant à la longueur de bâtiment sont demeurées en vigueur. Les pêcheurs qui utilisent le système de QI soutiennent qu’il était moins nécessaire de contrôler la longueur des navires et de gérer leurs règles de remplacement en raison de l’introduction des systèmes d’exploitation selon les QI, car la compétitivité a été pratiquement éliminée, et le quota impose une limite plus stricte au nombre de prises que ne le faisaient les restrictions relatives à la longueur des bâtiments[12]. En 2015, la majorité des navires de pêche commerciale maritime inscrits au Canada atlantique mesuraient moins de 35 pi de longueur, et 52 % d’entre eux étaient inclus dans cette catégorie. Le deuxième type de bâtiment le plus nombreux mesurait entre 35 pi et 44 pi 11 po, et 41 % des navires entraient dans cette catégorie. Les catégories de bâtiments de 65 pi et plus (c.-à-d. les bâtiments de la flottille hauturière) représentaient moins de 2 % des navires immatriculés au Canada atlantique en 2015[13]. Le chapitre 4 de la Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’Est du Canada —1996 présente les règles relatives au remplacement des bateaux dont la LHT est de moins de 65 pi, mais il convient de noter que la longueur autorisée dans les diverses pêcheries de l’Atlantique canadien n’est pas uniforme dans l’ensemble des régions du MPO[14]. B. Rôles à jouer à l’égard de la sécurité maritimeComme le prévoit la Loi sur les pêches[15], le ministre des Pêches et des Océans est responsable de la gestion des pêches, mais il « ne réglemente pas la sécurité, la construction ou l’intégrité des navires », celles-ci étant gérées par l’entremise de la réglementation de Transports Canada[16]. En effet, en vertu du Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche[17] (pris en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada[18]), le ministre des Transports est responsable des questions liées à la sécurité maritime (pour les bâtiments et le personnel maritime), même de celles se rapportant aux bâtiments de pêche commerciale. « Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) est un organisme indépendant qui œuvre à rendre les transports plus sûrs en menant des enquêtes sur les modes de transports maritime, de pipeline, ferroviaire et aéronautique[19] ». C. Prolongement des bateauxLes prolongements des bateaux prennent deux formes : on peut les trouver à l’arrière de l’embarcation (c.-à-d. la poupe), ou sur le côté de celle-ci (c.-à-d. le pont). On les ajoute à des bateaux de pêche commerciale pour prolonger la zone de travail ou ranger les engins de pêche. La figure 1 montre un prolongement à l’arrière d’un bateau de pêche commerciale de mer. Figure 1 – Bateau de pêche commerciale avec rallonge arrière mise en évidence
Source : Image fournie par le Bureau de la sécurité des transports du Canada et modifiée par la Bibliothèque du Parlement. Selon une publication du BST, le paragraphe « ajouter une plate-forme arrière pour respecter les restrictions imposées sur la longueur des navires [pour les permis de pêche] » figure sous la rubrique des « dangers qui peuvent se produire quand les besoins de l’exploitation sont incompatibles avec les exigences du MPO ». Cela risque d’avoir une incidence sur la stabilité d’un bateau[20]. Le prolongement de la poupe a été cité dans certains rapports d’enquête maritime du BST comme pouvant compromettre la stabilité des bâtiments et exacerber certaines situations dangereuses. Conformément au paragraphe 3.17(2) du Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche : Dans le cas d’un bâtiment de pêche qui a subi une évaluation de stabilité, l’inscription, dans un registre, des modifications ou séries de modifications qui ont une incidence sur la stabilité du bâtiment sont conservées jusqu’à ce qu’il subisse une nouvelle évaluation de stabilité qui tienne compte des nouvelles modifications ou de la série de modifications[21]. D. Échéances pour les transferts de bateaux et de permisLe Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985[22] énonce (entre autres) les catégories de navires et les paramètres de longueur des bateaux pour les pêches pratiquées dans le Canada atlantique. Cependant, il existe d’autres règlements et d’autres politiques liés aux permis dans cette région. Par exemple : le Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones[23], la Politique d’émission des permis pour la pêche dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador[24] et la Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans la région du Golfe[25]. En raison de ces différents outils de gestion, les pêches commerciales en mer font l’objet d’une gestion unique dans les régions du Canada atlantique du MPO. Comme le montre le tableau 1, l’utilisation de divers outils de gestion peut entraîner des incohérences dans les pratiques des transferts de bateaux et de permis côtiers dans l’ensemble des quatre régions du MPO. Tableau 1 — Normes de service de Pêches et Océans Canada pour les transferts de bateaux et de permis côtiers
Note: a. Les normes de service s’appliquent à partir du moment où le MPO reçoit les documents et les frais requis. Source: Tableau préparé par la Bibliothèque du Parlement à l’aide de l’information obtenue des communications avec Affaires législatives réglementaires, Pêches et Océans Canada, 10 janvier 2018. DÉFIS LIÉS À L’ACTUEL RÉGIME DE DÉLIVRANCE DE PERMISA. Restrictions relatives à la longueur des bâtimentsMark Waddell, du MPO, indique que toutes les pêcheries commerciales maritimes canadiennes ont des restrictions relatives à la longueur des bâtiments[26]. Jacqueline Perry, du MPO, explique que ces restrictions ont été imposées au cours des années 1970 comme moyen de contrôler la capacité de capture pour des raisons de conservation, et étaient « appliquées […] dans les zones concurrentielles. On pouvait ainsi gérer les capacités de pêches des navires[27] ». Comme il a été mentionné précédemment, le MPO a lancé ultérieurement des systèmes d’exploitation selon les quotas individuels pour la gestion des prises, mais les restrictions relatives à la longueur des bâtiments ont été maintenues[28]. Jacqueline Perry a expliqué que ces restrictions sont toujours pertinentes aujourd’hui et qu’elles « favorisent une récolte équitable et ordonnée des ressources, une participation durable et rentable pour le pêcheur moyen et l’adoption de politiques uniques, mais elles tiennent aussi compte du fait que des mesures précises peuvent être nécessaires pour certaines pêches et certains emplacements géographiques[29] ». B. Systèmes de gestion des pêchesJacqueline Perry a aussi expliqué que des pêches concurrentielles ainsi que celles faisant l’objet de quotas individuels se déroulent au Canada atlantique, et qu’un grand nombre de pêcheurs détiennent des permis pour les deux types de pêche, parce que « les entreprises de pêche ont tendance à être polyvalentes, c’est-à-dire qu’elles peuvent pêcher les poissons de fond, les mollusques et les crustacés, les poissons pélagiques, etc.[30] » Selon le MPO, dans le cas des pêches concurrentielles et de celles faisant l’objet de quotas individuels, si l’on augmentait les dimensions autorisées des bâtiments, les pêcheurs pourraient « transporter plus d’équipement et […] pêcher dans des conditions environnementales difficiles, ce qui leur donne […] un accès concurrentiel à des secteurs avantageux[31] ». Collin Greenham, un pêcheur, a ajouté que, en revanche, toutes les espèces clés à Terre‑Neuve sont des pêches faisant l’objet de quotas individuels ou d’une limite de prises par sortie[32], et Glen Best, un pêcheur, a expliqué qu’il ignorait « s’il reste encore des pêches vraiment concurrentielles[33] ». Eldred Woodford, un pêcheur, qui ne souscrivait pas à cette opinion et était plutôt d’accord avec le MPO, a fait savoir qu’il reste de nombreuses pêches concurrentielles à Terre-Neuve-et-Labrador[34]. La figure 2 présente les pêches de la région de Terre-Neuve-et-Labrador et leurs systèmes de gestion (c.-à-d., faisant l’objet de quotas individuels, concurrentiels, etc.). Toutefois, le MPO n’a pas fourni au Comité la proportion précise des pêches sous le régime des quotas individuels et des pêches concurrentielles dans cette région. Figure 2 – Résumé des pêches et des flottilles dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador de Pêches et Océans Canada, 2017
Source: Pêches et Océans Canada, 29 mars 2018. C. Changements antérieurs des restrictions relatives à la longueur des bâtimentsLors de leur audience, les représentants du MPO ont révélé que le Ministère examine au cas par cas les demandes d’exemptions à la longueur des bâtiments provenant des pêcheurs; des facteurs tels que la conservation, la concurrence, la viabilité économique des flottilles et la conception des bâtiments sont pris en compte. Toutefois, Jacqueline Perry a observé que l’attribution de ces exemptions avait soulevé la controverse au sein des flottilles par le passé et que, « [e]n règle générale, le ministère refuse les demandes d’exemption présentées par des particuliers[35] ». Jason Sullivan, un pêcheur, a indiqué que, le 23 mai 2017, « le nouveau formulaire d’immatriculation pour nouveaux navires [a été] émis[36] », ce qui a eu pour effet de modifier de nouveau la définition de la LHT dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador[37]. Le Comité n’a pas obtenu davantage de renseignements qui lui auraient permis de déterminer si la modification du formulaire d’immatriculation des bâtiments avait déclenché l’approche du MPO consistant à rejeter les demandes d’exemption dans des cas particuliers, ou si cette approche existait depuis longtemps déjà. On a aussi expliqué que, bien que le Ministère reçoive des pêcheurs des demandes individuelles d’exemption, « aucune des grandes associations de pêcheurs n’a manifesté un intérêt significatif en ce sens[38] », mais le MPO a indiqué qu’il était ouvert à l’idée de discuter avec les pêcheurs des flottilles à savoir si les règles actuelles des bâtiments sont adaptées ou si des modifications sont nécessaires pour leur type de flottille particulière[39]. Jacqueline Perry a expliqué que ces demandes devraient répondre aux critères suivants : que la majorité des pêcheurs de la flottille devraient appuyer les demandes de modification, et que celles-ci ne pourraient nuire aux objectifs établis en matière de conservation et de gestion des pêches[40]. Eldred Woodford a confirmé ce sentiment et a affirmé qu’à sa connaissance, lorsque la majorité des pêcheurs ont appuyé une modification des politiques, « nous avons très peu de difficulté au fil des ans à obtenir l’appui du MPO[41] ». Le MPO a fourni des exemples de modifications qui ont été apportées aux règles de remplacement des bateaux au fil des ans, entre autres aux restrictions relatives à la longueur des bâtiments ou à la façon de considérer ces modifications : en 2003, à la suite de consultations de l’industrie, on a convenu d’une nouvelle approche fondée sur 10 principes pour modifier les règles de remplacement des bateaux[42]; dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador, ces règles ont été modifiées en 2007 à la suite de consultations auprès de l’industrie[43]; la politique de remplacement des navires dans la région du Québec a été modifiée en 2014 après des « consultations exhaustives auprès du comité de liaison avec le secteur[44] ». Le Comité a également obtenu des exemples de modifications particulières aux flottilles, notamment les changements apportés en 2012 aux navires qui pêchent le crabe des neiges dans la zone 12 (dans le secteur de l’Est du Nouveau‑Brunswick et le golfe Nouvelle-Écosse); depuis ce changement, leur longueur a augmenté jusqu’à un maximum de 100 pi (ou 30,5 m[45]). VISER DES POLITIQUES ÉQUITABLES POUR LES PÊCHEURS DE TOUT LE CANADA ATLANTIQUEA. Délais de transfert des exploitantsRyan Cleary, de la Federation of Independent Sea Harvesters of Newfoundland and Labrador (FISH-NL), a rendu compte de divergences importantes entre les délais de transfert des exploitants. Il a signalé les délais suivants : un an à Terre-Neuve-et-Labrador, un mois en Nouvelle-Écosse et un jour dans la réserve indienne de Conne River, à Terre-Neuve-et-Labrador. Selon lui, ces divergences créent des inégalités économiques pour les pêcheurs côtiers de Terre-Neuve-et-Labrador, et il a recommandé que des délais de transfert uniformes soient mis en place dans les régions du MPO[46]. Roy Careen, un pêcheur, abondait dans son sens. Il a indiqué qu’un pêcheur « en Nouvelle-Écosse, la province voisine, peut louer un bateau pendant un mois et il est ensuite libre d’utiliser son bateau après un mois pour pêcher d’autres espèces. Un pêcheur comme moi à Terre-Neuve doit attendre 12 mois pour faire la même chose[47] ». Henry Thorne, un pêcheur, a expliqué que les pêcheurs devraient pouvoir déterminer le délai de transfert qui leur convient le mieux, et que l’exigence de 12 mois à Terre‑Neuve-et-Labrador « ne fonctionne pas[48] ». Recommandation 1 Que Pêches et Océans Canada envisage de simplifier et d’uniformiser les politiques sur les bâtiments commerciaux dans les régions des Maritimes et de Terre-Neuve-et-Labrador (c.-à-d. les politiques sur la location et sur le transfert de permis des bateaux). B. Longueur des nouveaux bâtimentsJason Sullivan a fait part de son expérience personnelle de la construction d’un nouveau bateau de pêche commerciale destiné à être utilisé dans la région de Terre‑Neuve‑et‑Labrador[49]. Il a mentionné qu’avant de commander le bateau, il avait consulté des représentants du MPO pour s’assurer que le prolongement amovible de sept pieds qu’il commandait satisferait aux conditions d’octroi de permis du MPO, et le service responsable de la délivrance des permis a répondu par l’affirmative. Toutefois, selon les explications de Jason Sullivan, au moment d’immatriculer son embarcation, on lui a indiqué que la définition de « longueur du navire » était en cours d’examen, ce qui remettrait en question l’immatriculation. De même, John Will Brazil, un pêcheur, a expliqué que le Ministère mettait en application une politique qui n’était pas en vigueur lorsqu’il a entrepris d’apporter des modifications à son bateau de pêche, ce qui a causé « beaucoup de stress financier et mental[50] » à sa famille et à lui. Les membres du Comité ont entendu les pêcheurs exprimer leur frustration à l’égard du bureau régional de Terre‑Neuve‑et‑Labrador du MPO et présenter des exemples de changement de politiques et de retards fréquents qui généraient de l’incertitude et un stress inutile. Le BST a expliqué jusqu’où de nombreux pêcheurs vont pour modifier leurs bateaux (p. ex. couper la proue, ajouter un prolongement à l’arrière ou élargir le bateau) « pour en maximiser l’efficacité tout en respectant les limitations de longueur[51] » imposées par le MPO. C. Changement des restrictions relatives à la longueur des bâtimentsLe MPO a donné des raisons socioéconomiques pour limiter la longueur des bâtiments. Les fluctuations des prix et la disponibilité des ressources sont dites cruciales pour la rentabilité des entreprises de pêche, ce qu’exacerbent peut-être les coûts totaux d’achat et d’entretien associés aux bâtiments plus importants. C’est pourquoi « les nouveaux pêcheurs font face à une barrière à l’entrée, c’est-à-dire qu’il en coûte beaucoup plus cher d’acquérir une entreprise de pêche », et les pêcheurs existants peuvent avoir de la difficulté à payer des embarcations plus grandes, car les coûts des ressources fluctuent[52]. Keith Smith, de la Fish, Food and Allied Workers (FFAW), a appuyé cette théorie en stipulant que les pêcheurs de la flottille côtière de Trinity-Bay (Terre‑Neuve-et-Labrador) pensent que, si l’on augmente la taille des navires, « il faudra que la ressource soit plus abondante[53] ». En réponse aux raisons socioéconomiques qu’a invoquées le MPO pour limiter la longueur des bâtiments, Glen Best estime que le rôle du Ministère consiste à gérer les stocks de poissons, pas la compétitivité de l’industrie[54]. Henry Thorne a expliqué que, selon les conditions de la pêche, accroître la longueur des bâtiments pourrait aider les pêcheurs à capturer un poisson de meilleure qualité[55]. Eldred Woodford s’est rangé du côté du MPO et a ajouté que, si l’on devait modifier les restrictions relatives à la longueur des bâtiments pour permettre des navires plus grands, cela serait susceptible de désavantager ceux qui n’ont pas les moyens financiers d’avoir de grands navires, qui pourraient décider de pêcher dans des conditions plus périlleuses[56]. Keith Smith a fait remarquer que plus de 90 % des crabiers de sa région ne veulent pas que la politique sur le remplacement des navires soit modifiée[57]. De l’avis de Jason Sullivan, toutefois, le fait de restreindre « la longueur des navires est une notion obsolète dans le contexte de la pêche moderne[58] ». D’après Ryan Cleary, la majorité des pêcheurs pensent que la longueur des bateaux devrait être unifiée dans tout le Canada atlantique (à 44 pi 11 po), et que la sécurité devrait être le principal élément à prendre en compte[59]. Selon Jason Sullivan, « [à] tout le moins, Terre-Neuve devrait présenter la même longueur de base que toutes les autres provinces de l’Atlantique : 44 pieds 11 pouces[60] ». La longueur de base, à l’heure actuelle, dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador est de 39 pi 11 po. Toutefois, les pêcheurs de flottilles de plus de 45 pi ne favoriseraient pas l’augmentation de la taille des navires, puisque cela donnerait ainsi aux bâtiments de plus grandes dimensions « un avantage dans des pêches concurrentielles […] ou des pêches qui pourraient être concurrentielles à l’avenir[61] ». De l’avis de Collin Greenham, ce sont les pêcheurs et Transports Canada qui doivent délimiter la longueur des bâtiments[62]. Henry Thorne a indiqué qu’en ce qui a trait à la capacité des navires et à l’utilisation de prolongements, « il faudrait laisser ces décisions aux pêcheurs, parce qu’ils ont peut-être besoin d’un plus gros bateau pour assurer leur sécurité et attraper du poisson de meilleure qualité[63] ». Qui plus est, les membres du Comité ont appris qu’un bateau peut respecter les restrictions relatives à la longueur des bâtiments fixées par le MPO, mais que le Ministère ne réglemente pas la largeur des navires, qui peuvent être aussi larges que longs, ce qui accroît considérablement leur capacité de transport. Collin Greenham a expliqué que les nouveaux navires de 39 pi 11 po mesurent 28 pi de large et sont des « boîtes » et « très dispendieux à faire fonctionner[64] ». Recommandation 2 Que Pêches et Océans Canada entreprenne un examen exhaustif et approfondi de la politique relative à la longueur des bâtiments à Terre-Neuve-et-Labrador, y compris les titres de propriété des permis de pêche, les maximums prévus pour l’équipement et le prolongement des bateaux. D. Coopération interministérielleMark Waddell a expliqué que le MPO (y compris la Garde côtière canadienne) et Transports Canada ont signé un protocole d’entente (PE) en 2006, qui a été renouvelé en 2015[65]. Le PE sur la sécurité en mer des pêcheurs commerciaux « fournit un cadre de coopération sur la sécurité maritime[66] » aux deux ministères. Cependant, Jean Laporte, du BST, a expliqué qu’il n’avait été entièrement mis en œuvre qu’il y a quelques années[67]. Malheureusement, on n’a pas précisé aux membres du Comité la date exacte à laquelle il l’a été. Mark Waddell a indiqué que le MPO et Transports Canada avaient signé en 2011 une lettre d’intention en ce qui a trait à la communication d’information à des fins d’élaboration de politiques et de règlements[68]. Patrick Vincent, du MPO, a fait savoir que, dans la région du Québec, un comité permanent sur la sécurité des bâtiments de pêche se réunit tous les ans en février afin d’organiser un atelier à l’intention des pêcheurs sur la sécurité des bateaux. Les participants viennent de Transports Canada, du MPO (y compris la Garde côtière canadienne) et de la « Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail du Québec[69] ». Plusieurs témoins ont souligné des incohérences dans la façon dont le MPO et Transports Canada mesurent la longueur des bâtiments. Un bateau de pêche peut être réputé avoir deux longueurs distinctes, l’une mesurée par le MPO et respectant les conditions des permis de pêche (qui n’inclurait aucune rallonge arrière amovible), et l’autre par Transports Canada (qui comprendrait une telle rallonge[70]). Luc Tremblay, de Transports Canada, a confirmé que le PE avait obligé ce ministère et le MPO à discuter de ces incohérences. Selon lui, « [i]l est bien évident que nous n’avons pas encore réussi à uniformiser[71] ». Jacqueline Perry a expliqué que, sur le plan opérationnel, le MPO consulte Transports Canada « au quotidien pour obtenir des réponses à certaines questions précises[72] ». Malgré les témoignages des représentants des deux ministères, les membres du Comité s’interrogent néanmoins sur l’efficacité des consultations ministérielles actuelles sur les politiques qui intéressent particulièrement les pêcheurs, comme les effets des restrictions relatives à la longueur des bâtiments sur les enjeux maritimes liés à la sécurité. E. Sécurité maritimeJean Laporte a expliqué au Comité que, « au cours des 5 dernières années, 43 personnes ont perdu la vie à la suite d’un accident de pêche », ce qui correspond à une moyenne de 8,6 décès par année[73]. Le Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche[74] récemment mise à jour, est entré en vigueur le 13 juillet 2017 et Jane Weldon, de Transports Canada, a expliqué qu’il « répond à plusieurs recommandations en suspens du Bureau de la sécurité des transports concernant la sécurité des bateaux de pêche et cherche à réduire le nombre de décès dans ce secteur[75] ». Toutefois, Mervin Wiseman, du FISH-NL, a indiqué que le MPO n’avait pas donné suite aux recommandations formulées dans les rapports d’enquête du BST et a recommandé de former un organisme d’arbitrage pour assurer leur mise en œuvre[76]. 1. Immatriculation des bâtimentsJean Laporte a expliqué que, d’après les enquêtes du BST sur la sécurité maritime, certains bâtiments qui avaient eu des incidents ou des accidents se voyaient délivrer un permis de pêche par le MPO, mais que les navires utilisés n’étaient pas enregistrés auprès de Transports Canada. Il a signalé que cette situation révélait une « lacune dans la coordination de la surveillance réglementaire[77] », ajoutant qu’en Colombie-Britannique, le MPO « a mis en œuvre une politique régionale pour s’assurer que les bateaux de pêche commerciale enregistrés auprès du MPO sont également immatriculés par [Transports Canada] », mais que cette politique n’est pas appliquée à l’échelle du pays. Enfin, il a recommandé, qu’avant « de délivrer un permis de pêche, Pêches et Océans Canada devrait vérifier auprès de Transports Canada si le bateau en question a été enregistré et s’il a fait l’objet d’une évaluation de stabilité ». Mark Waddell a fait remarquer que le MPO cherchait à « mettre à jour [ses] politiques opérationnelles » à cet égard[78]. Jean Laporte a ajouté que le Ministère ne semble pas songer à la sécurité lorsqu’il octroie des permis de pêche[79]. Recommandation 3 Que, d’ici la fin de l’année civile 2018 ou le plus tôt possible après cette date, le ministre des Pêches et des Océans et celui des Transports remettent au Comité un résumé écrit des commentaires reçus et des mesures que leurs représentants et eux auront cernées, en vue d’harmoniser et de rationaliser les processus qu’utilisent les entités fédérales pour accorder des permis pour des navires commerciaux, et d’accroître la sécurité des exploitants et des équipages de ces navires. Recommandation 4 Que le ministre des Pêches et des Océans ou celui des Transports ou les deux entreprennent d’adopter les modifications réglementaires ou législatives nécessaires à la mise en œuvre des mesures mentionnées visant à harmoniser et à rationaliser les processus qu’utilisent les entités fédérales pour accorder des permis pour des navires commerciaux, et à accroître la sécurité des exploitants et des équipages de ces navires. 2. Modification des bâtiments et évaluation de leur stabilitéJean Laporte a précisé que les prolongements de navires ne sont pas en soi dangereux[80]. La modification des bâtiments ne nécessite pas l’approbation préalable de Transports Canada[81], mais le Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche exige que l’on effectue une nouvelle évaluation de la stabilité si un prolongement est ajouté à un bâtiment ou si d’autres travaux prévus peuvent nuire à celle-ci. Cependant, les membres du Comité ont appris qu’il appartient au pêcheur de trancher à savoir si oui ou non il y a des répercussions sur la stabilité des bâtiments[82]. En fait, Luc Tremblay a expliqué que « certaines modifications ne suffisent pas à elles seules pour justifier une réévaluation, ce sont des modifications mineures. Par contre, d’autres modifications sont suffisamment importantes pour qu’une évaluation soit nécessaire, et parfois, c’est l’addition de toutes les petites modifications qui justifiera la modification[83] ». Toutefois, on n’a pas indiqué au Comité le délai au terme duquel une nouvelle évaluation de la stabilité du navire est requise après que des modifications influant sur la stabilité sont effectuées. Si une modification touche effectivement la stabilité du navire et qu’il n’y a pas de nouvelle évaluation de la stabilité, les membres du Comité ont appris que le prolongement peut contribuer à des incidents ou à des accidents[84]. Les exemples fournis dans les enquêtes du BST portent sur les prolongements de la poupe qu’utilisent les pêcheurs pour augmenter la capacité des navires et, parallèlement, satisfaire aux conditions de permis du MPO. Marc-André Poisson, du BST, a réitéré que les prolongements des navires ne constituent pas une « défaillance en un seul point » à l’origine d’incidents ou d’accidents, mais sont l’un des nombreux problèmes qui peuvent y contribuer[85]. 3. Politiques et inspectionsLes témoignages des représentants du BST révèlent que le MPO n’a pas mis en place de processus pour évaluer les répercussions de ses politiques sur les enjeux maritimes liés à la sécurité[86]. Jean Laporte a recommandé que Transports Canada et le MPO travaillent davantage de concert pour améliorer la situation[87]. Collin Greenham a présenté un exemple appuyant le témoignage des représentants du BST. Il a indiqué qu’en raison des règlements du MPO, les pêcheurs de Terre‑Neuve‑et‑Labrador sont obligés de pêcher le flétan noir « plus loin en haute mer, sans protection, et dans les eaux dangereuses de l’Atlantique Nord », près du plateau continental, alors que, par le passé, ils pêchaient ce poisson près du rivage. Collin Greenham a confirmé que, bien que les zones dans lesquelles ils pêchent aient bien changé, les limitations à la longueur des navires n’ont pas été modifiées en conséquence[88]. Derek Butler a corroboré ce témoignage en expliquant que « [t]out a changé dans l’industrie, y compris la distance de pêche par rapport à la côte, la quantité de poissons transportés, la nature de l’équipement des bateaux, les bômes, la taille des cales, etc.[89] ». Luc Tremblay a précisé que Transports Canada réglemente les navires de toutes tailles, mais que « plus le navire est grand, plus il subit d’inspections obligatoires[90] ». Il a ajouté que, même si les navires plus petits doivent respecter les dispositions de sécurité établies par règlement, le Ministère n’a pas à les inspecter afin de veiller au respect de ces dispositions. Jason Sullivan a indiqué que les petits bateaux de pêche « ne relèvent pas des normes CSI » [Inspection canadienne des navires à vapeur], qui impose une inspection tous les quatre ans et exige le transport d’équipement de sécurité supplémentaire[91] ». Il a ajouté que « seuls ceux de plus de 12 m » relèveraient des règles de la CSI. Selon Jason Sullivan, les politiques générales du MPO sur les pêches (p. ex. sur les baux à court terme et les restrictions relatives à la longueur des bâtiments) devraient s’appliquer également aux pêcheurs de l’ensemble du Canada atlantique, comme les politiques de Transports Canada, car cela « nous mettrai[…]t tous sur un pied d’égalité ». Il a poursuivi en expliquant que des politiques différentes offrent certains avantages et désavantages concurrentiels aux pêcheurs des provinces de l’Atlantique[92]. Ryan Cleary a abondé en ajoutant qu’il faudrait uniformiser la longueur des navires et de même que les autres orientations politiques (p. ex. celles qui ne sont pas propres à la gestion des pêches) à l’échelle du Canada atlantique pour garantir l’équité[93]. Mervin Wiseman a expliqué que « [l]a politique sur la longueur des bateaux et l’émission des permis, qui avait été conçue afin de répondre aux besoins des pêches des années 1970, n’a malheureusement pas été fondamentalement adaptée à l’environnement d’exploitation d’aujourd’hui[94] ». Selon Roy Careen, « les temps ont changé, et les politiques, les règles et la réglementation mises en place par le MPO et notre syndicat doivent aussi changer[95] ». F. Combinaison de quotas et jumelage de titulaires de permis de pêcheDes témoins ont indiqué aux membres du Comité que, dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador, les pêcheurs peuvent combiner des quotas et conclure des ententes de jumelage de permis de pêche. Certaines entreprises « combinent leurs quotas », auquel cas « un même bateau peut exploiter plusieurs QI », et les pêcheurs qui procèdent à des « jumelages de permis » « ne combinent pas de façon permanente leurs quotas, mais, au sein de certaines flottilles, ils sont autorisés à travailler ensemble et à pêcher ensemble sur un même bateau[96] ». Henry Thorne est d’avis que les combinaisons sont « l’une des meilleures politiques que le MPO a mises en place pour aider les pêcheurs » et que les pêcheurs peuvent s’en servir pour développer leur entreprise et prendre leur retraite dans la dignité[97]. Cependant, on considère que la règle qui consiste à imposer un plafond au nombre de permis pouvant être jumelés empêche les pêcheurs de développer leur entreprise et qu’à la place, les transformateurs achètent les permis[98]. De plus, Collin Greenham a signalé que combiner les quotas pourrait alléger le fardeau financier des entreprises qui voient leur quota réduit d’une année à l’autre[99]. Glen Best a expliqué que les accords de jumelage de permis entraînent la diminution des coûts d’exploitation et rendent les entreprises de pêche plus rentables[100]. Jason Sullivan a précisé que, à l’instar des combinaisons, selon les ententes de jumelage de permis, un nombre maximum d’entreprises peuvent être jumelées (cinq au total), ce qui restreint les possibilités pour les pêcheurs[101]. Les membres du Comité ont appris que certaines pêcheries n’autorisent pas les ententes de partenariat, telles que celle de la pêche du thon, qui est « une pêche soumise à des quotas individuels, et chaque bateau se voit remettre un certain nombre d’étiquettes[102] ». Roy Careen a expliqué qu’en 2017, son fils et lui se sont vu attribuer chacun sept étiquettes pour le thon, mais qu’ils ne pouvaient les jumeler et attraper le thon pour ces 14 étiquettes à bord du même navire, ce qui les a obligés tous deux à se rendre dans le golfe dans leurs navires respectifs, une activité coûteuse. Les membres du Comité se sont aussi fait dire que les pêcheurs dans la région des Maritimes ont d’autres moyens de combiner leurs entreprises (p. ex. les partenariats, le cumul et la mise en commun des avantages), mais que ceux-ci diffèrent de ceux de la région de Terre‑Neuve‑et‑Labrador[103], ce qui révèle un autre manque de cohérence entre les régions du MPO. G. ConsultationLes membres du Comité ont entendu de nombreux témoignages sur le processus de consultation du MPO et qui le Ministère choisi de consulter. Ryan Cleary a recommandé que le Ministère consulte directement les pêcheurs côtiers au sujet des politiques, et pas uniquement leurs agents négociateurs[104]. À cet égard, Ryan Cleary était favorable au fait que le MPO tienne 20 rencontres avec des pêcheurs de Terre-Neuve-et-Labrador à l’automne et à l’hiver 2017 pour rétablir le contact avec eux. Il a ensuite ajouté que « le FISH-NL recommande que de telles réunions soient tenues de façon continue[105] ». Roy Careen a également souligné que le MPO et le syndicat devraient consulter les pêcheurs directement visés par les changements de politiques et de réglementation[106]. De l’avis des membres du Comité, étant donné les coûts élevés des investissements que doivent effectuer les pêcheurs (p. ex. pour acheter un bateau, des engins de pêche, du matériel de surveillance et encore), il est important que le gouvernement fédéral crée des conditions favorables pour assurer une certitude à long terme au sein de l’industrie; le fait de modifier les restrictions relatives à la longueur des bâtiments et d’autres politiques d’octroi de permis sans procéder à une vaste consultation ne favorise pas cette certitude. Les membres du Comité encouragent le MPO à continuer de consulter régulièrement et de manière générale les pêcheurs et leurs agents négociateurs afin d’entendre leurs observations avant de mettre en œuvre la modification de politiques ou de règlements. Recommandation 5 Que toute révision ou modification de la politique fasse l’objet de consultations de fond avec les titulaires de permis et les entreprises de pêche commerciale du Canada atlantique. Recommandation 6 Que Pêches et Océans Canada tienne régulièrement de vastes consultations et des dialogues avec les titulaires de permis et des entreprises, particulièrement en ce qui a trait aux modifications des politiques qui les toucheraient, que ce soit en personne, ou au moyen de bulletins de vote ou de sondages envoyés par la poste, ou encore en utilisant des ressources en ligne. Recommandation 7 Que Pêches et Océans Canada s’engage à tenir des consultations plus ciblées concernant la politique sur la longueur des bâtiments et le processus d’octroi de permis. Ces consultations devraient être inclusives et impliquer les pêcheurs côtiers, les groupes de pêcheurs et leurs agents négociateurs. Des efforts devraient être faits afin de fixer la date des consultations lorsque le nombre maximum d’acteurs peuvent y participer, et que celles-ci s’appuient sur une initiative proactive visant à atteindre ceux qui n’ont pas participé aux séances de consultation. Recommandation 8 Que Pêches et Océans Canada et Transports Canada, s’il y a lieu, adoptent immédiatement un processus visant à faire participer les pêcheurs côtiers, les groupes de pêcheurs et leurs agents négociateurs, et à tenir des consultations avec eux, afin de déterminer toutes les politiques fédérales qui les régissent et qui les contrôlent, mais qui n’ont d’autre utilité à l’égard de la gestion de la pêche que de frustrer les pêcheurs et de nuire aux relations entre le MPO et eux. Dans ce contexte :
CONCLUSIONLe MPO gère les ressources halieutiques en contrôlant les prises à l’aide de divers outils, y compris (mais sans s’y limiter) les conditions de permis, les quotas, le nombre de sorties en mer, ainsi que les limites quotidienne et hebdomadaire, et les restrictions concernant les engins. Avec toutes ces mesures en place, les membres du Comité ne sont pas convaincus de la nécessité des limitations de longueur de bâtiment imposées aux pêcheurs côtiers. De plus, ils sont d’avis que les politiques et les règlements sur les permis de pêche côtière ne devraient pas différer d’une province de l’Atlantique à l’autre. Cependant, ils reconnaissent également qu’il faut l’appui d’une majorité de pêcheurs côtiers pour toute modification aux politiques et aux règlements actuels en matière de permis. Les membres du Comité ont appris que les pêcheurs ont besoin de plusieurs permis de pêche pour que leur entreprise puisse demeurer viable, et que l’industrie de la pêche côtière a beaucoup changé au fil des ans, que ce soit à l’égard des espèces pêchées, des engins de pêche utilisés, des zones dans lesquelles la pêche est autorisée, du milieu des affaires ou des caractéristiques démographiques des participants. De l’avis des membres du Comité, compte tenu de ces conditions changeantes, le régime d’octroi de permis doit être souple et pouvoir s’adapter. Cependant, la sécurité maritime devrait être un facteur important dans la modernisation des politiques et des règlements sur la délivrance de permis. [1] Chambre des communes, Comité permanent des pêches et des océans, Procès-verbal, 26 septembre 2017. [2] Pêches et Océans Canada [MPO], « Politique sur la préservation de l’indépendance de la flottille de pêche côtière dans l’Atlantique canadien », Préservation de l’indépendance de la flottille de pêche côtière. [3] Chaque pêcherie peut aussi présenter sa propre définition des flottilles de pêche côtière, semi-hauturière et hauturière, qui peut inclure des restrictions quant au poids et à la longueur du bâtiment. [4] Les conditions s'appliquent, à condition que les pêcheurs fassent partie des flottes suivantes : la flottille de pêche à plein temps du crabe des neiges dans les divisions 2J3KL de l’OPANO (Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest); la flottille de pêche d’appoint du crabe des neiges dans les divisions 2J3K de l’OPANO et de grande pêche d’appoint du crabe des neiges dans la division 3L de l’OPANO; les titulaires de permis de petite pêche d’appoint du crabe des neiges dans la division 3L de l’OPANO qui détiennent également un permis de pêche de la crevette nordique; la flottilles de pêche de la crevette nordique et de la crevette du golfe dans la division 4R de l’OPANO; ou les titulaires de permis de pêche de la crevette nordique qui ne détiennent pas de permis de pêche du crabe des neiges. Voir : MPO, Politique de délivrance des permis de pêche pour la région de Terre-Neuve-et-Labrador. [5] Règlement de pêche de l’Atlantique, 1985, DORS/86-21. [6] Loi sur les pêches, L.R.C., 1985, ch. F-14. [7] Transports Canada, Bâtiments de pêche – Capitaines et officiers de pont de quart, mars 2011. [8] Le prolongement de la poupe se trouve à l’arrière du bâtiment. [9] L’étrave à bulbe est située à l’avant de certains bâtiments, juste au-dessous de la ligne de flottaison. Elle vise à aider à réduire la résistance et à augmenter la vitesse. [10] MPO, Règles et procédures relatives au remplacement des bateaux sur la côte de l’Atlantique — Document de travail, 2002. [11] Le MPO définit les systèmes de gestion par quotas individuels (QI) comme ceux « par lesquels les titulaires de permis se voient attribuer une quantité de prises prédéterminée du total autorisé des captures ». Voir : MPO, Analyse économique. [12] MPO, Règles et procédures relatives au remplacement des bateaux sur la côte de l’Atlantique — Document de travail, 2002. [13] MPO, Info Embarcations, Info Embarcations 2015. [14] MPO, Chapitre quatre, Règles et procédures relatives au remplacement des bateaux sur la côte de l’Atlantique — Document de travail, 2002. [15] Loi sur les pêches, L.R.C., 1985, ch. F-14. [16] Communication personnelle avec Affaires législatives et réglementaires, MPO, 10 janvier 2018. [traduction] [17] Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche, C.R.C., ch. 1486. [18] Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26. [19] Bureau de la sécurité des transports du Canada [BST], Page d’accueil. [21] Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche, C.R.C., ch. 1486. [22] Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985, DORS/86-21. [26] Mark Waddell, directeur général intérimaire, Politiques sur les pêches et les permis, MPO, Témoignages, 15 février 2018. [27] Jacqueline Perry, directrice générale régionale de Terre-Neuve-et-Labrador, MPO, Témoignages, 15 février 2018. [28] MPO, Règles et procédures relatives au remplacement des bateaux sur la côte de l’Atlantique — Document de travail, 2002. [29] Jacqueline Perry, directrice générale régionale de Terre-Neuve-et-Labrador, MPO, Témoignages, 15 février 2018. [30] Ibid. [31] Ibid. [32] Collin Greenham, pêcheur, à titre personnel, Témoignages, 27 mars 2018. [33] Glen Best, pêcheur, à titre personnel, Témoignages, 27 mars 2018. [34] Eldred Woodford, pêcheur, à titre personnel, Témoignages, 27 mars 2018. [35] Jacqueline Perry, directrice générale régionale de Terre-Neuve-et-Labrador, MPO, Témoignages, 15 février 2018. [36] Jason Sullivan, pêcheur, à titre personnel, Témoignages, 22 mars 2018. [37] Jason Sullivan a expliqué au Comité qu’au moment où il avait d’abord envisagé d’ajouter une rallonge arrière à son nouveau navire, le service d’octroi des permis du MPO l’avait avisé que, si cette rallonge était amovible, elle ne serait pas visée par la définition de la LHT. Le Comité n’a pas obtenu de plus amples renseignements sur la façon dont cette longueur est mesurée dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador depuis que sa définition a changé. [38] Jacqueline Perry, directrice générale régionale de Terre-Neuve-et-Labrador, MPO, Témoignages, 15 février 2018. [39] Au sens de la Politique de délivrance des permis de pêche pour la région de Terre-Neuve-et-Labrador, une flottille inclut les pêcheurs qui capturent la même espèce, « ont des bateaux de la même catégorie de taille ou pêchent dans la même zone de pêche ». [40] Jacqueline Perry, directrice générale régionale de Terre-Neuve-et-Labrador, MPO, Témoignages, 15 février 2018. [41] Eldred Woodford, pêcheur, à titre personnel, Témoignages, 27 mars 2018. [42] Le MPO et les représentants de l’industrie ont convenu de 10 principes pour la modification des restrictions relatives à la longueur des bâtiments pour certaines flottilles. Ces principes sont les suivants : « la conservation, la capacité de la flotte, les mécanismes d’autoadaptation, la sécurité des bateaux, la viabilité des entreprises, les parts des flottilles, les membres principaux, les mécanismes facilement applicables, la conformité aux politiques et objectifs en matière de délivrance de permis et la prise en compte des entreprises détentrices de multiples permis dans le Canada atlantique ». Voir : Mark Waddell, directeur général intérimaire, Politiques sur les pêches et les permis, MPO, Témoignages, 17 avril 2018. [44] Jacqueline Perry, directrice générale régionale de Terre-Neuve-et-Labrador, MPO, Témoignages, 15 février 2018. [45] Ibid. [46] Ryan Cleary, président, Federation of Independent Sea Harvesters of Newfoundland and Labrador [FISH‑NL], Témoignages, 22 mars 2018. [47] Roy Careen, pêcheur, à titre personnel, Témoignages, 27 mars 2018. [48] Henry Thorne, pêcheur, à titre personnel, Témoignages, 27 mars 2018. [49] Jason Sullivan, pêcheur, à titre personnel, Témoignages, 22 mars 2018. [50] John Will Brazil, pêcheur, à titre personnel, Témoignages, 22 mars 2018. [51] Jean Laporte, administrateur en chef des opérations, BST, Témoignages, 22 mars 2018. [52] Patrick Vincent, directeur général régional, Région — Québec, MPO, Témoignages, 15 février 2018. [53] Keith Smith, membre du Conseil côtier, Fish, Food and Allied Workers [FFAW], Témoignages, 27 mars 2018. [54] Glen Best, pêcheur, à titre personnel, Témoignages, 27 mars 2018. [55] Henry Thorne, pêcheur, à titre personnel, Témoignages, 27 mars 2018. [56] Eldred Woodford, pêcheur, à titre personnel, Témoignages, 27 mars 2018. [57] Keith Smith, membre du Conseil côtier, FFAW, Témoignages, 27 mars 2018. [58] Jason Sullivan, pêcheur, à titre personnel, Témoignages, 22 mars 2018. [59] Ryan Cleary, président, FISH-NL, Témoignages, 22 mars 2018. [60] Jason Sullivan, pêcheur, à titre personnel, Témoignages, 22 mars 2018. [61] Ryan Cleary, président, FISH-NL, Témoignages, 22 mars 2018. [62] Collin Greenham, pêcheur, à titre personnel, Témoignages, 27 mars 2018. [63] Henry Thorne, pêcheur, à titre personnel, Témoignages, 27 mars 2018. [64] Collin Greenham, pêcheur, à titre personnel, Témoignages, 27 mars 2018. [65] Mark Waddell, directeur général par intérim, Émission des permis et planification, MPO, Témoignages, 15 février 2018. [66] Gouvernement du Canada, PE entre le MPO, la GCC et TC, Le point sur la sécurité en mer — Comité permanent sur la sécurité des bateaux de pêche du Conseil consultatif maritime canadien, décembre 2017. [67] Jean Laporte, administrateur en chef des opérations, BST, Témoignages, 22 mars 2018. [68] Mark Waddell, directeur général par intérim, Émission des permis et planification, MPO, Témoignages, 15 février 2018. [69] Patrick Vincent, directeur général régional, Région — Québec, MPO, Témoignages, 15 février 2018. [70] Marc-André Poisson, directeur, Enquêtes maritimes, BST, Témoignages, 22 mars 2018. [71] Luc Tremblay, directeur exécutif, Surveillance réglementaire des bâtiments canadiens et sécurité nautique, Transports Canada, Témoignages, 22 mars 2018. [72] Jacqueline Perry, directrice générale régionale de Terre-Neuve-et-Labrador, MPO, Témoignages, 17 avril 2018. [73] Jean Laporte, administrateur en chef des opérations, BST, Témoignages, 22 mars 2018. [74] Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche, C.R.C., ch. 1486. [75] Jane Weldon, directrice générale, Sécurité et sûreté maritimes, Transports Canada, Témoignages, 22 mars 2018. [76] Mervin Wiseman, membre, FISH-NL, Témoignages, 22 mars 2018. [77] Jean Laporte, administrateur en chef des opérations, BST, Témoignages, 22 mars 2018. [78] Mark Waddell, directeur général intérimaire, Politiques sur les pêches et les permis, MPO, Témoignages, 17 avril 2018. [79] Ibid. [80] Jean Laporte, administrateur en chef des opérations, BST, Témoignages, 22 mars 2018. [81] Jane Weldon, directrice générale, Sécurité et sûreté maritimes, Transports Canada, Témoignages, 22 mars 2018. [82] Ibid. [83] Luc Tremblay, directeur exécutif, Surveillance réglementaire des bâtiments canadiens et sécurité nautique, Transports Canada, Témoignages, 22 mars 2018. [84] Marc-André Poisson, directeur, Enquêtes maritimes, BST, Témoignages, 22 mars 2018. [85] Ibid. [86] Jean Laporte, administrateur en chef des opérations, BST, Témoignages, 22 mars 2018. [87] Ibid. [88] Collin Greenham, pêcheur, à titre personnel, Témoignages, 27 mars 2018. [90] Luc Tremblay, directeur exécutif, Surveillance réglementaire des bâtiments canadiens et sécurité nautique, Transports Canada, Témoignages, 22 mars 2018. [91] Jason Sullivan, pêcheur, à titre personnel, Témoignages, 22 mars 2018. [92] Ibid. [93] Ryan Cleary, président, FISH-NL, Témoignages, 22 mars 2018. [94] Mervin Wiseman, membre, FISH-NL, Témoignages, 22 mars 2018. [95] Roy Careen, pêcheur, à titre personnel, Témoignages, 27 mars 2018. [96] Jacqueline Perry, directrice générale régionale de Terre-Neuve-et-Labrador, MPO, Témoignages, 17 avril 2018. [97] Henry Thorne, pêcheur, à titre personnel, Témoignages, 27 mars 2018. [98] Ibid. [99] Collin Greenham, pêcheur, à titre personnel, Témoignages, 27 mars 2018. [100] Glen Best, pêcheur, à titre personnel, Témoignages, 27 mars 2018. [101] Jason Sullivan, pêcheur, à titre personnel, Témoignages, 22 mars 2018. [102] Roy Careen, pêcheur, à titre personnel, Témoignages, 27 mars 2018. [103] Verna Docherty, gestionnaire par intérim des politiques de délivrance de permis et des opérations, Région — Maritimes, MPO, Témoignages, 17 avril 2018. [104] Ryan Cleary, président, FISH-NL, Témoignages, 22 mars 2018. [105] Ibid. [106] Roy Careen, pêcheur, à titre personnel, Témoignages, 27 mars 2018. |
|||||||||||||||||