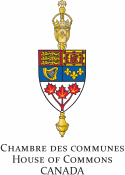:
Je déclare ouverte la huitième séance de la présente session parlementaire du Comité permanent de la sécurité publique et nationale.
Avant de commencer, je tiens à souhaiter la bienvenue à nos visiteurs au fond de la pièce — il s'agit d'élèves du secondaire de Montréal, de Toronto, d'Ottawa, de Winnipeg et peut-être d'autres endroits. Ils sont ici avec le CAPCJ. Nous promettons de nous comporter de façon exemplaire pendant que vous nous regardez. Merci d'être venus.
Nous poursuivons notre étude des blessures de stress opérationnel et du syndrome de stress post-traumatique, en particulier chez les agents de la sécurité et les premiers intervenants. Nous recueillons des renseignements pour bien comprendre comment ces deux éléments touchent les agents de la sécurité publique.
Nous avons invité des témoins à venir nous faire part de leurs connaissances, du point de vue de la théorie ou de la recherche, mais aussi de leur expérience clinique. Dans notre premier groupe, nous accueillons Nicholas Carleton, professeur associé au département de psychologie à l'Université de Regina, et Mike Dadson, directeur exécutif et clinique au sein du Veterans Transition Network, de Langley, en Colombie-Britannique.
Nous allons commencer par vous, monsieur Carleton. Si vous pouviez prendre 10 minutes pour prononcer vos remarques liminaires, nous enchaînerons tout de suite après avec M. Dadson.
:
Merci beaucoup de m'avoir invité à parler avec vous aujourd'hui. Je suis psychologue clinicien agréé et professeur à l'Université de Regina. Je suis spécialisé dans les questions d'anxiété, de traumatisme et de douleur puisque j'étudie les réactions traumatiques depuis les 15 dernières années.
Mes travaux de recherche sont subventionnés, entre autres, par les Instituts de recherche en santé du Canada et la Saskatchewan Health Research Foundation. J'ai une petite pratique privée dans laquelle je traite principalement des agents de la GRC et des agents de la sécurité publique qui souffrent du syndrome du stress post-traumatique et d'autres blessures de stress opérationnel.
Les Canadiens ont reconnu le besoin de déployer des efforts soutenus pour appuyer nos militaires; nos agents de la sécurité publique, qui englobent une vaste gamme de personnes, comme les policiers, les pompiers et les paramédics; ainsi que les agents de correction, les répartiteurs du 911, et les anciens combattants et leurs familles. Comme vous l'a mentionné mon collègue, le Dr Sareen, nous avons réalisé des progrès particulièrement importants pour ce qui est d'offrir des services de santé mentale aux militaires, mais il nous en reste autant à faire pour en offrir aux groupes de la sécurité publique.
Nos agents de la sécurité publique ont des milieux de travail uniques, où l'exposition à des événements traumatisants est la règle plutôt que l'exception. L'exposition n'est pas la même pour les agents de la sécurité publique et le personnel militaire — elle n'est ni meilleure ni pire, seulement différente. Nos agents de la sécurité publique sont déployés au pays dans un milieu où l'incertitude est constante, souvent pendant des décennies. Ils jouent des rôles complexes, comme ceux de protéger, d'appliquer la loi et de faire du développement communautaire. En conséquence, ils ont besoin de ressources spéciales et spécialisées pour assurer leur bonne santé mentale.
J'ai récemment vu nos groupes de premiers intervenants faire preuve d'un leadership exceptionnel en matière de santé mentale, et ce, de façon constante. En effet, on observe une hausse des demandes de la part de tout le personnel de la sécurité publique pour offrir des solutions, des interventions et des stratégies préventives fondées sur des preuves afin d'améliorer la santé mentale. La justification est claire: ils en sont presque rendus à un point critique. La hausse dramatique des blessures de stress opérationnel signalées commence à l'emporter sur la stigmatisation qui a empêché tant de personnes de parler pendant si longtemps. Cependant, ces mêmes personnes ont aussi souligné le besoin de solutions fondées sur des preuves appuyées par des travaux de recherche d'experts.
Notre gouvernement a pour mandat de développer le plan d'action national coordonné sur le syndrome du stress post-traumatique pour notre personnel de la sécurité publique. Ce mandat a été suivi, le 29 janvier, de la table ronde nationale sur le syndrome du stress post-traumatique tenue par notre à l'Université de Regina.
La table ronde a réuni des chercheurs éminents avec des dirigeants du gouvernement et de la sécurité publique, tous en faveur d'élaborer de toute urgence un plan d'action national coordonné grandement axé sur la recherche.
Les Canadiens sont dotés d'un mécanisme national établi pour appuyer et coordonner la recherche dans le domaine de la santé et en communiquer les résultats. L'Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans, l'ICRSMV, représente un réseau de 40 universités et facilite le développement de nouvelles capacités de recherche et l'application efficace des connaissances.
Au cours des 18 derniers mois, l'Université de Regina, membre fondateur de l'ICRSMV, travaille en étroite collaboration avec les chefs de file de la recherche d'autres universités membres, des universitaires internationaux éminents et nos dirigeants de la sécurité publique pour mettre en place un institut canadien de recherche et de traitement axé sur la sécurité publique, afin d'appuyer les politiques, pratiques et programmes fondés sur des preuves en ce qui touche la santé mentale des intervenants de la sécurité publique.
L'institut qui se développe rapidement compte une gamme de leaders dans des disciplines variées provenant d'universités de partout au Canada, ainsi que des représentants clés de la Commission de la santé mentale du Canada, de l'ICRSMV, de la GRC, de l'Association des anciens de la GRC, de l'Association canadienne des chefs de police, de l'Association canadienne des policiers, des Chefs paramédics du Canada, de l'Association des paramédics du Canada, de l'Association canadienne des chefs de pompiers et de l'Association internationale des pompiers, pour n'en nommer que quelques-uns.
Les membres de l'institut évaluent déjà l'incidence de la mise en oeuvre du Programme En route vers la préparation mentale avec le service de police de Regina et d'autres, et font de la recherche sur l'intégration officielle de la santé mentale dans les politiques, l'éducation, les pratiques et le soutien. Ils ont mené à bien le premier de plusieurs rapports d'évaluation de programmes après avoir évalué les preuves relatives aux programmes d'intervention en cas de crise et de soutien par les pairs pour les premiers intervenants canadiens et le déploiement de ces derniers.
En ce moment, l'institut s'apprête, dans un premier temps, à mener un sondage national sur la prévalence des maladies mentales pour raffiner les estimations radicalement différentes associées au personnel de la sécurité publique.
Deuxièmement, il doit demander à Statistique Canada de mener une étude de faisabilité à l'appui d'une enquête épidémiologique de référence en ce qui touche la santé mentale des intervenants de la sécurité publique.
Troisièmement, il doit mener une étude pilote des traumatismes simulés haute fidélité et des scénarios de formation pour que nous puissions mieux comprendre, au plan empirique et expérimental, les variables de risque et de résilience des blessures de stress opérationnel, ce qui permettra d'éclairer les procédures en matière de stress post-traumatique.
Quatrièmement, il doit mettre en oeuvre une évaluation biospychosociale exhaustive et continue des cadets et des officiers de la GRC au moyen de technologies de pointe pour évaluer l'incidence de l'intégration des interventions fondées sur des preuves pendant leur formation initiale, leur service et leur apprentissage continu. La recherche sera sans précédent au niveau mondial et au plan historique: elle fournira des renseignements cruciaux concernant les variables de risque et de résilience pour informer les médecins spécialistes de la santé mentale du personnel de la GRC, d'autres agents de la sécurité publique, de l'ensemble de leurs familles et, au bout du compte, de tous les Canadiens.
L'institut peut aussi trouver des solutions pour essayer de faire face à la difficulté de répondre à la demande de services de santé mentale, comme ceux qui ont été récemment soulignés par l'ombudsman militaire. La solution requiert que nous fassions trois choses: premièrement, que nous nous assurions que les patients ont accès à des spécialistes appropriés qui utilisent correctement des traitements fondés sur des preuves; deuxièmement, que nous appuyions la formation et l'accréditation de plus de spécialistes; et troisièmement, que nous soutenions les travaux de recherche qui améliorent les soins fondés sur des preuves et trouvions des modèles de prestation de soins novateurs.
À cette fin, l'institut s'apprête aussi à prolonger les travaux faits à l'Université de Regina sur la thérapie cognitivocomportementale par Internet, qui peut accroître notre accès à des traitements fondés sur des preuves hautement efficaces, privés, populaires et largement déployables dans le cadre d'un système national de soins par paliers pour tout le personnel de la sécurité publique. Si les ressources le permettent, l'essai pilote de ce système en Saskatchewan et au Québec peut commencer dès 2017; notre personnel de la sécurité publique pourrait bénéficier d'un accès pancanadien dès 2018.
L'institut peut aussi insister sur les pratiques fondées sur des preuves. En effet, bien des agents de la sécurité publique semblent recevoir des soins qui ne sont pas appuyés par des données empiriques, et c'est inadmissible. En conséquence, les membres de l'institut ont travaillé avec l'Alberta Paramedic Association pour élaborer de nouvelles normes pour la prestation de soins de santé mentale à leurs membres. Nous avons aussi vu qu'on s'efforçait d'améliorer la qualité des soins de santé mentale et l'accès par l'intermédiaire de l’Association canadienne des thérapies cognitives et comportementales, qui s'affaire à accréditer les praticiens et à assurer l'accès à des soins fondés sur des preuves. Voilà quelques exemples de personnes qui travaillent d'arrache-pied pour faire en sorte que les personnes qui ont le plus besoin de nos pratiques fondées sur des preuves y aient accès.
Les solutions pour le personnel de la sécurité publique éclairent les solutions pour la population en général. En outre, il s'agit de nos dirigeants communautaires et de nos modèles qui peuvent faciliter les changements d'attitude et les actions en faveur de la santé mentale à l'échelon communautaire au Canada. Nous avons des dirigeants, dont vous tous, qui veulent faire fond sur les initiatives que j'ai soulignées aujourd'hui.
J'estime qu'une réponse complète et adéquate au mandat du exige que nous fassions ce qui suit: premièrement, que nous investissions dans l'institut canadien de recherche et de traitement axé sur la sécurité publique; deuxièmement, que nous fassions en sorte que l'institut demeure indépendant tout en collaborant avec les gouvernements fédéral et provinciaux, les universitaires, les décideurs et les principaux intervenants; et troisièmement, que nous encouragions les traitements par l'intermédiaire de thérapies cognitivocomportementales par Internet et de cliniques offrant des soins par paliers qui sont financées grâce à des partenariats entre les organismes fédéral et provinciaux et les commissions d’indemnisation des travailleurs.
L'institut peut alors faire quatre choses: premièrement, utiliser des preuves pour guider un plan d'action national pour la recherche et le traitement axé sur le personnel de la sécurité publique qui tienne compte du leadership de notre personnel de sécurité publique; deuxièmement, faciliter les projets de recherche interdisciplinaires ponctuelles et longitudinales pour que nous puissions parler avec autorité des variables associées au risque, à la résilience et au rétablissement; troisièmement, élaborer des ressources en ligne fondées sur des preuves reconnues à l'échelle nationale pour les blessures de stress opérationnel afin d'appuyer nos clients, leurs familles, et leurs fournisseurs; et quatrièmement, travailler en collaboration afin de faciliter l'accès pancanadien du personnel de la sécurité publique à des normes minimales de prévention fondée sur des preuves, des interventions précoces et des programmes de traitement.
Nous pouvons et nous devons faire mieux. Ces solutions ne sont plus ambitieuses; elles sont atteignables. En nous servant de notre personnel de la sécurité publique comme modèles dans nos collectivités, nous pouvons mener et diffuser de meilleures évaluations et procéder à de meilleures interventions. Nous pouvons aussi opter pour des stratégies préventives qui réduisent les risques, accroissent la résilience et améliorent la santé mentale, d'abord pour ces membres essentiels de nos collectivités et, ensuite, pour l'ensemble des Canadiens.
Nous nous réjouissons à la perspective d'avoir votre appui. Merci.
Je suis Mike Dadson, professeur adjoint à l'Université de la Colombie-Britannique et membre du comité consultatif pour le centre de thérapie de groupe et de traumatisme. Je suis aussi le directeur clinique et le directeur national du Programme de transition des vétérans. En outre, je suis membre du conseil de l'International Society for the Study of Trauma and Dissociation. Je suis un aumônier ordonné et je gère un centre de traitement des traumatismes et un centre de formation ici à Langley, en Colombie-Britannique, qui offre des services à environ 200 personnes par semaine.
Je suis ici pour parler au Comité principalement à titre de clinicien et à la lumière de mon expérience du Programme de transition des vétérans, programme expérientiel de groupe en opération depuis 18 ans qui a fait l’objet de travaux de recherche et a été élaboré par l'intermédiaire de l’Université de la Colombie-Britannique. Au fil des ans, nous avons été témoins des difficultés qu’éprouvent les anciens combattants et les premiers intervenants à solliciter des traitements de santé mentale. Nous constatons la présence de nombreux obstacles qui les en empêchent. Nous sommes d’avis qu’il existe de nombreux traitements appuyés par de la recherche et fondés sur des données empiriques, mais que bien des premiers intervenants n’y ont pas accès, car ils doivent faire preuve d’un niveau si élevé de compétence et subir tant de pression que s’ils finissent par craquer, montrer des signes de faiblesse ou demander de l’aide, ils sont perçus comme étant des ratés ou des faibles qui sont incapables de continuer à travailler. Demander de l’aide pourrait mettre leur carrière en péril. Nous l’avons vu régulièrement avec les anciens combattants: même s’ils souffrent clairement de blessures de stress opérationnel ou même de syndrome de stress post-traumatique, ils continueront à travailler dans leur domaine et s’abstiendront de demander des traitements précoces, car ils croiront que le faire pourrait nuire à leur carrière, alors qu’un traitement précoce pourrait, au contraire, la prolonger.
Ils gèrent des situations très hors normes. Ils ne vivent pas un accident ou un événement isolé; ils sont exposés à de multiples situations de stress traumatisantes ou à incidence élevée. Ils disent souvent, même lorsqu’ils parlent à des thérapeutes, qu’ils vont leur causer du tort en raison des horreurs dont ils ont été témoins. La façon dont ces expériences traumatisantes ou ces blessures de stress opérationnel le rôle sexospécifique masculin ou les attentes masculines de leur postes se recoupent, car ils sont hautement… On s’attend à ce qu’ils se comportent selon les normes masculines, c’est-à-dire qu’ils soient des hommes forts, fonceurs, compétents, indépendants qui ne demandent pas d’aide. Ce ne sont pas des agneaux, ce sont eux qui, dans les faits, offrent de l’aide. Lorsqu’ils ont eux-mêmes besoin d’aide, ils ont beaucoup de mal à en demander parce que cela va à l’encontre de la culture même de leur milieu de travail.
En réponse à cette question, le Programme de transition des vétérans a été élaboré en fonction des besoins des premiers intervenants. Nous avons rencontré les premiers intervenants, nous avons travaillé avec eux et nous leur avons demandé ce qui les aiderait à apaiser ces préoccupations. Nous offrons un programme multidisciplinaire axé sur une approche fondée sur les forces et une aide par les pairs. Nous travaillons en groupes et nous ne faisons pas qu’aider ou offrir de la thérapie à des particuliers, nous leur enseignons des techniques très élémentaires et des techniques de communication de base qui peuvent les aider à s’entraider. Cette démarche, en soi, normalise l’expérience, ce qui importe vraiment pour ces premiers répondants parce que cela les aide à reconnaître qu’ils peuvent rester les guerriers qu’ils ont l’impression d’être, tout en faisant place à la possibilité qu’ils pourraient aussi avoir besoin d’aide.
Ils trouvent aussi qu’il est facile de se parler entre eux de leurs expériences, des horreurs dont ils ont été témoins, car ils savent qu’ils les ont vues chacun de leur côté. Ils ne disent rien de nouveau lorsqu’ils discutent en groupe. Cela normalise leurs expériences et fait en sorte qu’ils puissent recevoir de l’aide. Nous atténuons les expériences en leur offrant attention et soutien, ce qui réduit l’anxiété et l’évitement pour leur permettre d’approfondir ensemble leurs expériences communes. Cela les aide à normaliser l’expérience et à ensuite faire le travail qu’ils ont besoin de faire.
Dans les faits, ils se mettent au défi l’un l’autre de faire le travail, car ils estiment que cela fait partie de leur nouvelle bataille, de leur nouvelle carrière ou de leur nouvel emploi.
Nous utilisons des termes qui déstigmatisent. Par exemple, au lieu de dire « aller en thérapie », nous parlons de « tenter de poser des valises » ou « simplement essayer de passer à travers une situation ». Au lieu de parler d’expériences émotionnelles, nous parlerons d’expériences sensorielles. Nous commencerons par le corps et leurs réactions physiques, que nous normaliserons.
Nous croyons qu’une des raisons pour lesquelles notre programme est aussi couronné de succès est que la moitié des personnes ont été encouragées à y participer par d’autres anciens combattants ou intervenants de première ligne. C’est donc dire qu’elles viennent déjà avec l’idée de recevoir de l’aide qui diffère un peu de celle qu’elles ont reçue par le passé. Autrement dit, elles ne se heurteront pas aux mêmes obstacles qu’avant.
Voici un exemple d’obstacle pour des anciens combattants. Pour recevoir des traitements pour le syndrome de stress post-traumatique, ils doivent montrer qu’ils en souffrent vraiment. Ils doivent donc répéter leur histoire un certain nombre de fois, encore et encore, à diverses personnes qui pensent vraiment en termes cliniques. Elles ne sont pas là pour offrir de la thérapie, mais bien pour déterminer si les gens sont admissibles, s’ils souffrent bien du syndrome de stress post-traumatique. Il n'est pas utile de répéter un récit ad nauseam dans ce contexte. Cela crée de l’évitement — ils finissent même par éviter de demander de l’aide.
Nous voyons beaucoup d’anciens combattants qui ne reçoivent même pas de services d’ACC parce qu’ils ne peuvent pas suivre ce processus. Leur blessure les empêche de le faire, si bien qu’ils ne reçoivent pas de traitements.
En conséquence, 50 % de nos participants n’ont pas fait appel à Anciens Combattants Canada pour bénéficier de leurs services. Nous avons un taux de fidélisation de 90 %, ce qui signifie que peu de gens qui ont suivi notre programme l’ont abandonné. Lorsqu’ils le font, c’est habituellement pour des raisons familiales ou médicales. Je connais une seule personne qui a abandonné le programme parce qu’elle avait décidé de ne pas continuer; il ne lui convenait pas.
Nous sélectionnons les participants, alors nous n’acceptons pas tout le monde. Si une personne est très suicidaire ou souffre de troubles psychotiques, elle ne participera pas à notre programme. Elle doit d’abord régler certains de ces problèmes. Cela dit, le taux de réussite de notre programme est très élevé. Sur plus de 600 participants, pas un seul ne s’est enlevé la vie.
À ce stade, ce qui nous préoccupe surtout ce sont les listes d’attente partout au Canada qui font en sorte que certains anciens combattants peuvent attendre un an ou deux, selon leur région, pour pouvoir suivre notre programme. Cependant, s’ils le suivent, nous sommes persuadés qu’ils risquent beaucoup moins de se suicider, dans la mesure que maintenant nous… Notre recherche montre que le nombre de cas de dépression a baissé et que les tendances suicidaires sont minimisées.
Ce qui me préoccupe, c’est qu’une des personnes sur la liste d’attente se suicide… Je suis troublé de penser qu’on aurait pu l’aider considérablement alors qu’elle attendait de pouvoir obtenir nos services.
Nous sommes sur le terrain, en quelque sorte. Nous sommes ici pour parler au Comité de certaines des difficultés auxquelles nous voyons les anciens combattants faire face alors que nous leur offrons des traitements thérapeutiques.
Je pense que je vais m’arrêter ici.
:
J'ai une certaine expérience avec les services correctionnels. Nous invitons les premiers répondants à participer à nos programmes. Nous nous retrouvons donc avec un ou deux premiers répondants et, parfois, un agent des services correctionnels se joint à nous.
Les agents des services correctionnels sont comme les répondants de la police, les ambulanciers ou les pompiers, sauf que leur contexte est différent. L'effet qu'un traumatisme aura sur eux dépend du contexte dans lequel ils se trouvent.
Comme mon collègue l'a dit à propos des vétérans, ils sont comme des instruments contondants. Les militaires seront exposés à des situations horribles et traumatisantes. Ils les vivront avec des camarades et ils quitteront les lieux avec des camarades. Cette présence agit souvent comme tampon par rapport à l'expérience vécue, car ils sentent qu'ils font partie d'une communauté solide ou d'une meute, ce qui leur donne de la force.
Les choses sont un peu différentes pour les policiers, puisqu'ils sont constamment sur le terrain et qu'ils se servent de l'engagement social comme d'un moyen pour contrôler les foules. Ils doivent sans arrêt scruter leur environnement afin de repérer les menaces possibles et, lorsqu'ils en voient une, ils doivent se garder de répondre avec un instrument contondant. Ils doivent recourir à une réponse plus nuancée. Ils se servent de leurs aptitudes sociales afin de dédramatiser un incident ou d'empêcher qu'une situation se transforme en quelque chose de violent. La violence, si elle a lieu, se manifeste très rapidement. Il leur faut alors décider s'ils vont se battre ou battre en retraite, ou s'ils vont prendre l'initiative de l'agression afin de tenter de mater cette autre agression, ou d'être en mesure de contenir la situation ou de la contrôler.
Dans le cas des pompiers, le contexte est différent. C'est la même chose pour ceux qui travaillent dans le système carcéral, le contexte est différent. En fait, le milieu carcéral devient l'endroit où ils vivent. Ils voient des choses comme des détenus qui s'automutilent, des détenus qui se suicident à petit feu et d'autres qui essaient de faire la vie dure aux gardiens. Ils sont exposés à ce genre de choses sur une base quotidienne et ils doivent fournir des soins à ces personnes qui essaient délibérément de les blesser sur le plan psychologique.
M. Nicholas Carleton: Je suis d'accord.
:
Je peux parler un peu de cela et de l'un des plus grands problèmes auxquels nous sommes confrontés à l'heure actuelle.
Tout d'abord, oui, je crois que nous pourrions faire plus. Deuxièmement, je pense que certaines organisations travaillent dans le sens de ces mesures de prévention.
L'un des plus grands problèmes a été et continue d'être que nous ne disposons pas de données soutenues par la pratique aussi solides qu'il le faudrait pour donner une réponse claire à une question comme celle-ci: admettons que vous pouviez vous permettre une poignée d'interventions, lesquelles choisiriez-vous pour assurer la meilleure prévention possible, pour améliorer la résilience et pour réduire les risques?
Nous pouvons vous donner les grandes lignes, mais l'une des choses que nous avons constatées, c'est qu'il est très difficile d'entreprendre les études longitudinales prospectives qui nous permettraient de « croquer » les personnes avant qu'elles ne soient blessées, de cerner quels aspects sont associés à chaque membre d'un grand groupe et de faire un suivi au fil des ans. Si nous avions ce type de renseignements, nous serions en mesure de vous répondre: « Telle variable est associée à la résilience, et telle autre, au risque. » Il faut pour cela un engagement très fort de la part des chercheurs, des cliniciens, de l'État et des organismes de sécurité publique. C'est un effort collectif. C'est l'une des choses qui nous réjouissent et que nous nous apprêtons à commencer avec la GRC; il s'agit de renseignements d'une importance cruciale.
Nous pouvons quand même vous communiquer certaines généralités. Toutefois, les détails qui nous permettraient de fournir de l'information très pertinente nécessiteront des investissements dans la recherche à long terme, ce qui demande aussi des collaborations de grande envergure. C'est ce que nous essayons de faire et c'est ce que nous amorcerons cette année. Nous espérons donc être en mesure de vous donner de meilleures réponses dans un avenir très rapproché.
:
Si je puis ajouter quelque chose à cela, c'est qu'il est difficile de réussir ces recherches et d'y accéder. Selon moi, l'une des raisons qui expliquent cette difficulté est le fait que le mandat de ces organisations — l'armée, la GRC et les services des incendies — est de servir et de protéger. Pour les militaires, on dit« la mission, l'équipe, soi-même »; le soi arrive en dernier. Cela fait partie de la culture organisationnelle et de cette culture « hypermasculine » dont les militaires ont besoin pour faire leur travail. Ces principes font partie de la zone tampon. Malheureusement, ce sont eux qui nous empêchent d'être en mesure d'investir le milieu pour mener à bien nos recherches, car ils peuvent aussi engendrer une culture qui n'accorde pas d'attention particulière à la prévention et au rétablissement. L'accent est mis sur la réussite de la mission ou sur la protection du public.
Lorsque des vétérans, des membres de la GRC et des pompiers n'arrivent pas à être à la même hauteur que la norme, à vivre la norme, ils se retrouvent en retrait de cette culture et ils commencent à s'enfoncer. Ils sont déjà blessés alors qu'on ne les a même pas reconnus en tant que tels, mais lorsqu'ils n'arrivent plus à cacher leur blessure, ils commencent à sortir de cette culture. Ils s'aliènent du groupe qui les aidait à temporiser la manifestation de leurs symptômes. C'est quand ils sortent du groupe que l'on peut commencer à voir les effets des blessures de stress opérationnel ou l'état de stress post-traumatique.
Il est difficile pour une organisation comme le ministère de la Défense nationale de faire de la recherche et de chercher à protéger les gens quand son attention et son mandat portent sur la mission et non sur la protection. À l'évidence, on cherche à protéger des vies, mais cela n'empêche pas les gens de subir des blessures de stress opérationnel. En effet, leur stress est continuel: leur mandat est de réussir la mission.
Ce qui se passe pour les vétérans — surtout quand ils commencent à sortir du groupe et qu'ils n'arrivent plus à fonctionner avec la même intensité qu'auparavant —, c'est qu'on leur confie des rôles ou des travaux qui sont beaucoup moins exigeants que ce à quoi ils étaient habitués, et qu'ils se voient déjà comme « finis ». À présent, ce sont eux les blessés. Ils sont perçus — et la culture corrobore cette vision — comme des blessés, ce qui ne fait qu'empirer leurs symptômes. Il est impératif de commencer à les traiter à ce moment-là, soit avant qu'ils sortent de l'armée ou qu'ils présentent une demande d'aide au ministère des Anciens Combattants. Je n'ai pas encore vu d'empressement particulier de la part de ces organismes pour aider ces personnes à trouver leurs maux et pour traiter ces maux avant qu'ils ne s'aggravent.
M. Nicholas Carleton: Si vous me le permettez, je vais poursuivre dans la même veine que M. Dadson...
Excusez-moi. Allez-y.
:
Mesdames et messieurs les membres du Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes, je vous remercie de me donner l'occasion de vous faire part aujourd'hui de mon point de vue sur cet important sujet.
Mon nom est Donna Ferguson. Je suis psychologue clinicienne et directrice de la pratique en psychologie au Centre de toxicomanie et de santé mentale à Toronto. Le CAMH est l'un des plus grands centres universitaires de sciences de la santé sur la santé mentale et la toxicomanie. Nous combinons les soins cliniques, la recherche et l'éducation pour transformer la vie des personnes souffrant de troubles mentaux et de toxicomanie.
Le trouble de stress post-traumatique, ou TSPT, est un problème important sur lequel nous mettons beaucoup d'efforts au CAMH. Le TSPT survient quand une personne vit directement un événement traumatisant ou en est témoin, ou quand une personne est exposée directement de façon répétée ou extrême aux détails horrifiants d'un événement traumatisant. Le TSPT perturbe le fonctionnement social et professionnel ainsi que d'autres sphères de la vie. Les symptômes du TSPT sont l'évitement des événements traumatisants, des pensées envahissantes, des flashbacks et des cauchemars, et un état d'hyperéveil, dont une très grande irritabilité et des troubles du sommeil.
Un Canadien sur 10 développera un TSPT, mais ce nombre est deux fois plus élevé chez les premiers répondants en raison du risque d'exposition quotidienne aux facteurs de stress traumatiques. Le taux de suicide des premiers répondants est aussi élevé. Entre le 29 avril et le 31 décembre 2014, 27 premiers répondants se sont enlevé la vie. En mars 2015, ce nombre était passé à 40 au Canada. C'est un problème croissant et urgent auquel nous devons trouver une solution.
Alors, comment peut-on s'assurer que les premiers répondants aux prises avec un TSPT reçoivent l’aide dont ils ont besoin pour retrouver la santé et revenir au travail? Nous n’avons pas toutes les réponses, mais je vous partage aujourd’hui trois recommandations qui, selon moi, aideront les premiers répondants atteints d’un TSPT sur leur chemin vers la guérison.
Premièrement, toutes les provinces doivent adopter une loi qui permet aux premiers répondants d'avoir plus rapidement accès à leurs prestations d'accident du travail. De nombreux premiers répondants ont dû prouver que les événements traumatisants qu’ils ont vécus en milieu de travail avaient contribué directement à leurs symptômes et à leur diagnostic de TSPT, ce qui les a empêchés d'avoir accès rapidement à des soins appropriés. En février 2016, l'Ontario a déposé un projet de loi visant à créer une présomption que le TSPT diagnostiqué chez les premiers répondants est automatiquement lié au travail. Le retrait de l'obligation de prouver le lien de causalité entre le TSPT et l'événement vécu en milieu de travail accélérera le traitement des réclamations par les compagnies d’assurances et, par conséquent, l’accès au traitement et aux ressources. Si elle est adoptée, cette loi obligera aussi les employeurs à mettre en place des plans de prévention du TSPT dans leur milieu de travail. Nous devons nous assurer que tous les premiers répondants canadiens sont protégés par une loi semblable.
Deuxièmement, les premiers répondants doivent être en mesure de travailler dans des milieux sécuritaires sur le plan psychologique et exempts de toute stigmatisation. De nombreux premiers répondants souffrent d'un TSPT, mais n'ont jamais été diagnostiqués. Certains peuvent vivre au quotidien avec les symptômes du TSPT et ressentir une grande détresse, mais ils ont peur d’en parler à leurs amis, à leur famille, à leurs collègues ou à leurs supérieurs par crainte de représailles. Ils ont peur que leurs collègues les rejettent et que leurs supérieurs les rétrogradent injustement.
Certaines personnes ont encore beaucoup de difficulté à parler de leur santé mentale, surtout les premiers répondants dont le travail leur demande d'être inébranlables en tout temps. Les premiers répondants font partie d’une culture qui accepte mal la faiblesse. Nombreux sont ceux qui croient que le travail passe en premier et que leurs vies, leurs sentiments et leurs familles arrivent deuxièmes. Cette attente est accompagnée d'une très forte pression exercée sur les personnes qui sont régulièrement les témoins d'effondrements, de destructions, de décès et de carnages. Il est difficile de travailler dans ces conditions chaque jour, mais ça l'est encore plus pour les personnes atteintes d'un TSPT qui doivent composer avec des souvenirs envahissants d'événements traumatisants liés au travail, des rêves provoquant un sentiment de détresse ou des cauchemars, des troubles du sommeil et de l'hyperéveil. Et c'est encore plus difficile quand vos collègues et vos supérieurs vous disent de « prendre sur vous » et de tourner la page.
Il est important de créer un milieu de travail positif pour les premiers répondants, un milieu qui accorde la priorité à la santé mentale, qui lutte contre la stigmatisation et qui donne de la psychoéducation sur le TSPT. De telles mesures empêcheront que le TSPT s'aggrave et peut-être même que des personnes se suicident, favoriseront un rétablissement rapide et aideront à réussir le retour au travail ou à assurer le maintien au travail. Parmi les mesures qui peuvent être appliquées pour créer un milieu de travail positif, on retrouve l'adoption des normes de la Commission de la santé mentale visant à assurer la sécurité psychologique dans le milieu de travail ou l'élaboration d'une stratégie de santé mentale pour les employés qui comprend de la formation et de la psychoéducation sur les symptômes et les défis du TSPT.
J'ai un exemple de cas pour vous. Une femme âgée de 48 ans a travaillé comme policière pendant près de 21 ans. Elle a souffert de symptômes de TSPT non diagnostiqué pendant les cinq premières années de sa carrière. Elle a continué de travailler malgré ces symptômes, vivant un événement traumatisant après l'autre jusqu'à ce qu’une dernière goutte d'eau fasse déborder le vase. Elle a vécu un événement traumatisant qu'elle ne pouvait plus mettre derrière elle et elle a cessé de travailler. Elle a consulté son médecin de famille qui lui a prescrit des médicaments pour traiter son TSPT et elle a reçu un diagnostic officiel de TSPT.
En quelques mois, sa demande a été acceptée par la CSPAAT et elle a été référée à un psychologue de sa région. Un an plus tard, elle a repris le travail à temps plein, mais avec des tâches modifiées. Elle a été affectée à des tâches administratives et elle ne pouvait pas travailler sur la route en première ligne pendant au moins deux ans. Elle a eu de la difficulté à retourner au travail, car ses collègues l'agaçaient et lui jouaient constamment des tours. Ses supérieurs se sont moqués d'elle et on l'accusait de se dérober à son devoir. Ses collègues l'inondaient de la quasi-totalité de la paperasserie et lui disaient que c'était son nouveau travail. Ce fut une période très difficile pour elle, car elle ne disposait pas du soutien dont elle avait besoin pour se rétablir et continuer à travailler. Elle consultait un psychologue et s'était rétablie avant de revenir au travail, mais elle a vécu une rechute. Elle était démoralisée et ses symptômes se sont détériorés en raison du manque de soutien au travail.
Ma troisième recommandation est que tous les premiers répondants aient accès à un traitement factuel pour le TSPT. Il est non seulement important que les premiers répondants souffrant d'un TSPT puissent avoir accès à du soutien et à des traitements, mais aussi qu'ils puissent avoir accès au bon traitement qui leur permettra de se rétablir.
Le traitement factuel du TSPT comprend la thérapie cognitivo-comportementale. Un premier type de thérapie, appelée « exposition prolongée », met en jeu l'exposition en imagination ou le traitement de l'événement traumatisant afin d'aider à réduire l'intensité et la fréquence des pensées envahissantes, des flashbacks et des rêves provoquant un sentiment de détresse.
Un autre type de thérapie cognitivo-comportementale est l'exposition in vivo ou réelle. Pour ce type de traitement, le thérapeute aide le client à établir une échelle ou une hiérarchie des situations traumatisantes que le client évite tout en évaluant le niveau de détresse de chaque situation et en travaillant à réduire ce niveau de détresse au fil du temps.
Quand un premier répondant qui a reçu un diagnostic de TSPT peut avoir accès à ces traitements, ses chances de réussir son retour au travail et de revenir à une vie productive sont bonnes.
Une étude américaine sur la thérapie cognitivo-comportementale et les résultats à long terme pour le TSPT a indiqué que les patients ayant suivi une thérapie cognitivo-comportementale ont remarqué une réduction de l’intensité de leurs symptômes et, surtout, de leurs symptômes d’évitement plus marqués que ceux qui ont reçu du counseling par encouragement.
J'ai un autre exemple de cas. Un homme âgé de 40 ans travaille comme policier depuis près de huit ans. Il souffre d'un TSPT non diagnostiqué depuis un événement traumatisant où lui et sa famille ont été menacés par un suspect qu'il venait d’arrêter. La menace et le harcèlement présumé de ce suspect ont duré plusieurs mois avant que de nombreux symptômes de TSPT commencent à se manifester. Finalement, après une année complète de consultations avec un médecin de famille, un diagnostic de TSPT a été posé et des médicaments ont été prescrits pour en atténuer les symptômes. Après quelques mois, sa demande à la CSPAAT a été approuvée, il a été retiré du travail et on me l'a référé pour une évaluation et un traitement psychologiques. J'utilise la thérapie cognitivo-comportementale avec ce client en plus de certaines techniques de gestion de la colère et d'apprentissage social afin de diminuer sa très grande irritabilité qui était un problème important pour lui. Après près d'un an de traitements, il était prêt à commencer son processus de retour au travail. Il a effectué un retour progressif au travail dans de nouvelles fonctions avant de reprendre son ancien poste de policier à temps plein.
Depuis son retour à temps plein, sa qualité de vie s'est améliorée. Il a maintenant une meilleure relation avec sa famille et il socialise à nouveau avec ses amis. Sa colère est contrôlée et il est entièrement fonctionnel au travail, s'occupant même de certains problèmes liés à la stigmatisation dans son milieu de travail. Il reçoit des éloges de ses supérieurs pour son travail. Cet homme m'a dit que la thérapie cognitivo-comportementale que j'ai utilisée lui a sauvé la vie et qu'il m'était très reconnaissant de lui avoir permis de reprendre sa vie avec sa famille et ses amis ainsi que son travail dont il est très fier et dans lequel il est très bon.
Mesdames et messieurs les membres du Comité, je vous remercie à nouveau de m’avoir donné l’occasion de vous parler aujourd’hui. Nous sommes reconnaissants de votre travail visant à élaborer un cadre ou un plan d’action national pour les premiers intervenants souffrant du SSPT. J’espère que les renseignements et les recommandations que je vous ai donnés vous aideront dans les prochaines étapes de votre travail.
C'est avec plaisir que je répondrai à vos questions.
:
Merci de m’avoir invitée ici aujourd’hui.
Je suis ici pour parler des interventions fondées sur des données probantes visant à prévenir le SSPT et les BSO chez les premiers intervenants. Mes antécédents comprennent plus de 10 ans de travail effectué auprès des premiers intervenants, des anciens combattants et des policiers, tant à titre de chercheuse scientifique dans deux hôpitaux américains pour anciens combattants que, plus récemment, comme universitaire attachée à l’Université de Toronto. Mes recherches visent les coûts en santé et en rendement résultant du stress grave et chronique vécu par les premiers intervenants exposés à des événements traumatisants. Je présenterai des affirmations clés, puis je formulerai des recommandations.
Premièrement, les blessures de stress opérationnel et le syndrome de stress post-traumatique sont associés à de lourds coûts en soins de santé, à des maladies physiques et à une mortalité précoce. Mes collègues et moi avons démontré que les policiers courent deux ou trois fois plus de risques d’être atteints de maladies chroniques, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète et même le cancer, comparativement à la population générale. Selon les données du département des Anciens combattants des États-Unis, le coût des soins de santé pour le traitement d’un premier intervenant souffrant du SSPT s’élève à presque cinq fois le coût du traitement d’un premier intervenant n’en souffrant pas, en raison des frais associés au traitement des maladies physiques et mentales concomitantes.
Deuxièmement, la recherche montre clairement que les premiers intervenants courent davantage de risques de voir se déclarer des BSO ou le SSPT après avoir vécu des événements graves très stressants les ayant exposés à une situation traumatisante, comme un enfant victime d’abus graves, ou après avoir été obligés d’avoir recours à la force mortelle. Pourtant, durant leur formation sur le recours à la force, les premiers intervenants n'apprennent pas adéquatement à gérer les réactions de stress psychologiques ou biologiques graves susceptibles de causer des BSO ou le SSPT.
Mes collègues et moi l'avons constaté nous-mêmes. Nous avons rassemblé des milliers d’heures de données d’ordre psychologique et biologique auprès de premiers intervenants, tant durant leur formation que lors de situations urgentes survenues pendant qu’ils étaient en service actif. Nous avons recueilli des données sur des facteurs comme la fréquence cardiaque, la respiration, les mouvements du corps, la distorsion sensorielle, les réactions de peur et les hormones de stress. Nos recherches montrent que les réactions extrêmes de stress ont en réalité un effet négatif sur le rendement des premiers intervenants, ce qui augmente le risque qu’ils ne se servent pas de leurs techniques de désescalade durant une situation qui exige le recours à la force mortelle et qu’ils commettent une erreur. Les situations de ce genre sont directement reliées à l’apparition des BSO ou du SSPT.
Troisièmement, des interventions en résilience scientifiquement validées visant le stress associé aux situations graves et au recours à la force sont essentielles à la prévention des BSO et du SSPT. Seules des méthodes fondées en science permettent d’évaluer l’efficacité d’une intervention quant à l’atteinte du résultat voulu et de justifier l’investissement financier dans cette intervention.
Le Canada se trouve à une étape cruciale du processus de choisir la meilleure façon de lutter contre les BSO et le SSPT chez les premiers intervenants. Le Comité envisagera les interventions disponibles et proposées nécessitant un budget de formation limité. Il est donc essentiel que nous précisions ce que nous considérons comme une intervention en résilience fondée sur des données probantes. Des programmes à grande échelle de renforcement de la résilience, initialement créés pour les militaires, sont maintenant appliqués à des organisations policières. Le programme En route vers la préparation mentale en est un exemple. Or, aucune étude fondée sur des données probantes et aucun essai clinique randomisé ne montrent que ces programmes préviennent réellement les BSO et le SSPT chez les premiers intervenants.
Un des problèmes, comme les recherches l’ont montré, c’est que les apprentissages faits en classe ne sont pas facilement transférables lorsqu’il est question d’habiletés motrices comme celles enseignées dans les cours sur le recours à la force. Il peut donc être trompeur de supposer que les programmes de résilience donnés en classe influenceraient le recours à la force et les comportements dans des situations réelles. De fait, les données biologiques objectives montrent que si nous voulons réduire la physiologie du stress mésadaptée associée aux BSO et au SSPT, nous devons intervenir directement dans la formation sur les situations graves très stressantes, y compris la formation sur le recours à la force.
Il n’y a au monde que très peu de chercheurs qui travaillent à l’élaboration de programmes de prévention des BSO et du SSPT fondés sur des données probantes — c’est-à-dire des données obtenues au moyen d’essais cliniques randomisés. Je sais qu’il en existe un groupe aux États-Unis. À ma connaissance, notre équipe est une des seules au Canada qui se livre à ce type de travaux. Je vais vous présenter les bases de notre programme.
Premièrement, notre méthode scientifique, fondée sur toutes les données objectives que nous avons recueillies, montre que la formation sur le recours à la force et les techniques de désescalade devrait être donnée par des instructeurs en recours à la force, et non en classe par des professionnels de la santé ou autres. Les policiers qui travaillent dans ce milieu très dur sont plus réceptifs lorsque la formation est donnée par des instructeurs en recours à la force. Les sujets abordés devraient aider les policiers à envisager la gamme complète de leurs choix, y compris la désescalade verbale et l’application de techniques moins mortelles de recours à la force, de façon à éviter que les rencontres s’intensifient inutilement, ce qui peut mener à des BSO et au SSPT.
Deuxièmement, nous mettons en œuvre des stratégies qui maximisent la façon d’acquérir des apprentissages nouveaux et de les conserver. Ce point est essentiel parce que dans des situations très stressantes, les réactions naissent des réflexes les plus automatiques et les plus instinctifs. L’application de techniques de contrôle physiologique dans des situations graves peut supplanter les réactions naturelles qui empêchent un policier d’envisager la gamme complète de méthodes appropriées de recours à la force et de désescalade.
Troisièmement, la formation devrait être personnalisée et adaptée à chaque policier. Dans le cadre de notre programme, les appareils que les policiers utilisent sont dotés de nouvelles technologies. Ces appareils peuvent analyser les mesures du système nerveux sensoriel du policier pendant le déroulement de scénarios hautement réalistes de formation policière — des situations comme des prises d'otages, des fusillades dans les écoles et des interventions auprès de personnes en détresse. C'est très important qu'ils soient exposés, durant leur formation, à des scénarios très réalistes de ce genre.
Quand les policiers reçoivent de l'information sur leur propre corps et leurs réactions de stress, les instructeurs experts chargés de la formation sur le recours à la force peuvent créer une instruction individualisée afin de permettre aux policiers d'apprendre les facteurs qui déclenchent des réactions chez eux et les méthodes pour supplanter ces réactions dans des situations de recours à la force. À l’heure actuelle, la formation des premiers intervenants est générale; la même formule est appliquée à tous. De toute évidence, la formation que suivent certains policiers ne répond pas à leurs besoins. Nous l'avons constaté même au sein des équipes tactiques fédérales les plus spécialisées. La formation personnalisée leur a aussi été utile. Les agents couraient moins le risque de tirer sur la mauvaise personne, comme une personne tenant un cellulaire plutôt qu'une arme. Ce sont ces situations qui causent les BSO et le SSPT.
Nous avons des recommandations basées sur ces données. Premièrement, il faut davantage de soutien pour la recherche et l’intervention scientifiques fondées sur des données probantes. Il faut allouer plus de financement juste-à-temps aux chercheurs. Les cycles de financement actuels, qui prennent huit ou neuf mois, sont trop longs. Nous ratons des occasions de travailler avec des organisations qui tentent de répondre à la demande de la population d’augmenter la formation policière et qui finissent par adopter des programmes de formation non fondés sur des preuves. Nous ne disposons pas des fonds nécessaires pour leur offrir des programmes fondés sur des données probantes.
Deuxièmement, nous devons élaborer des normes minimales d’évaluation du rendement des programmes de formation policière au chapitre de la qualité et des résultats obtenus par les policiers et par le public qu’ils servent. Je le répète, il existe des programmes, mais ils ne reposent pas sur des données probantes. Il faut établir des normes de qualité des programmes. Les données probantes, les études scientifiques, les essais cliniques randomisés et les données d’études pilotes sont essentiels. De plus, il faut financer le suivi longitudinal à grande échelle pour comprendre à quelle fréquence et avec quelle intensité nous devons former les policiers pour prévenir les BSO et le SSPT. La société fait peser des menaces toujours changeantes sur la sécurité et le bien-être des policiers. Nous devons tirer profit des appareils technologiques les plus récents et de la neurobiologie de l'apprentissage pour satisfaire les besoins changeants de la société.
Troisièmement, il faut établir un centre d’excellence pour la formation policière fondée sur des données probantes. Fait surprenant, il n’existe pas, à l’heure actuelle, de centre d’excellence mondial en formation policière. En établissant un centre national, le Canada pourra jouer un rôle de premier plan, sur la scène internationale, dans l’élaboration d’une formation policière de la plus haute qualité en recours à la force et en gestion du stress dans le cadre de situations graves. Le Canada pourra créer et exporter de nouveaux programmes de formation policière, ce qui profitera encore davantage au domaine policier à l’échelle internationale et renforcera la réputation et la bonne volonté du Canada.
Enfin, nous devons exiger la certification des instructeurs de la police et des installations de formation en fonction de normes et pratiques exemplaires de haute qualité.
Nous recommandons que les instructeurs de la police soient tenus de renouveler leur certification régulièrement et de maintenir un degré élevé de connaissances actuelles au moyen de programmes de formation continue, ce qui est très comparable à ce que l’on exige des professionnels de la santé et des médecins. En outre, il est avantageux sur le plan financier d’intervenir contre les BSO et le SSPT. Même s’il n’était pas aussi exhaustif que le nôtre, un programme américain a permis de réduire de 14 % les coûts annuels de soins de santé chez les premiers intervenants. Vous pouvez donc imaginer que si la somme est de plus de 1 000 $ par année par employé, dans une organisation de 500 policiers, cela représenterait une économie de plus d’un demi-million de dollars qu’on pourrait investir dans la formation.
Merci.